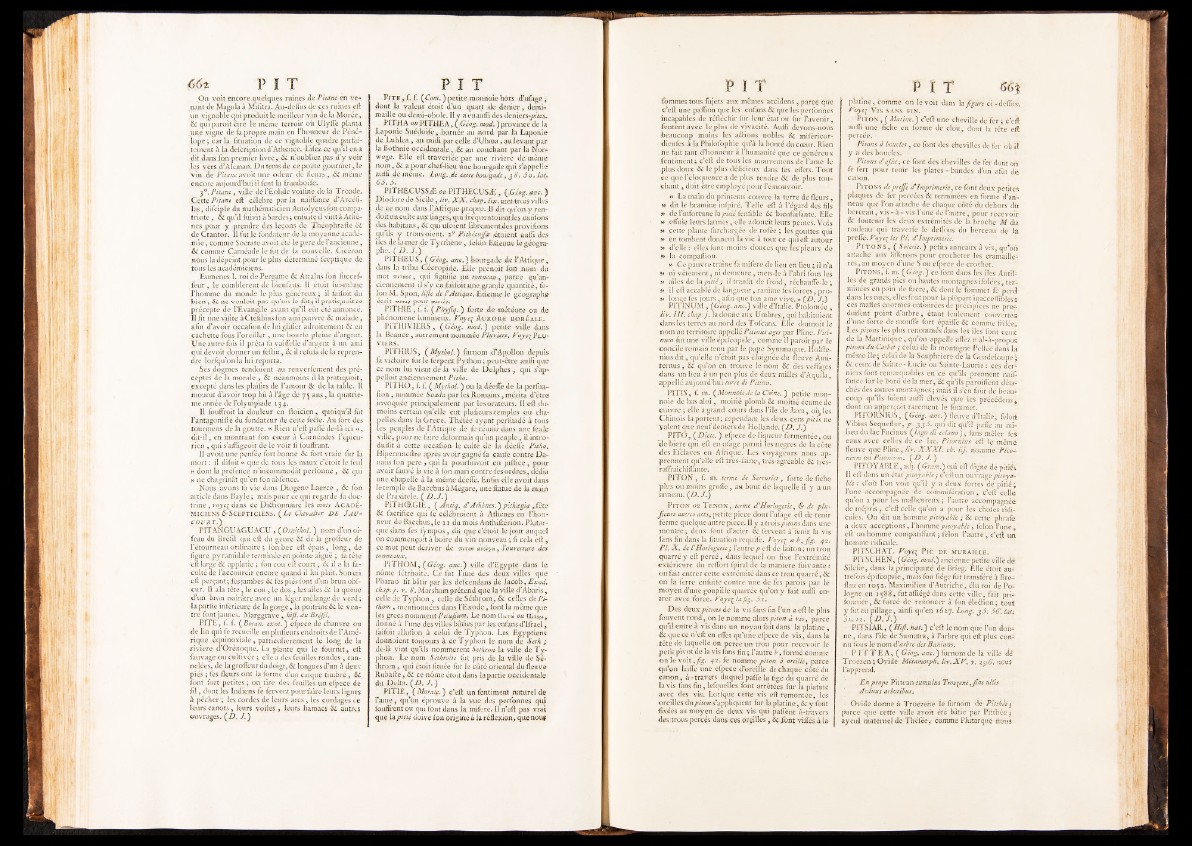
On voit encore .quelques ruines de Puant en venant
de Magula à Mifltra. Au-delliis4 e ces ruines eft
un vignoble qui produit le meilleur vin de la Morée,
6c qui paroît être le même terroir où Ulyffe planta
une vigne de fa propre main en l’honneur de Pénélope
; car la fituation de ce vignoble quadre parfaitement
à la defcription d’Athenée. Lifez ce qu’il en a
dit dans ,fqn premier livre, 6c n’oubliez pas d’y voir
les vers .d’Alcman. Du tcnis de .cepoëte gourmet, le
Vin de Pitane avoït une odeur de fleurs , de même
encore aujourd’hui il lent fa framboife.
30. Pitane, ville de l’Eoliçle voifinç de la Troade.
Cette Pitane eft célébré par la naiflan.ee d’Arcéfl-
las, difciple du mathématicien Autolyeusfon,compatriote
, de qu’il fuivit à Sardes ; enluite il vint à Athènes
pour y prendre des leçons de 'J'heophrafte 6c
de Crantor. Il fut le fondateur de la moyenne académie
, comme Socrate avoit été le p.ere de l’ancienne,
6c comme Carnéade le fut de la nouvelle. Cicéron
nous la dépeint pour le plus déterminé feeptique de
tous les académiciens.
Eumenes I. roi de Pergame 6c Attalus fon •fuccef-
fe.ur, le .comblèrent de pienfaijts. Il .étoit lui-même
l’homme du monde le plus généreux ; il faifoit du
bien, de ne vouloit pas qu’on le fut ; il pratiquoitee
précepte de l’Evangile avant qu’il eut été annoncé.
Il lit une viftte àCteiibiusion ami pauvre 6c malade,
afin d’avoir occafion de lui glifler adroitement Se en
cachette fous l’oreiller , une bqurfe pleine d’argent.
Une autre fois il prêta la vaifl'elle d’argent à un ami
qui devoit donner un feftin, & il refula de la reprendre
lorfqu’on la lui reporta.
Ses dogmes tendoient au renverfement des préceptes”
de la morale , 6c néanmoins il la pratiquoit,
excepté dans les plaifirs de l’amour & de la table. Il
mourut d’avoir trop bû à l’âge de 75 ans, la quatrième
année de l’olympiade 134.
Il fouffroit la douleur en ftoïcien, quoiqu’il fut
l’antagonifle du fondateur de cette fecte. Au fort des
tourmens de la goutte. « Rien n’eft pafle de-là ici »,
dit-il. en montrant fon coeur à Carnéades l’épicurien
, qui s’afïïigeoit de le voir li fouffrant.
Il avoit une penfée fort bonne 6c fort vraie fur la
mort : il difoit « que de tous l?s maux c’étoit le feul
» dont la préfence n’incommodât perfonne , 6c qui
» ne chagrinât qu’en fon abfence.
Nous avons fa vie dans Diogene Laerce , 6c fon
article dans Bayle ; mais pour ce qui regarde fa doctrine
, voye^ dans ce Dictionnaire les mots Académiciens
6-ScePTICIENS. (Le Chevalier DE Ja u -
COURT.)
PITANGUAGUACU , ( Ornithol. ) nom d’unoi-
feau du Bréfll qui eft du genre 6c de la grofleur de
l’étourneau ordinaire ; fon bec eft épais, long, de
figure pyramidale terminée en pointe aiguë ; fa tête
clt large 6c applatie ; fon cou .eft court, & il a la faculté
de l’accourcir encore quand il lui plaît. Son cri
eft perçant; fes jambes 6c fes pies font d’un brun obf-
,cur. 11 a la tête, le cou , le dqs, les aîles $ç la queue
d’un brun noirâtre avec un léger mélange de yerd;
la partie inférieure de la gorge, la poitrine & le ventre
font jaunes. Marggrave , hift. du Bréjil.
PITE, f. f. ( Botan. exot. ) efpece de chanvre ou
de lin qui fe recueille en plufieurs endroits de l’Amérique
équinoxiale, particulièrement le long de la
riviere d’Orénoque. La plante qui le fournit, eft:
fauvage ou cultivée ; elle a des feuilles rondes , cannelées,
de la grofleur du doigt, & longues d’un à deux
pies ; fes fleurs ont la forme d’un calque timbré, 6c
font fort petites; on tire des, feuilles un efpece de
f il, dont les Indiens fe fervent pour faire leurs lignes
à pêcher ; les cordes de leurs arcs, les cordages ce
leurs canots, leurs voiles , leurs hamacs 6c autres
ouvrages. (D . J .)
Pit e , f. f. (Ç om . ) .petite raonnoie hórs d’ufage ;
dopt II yale^r étoit d’un quar,t .de .denier, demi-
maille ou demi-obole. Il y a euaufli des deniers^?*««.
PITHA ou PITJtiE A ,,( Géog. moi. ) province de la
Laponie Suédoife, ;bornée au nord par la Laponie
de Luhlea, au midi par celle d’iUhma ? au levant par
la Bothnie occidentale, ,6c .au couahant parla Nor.-
wege. Elle eft traverfée par une riviere de même
nom, & a pour chef-lieu Une bourgade .qui s’appelle
.aulïi de même. Long, de cette bourgade, 7.8, So. lot.
CS. S. " - • -j *
PITHECU^Æ.^'PITHEÇUS^:, (GÂ<?g:#nc.)
Diodore de -S icileliv, X X . ckap. iiy. mût/treés villes
de çe nom dans l’Affique propre. Jil dit.qu’on y ren-
doit unçulte a\iyfinges,qui fréquentoienitjes maifons
des habitans, 6c qui ufoi^nt librement, des proyiftons
qu’ils y trouypient. z° Phkécvftk Soient auflî 4e?
îles de la mer 4 e Tyrrhèue, félon Etienne le géographe.
(D . J .) p b
P1THEUS j ( G/og. ajiç. ) bourgade 4 e l’Attique ,
dans la tribu Çécropide. 0 1e pr^noit -Ion nom du
mot nnnoi, qui fignjfie tqimeyy, .parce qu’ao-
.ciennement il s’y ,en faifoit,une .grande',quantité, félon
M. Spon, lifte <U l'Attiqiie. Etienne le géographj?
écrit Ttn-ciç pour
PITHIE, f. f. (Phyftq. ) forte 4e météore ou de
phénomène lumineux. Fçye^ Auji.op.iE PORÉAEEPITHlVIjÈRS
, (Gé.og, mqd. ) .petite ville dans
la Beauce, autrement nommée Ph/yiers. Foyer Pluviers.
PITKIUS, ( Mytjiol. ) furnom 4 ’Ap.ollpn depuis
fa vi&oire fur le.lèrpen.t Python ; peut-être auflî que
ce nom lui vient de la vjlle de Delphes , qui s’ap-
peUoit anciennement Pitko.
PITHÔ, f. f. (Mytkol.'') ou la.dé.effe de la perfua-
fion, nommée Suada par les Jlomains, mérita d’être
invoquée principalement par Lesorateurs. f l eft .du-
moins certain qu’elle eut ,phifte.urs .temples ou chapelles
dans la Grece. Théfée ayant perftiadé à tous
les peuples de l’Attique de fe réunir dans une feule
ville, pour ne faire .déformais,qu’un peuple, il intro-
duifit à cette occafion le culte de |a déefîe Pitho,
Hipermneftre après avoir gagné fa caufe ç.onti-e Da-
naiis fon pere , qui la pourfuiyo.it en juftjce, ppur
avoir fauve la vie à fon mari contre fes ordres , dédia
une chapelle à la même dé,effè. Enfin elle ayoit dans
le temple de Bacchus à Mégare, une ftatue de la main
de Praxitèle.. ( D . J. )
P1THCEGIE, (Antiq. d'Athènes.') pilJiægiq ,£êtp
6c facrifice qui fe çélébroient à Athènes en l’honneur
de Bacchus,le 11 du mois Anthiftérion. Plutarque
dans fes fympos , dit que ç’étoit le jour auquel
on commençoit à boir,e du vin nouveau ; ft pela e ft ,
ce mot peut dériver de trnwv avciyn, l'ouverture des
tonneaux.
PlTHOM, ( Géog. apc.') ville d’Egypte dans le.
nome fétrhoite. Ce fut l’une des deux vifles que
Pharao fit bâtir par les defeendans de Jappb, Exod.
chap.j. v. 8. Marsham prétend que yiile d’Abaris,
celle de Typhon , celle de Séthrom, 6c celles de Pi-
thom, mentionnées dçins l’Exode , font la même que
les grecs nomment Pçlufium. Le nom nujÙ ou uho/x.
donné à l’une des villes bâties par les enfans d’Ifrael,
faifoit allufion à celui de Typhon. Les Egyptiens
donnoient toujours à ce Typhon le nqm de S et h ;
de-là vint qu’ils nommèrent Sethr>on la ville de T y phon.
Le nom Séthroite fi.it pris d.e la ville de Sé-
thtqm , qui étoit fituée fur le côté oriental du fleuve
Rubafte, 6c ce nqme étoit d^ns la partie occidental?
du Delta. (D . J .)
PITIÉ, ( Morale. ) c’eft un fentiment naturel de
l’ame, qu’on éproviye à la vue des perfonnes qui
louffrent ou qui font dans la mifere. Il n’eft pas vrai
que la pitié doive fpn origine à la réflejdpn, quçnoui
fommes tous fujets aux mêmes 'accidens, parcé que
c ’eft. une .paflion que les enfans 6c que les perfonnes
incapables de réfléchir fur leur état ou fur l’avenir,
fentent avec le plus de vivacité. Auflî devons-nous
beaucoup moins les a&ions nobles & miféricor-
• dieufes à la Philofophie qu’à la bonté du coeur. Rien
ne fait tant d’honneur à l’humanité que ce généreux
fentiment ; c’eft de tous les rnouvemens de l’ame le
plus doux & le plus délicieux dans fes effets. Tout
ce que l’éloquence a de plus tendre 6c de plus touchant
, doit être employé pour l’émouvoin
« La main du printems couvre la terre de fleuri,
» dit le bramine infpiré. Telle eft à l’égard des fils
» de l’infortune la pitié fenfible 6c bienfaifante. Elle
» efluie leurs larmes , elle: adoucit leurs peines. Vois
» cette plante furchargée de rofée ; les gouttes qùi
• » en tombent donnent la vie à tout ce qui eft autour
» d’elle ': elles font moins douces que les pleurs de
»•la compaffion-.
» Ce pauvre trâine fa mifere de lieu en lieu ; il n’a
» ni vêtement, ni demeure, mets-le à l’abri fôus lés
» aîles de la pitié; il tra.nfit de froid, réchauffe-le;
» il eft accablé de langueur, ranime fes forces, pro-
» longe fes jours, afin que ton ame vive. » (D. J .)
PITINUM, (Géog. anc.) ville d’Italie. Ptolomée ,
liv. I 1L chap. j . la donne aux Umbres, qui habitoiertt
dans les terres au nord des Tofcans. Elle donnoit le
nom au territoire appelle Pitinus ager par Pline. Piti-
ntim fut une ville épifcopale, comme il paroît par le
concile romain tenu par le pape Symmaque. Holfte-
nius d it, qu’elle n’étoit pas éloignée du fleuve Ami-
ternus, 6c qu’on en trouve le nom 6c dés veftigés
dans un lieu à un peu plus de deux milles d’Aquila,
appelle aujourd’hui iorre di Picino.
PITIS, f. 111. (Monnùiè de la Chine. ) petite môn-
hoie de bas alo i, moitié plomb 6c moitié écume de
cuivre ; elle a grand côurs dans l’île de Java, oïl les
Chinois la portent; cependant les deux cens pitis ne
.Valent que neuf deniers de Hollande. (D . J.)
PITO, (Diete. ) efpece de liqueur fermenteé, ou
de biere qui eft en ufage parmi les negres de la côte
des Efclaves en Afrique. Les voyageurs nous apprennent
qu’elle eft très-faine, très-agréable 6c très-1
raffraichiflante.
PITON , f. rh. ternie de Serrurier, forte défiché
plus ou moins groffe, au bout dë laquelle il y a un
anneau. (D. J.)
PlTON ou T en o n , terme d'Horlogerie, & de plusieurs
autres arts, petite piece dont l’uïage eft de tenir
ferme quelque autre piece. Il y atrois pitons dans une
jmontre ; deux font d’acier 6c fervent à'tënir la vis
fans fin dans la fituation requife. Foye^ a b, ftg. 42.
PI. X . de VHorlogerie; l’autrep eft de laiton; un trou
quarré y eft percé, dans lequel on fixe l’extrémité
extérieure du reffort fpiral de la maniéré fuivante :
on fait entrer cette extrémité dans ce trou quarré, 6c
on la ferre enfuite contre une de fes parois par le
moyen d’une goupille quarrée qu’on y fait aufli entrer
avec force* Foyeç la ftg. Sx.
Des deux pitons de la vis fans fin l’un à eft le plus
fouvent rond, on le nomme alors piton à vis, parce
qu’il entre à vis dans un noyau fait dans la platine ,
6c que ce n’eft en effet qu’une efpece de v is , dans la
, tête de laquelle on perce un trou pour recevoir le
petit pivot de la vis fans fin ; l’autre b , formé comme
on le voit yfig. 42- fe nomme piton à oreille, parce
qu’on laiffe une efpece d’oreille de chaque côté du
canon, à-travers duquel pafle la tige du quarré de
la vis fans fin, lefquelles font arrêtées fur la platine
avec des vis. Lorfque cette vis eft remontée, les
oreilles du piton s’appliquent fur la platine, 6c.y font
fixées au moyen de deux vis qui pafîent à-travers
des trous percés dans ces orçilles, de/ont viffés à la
platine, comme on le voit dans la figure di-deiTusi
Foye1 V is SANS f in .
Pit o n , ( Marine. ) c’e ft une cheville de ’fer ; C’eft:
auflî une fiche en forme de clou, dont la tête eft
percée.-
Pitons à boucles, ce font des chevilles de fer où il.
y a des boucles.
Pitons d'aftût * ce fónt des fchevilles de fer dont on
fe fert pour tenir les plates - bandes d’un afût dé
carton.
P it o n s deprejfe d?Imprimerie, ce font deiix petites
plaques de fer percées 6c terminées en forme d’anneau
que l’on attache de chaque côté du dehors du
berceau, vis - à - vis 1 une de l’autre, pour recevoir
6c foutenir les deux extrémités de la broche M du
rouleau qui traverfe le deffous du berceau de la
preffe. Foyeç les PI: d'Imprimerie.
P i t o n s , ( Soierie. ) petits anneaux à v is , qu’oiî
attache aiix lifferons pour crocheter les cramaille-
r e s , au moyen d’une S ou efpece de Crochet.
P it o n s , f. m. ( Géog. ) ce font dans les îles Antilles
de grands pics ou hautes montagnes ifolcès, terminées
en pain de fuer.e, 6c dont le fommet fe perd
dans les nues, elles font pour la plupart inacceflîblesi:
, ces maffes énorriies entourées de précipices ne pro-
duifeiit point d’arbre, étant feulement .'couvertes;
d’une forte de moufle fort épaiffe 6c comme frifée^
Les pitons les plus rënommés dRns les îles'font ceux
de la Martinique , qu’on appelle afîez mal-à-propoâ
pitons du Càrbet ; Celui dë la mbntagne Pelléë dans la
même île; Celui de la So.uphriefé dë la Guadeloupe ;
6c ceux de Sainte - Lucie ou Sainte-Laurie : ces deri
niers font remarquables én eé qu’ils prennerit naif-
fance fur le bord de la mer, 6c qu’ils paroiffent détachés
des autres montagnes ; biais il s’en faut de beaucoup
qu’ils foient aufli élevés quë les précédensi
dont On âpperçoit rarement le fommet.
PITORNIUS, (Géog. anc.) fleuve d’Italie, feloit
yibius Sequefter, p. j j S. qui dit qu’il paffe au milieu
du lac Fucinus ( lago di celanoj-, fans mêler fes
eaux avec celles de ce lac. Pitomius eft le mêmé
fleuve que Pline, liv. X X X I . ch-, iij. nomme Pico-
nium o u Pitonium. (D . J .)
PITOYABLE, adj. (Gramî) qui eft digne de pitié;'
Il eft dans un état pitoyable ; c’éftun ouvrage pitoyable
: d’où l’on voit- qu’il y a deux fortes de pitié ;
l’une accompagnée de commifération c’eft cellé
qu’on a pour les malheureux ; l’autre accompagnée
de mépris , c’èft celle qu’on a pour les choies ridicules.
On dit un homme pitoyable ; 6c cette phrafé
a deux acceptions, l’homme pitoyable, félon l’une ;
eft un homme compatiffant ; félon l’autre , c’eft uxi
homme ridicule;
PITSCHAT. Fôyè[ P ic dë m u r a il l e ;
PITSCHEN, (Géog. mod.) ancienne petite ville dè
Siléfie, dans la principauté de Brieg. Elle étoit autrefois
épifcopale, mais fon fiége fut transféré à Bre-
flau en 1051. Maximilien d’Autriche, élu roi dé Pologne
en 1588 ; fut afliégé dans cëtte ville, fait pri-
fonnier , & forcé dé renoncer à fon éleftion ; tout
y fut au pillage, ainfi qu’en i6x7. Long-, 3 S; SG. lati
. '
• PITSIAR, ( Hifi. hai. ) c ’eft le nom que Bón donne
, dans l’île de Sumatra, à l’arbre qui eft plus connu
fous lé nom dé arbre des Banians-,
■ P IT T E A , ( Géog. ahc. ) furnom de là ville dê
Troczen ; Ovide Métamorph■. liv-.XF. v. xgG. nous
l’apprend.
En prope Pittean'tumulus Troezenè,ftne ullis
A rd u u s arboribuSi , '
■ Ovide doririe à Tfoèzénë le furnom dë Pittheé3
parce que cette ville avoit été bâtie par Pitthéc 3
ayeul maternel de Théfée 3 comme Plutarque flous