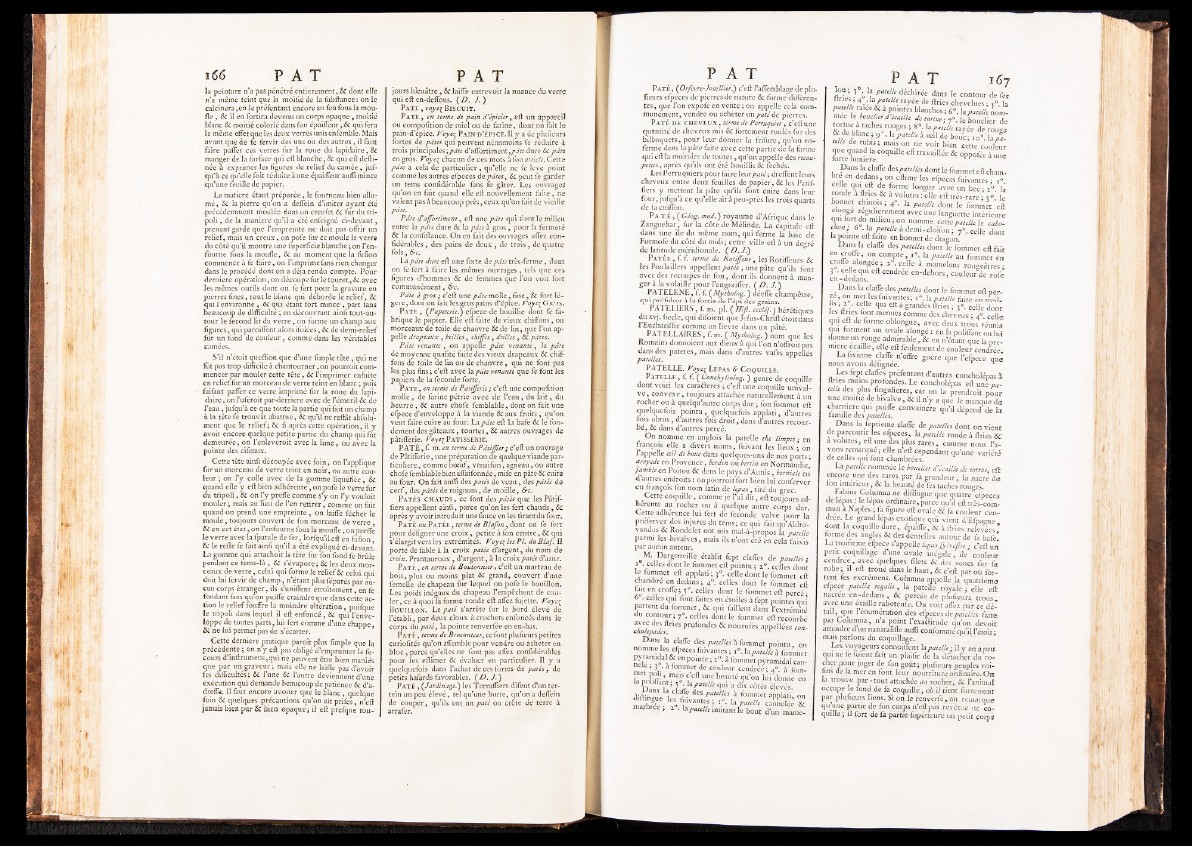
la peinture n’a pas pénétré entièrement, & dont elle
n’a même teint que la moitié de la fubftance : on le
calcinera,en le préfentant encore au feu fous la mouf
le , & il en fortira devenu un corps opaque, moitié
blanc Sc moitié colorié dans fon epaiffeur, Sc qui fera
le même effet que les deux verres unis enfemble. Mais
avant que de le fervif des uns ou des autres , il faut
faire paffer ces verres fur la roue du lapidaire, Sc
manger de la furfece qui eft blanche, Sc qui eft defti-
née a exprimer les figures de relief du camée, jufqu’à
ce qu’elle foit réduite à une épaiffeur auffi mince
qu’une feuille de papier.
La matière étant préparée, le fourneau bien allumé
, Sc la pierre qu’on a deffein d’imiter ayant été
précédemment moulée dans un creufet Sc fur du tripoli
, de la maniéré qu’il a été enfeigné ci-devant,
prenant garde que l’empreinte ne doit pas offrir un
relief, mais un creux, on pofe fur ce moule le verra
du côté qu’il montre une fuperficie blanche ; on l’enfourne
fous la moufle, & au moment que la fufion
commence à fe faire, on l’imprime fans rien changer
dans le procédé dont on a déjà rendu compte. Pour
derniere opération, on découpe furie touret, Sc avec
les mêmes outils dont on fe iert pour la gravure en
pierres fines, tout le blanc qui débordé le relief, Sc
qui l’environhe , Sc qur étant fort mince , part fans
beaucoup de difficulté ; en découvrant ainfi tout-autour
le fécond lit du verre, on forme un champ aux
figures, qui paroiffent alors ifolées, & de demi-relief
fur un fond de couleur, comme dans les véritables
camées.
S’il n’étoit queffion que d’une Ample tête, qui ne
fut pas trop difficile à chantourner, on pourroit commencer
par mouler tette tête, Sc l’imprimer enfuite
en relief fur un morceau de verre teint en blanc ; puis
faifant paffer ce verte imprimé fur la roue du lapidaire
, on l’uferoit par-derriere avec de l’émeril & de
l’eau, jufqu’à ce que toute la partie qui.fait un champ
à la tête fe trouvât abattue, Sc qu’il ne reftât abfolu-
ment que le relief ; Sc fi après cette opération, il y
avoit encore quelque petite partie du champ qui fut
demeurée, on l’enleveroit avec la lime, ou avec la
pointe des cifeaux.
Cette tête ainfi découpée avec foin, on l’applique
fur un morceau de verre teint en noir , ou autre couleur
; on l’y colle avec de la gomme liquéfiée, Sc
quand elle y eft bien adhérente, on pofe le verre fur
du tripoli, & on l’y preffe comme s’y on l’y vouloit
mouler ; mais au lieu de l’en retirer, comme on fait
quand on prend une empreinte, on laiffe fécher le
moule, toujours couvert de fon morceau de verre
Sc en cet état, on l’enfourne fous la moufle, on preffe
le verre avec la fpatule de fer, lorfqu’il eft en fufion
Sc le refte fe fait ainfi qu’il a été expliqué ci-devant.
La gomme qui attachoit la tête fur fon fond fe brûle
pendant ce tems-là , Sc s’évapore ; Sc les deux morceaux
de verre, celui qui forme le relief & celui qui
doit lui fervir de champ, n’étant plus féparés par aucun
corps étranger, ils s’uniffent étroitement, en fe
fondant fans qu’on puiffe craindre que dans cette action
le relief iouffre la moindre altération, puifque
le tripoli dans lequel il eft enfoncé, & qui l’enveloppe
de toutes parts, lui fert comme d’une chappe,
Sc ne lui permet pas de s’écarter.
Cette derniere pratique paroît plus fimple que la
précédente ; on n’y eft pas obligé d’emprunter le fe-
cours d inftnimens, qui ne peuvent être bien maniés
que par un graveur ; mais elle ne laiffe pas d’avoir
les difficultés; Sc l’tme & l’autre deviennent d’une
exécution qui demande beaucoup de patience Sc d’a-
dreffe. Il faut encore avouer que le blanc , quelque
foin Sc quelques précautions qu’on ait prifes n’eft
jamais bien pur Sc bien opaque ; il eft prefque toujours
bleuâtre, Sc laiffe entrevoir la nuance du verre
qui eft en-deffous. ( D . J .)
Pâte , voye^ Bis cu it .
Pâte , en terme de pain d'épicier, eft un appareil
; ou compofition de miel ou de farine, dont on fait le
pain-d’epice. Voye^ Pain-d’Ép ic e . Il y a de plufieurs
fortes de pâtes qui peuvent néanmoins fe réduire à
i trois principales ; pâte d’affortiment ypâte dure Sc pâte
\ en gros. Voye^ chacun de ces mots à fon article. Cette
pâte a cela de particulier , qu’elle ne fe leve point
comme les autres efpeces de pâtes, Sc peut fe garder
un tems confidérabje fans fe gâter. Les ouvrages
qu’on en fait quand elle eft nouvellement faite , ne
valent pas à beaucoup près, ceux qu’on fait de vieille
pâte.
Pâte d'ajforliment, eft une pâte qui tient le milieu
entre la pâte dure Sc la pâte à gros, pour la fermeté
& la confiftance. On en fait des ouvrages affez con-
fidérables, des pains de deux, de trois, de quatre
fols, &c.
La pâte dure eft une forte de pâte très-ferme, dont
on fe fert à faire les mêmes ouvrages , tels que ces
figures d’hommes Sc de femmes que l’on voit fort
communément, &c.
Pâte à gros ; c’eft une pâte molle, fine, & fort légère,
dont on fait les gros pains-d’épice. Voye^ Gros.
Pâte , (Papeterie.J efpece de bouillie dont fe fabrique
le papier. Elle eft faite de vieux chiffons, ou
morceaux de toile de chanvre & de lin, que l’on appelle
drapeaux , le il les, chiffes, drilles , Sc pâtes.
Pâte venante , on appelle pâte venante, la pâte
de moyenne qualité faite des vieux drapeaux Sc chiffons
de toile de lin ou de chanvre, qui ne font pas
les plus fins ; c’eft avec la pâte venante que fe font les
papiers de la fécondé forte.
Pâ t e , en terme de Pâtifferie; c’eft une compofition
molle, de farine pétrie avec de l’eau, du la it , du
beurre, Sc autre chofe femblable, dont on fait une
efpece d’enveloppe à la viande & aux fruits , qu’on
veut foire cuire au four. La pâte eft la bafe Sc le fondement
des gâteaux, tourtes, Sc autres ouvrages de
pâtifferie. Voye{ PATISSERIE.
PÂ TÉ, f. m. en terme de PâtiJJier; c’eft un ouvrage
de Pâtifferie, une préparation de quelque viande particulière
, comme boeuf, venaifon, agneau, ou autre
chofe femblable bienaffaifonnée, mife en pâte & cuite
au four. On foit auffi des pâtés de veau, des pâtés de
ce r f, des pâtés de roignons, de moelle, &c.
Pâtés chauds , ce font des pâtés que les Pâtif-
fiers appellent ainfi, parce qu’on les fert chauds , 8c
après y avoir introduit une fauce en les tirant du four.
Pâté ou Pâtée , terme de Blafon, dont on fe fert
pour défigner une croix, petite à fon centre, Sc qui
s’élargit vers les extrémités. Voyelles PI. duBlaf. Il
porte de fable à la croix pâtée d’argent, du nom de
croix. Prantauroux, d’argent, à la croix pâtée d’azur.
Pa tÉ , en terme de Boutonnier, c^eft un marteau de
bois, plus ou moins plat Sc grand, couvert d’une
femelle de chapeau fur lequel on pofe le bouillon.
Les poids inégaux du chapeau l’ empêchent de couler,
ce à quoi fa forme ronde eft affez fujette. Voye{
Bouillon. Le p â té s’arrête fur le bord élevé de
l’établi, par deux doux à crochets enfoncés dans le
corps du p â té t la pointe renverfée en en-bas.
Pâ té , terme de Brocanteur y ce font plufieurs petites
curiofités qu’on affemble pour vendre ou acheter en
b lo c , parce qu’elles ne font pas affez confidérables
pour les eftimer Sc évaluer en particulier. Il y a
quelquefois dans l’achat de ces fortes de pâtés, de
petitshafards favorables. (D . J.)
Pâ té , (" Jardinage.) les Terraffiers difent d’un ter-
tein un peu élevé, tel qu’une butte, qu’on a deffein
de couper, qu’ils ont un p â té ou çrête de terre à
arrafer.
PatÉ, (Or/evre-Joaillier.) c’eft l’affemblage de plu-
iieurs efpeces de pierres de nature & .forme différentes
, que l’on expofe en vente ; on appelle cela communément,
vendre ou acheter un pâté de pierres.
Pa t É de ch ev eu x , terme de Perruquier , c’eft une
quantité de cheveux mis Sc fortement roulés fur des
bilboquets, pour leur donner la frifure, qu’on enferme
dans la pâte faite avec cette partie de la farine
qui eft la moindre de toutes, qu’on appelle dés recoupâtes
, après qu’ils ont été bouillis Sc léchés.
Les Perruquiers pour foire leur pâté ; dreffent leurs
cheveux entre deux feuilles de papier, & les Patif-
fiers y mettent la pâte qu’ils font cuire dans leur
four, jufqu’à ce qu’elle ait àpeu-près les trois quarts
de fa cuiffon.
P A T É, ( Géog. mod. ) royaume d’Afrique dans le
Zanguebar, fur la côte de Mélinde. La capitale eft
dans une île du même nom, qui ferme la baie de
Formofe du côté du midi ; cette ville eft à un degré
de latitude méridionale. ( D. J.)
Pâ t é e , f. f. terme de Rotiffeur, les Rotiffeurs Sc
les Poulaillers appellent pâtée, une pâte qu’ils font
avec des recoupes de fon , dont ils donnent à manger
à la volaille pour l’engraiffer. ( D . J .)
PATELENE, f. f. (Mytkolog. ) déeffe champêtre,
qui préfidoit à la fortie de l’épi des grains.
RATELIERS, f. m. pl. ( Hijl. eccléf.) hérétiques
duxvj. fiecle, qui difoient que Jefus-Chrift étoit dans
TEuchariftie comme un lievre dans un pâté.
PAT ELLAIRES, f. m. ( Mytkolog. ) nom que les
Romains donnoient aux dieux d qui l’on n’offroit pas
dans des pateres, mais dans d’autres vafes appellés
patelles.
PATELLE. Voyei L epas & C oquille.
Patelle , f. f. ( Conchyliolog. ) genre de coquille
dont voici les cara&eres ; c’eft une coquille unival-
v e , convexe, toujours attachée naturellement à un
rocher ou à quelqii’autre corps dur ; fon fommet eft
quelquefois pointu, quelquefois applati, d’autres
fois obtus, d’autres fois droit, dans d’autres recourbe,
Sc dans d’autres percé.
On nomme en anglois la patelle the limpet ; en
françois elle a divers noms, fuivant les lieux ; on
l’appelle oeil de bouc dans quelques-uns de nos ports ;
arapedê en Provence, berdin ou bénin en Normandie*
jamble en Poitou Sc dans le pays d’Aunis, bernide en
d’autres endroits : on pourroit fort bien lui conferver
en françois fon nom latin de lepas, tiré du grec.
Cette coquille, comme je l’ai dit, eft toujours adhérente
au rocher ou à quelque autre corps dur.
Cette adhérence lui fert de fécondé valve pour la*
préserver des injures du tems; ce qui fait qu’Aldro-
vandus & Rondelet ont mis mal-à-propos la patelle
parmi les bivalves, mais ils n’ont été en cela fuivis
par aucun auteur.
^M.Dargenville établit fept claffes de patelles;
i . celles dont le fommet eft pointu ; i ° . celles dont
le iommet eft applati; 3 celle dont le fommet eft
chambre en dedans ; 40. celles dou't le fommet eft
tait en croffe; 50. celles dont le fommet eft percé •
0 . celles qui font faites en étoiles à fept pointes qui
partent du fommet, & qui foillent dans l’extrémité
du contour ; 7 0. celles dont le fommet eft recourbé
™hoU i ! / « 65 Profondes &noueufes appellées con-
Dans la claffe des patelles à fommet pointu, on
B H H B I H l0- x*ratùu à fo<™«
W S S Ê M en P01" te ; 1 ■ à fommet pyramidal can-
nele ,.3 . à fommet de couleur cendree; 4°. à fom-
— H S S=ft “ “ beauté qu’on M M ■
— P f f f i f g ■ » <& côtés i p é s .
B W W B des B S I fommet afelati,.on
cultmgue les fiuvantes ; 1°. la vatilU cannelée &
mV bréf } imitant l l b O r f f f ü h ^ e - ,
■ ■ I R dans le contour de fes
7°. le bouclier de
tortue à taches rougçfe 8°. lap « J k ™ é e de rouge
W B S f f Ê 1 9 • H H à oei* de Kouç; ,o°. lapa-
tMt de rubis ; mais on me yoit bien cette couleur
que quand la coquille efl travaillée & oppofée à une
forte lùmiere. ' 1
Dans la claffe d es patelles dont le fommet eft chatn.1
bre en dedans, on eftnne les efpeces fuivantes ; i°
celle qui eft de forme longue ayec'nn bec ; »». la
ronde à ftrtes & â volutes : elle eft très-rare ■ 1« le
bonnet, chinois ; 4”. la pautU dont le fommet 'eft
alonge regulierement avec' une languette intérieure
qui fort du milieu; on nomme, cettepaielle le caho-
f . f - l a ^ & àdemi-cloifoi,; #£celle dont
la pointe eft faite en bonnet de dragon.
Dans la claffe des patelles dont le fommet eft fait
en croffe, on compte i°. la patelle au fommet en
croffe alongee; 2 .ce lle à mamelons rougeâtres*
3 - celle qui eft cendrée en-dehors, couleur de rofe
en - dedans.
: ^D âhs.la claffe des patelles dont le fommet eft perc
e , on met les fuivantes ; 1°, h patelle (aité en treil-
m H EUS 1 “ eft à grandes ftries ; M M dont
les ltnes lont menues comme des cheveux • 40 celle
qui eft déformé oblpngie,.avec deux trous réunisi
y u forment un ovale alongé : en la polif&nt on lut
donne un rouge admirable, & en n’ôtant que la première
écaillé , elle eft feulement de couleur cendrée
La fixieme claffe n’of&e guère que l’efpece que
nous avons defignée. ^
Les fept claffes préfentent d’autres concholépas à
Unes moins profondes. Le concholépas eft une pa-
0 * des plus fmgulieres, car on la prendrait pour
une.moitié de b ivalve, & il n’y a que le manque de
charnière qui puiffe convaincre qu’il dépend de la
ïamille des patelles.
Dans la leptieme claffe de patelles dont on vient
de parcounHes efpeces, la patelle, ronde à ftries &
à volutes, eft une des plus rares, comme nous l’avons
remarque ; elle .n’eft cependant qu’une variété
de celles qui font chambrées.
La patelle nommée le bouclier d'écaille Je. tortue eft
encore mie des rares par fa grandeur, la nacré de
ion intérieur, Sc la beaute de fes taches rouges.
Fabius Cplumna ne diftingue que quatre eipeces
de lepas : le lépas ordinaire, parce qu’i l efttii:s,-coin-
piun adNEaples ; fe figure eft ovale & fa cSuieur cen-
dree Le grand, lepas exotique qui viènt d’Efpagne
dont la.coquille dure, épaiffe, & à ftries relevees’
forme des angles & des dentelles autour de fa bafe’
La troificme efpece s’appelle lepas fyhejhe ; c’ eft uiï
petit coquillage d’une ovale inégalé , . de ,'oeuleur
cendree, avec quelques filets & âés aoncs fin- lit
robe ; il eft troué dans le haut, & c’eft'paf o à for-
tent fes excrémens, - Columna appelle I4 quatriema
efpece patella /egalis, la patelle royale.;; efle eft
nacrée en-dedans, & percée.de plufteursétrous '
avec une écaillé rabotétife. On voit affez par ce de?
tail, que l’énumération des efpeces de patelles fait?
par Oplumna, n’a point.l’exaàitu'de;qu’on.dévoit
attendre d’un naturalise auffi confomme qu’k i ’étoit;
mais parlons du coquillage.
Les voyageurs connoiffent la (ateliers 1 y en a petf
tnu ne fe foient fait un pl'atffr de la détàciïèf dit rocher
pour, juger de fon gept ; -plufieurs-neuples voi-
lins de la mer en fontjeiir .notirfiturkqrdinaire. Oit
la trouve par-tout attachée au rocher, & l’animal
occupe le fond de fa coquille, oii il tient fortement
par plufieurs liens. Si on le renyerfe,!;on remarque
qu’une partie de fon corps n’eft pas revêtue de coquille
; il fort de fa parüe-fup.érieüre un petit corps