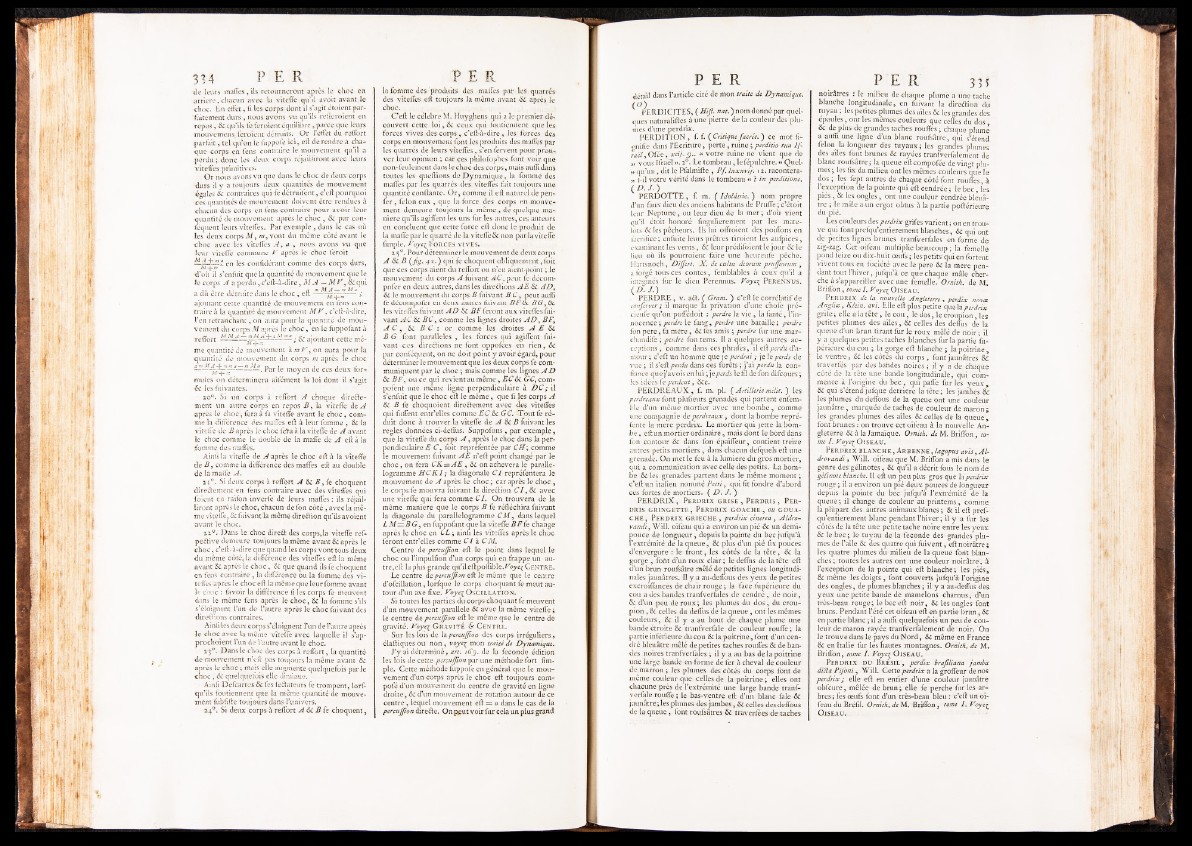
tif
I•I
rdm )
! IIIW
S-[(ê i
•M i, ;
1
334 P E R
île leurs malles, ils retourneront après le choc en
arriéré, chacun avec la vîteffe qu’il avoit avant le
choc. En effet, h les corps dont il s’agit étoient par*-
faitement durs , nous avons vu qu’ils relleroient en
repos, 6c qu’ils fe feroient équilibre, parce que leurs
mouvemens. feroient détruits. Or l’effet du rellort
parfait, tel qu’on ie luppole ic i, eft de rendre à cha-»
que corps en fens contraire le mouvement qu’il a
perdu ; donc les deux corps rejailliront avec leurs
Vîtelies primitives»
Or nous avons vu que dans le choc de deux corps
durs il y a toujours deux quantités de mouvement
égales & contraires qui fe détruifent, c’eft pourquoi
xes quantités de mouvement doivent être rendues à
chacun des corps en fens contraire pour avoir leur
quantité de mouvement après le choc , 6c par con-
féquent leurs vîtelfes. Par exemple, dans le cas où
les deux corps M , m, vont du même côté avant le
•choc avec:les vîtelfes A , a , nous avons vu que
leur vîtelfe commune V après le choc feroit
r ~" en ^ès c°nlîdérant comme des corps durs,
d ’où il s’enfuit que la quantité de mouvement que le
le corps A a perdu, c’elt-à-dire, M A — M V ,6 c qui
a du être détruite dans le choc , eft m Ma >
ajoutant cette quantité de mouvement en fens contraire
à la quantité de mouvement M V , c’eft-à-dire,
l’en retranchant, on aura pour la quantité de mouvement
du Corps M après le choc, en le fuppofant à
reffort ^ - —^ 4 ^ — — — ; & ajoutant cette même
quantité de mouvement à m V , on aura pour la
quantité de mouvement du corps m après le choc
a~ m Par le moyen de ces deux formules
on déterminera aifément la loi dont il s’agit
•& les fuivantes.
• io ° . Si un corps à reffort A choque directement
un autre corps en repos B , la vîteffe de A
•après le choc, fera à fa vîteffe avant le choc, comme
la différence des maffes eft à leur fomme , 6c la
vîteffe de B après le choc fêta à la vîteffe de A avant
le choc comme le double de la maffe de A eft à la
fomme des maffes.
Ainfi la vîteffe de A après le choc eft à là vîteffe
de B , comme la différence des maffes eft au double
de là maffe A.
2 i° . Si deux corps à reffort A 6c B , fe choquent
directement en fens contraire avec des vîteffes qui
foient en raifon inverfe de leurs maffes : ils rejailliront
après le choc, chacun de fon côté , avec la même
vîteffe, 6c fuivant la même direction qu’ils avoient
avant le choc.
22°. Dans le choc direû des corps,la vîteffe ref-
peélive demeure toujours la même avant & après le
ch oc, c’eft-à-dire que quand les corps vont tous deux
du même côté, la différence des vîteffes eft la même
avant 6c après le choc , 6c que quand ils fe choquent
en fens contraire , la différence ou la fomme des vî-
teflès après le choc eft la même que leur fomme avant
le choc : lavoir la différence fi les corps fe meuvent
dans le même fens après le choc, & la fomme s’ils
s’éloignent l’un de l’autre après le choc fuivant des
directions contraires.
AinlUes deux corps s’éloignent l’un de l’autre après
le choc avec la même vîteffe avec laquelle il s’ap-
proehoient l’un de l’autre avant le choc.
230'. Dans le choc des corps à reffort, la quantité
de mouvement n’eft pas toujours la même avant 6c
après le choc ; mais elle augmente quelquefois parle
ch o c , 8c quelquefois elle diminue.
Ainfi Defcartes & fes feclateurs fe trompent, lorf-
qu’ils fouïiennent que la même quantité de mouvement
fubfifte toujours dans l’univers.
24°. Si deux corps à reffort A 6c B fe choquent,
P E R
la fomme des produits des maffes par les quarrés
des vîteffes ,eft toujours la même avant 6c après le
choc.
C’eft le célébré M. Huyghens qui a le premier découvert
cette lo i, 8c ceux qui Soutiennent que les;
forces vives des corps., c’eft-à-dire, les; forces des
corps en mouvement font les produits des maffes par
les quarrés de leurs vîteffes, s’en fervent pour prou-,
ver leur opinion ; car ces philofophes font voir què.
non-feulement dans le choc des corps, mais auflidans
toutes les queftions de Dynamique, la fomme des
malles par les quarrés des vîteffes fait toujours une
quantité confiante. Or, comme il eft naturel de penfer
, félon eux , que la force des corps en mouvement
demeure toujours la- même, de quelque maniéré
qu’ils agiffent les uns fur les autres, ces auteurs
en concluent que cette force eft donc le produit de
la maffe par le quarré de la vîteffe & non par la vîteffe
Simple. Voyt{ Forces vives.
2 5 °. Pour déterminer le mouvement de deux corps
A 6c B (fig. 42 .) qui fe choquent obliquement, loit
que ces corps aient du reffort ou n’en aient-point ; le
mouvement du corps A fuivant AC, peut le décom-
pnfer en deux autres, dans les direélions A E 6c AD,
6c le mouvement du corps B fuivant B C , peut aufli
fe décompofer en deux autres fuivant B F 6c B G , 6c
les vîteffes fuivant A D 6c B F feront aux vîtefies fuivant
A C 6c B C , comme les lignes droites A D , B F,
A C , 6c B C : or comme les droites A E 6c
B G font parallèles , les. forces qui agiffent fuivant
ces direftions ne font oppofees en rien, 6c
par conféquent, on ne doit point y avoir égard, pour
déterminer le mouvement que les deux corps fè communiquent
par le choc ; mais comme les lignes A D
6c B F , ou ce qui revient au même, E C 6c GC\ com»
pofent une meme ligne perpendiculaire à D C ; il
s’enfuit que le choc eft le même, que fi tes corps A
6c B fe choquoient directement avec des vîteffes
qui fuffent entr’elles comme E C 6c GÇ. T o u t fe réduit
donc à trouver la vîteffe de A 6c B luivant tes
réglés données ci-deflus. Suppofons , par exempte,
que la vîteffe du corps A , après 1e choc dans la perpendiculaire
E C , foit reprefentée par Cf/; comme
le mouvement fuivant A E n’eft point changé par le
ch oc, on fera C K = A E , 6c on achèvera 1e parallélogramme
H C K I ; la diagonale C l repréfentera le
mouvement de A après 1e choc ; car après 1e choc ,
le corps fe mouvra fuivant la. direction C I ,6 c avec
une vîteffe qui fera comme C I . On trouvera de la
même maniéré que 1e corps B fe réfléchira fuivant
la diagonale du parallélogramme CM , dans lequel
LM — B G , en fuppofant que la vîteffe B F fe change
après le choc en CL ; ainfi tes vîteffes après 1e choc
feront entr’elles comme C l à C M.
Centre de pereuffion eft 1e point dans lequel 1e
choc ou l’impulfion d’un corps qui en frappe un autre,
eft lapins grande qu’il eft poffible.Fbye^ Centre.
Le centre depercujjion eft 1e même que 1e centre
d’ofcillation, lorfque 1e corps choquant fe meut autour
d’un axe fixe. Voye^ Oscil la t io n .
Si toutes tes parties du corps choquant fe meuvent
d’un mouvement parallèle 6c avec la même vîteffe ;
1e centre de percujjion eft 1e même que 1e centre de
gravité. Voye^ G ravité & C entre.
Sur tes lois de la percujjioiz des corps irréguliers,
élaftiques ou non, voyeç mon traité de Dynamique.
J’y ai déterminé, art. iGg. de la fécondé édition
tes lois de cette percujjion par une méthode fort fimple.
Cette méthode fuppofe en général que 1e mouvement
d’un corps après 1e choc eft toujours com-
pofé d’un mouvement du centre de gravité en ligne
droite, 6c d’un mouvement de rotation autour de ce
centre, lequel mouvement eft = o dans 1e cas de la
percujjion direfte. On p£ut voir fur cela un plus grand
P E R
détail dans l’article cité de mon traite de Dynamique.
( o ) m i
PERDIC1TES, ( Hijt. nat. ) nom donne par quelques
naturaliftes à une pierre de la couleur des plumes
d’une perdrix.
PERDITION , f. f. ( Critique facrée. ) ce mot lignifie
dans l’Ecriture, perte, ruine ; perditio tua lf-
ra'èl, Ofce, xeij. g .. « votre ruine ne vient que de
„ vous Ifraël ». 20. Le tombeau, lefépulchre. « Quel-
» qu’un, dit 1e Pfalmifte , P f Ixxxvij. 12. racontera-
„ t-il votre vérité dans 1e tombeau « ? in perditione.
( D . J . )
PERD O T TE, f. m. ( Idolâtrie. ) nom propre
d’un faux dieu des anciens habitans de Pruffe ; c’étoit
leur Neptune, ou leur dieu de la mer; d’ou vient
ciu’il étoit honoré fingulicrement par tes matelots
6c les pêcheurs. Ils lui offroient des poiffons en
i’acrifice ; enfuite leurs prêtres tiroient tes aufpices,
examinant tes vents, 6c leur prédifoient 1e jour 6c 1e
Heu où ils pourroient faire une heureufe pêche.
Hartsnoch, DiJJert. X . de cultu deorum prufjiorum ,
a forgé tous ces contes, femblables à ceux qu’il a
imaginés fur 1e dieu Perennus. Voye^ Perennus.
( D . J .)
PERDRE, v. a£t. ( Gram. ) c’eft 1e corrélatif de
conferver ,* il marque la privation d’une cnofe pré-
cieufe qu’on poffedoit : perdre la vie , la fanté, l’innocence
; perdre 1e fang, perdre une bataille ; perdre
fon pere, fa mere, 6c fes amis ; perdre fur une mar-
.chandife ; perdre fon tems. Il a quelques autres acceptions
, comme dans ces phraies, il eft perdu d’amour
; c’eft un homme que je perdrai ; je 1e perds de
vue ; il s’eft perdu dans ces forêts ; j’ai perdu la confiance
que j’avois en lui ; j e perds 1e fil de fon difeours ;
les idées fe perdent, &c.
PERDREAUX , f. m. pl. ( Artillerie milit. ) les
perdreaux font plufieurs grenades qui partent enfem-
ble d’un même mortier avec une bombe, comme
une compagnie de perdreaux, dont la bombe repréfente
la mere perdrix. Le mortier qui jette la bombe
, eft un mortier ordinaire, mais dont le bord dans
fon contour 6c dans fon épaiffeur, contient treize
autres petits mortiers, dans chacun defquels eft une
grenade. On met 1e feu à la lumière du gros mortier,
qui a communication avec celle des petits. La bombe
6c tes grenades partent dans 1e même moment ;
c’eft un italien nommé Pétri, qui fit fondre d’abord
ces fortes de mortiers. ( D . J . )
PERDRIX, Perdrix g r is e , Perd r is , Per-
DRIS GRINGETTE, PERDRIX GOACHE , OU GOUACHE,
PERDRIX GRIECHE, perdrix cinerea , Aldrovandi,
"Will. oifeau qui a environ un pié 6c un demi-
pouce de longueur, depuis la pointe du bec jufqu’à
l’extrémité de la queue, 6c plus d’un pié fix pouces
d’envergure : 1e front, tes côtés de la tête, 6c la
gorge , font d’un roux clair ; 1e deffus de la tête eft
d’un brun roufsâtre mêlé de petites lignes longitudinales
jaunâtres. Il y a au-deffous des yeux de petites
excroiffances de chair rouge ; la face fupérieure du
cou a des bandes traniVerlàles de cendré, de noir,
6c d’un peu de roux ; tes plumes du dos, du croupion
, 6c celtes du deffus de la queue, ont les mêmes
couleurs, & il y a au bout de chaque plume une
bande étroite & tranfverfale de couleur rouffe; la
partie inférieure du cou 6c la poitrine, font d’un cendré
bleuâtre mêlé de petites taches rouffes 6c de bandes
noires tranfverfales ; il y a au bas de la poitrine
une large bande en forme de fer à cheval de couleur
de marron ; les plumes des côtés du corps font de
même couleur que celles de la poitrine ; elles ont
chacune près de l’extrémité une large bande tranf-
verfale rouffe ; 1e bas-ventre eft d’un blanc fale 6c
jaunâtre; les plumes des jambes, & celtes des deffous
de la queue, font roufsâtres 6c traverfée^ de taches
P E R 335
noirâtres ; le milieu de chaque plume a une tache
blanche longitudinale, en fiiivant la direélion du
tuyau, tes petites plumes des ailes 6c les grandes des
épaules, ont les mêmes couleurs que celles du dos
6c de plus de grandes taches rouffes ; chaque plume
a auffi une ligne d’un blanc roufsâtre, qui s’étend
felon^ la longueur des tuyaux; les grandes plumes
des aîles font brunes 6c rayées tranlverfalement de
blanc roufsâtre ; la queue eft compofée de vingt plumes;
tes fix du milieu ont tes mêmes couleurs que 1e
dos ; les fept autres de chaque côté font rouffes, à
l’exception de la pointe qui eft cendrée ; 1e b ec, tes
piés , & tes ongles, ont une couleur cendrée bleuâtre
; le male a un ergot obtus à la partie poftérieure
du pié.
Les couleurs des perdrix grifes varient; on en trouve
qui fontprefqu’entierement blanches, & qui ont
de petites lignes brunes tranfverfales en forme de
zig-zag. Cet oifeau multiplie beaucoup ; la femelle
pond lëize ou dix-huit oeufs ; tes petits qui en fortent
vivent tous en fociété avec le pere & la mere pendant
tout l’hiver, jufqu’à ce que chaque mâle cherche
à s’appareiller avec une femelle. Ornith. de M.
Briffon, tome I. Voyeç O iseau.
Perdrix de La nouvelle Angleterre , perdix novat
Anglioe, Klein, avi. Elle eft plus petite que la perdrix
grifë ; elle a la tê te , te cou , 1e dos, 1e croupion, tes
petites plumes des aîles, 6c celtes des deffus de la
queue d’un brun tirant fur le roux mêlé de noir ; il
y a quelques petites taches blanches fur la partie fupérieure
du cou ; la gorge eft blanche ; la poitrine,
le ventre, 6c tes côtés du corps, font jaunâtres 6c
traverfés par des bahdes noires ; il y a de chaque
côté de la tête une bande longitudinale, qui commence
à l’origine du b e c , qui paffe fur tes yeux ,
6c qui s’étend jufque derrière la tête ; tes jambes 6c
tes plumes du deffous de la queue ont une couleur
jaunâtre, marquée de taches de couleur de maron ;
tes grandes plumes des aîles 6c celtes de la queue ,
font brunes : on trouve cet oifeau à la nouvelle Angleterre
& à la Jamaïque. Ornith. de M. Briffon, tome
I. Voye^ O iseau.
Perdrix blanche , Arbenne ,lagopus avis, Al-
drovandi, Will. oifeau que M. Briffon a mis dans le
genre de£ gélinotes, 6c qu’il a décrit fous 1e nom de
gélinote blanche. Il eft un peu plus gros que la perdrix
rouge ; il a environ un pié deux pouces de longueur
depuis la pointe du bec jufqu’à l’extrémité de la
queue ; dl;change de couleur au printems, comme
la plupart des autres animaux blancs ; & il eft prefqu’entierement
blanc pendant l’hiver; il y a fur tes
côtés de la tête une petite tache noire entre tes yeux
6c 1e bec; 1e tuyau de la fécondé des-grandes plumes
de l’aîle 6c des quatre qui fuivent, eft noirâtre ;
tes quatre plumes du milieu de la queue font blanches
; toutes tes autres ont une couleur noirâtre , à
l’exception de la pointe qui eft blanche-; les; piés,
6c même les doigts , font couverts •jiifqu’à l’origine
des ongles, de plumes blanches ; il y a au-deffus des
yeux une petite bande de mamelons charnus, d’un
très-beau rouge; 1e bec eft noir, 6c tes ongles font
bruns. Pendant l’été cet oifeau eft en partie brun, 6c
en partie blanc ; il a auffi quelquefois un peu de couleur
de maron rayée tranfverfalement de noir. On 1e trouve dans 1e pays du Nord, 6c même en France
6c en Italie fur tes hautes montagnes. Ornith. de M.
Briffon, tome I. Voye{ OlSEAU.
Perdrix DU Br é s il , perdix brajiliana jambu
dicta PiJ'oni, Will. Cette perdrix a la groffeur de nos
perdrix ; elle eft en entier d’une couleur jaunâtre
obfcure, mêlée de brun ; elle fe perche fur les arbres
; fes oeufs font d’un très-beau bleu : c’eft un oifeau
du Bréfil. Ornith, de M. Briffon, tome /, Voye7
O iseau.