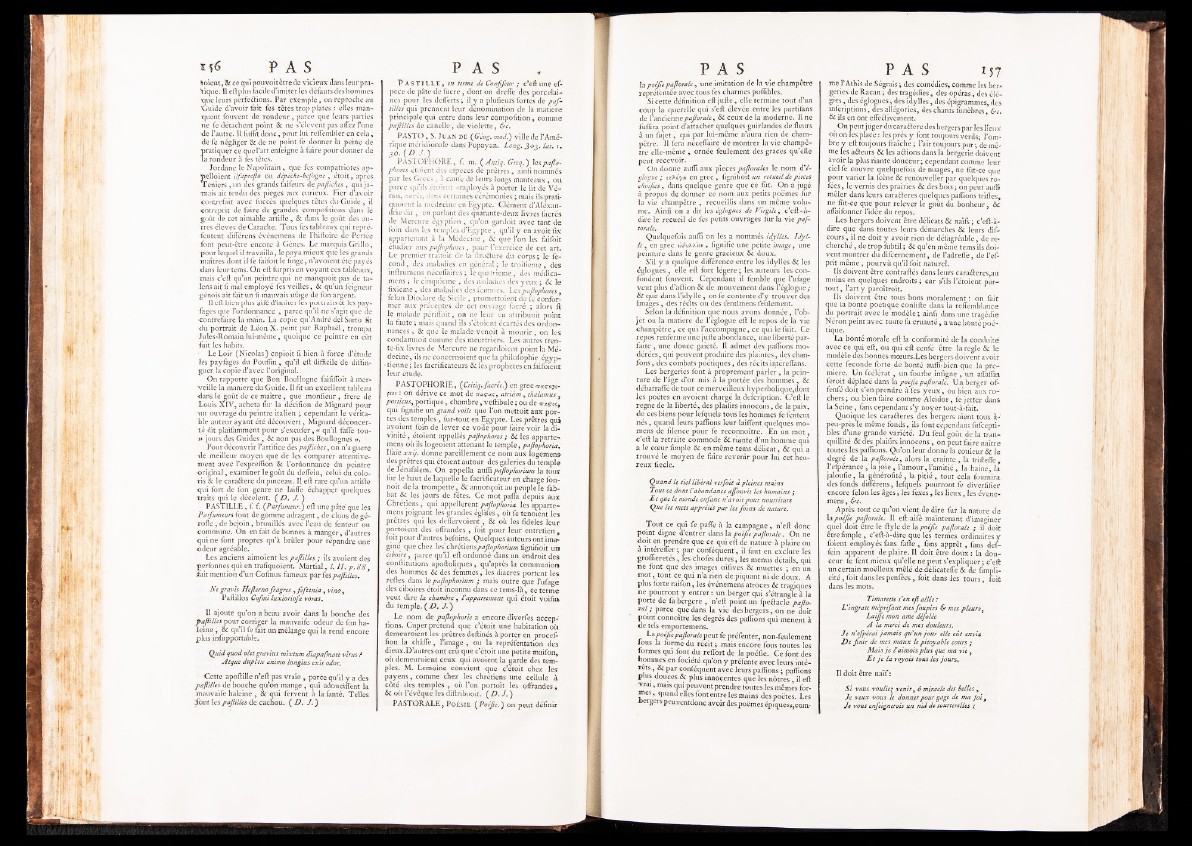
*oient,'8t ce qui pou voit être de vicieux dans leur pratique.
Il efl plus facile d’imiter les défauts des hommes
que leurs perfections. Par exemple, on reproche au
■ Guide d’avoir fait fes têtes trop plates : elles manquent
fouvent de rondeur, parce que leurs parties
ne fe détachent point & ne s’élèvent pas affez l’une
'de l’autre. Il fiiffit donc, pour lui refl'embler en cela,
de fe négliger & de ne point fe donner la peine de
pratiquer ce quel’art enleigne à faire pour donner de
la rondeur à les têtes.
Jordane le Napolitain, que fes compatriotes ap-
pelloient ilfaprejto ou dépêche-befogne , étoit, après
i eniers ,iin des grands faifeurs de pafliches , qui jamais
ait tendu des piégés aux curieux. Fier d’avoir
'contrefait avec fuccès quelques têtes du Guide, il
entreprit de faire de grandes compofitions dans le
£oût de cet aimable artifte, & dans le goût des autres
éleves de Carache. Tous fes tableaux qui repré-
fentent différens événemens de l'hiftoire de Perlée
font peut-être encore à Gènes. Le marquis Grillé,
pour lequel il travailla, le paya mieux que les grands
maîtres dont il fe faifoit le linge, n’avoient été payés
clans leur tems. On eft furpris en voyant ces tableaux,
mais c’eft qu’un peintre qui ne manquoit pas de ta-
"lens ait fi mal employé fes veilles, & qu’un feigneur
-génois ait fait un li mauvais ufage de fon argent.
Il eft bien plus aifé d’imiter les portraits & les paysages
que l’ordonnance , parce qu’il ne s’agit que de
^contrefaire la main. La copie qu’André del Sarto fit
du portrait de Léon X. peint par Raphaël, trompa
Jules-Romain lui-même, quoique ce peintre en eût
fait les habits.
Le Loir (Nicolas ) copioit fi bien à force d’étude
les payfàges du Pouflin , qu’il eft difficile de diftin-
guer la copie d’avec l’original.
On rapporte que Bon Boullogne faififloit à merveille
la maniéré du Guide. Il fit un excellent tableau
■ dans le goût de ce maître , que monfieur , frere de
Louis XIV, acheta uir la decifion de Mignard pour
'un ouvrage du peintre Italien ; cependant le véritable
auteur ayant été découvert, Mignard déconcerté
dit plaifamment pour s’excufer, « qu’il faffe tou-
» jours des Guides , & non pas des Boullognes ».
Pour découvrir l’artifice des pafliches, on n’a guere
-de meilleur moyen que de les comparer attentivement
avec l’expreffion & l’ordonnance du peintre
•original, examiner le goût du deffein, celui du colo-
f is & le caraftere du pinceau. Il eft rare qu’un artifte
q ui fort de fon genre ne laifle échapper quelques
traits qui le décelent. ( D . J. )
PASTILLE, f. f. (Parfumeur.) eft une pâte’ que les
Parfumeurs font de gomme adragant, de clous de gé-
rofle , de bejoin, brouillés avec l’eau de fenteur ou
•commune. On en fait de bonnes à manger, d’autres
qui ne font propres qu’à brûler pour répandre une
odeur agréable.
Les anciens aimoiént les pajlilles ; ils avoient des
•perfonnes qui en trafiquoient. Martial, /. II. p. 8 8,
fait mention d’un Cofmus fameux par fes pajlilles*
.Ne gravis Hefier nofragrès, fefcenia, vino,
Paftillos Cofmi lux ior lofa voras.
Il ajoute qu’on a beau avoir dans la bouche des
pajlilles pour corriger la mauvaife odeur de fon hale
in e , & qu’il fe fait un mélange qui la rend encore
plus infupportable.
Quid quod olet gravius mixtum diapafinate virus ?
Atque duplex animo longius exit odor.
Cette apoftille n’eft pas vraie , parce qu’il y a des
pajlilles de bouche qu’on mange , qui adouciffent la
mauvaife haleine , & qui fervent a là fanté. Telles
ibnî -lespajlilles de cachou. ( D . J. )
P A S T IL L E , en terme de Confifeur ; c’eft une ef*
pece de pâte de fucre, dont on drefle des porcelaines
pour les defferts ; il y a plufieurs fortes de paf-
lilles qui prennent leur dénomination de la matière
principale qui entre dans leur compofition, comme
pajlilles de canelle, de violette, &c.
PASTO, S. Juan de (Géog. mod.) ville de l’Amérique
méridionale dans Popayan. Long. 3 o ? . lat. /.
30. {D . J .)
PASTOPHORE, f. m. ( Antiq. Greq. ) 1 espaflo-
pkores etoient des efpeces de prêtres, ainfi nommés
par les Grecs , à caufe de leurs longs manteaux, ou
parce qu’ils étoient employés à porter le lit de Vénus,
vraç-oç, dans certaines cérémonies ; mais ils pratî-
quoient la médecine en Egypte. Clément d’Alexandrie
d i t , en parlant des quarante-deux livres facrés
de Mercure égyptien , qu’on gardoit avec tant de
foin dans les temples d’Egypte , qu’il y en avoit fix
appartenant à la Médecine, & que l’on les faifoit
étudier aux pajlopkores, pour l’exercice de cet art.
Le premier traitoit de la ftrutture du corps ; le fécond
, des maladies en général ; le troifieme, des
inftrumens néceflaires ; le quatrième, des médica-
mens ; le cinquième , des maladies des yeux ; & le
fixieme , des maladies des femmes. Les paflophores ,
félon Diodore de Sicile , promettoient de fe conformer
aux préceptes de cet ouvrage facré ; alors li
le malade périffoit, on ne leur en attribuoit point
la faute ; mais quand ils s’étoient écartés des ordonnances
, & que le malade venoit à mourir, on les
condamnoit comme des meurtriers. Les autres tren-
te-fix livres de Mercure ne regardoient point là Médecine,
ils ne concernoient que la philofophie égyp-
• tienne ; les facrificateurs &: les prophètes en faifoient
leur étude.
PASTOPHORIE, ( Critiq.facrce.) en grec <nretçotpo-
piov : on dérivé ce mot de ttuç-blç, atrium, thalamus ,
porticus, portique, chambre, veftibule ; ou de <m*ç-o?,
qui lignifie un grand voile que l’on mettoit aux portes
des temples, fur-tout en Egypte. Les prêtres qui
avoient foin de lever ce voile pour faire voir la divinité
, étoient appellés paflophores ; & les appartenons
où ils logeoient attenant le temple, paflophoria.
Ifaïe x x j . donne pareillement ce nom aux ïogemen9
des prêtres qui étoient autour des galeries du temple
de Jérafalem. On appella auffipaflophorium la tour
fur le haut de laquelle le facrificateur en charge fon-
noit delà trompette, & annonçoit au peuple le fab-
bat & les jours de fêtes. Ce mot paffa depuis aux
Chrétiens, qui appelèrent paflophoria les appartenons
joignant les grandes égliles, oîi fe tenoient les
prêtres qui les deffervoient, & où les fideles leur
portaient des offrandes , foit pour leur entretien ,
ioit jpour d’autres befoins. Quelques auteurs ont imagine
que chez les' chrétiens paflophorium fignifioit un
ciboire, parce qu’il eft ordonné dans un endroit des
conftitutions apoftoliques, qu’après la communion
des hommes & des femmes, les diacres portent les
reftes dans le paflophorium ; mais outre que l’ufage
des ciboires étoit inconnu dans ce tems-là, ce terme
veut dire la chambre, l'appartement qui étoit voifi»
du temple. ( D . J. )
Le nom de paflophorie a encore diverfes acceptions.
Cuper prétend que c’étoit une habitation oit
demeuroient les prêtres deftinés à porter en procef-
fion la châffe, l’image , ou la repréfentation des
dieux.D’autres ont cru que c’étoit une petite maifon,
où demeuroient ceux qui avoient la garde des temples.
M. Lemoine convient que c’etoit chez les
payens, comme chez les chrétiens une cellule à
côté des temples , où l’on portoit les offrandes,
& oii l’évêque les diftribuoit. ( D. J. )
PASTORALE, Poésie ÇPoéfîc.') on peut définir.
la poéfie paflorale, une imitation de la v ie champêtre
reprélèntée avec tous fes charmes poffibles.
Si cette définition eft jufte, elle termine tout d’un
coup la querelle qui s’eft élevée entre les partifans
de l’ancienne paflorale, & ceux de la moderne. Il ne
fuffira point d’attacher quelques guirlandes de fleurs
à un fujet, qui par lui-même n’aura rien de champêtre.
Il fera néceffaire de montrer la vie champêtre
elle-même , ornée feulement des grâces qu’elle
peut recevoir.
On donne auffi aux pièces paflorales le nom dV-
glogue ; tKXÔy» en grec , fignifioit un recueil de pièces
choijies, dans quelque genre que ce fut. On a jugé
à propos de donner ce nom aux petits poëmes fur
la vie champêtre , recueillis dans un même volume.
Ainfi on a dit les églogues de Virgile, c’eft-à-
dire le recueil de fes petits ouvrages fur la vie paf-
torale.
Quelquefois auffi on les a nommés idylles. Idylle
, en grec tiS'uXxhv, fignifie une petite image, une
peinture dans le genre gracieux & doux.
- S’il y a quelque différence entre les idylles & les
églogues , elle eft fort légère ; les auteurs les confondent
fouvent. Cependant il femble que l’ufage
veut plus d’aâion & de mouvement dans l’églogue,*
& que dans l’id ylle, on fe contente d’y trouver des
images, des récits ou des fentimens feulement.
Selon la définition que nous avons donnée, l’objet
Ou la matière de l’églogue eft le repos de la vie
champêtre, ce qui l’accompagne, ce qui le fuit. Ce
repos renferme une jufte abondance, une liberté parfaite
, une douce gaieté. Il admet des paffions modérées,
qui peuvent produire des plaintes, des chan-
fons, des combats poétiques, des récits intéreffans.
Les bergeries font à proprement parler, la peinture
de l’âge d’or mis a la portée des hommes, &
débarrafféae tout ce merveilleux hyperbolique,dont
les poètes en avoient chargé la delcription. C’eft le
régné de la liberté, des plaifirs innocens, de la paix,
de ces biens pour lefquels tous les hommes fe fentent
nés, quand leurs paffions leur laiflënt quelques mo-
mens de filence pour fe reconnoître. En un m o t, ‘
c ’eft la retraite commode & riante d’un homme qui
a le coeur fimple & en même tems délicat, & qui a
trouvé le moyen de faire revenir pour lui cet heureux
fiecle.
Quand le ciel liberal verfoit à pleines mains
Tout ce dont l'abondance affouvit les humains ;
E t que le monde enfant n avoit pour nourriture
Que les mets apprêtés par les foins de nature.
Tout ce qui fe pafle à la campagne, n’eft donc
point digne d’entrer dans la poéfie paflorale. On ne
doit en prendre que ce qui eft de nature à plaire ou
à intéreffer ; par conféquent, il faut en exclure les
groffieretés, les chofes dures, les menus détails, qui
ne font que des images oifives & muettes ; en un
mot, tout ce qui n’a rien de piquant ni de doux. A
plus forte raifon, les événemens atroces & tragiques
ne pourront y entrer : un berger qui s’étrangle à la
porte de fa bergere , n’eft point un fpeâacle pajlo-
ral ; parce que dans la vie des bergers, on ne doit
point connoître les degrés des paffions qui mènent à
de tels emportemens.
La poéfle paflorale y eut fe préfenter, non-feulement
lous la forme du récit ; mais encore fous toutes les
formes qui font du reffort de la poéfie. Ce font des
hommes en focieté qu’on y préfente avec leurs inté-
ïe ts , & par conféquent avec leurs paffions ; paffions
plus douces & plus innocentes que les nôtres, il eft
v rai, mais qui peuvent prendre toutes les mêmes formes,
quand elles font entre les mains des poètes. Les
.Bergers peuventdonc avoir des poëmes épique«,comme
l’Athis de Ségrais ; des comédies* comme les bergeries
de Racan ; des tragédies, des opéras, des élégies
, des églogues, des idylles, des épigrammes, des
înfcriptions, des allégories, des chants funèbres, &c.
& ils en ont effe&ivemertt.
v On peut juger du cataÛère des bergers par lés lieux
où on les place : les prés y font toujours verds; l’ombre
y eft toujours fraîche ; l’air toujours pur ; de même
les aéfeurs & les aérions dans la bergerie doivent
avoir la plus riante douceur; cependant comme leur
ciel fe couvre quelquefois de nuages, ne fut-ce que
pour varier la fcène & renouveller par quelques ro-
lées, le vernis des prairies & des bois ; on peut auffi
mêler dans leurs cara&eres quelques paffions triftes,
ne fïit-ce que pour relever le goût du bonheur, &C
aflaifonner l’idée du repos.
Les bergers doivent être délicats & naïfs ; c’eft-à-
dire que dans toutes leurs démarches & leurs discours
, il ne doit y avoir rien de défagréable, de recherché
, de trop fubtil ; & qu’en même tems ils doivent
montrer dudifeernement, de l’adrefl'e, de l’ef-
prit même , pourvû qu’il foit naturel.
Ils doivent être contraftés dans leurs cara£leres,ait
moins en quelques endroits ; car s’ils l’étoient partout
, l’art y paroîtroit.
Ils doivent être tous bons moralement î on fait
que la bonté poétique Confifte dans la reffemblance
du portrait avec le modèle ; ainfi dans une tragédie
Néron peint avec toute fa cruauté, a une bonté poétique.
La bonté morale eft la conformité de la conduite
avec ce qui eft, ou qui eft cenfé être la réglé & le
modèle des bonnes moeurs.Les bergers doivent avoir
cette fécondé forte de bonté auffi-bien que la première.
Un fcélérat, un fourbe infi'gne , un aftaffin
feroit déplacé dans la poéfie paflorale. Un berger of-
fenfé doit s’en prendre à fes y e u x , ou bien aux rochers
; ou bien faire comme Alcidor, fe jetter dans
la Seine, fans cependant s’y noyer tout-à-fait.
Quoique les caraélefes des bergers aient tous à-
peu-près le même fonds, ils font cependant fufeepti-
bles d’une grande variété. Du feul goût de la tranquillité
& des plaifirs innocens, on peut faire naître
toutes les paffions. Qu’on leur donne la couleur & le
degré de la p a flo ra le , alors la crainte , la triftelfe ,
l’efpérance,’ la joie , l’amour, l’amitié , la haine, la
jaloufie, la générofité , la pitié, tout cela fournira
des fonds différens, lefquels pourront fe diverfifier
encore félon les âges, les fexes, les lieux, les évene-
mens, &c.
Après tout ce qu’on vient de dire fur la nature de
la poéfie paflorale. Il eft aifé maintenant d’imaginer
quel doit être le ftyle de la poéfie paflorale ; il doit
être fimple , c’eft-à-dire que les termes ordinaires y
foient employés fans fafte , fans apprêt , fans def-
fein apparent de plaire. Il doit être doux : la douceur
fe fent mieux qu’elle ne peut s’expliquer ; c’eft
un certain moëlleux mêlé de délicateffe & de fimpli-
cité, foit dans les penfées , foit dans lès tours, foit
dans les mots.
Timarette s'en efl allée :
L'ingrate méprifant mes foupirs & mes pleurs.
Laiffe mon ame défolée
A la merci de mes douleurs.
Je n'efpèrai jamais qu'un jour elle eût envie.
De finir de mes maux le pitoyable cours ;
Mais je Üaimois plus que ma vie ,
E t je la voyois tous les jour$y
Il doit être naïf :
Si vous voülieç venir, 6 miracle des belles,
Je veux vous le donner pour gage de ma foi .
Je vous enfeignerois un nid de tourterelles :