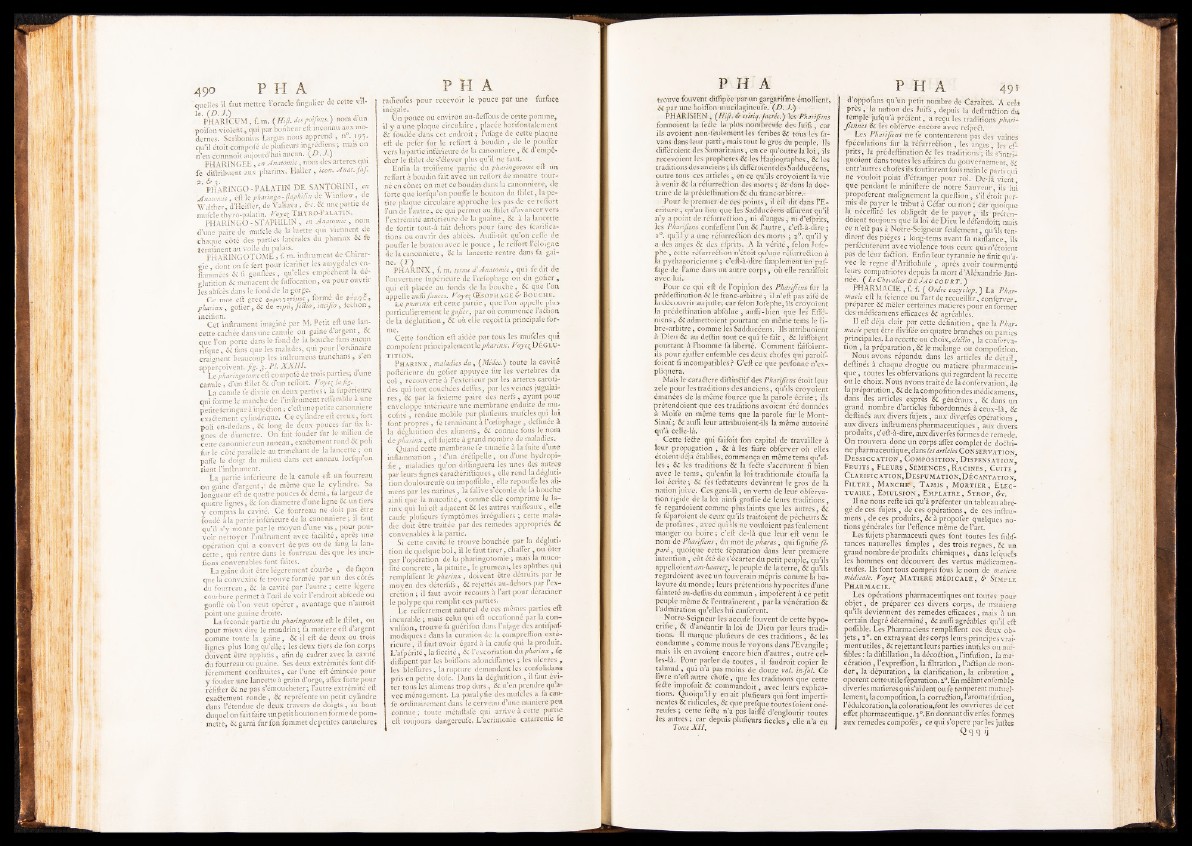
quelles il faut mettre l’oracle fingulier de cette ville.
(L>. y.) ■ I I I
PHARICÜM, f. m. {Biß. despoifons.) nom dun
poifon v iolent, qui par bonheur eft inconnu aux modernes.
Scribonius Largus nous apprend , n . 195’
qu’il étoit compofé de plufieurs Ingrediens ; mais on
n’en cônnnoît aujourd’hui aucun. £Z>.7 .) •
PHARINGÉE, en Anatomie , nom des arteres qui
fe diftribuent aux pharinx. Haller , icon. Anat. faf.
* ’ PHÀRINGO-PALATIN DE SANTORINI, en
Anatomie, èft l e pharingo-JiäpUl'm de Window, de
AValther, d’Heüfe, de Valiàva, 6-e. & une partie de
niufcle thyro-palatinv- Voye\ T hyro -Pala t in .
PHARINGO - STÄPHILIN , en Anatomie , nom
d’une paire de mufcle de la luette qui viennent de
chaque; côté des parties latérales du pharinx & fe
terminent ait voflé du palais'. y
PHARINGOTOME, f. m- inftmment de Chirurgie
, dont on fe fert pour Ratifier les amygdales-enflammées
& fi gonflées , qu’elles empêchent la déglutition
& menacent de fuffocation, ou pour ouvrir
les abfcès dans lê fond de là gorgé* ,
Ce mot eft grec ^pu^oTo/^s , forme de papoyS,
pharinx, gofier, & de teyi, feéiio, iricißo , fedion,
incifion. . A . .
Cet infiniment imaginé par M. Petit eft une lancette
cachée dans une canule ou gaine d argent, 6c
que l’on porte dans le fond de la bouche fans aucun
rifque, & fans que les malades, qui pour l’ordinaire
craignent beaucoup les inftrumens tranchans, s eh
apperçoivent. fig. 3. PI- X XIII. .
L epharingotome eft compofé de trois parties; d une
canule, d’un ftilet 6c d’un reffort. Voye{ la fig.
La canule fe divife en deux parties ; la fuperieure
qui forme le manche de l’inftrument reffemble à une
petite feringue à injeftion ; c’eft une petite canonnière
exactement cylindrique. Ce cylindre eft creux, fort
poli en-dedans, 6c long de deux pouces fur fix lignes
de diamètre. On fait fouder fur le milieu de
cette canonnière un anneau, exactement rond 6c poli
fur le côté parallele au tranchant de la lancette ; on
paffe le doigt du milieu dans cet anneau lorfqu’on
tient l’inftrument. -
La partie inférieure de la canule eft un fourreau
ou gaine d’argent ,1 de même que le cylindre. Sa
longueur eft de quatre pouces 6c demi, fa largeur de
quatre lignes, 6c fon diamètre d’une ligne 6c un tiers
y compris la cavité. Ce fourreau ne doit pas être
foudé à la partie inférieure de la canonnière ; il faut
qu’il s’y monte par le moyen d’une v is , pour pouvoir
nettoyer l’inftrument avec facilite, apres une
opération qui a couvert de pus ou de fang la lancette
, qui rentre dans le fourreau dès que les inci-
fions convenables font faites. >
La traîne doit être légèrement courbe , de façon
que la convéxité fe trouve formée par un des côtés
du fourreau, 6c la cavité par l’autre ; cette légère
courbure permet à l’oeil de voir l’endroit abfcede ou
gonflé oit l’on veut opérer , avantage que n’auroit
point une guaîne droite.
La fécondé partie du pharingotome eft le ftilet, ou
pour mieux dire le mandrin ; fa matière eft d’argent
comme toute la gaine , & il eft de deux ou trois
lignes plus long qu’elle ; les deux tiers de fon corps
doivent être applatis , afin de cadrer avec la cavité
du fourreau ou guaîne. Ses deux extrémités font différemment
conftruites, car l’une eft émincée pour
y fouder une lancette à grain d’orge, affez forte pour
réfifter 6c ne pas s’émoucheter ; l’autre extrémité eft
exactement ronde , 6c repréfente un petit cylindre
dans l’étendue de deux travers de doigts, au bout
duquel on faitfaire un petit bouton en forme de pommette,
6c garni fur fon fommet de petites cannelures
radieufes pour recevoir le pouce par une ftirface
inégale.
Un pouce ou environ au-deffous de cette pommé,
il y a une plaque circulaire, placée horifontalement
6c foudée dans cet endroit ; l’ufage de cette plaque
eft de pefer fur le reffort à boudin , de le pouffer
vers la partie inférieure de la canonhiere, 6c d’ empêcher
le ftilet de s’élever plus qu’il ne faut.
Enfin la troifieme partie du pharingotome eft lin
reffort à boudin fait avec un reflort de montre tourné
en cône; on met ce boudin dans la canonnière, de
forte que lorfqu’on pouffe le bouton du ftilet, la petite
plaque circulaire approche les pas de ce reflort
l’un de l’autre, ce qui permet au ftilet d’avancer vers
l’extrémité antérieure de la guaîne,, 6c à la lancette
de fortir tout-à fait dehors pour faire des fcarificâ-
tions ou ouvrir des abfcès. Aufîi-tôt qu’on ceffe de
pouffer le bouton avec le pouce , le reffort l’éloigne
de la canonnière, 6c la lancette rentre dans fa gai-*
ne. (T )
PHARINX, f. m. terme d'Anatomie, qui fe dit de
l’ouverture fupérieure de l’cefophage ou du gofier ,
qui eft placée au fonds de la bouche, 6c que l’on
appelle aufli fautes. V OEsophage & Bouche.
Le pharinx eft cette partie, que l’on appelle plus
particulièrement le gofier, par où commence l’aCtion
de la déglutition, 6c où elle reçoit fa principale forme.
H . .
Cette fonction eft aidée par tous les mufcles qui
compofent principalement le pharinx. Vyye{ D églut
it io n .
Ph a r in x , maladies du, (Médec.j toute la cavité
poftérieure du gofier appuyée fur les vertebres du
c o l , recouverte à l’extérieur par les arteres carotides
qui font couchées deffus, par les veines jugulaires
, 6c par la fixieme paire des nerfs, ayant pour
enveloppe intérieure une membrane enduite de mu-
cofité , rendue mobile par plufieurs mufcles qui lui
font propres , fe terminant à l’oefophage , deftinée à
la déglutition des alimens, & connue fous le nom
de pharinx, eft fujette à grand nombre de maladies.
Quand cette membrane fe tuméfie à la fuite d’une
inflammation , [ d’un éréfipelle, ou d’une hydropi-
fie maladies qu’on diftinguera les unes des autres
par leurs fignes caraCtériftiques, elle rend la déglutition
douloureufe ou impoflible, elle repouffe les alimens
par les narines, la falive s’écoule de la bouche
ainfi que la mucofité, comme elle comprime le la-
rinx qui lui eft adjacent 6c les autres vaiffeaux, elle
caufe plufieurs fymptômes irréguliers ; cette maladie
doit être traitée, par des remedes appropriés 6c
convenables à la partie.
Si cette cavité fe trouve bouchée par la déglutition
de quelque b o l, il le faut tirer, chaffer, ou oter
par l’operation de la pharingotomie ; mais la mucofité
concrete, la pituite, le grumeau, les aphthes qui
rempliffent le pharinx, doivent être détruits par le
moyen des déterfifs, 6c rejettés au-dehors pay 1 excrétion
; il faut avoir recours à l’art pour déraciner
le polype qui remplit ces parties.
Le refferrement naturel de ces mêmes parties eft
incurable ; mais celui qui eft occafionné par la con-
vulfion, trouve fa guérifon dans l’ufage des antifpaf-
modiques : dans la curation de la compreflion extérieure
, il faut avoir égard à la caufe qui la produit.
L’afp érité, la ficcité, 6c l’excoriation du pharinx, fc
diflipent par les boiffons adouciffantes ; les ulcérés ,
les bleffures, la rupture demandent les confolidans
pris en petite dofe. Dans la déglutition , il faut éviter
tous les alimens trop durs, 6c n’en prendre qu’avec
ménagement. La paralyfie des mulcles a fa caufe
ordinairement dans le cerveau d’une maniéré peu
connue ; toute métaftafe qui arrive à cette p ^m
eft toujours dangereufe. L’acrimonie catarreuie fe
trouve fouvent diffipee par-un gargafifme émollient,
6c par uneboiffon muciïagineiife. (iD. ƒ.>) ■ • •
PHARISIEN, {Bïfiv&crmqïjacréeÿtesfharifiens
formoient la feCte la plus nombreufie des Juifs, car
ils avoient non-feulement les fcribes & tous lés fa-
vans dans leur parti, mais tout le gros du peuple. Ils
différoient des Samaritains, en ce qu’outré1la lo i , ils
recevaient les prophètes & -les Hagiographes, 6c les
traditions des anciens ; ils différoient dés Sadduceens,
outre tous ces.articles, en ce qu’ils croyoient la vie
à venir & la réfurrèCtion dès morts ; & dans la doctrine
de la prédeftination & du franc-arbitre.-
Pour le premier de Ces points, il eft dit dans l’Ecriture,
qu’au lieu que les Sadducéènsaffurénf qu’il
n’y a point de réfurrèCtion, ni d’anges , ni d’efprits,
les Pharifiens confeffent l’un 6c l’autre f c’eft-à-dire ;
i° . qu’il y a une réfurrèCtion des morts ; 2°. qu’il y
a des anges 6c des Çlprits. Â là vérité, félon Jofe-
phe, cette réfurrèCtion n’étoit qu’une réfurrèCtion à
la pythagoricienne ; c’ eft-à-dire fimplemènt iin paf-
fage de l’ame dans un autre corps, où elle renaiffoit
avecfiui»*- - -
Pour ce qui eft de l’opinion des Pharifiens fur la
prédeftination 6c le franc-arbitre ; il n’eft pas aifé de
îa découvrir au jufte; car félon Jofephe, ils croyoient
la prédeftination abfôlue, aufli-bien que les Effc-
niens ; & admettoient pourtant en mêmetems le li-
bre-arbitre, comme les Sadducéens. Ils attribuoient
à Dieu 6c au deftin tout ce qui fe fait, 6c laiffoient
pourtant à l’homme fa liberté. Comment faifoient-
ils pour ajufter enfemble ces deux chofes qui paroif-
foient fi incompatibles ? C’eft ce que perfonne n’expliquera.
Mais le caraCtere diftinCtif dés Pharifiens étoit leur
zele pour les traditions des anciens, qu’ils croyoient
émanées de la même fource que la parole écrite ; ils
prétendoient que ces traditions avoient été données
a Moïfe en même tems que la parole fur le Mont-
Sinaï; & aufli leur attribuoient-ils la même autorité
qu’à celle-là.
• Cette fefte qui faifoit -fon capital de travailler à
leur propagation , & à les faire obferver où elles
étoient déjà établiëis, commença en mêmetems qu’elles
; 6c les traditions 6c la fefte s’accrurent fi bien
avec le tems, qu’enfin la loi traditionale étouffa la
loi écrite ; 6c fes feriàtèurs devinrent le gros de la
nation juive. Ces gens-là, en vertu de leur ôbferva-
tion rigide de la loi ainfi grofliede leurs traditions,
fe regardoient comme plus faints que les autres, 6c
fe féparoient de ceux qu’ils traitoient de pécheurs 6c
de profanes , avec qui ils ne vouloient pas.feulement
manger ou boire ; c’eft de-là que leur eft venu le
nom de Pharifiens, du mot de pkaras, qui fignifie fié-
paré, quoique cette féparation dans leur première
intention, eut été de s’écarter du petit peuple, qu’ils
appelloient am-haaretç, le peuple de la terre, & qu’ils
regardoient avec un fouverain mépris comme la ba-
layure du monde ; leurs prétentions hypocrites d’une
fainteté au-deffus du commun, impoferent à ce petit
peuple même 6c l’entraînerent, par la vénération 6c
l ’admiration qu’elles lui cauferent.
Notre-Seigneur les accufe fouvent de cette hypo-
crifie, 6c d’anéantir la loi de Dieu par leurs traditions.
Il marque plufieurs de ces traditions, & les
condamne, comme nous le voyons dans l’Evangile ;
mais ils en avoient encore bien d’autres, outre celles
là. Pour parler de toutes, il faudrait copier le
talmud, qui n’a pas moins de douze vol. in-fol. Ce
livre n eft autre chofe, que les traditions que cette
feéte impofoit & commandoit, avec leurs explications.
Quoiqu’il y en ait plufieurs qui font impertinentes
6c ridicules, & que prefque toutes foient oné-
reufës ; cette feéte n a pas laiffé d’engloutir toutes
les autres ; car depuis plufieurs fiecles, elle n’a eu
Tome XII\
d oppofans qu’un petit nombre de Caraïtes/ A cela
près , .la nation des Juifs , depuis la deffruftion du
temple jufqu’à préfent, a reçu les traditions phari*
fieriries 6c les obferve encore avec refpeét.
Les Pharifiens ne fie contentèrent pas des vaines
fpéeùlàfions fur là reftirreriion , les anges les efi-
prits , la prédeftination & les traditions ;-ils s’intri-
guoient dans toutes les affaires du gouvernement 6t
entr’autres chofes ils foutinrent fous main lé parti qui
ne vouloit point d’étranger pour roi. De-fià. vient,
que pendant le miniftere de notre Sauveur, ils lui
propoferent malignement la queftion, s’il étoit permis
de payer le tribut à Céfar ou non ; ca'r qùoique
la néceflité les obligeât de fie payer- ils préten-
doient toujours que là loi de Dieu le défendoit; mais
ce n’eft pas à Notre-Seigneur feulement, qu’ils tendirent
des pièges ; long-tems avant fa naifiance, ils
perféciiterent avec violence tous ceux qui n’êtoient
pas de leur faétion. Enfin leur tyrannie ne finit qu’avec
fié régne d’Ariftobtîle , après avoir tourmenté
leurs, compatriotes depuis la mort d ’Àléxandrie Jan-
neë. (Le Chevalier d e J a u c o u r t . )
PHARMACIE , f, f. -( Ordre encyclop. ) La Phar-
macie eft la fcience ou l’art de recueillir, conferver,
préparer 6c mêler certaines matières pour en former
des médicamens efficaces 6c agréables.
Il eft déjà clair, par cette définition -, que la Phar-
macie peut être divifée en quatre branches ou parties
principales. La recette ou choix, eleclio, la cônferva-
tion , la préparation, 6c le mélange ou compofition.
Nous avons répandu dans les articles de détail
deftinés à chaque drogue ou matière pharmaceutique,
toutes les obfervations qui regardent la recette
ou le choix. Nous avons traite de la Conférvation, de
la préparation, 6c de la compofition des médicamens>
dans des articles exprès 6c généraux, 6ç dans un
grand nombre d’articles fubordonnés à ceux-là, &
deftinés aux divers ftijets, aux diverfes opérations
aux divers inftruméns pharmaceutiques , aux divers
produits, c’eft-à-dire, aux diverfes formes dé remede.
On trouvera donc un corps affez complet de doftri-
ne pharmaceutique, dans les articles C onservation
D e s s ic c a t io n , C om pos it ion , D ispensat ion^
Fruits , Fleurs , Semences , Racines , Cuite ,
Cla r if ic a t io n , D espum at ion,D éc antation,
Fil t r e , Manche*', T amis , Mo r t ie r , Elec-
tuaire , Émulsion , Emplâtre , Sy r o p , & c.
Il ne nous refte ici qu’à préfenter un tableau abrégé
de ces fujets, de ces opérations, de ces inftrumens
, de ces produits, 6c à propofer quelques notions
générales fur l’effence même de l’art.
Les fujets pharmaceuti qués font toutes les fubf-
tances naturelles fimples , des trois régnés, 6c un
grand nombre de'produits chimiques, dans lëfquels
les hommes ont découvert des vertus médicamen-
teufes. Ils font tous compris fous le nom de matière.
médicale. Voye£ MATIERE MÉDICALE, & SlMPLÉ
Ph a rm a c ie .
Les opérations pharmaceutiques ont toutes pour
o b je t , de préparer ces divers corps', de maniéré
qu’ils deviennent des remedes efficaces , mais à un
certain degré déterminé, 6c aufli agréables qu’il eft
poffible. Les Pharmaciens rempliffent ces deux objets
, i° . en extrayant dés corps leurs principes vraiment
utiles, &rejettant leurs parties inutiles ounui-
fibles : la diftillation, la décoétion, l’infiifion, la macération
, l’expreffion, la filtration, l’aétion de monder,
la dépuration, la clarification, la cribration ,
opèrent cette utile féparation. 20. En mêlant enfemble
diverfes matières qui s’aident ou fe teirtperent mutuellement,
la compofition, la correction, l’aromatifation,
l’edulcoration, la coloration,font les ouvrières de cet
effet pharmaceutique. 3°.En donnant diverfes formel
aux remedes compofés, ce qui s’opère par les juftes
.Q î q ü