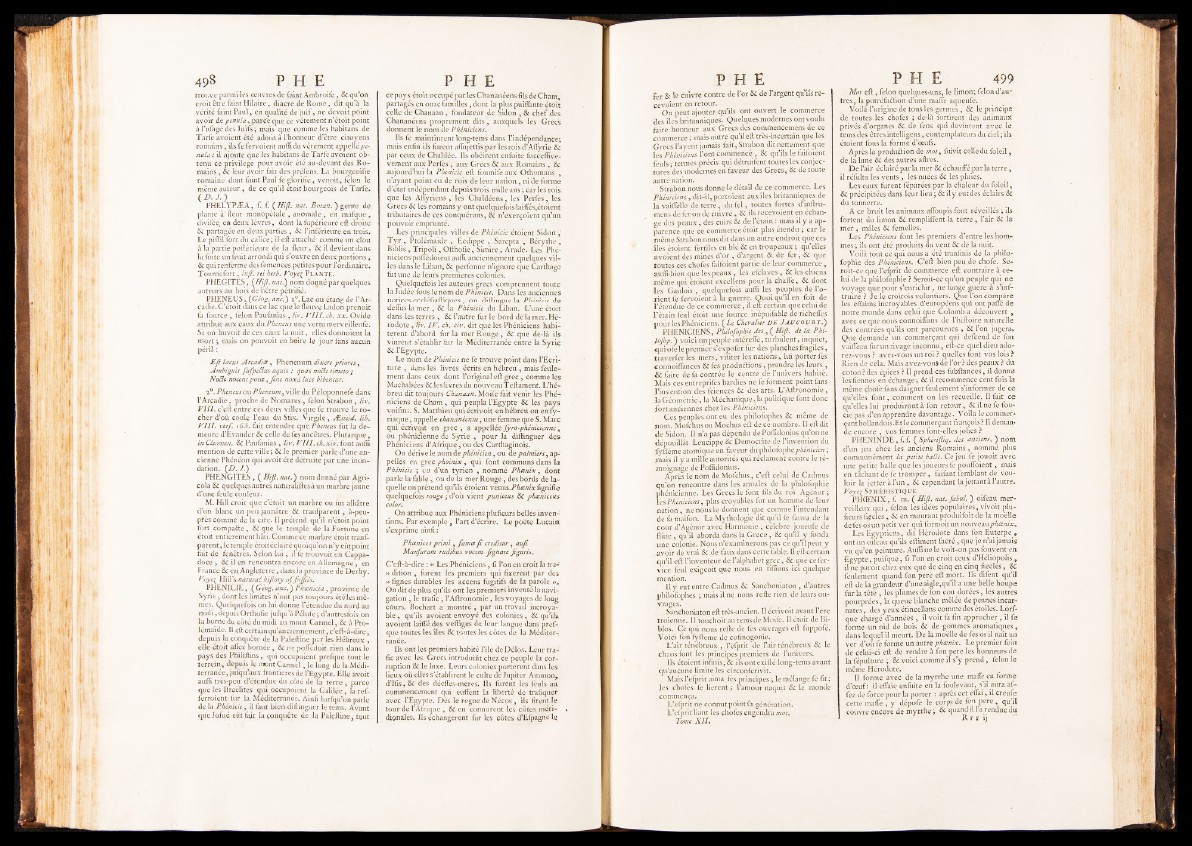
trouve parmi les oeuvres de faint Ambroife, Sc qu’on
croit être faint Hilaire, diacre de Rome, dit qu’à la
vérité faint Paul, en qualité de ju if, ne devoit point
avoir de penula, partie que ce vêtement n’étoit point
à l’ufage des Juifs ; mais que comme les habitans de
Tarfe avoient été admis à l’honneur d’être citoyens
romains, ils fefervoient auffi du vêtement appellépenula
: il ajoute que les habitans de Tarfe avoient obtenu
ce privilège pour avoir été au-devant des Romains
, Sc leur avoir fait des préfens. La bourgeoifie
romaine dont faint Paul fe glorifie, venoit, félon le
même auteur , de ce qu’il etoit bourgeois de Tarfe.
( D J • ) H
PHELYPÆA, f. f. ( Hiß. nat. Botan. ) genre de
plante à' fleur monopétale , anomale , en mafque ,
diviféej ea deux lèvres, dont la fupérieure eft droite
Sc partagée en deux parties , Sc l’inférieure en trois.
Le piftil fort du calice ; il efl attaché comme un clou
à la partie poftérieure de la fleur, & il devient dans
la fuite un fruit arrondi qui s’ouvre en deux portions,
& qui renferme desfemences petites pour l’ordinaire.
Tournefort, Infi, rei herb. Voyc^ P l a n t e .
PHEGITES, {Hiß. nat.) nom doijné par quelques
auteurs au bois de hêtre pétrifié.
PHENEUS, {Géog. anc.) i°. Lac ou étang de l’Arcadie.
C ’étoit dans ce lac que le fleuve Ladon prenoit
fa foiirce , félon Paufanias , liv. VIII. ch. xx. Ovide
attribue aux eaux du Pheneus une vertu merveilleufe.
Si on buvoit de ces eaux la nuit, elles donnoient la
mort ; mais on pouvoit en boire le jour fans aucun
péril :
E ß lacus Arcadia , Phenenum dixere priores,
Ambiguis fufpeclus aquis : quas nocie timeto ;
Nocie nocent potce, fine noxâ luce bibentur,
2°. Pheneus ou Pheneum^ ville-du Péloponnefe dans
l’Arcadie, proche de Nomarus , félon Strabon, liv.
VIII. c’eft entre ces deux villes que fe trouve le rocher
d’où coule l’eau du Stix. Virgile, Æneid. lib.
VIII. verf. 166. fait entendre que Pheneus fut la demeure
d’Evander Sc celle de fes ancêtres. Plutarque,
in Cleomen. Sc Paufanias , liv. VIII. ch.xiv. font auffi
mention de cette ville ; Sc le premier parle d’une ancienne
Phénéon qui avoit été détruite par une inondation.
{D. ƒ.)
PHENGITES , ( Hiß. nat. ) nom donné par Agri-
cola & quelques autres naturaliftes à un marbre jaune
d’une feule couleur.
M. Hill croit que c’étoit un marbre ou un albâtre
d’un blanc un peu jaunâtre & tranfparent, à-peu-
pïès comme de la cire. Il prétend qu’il n’étoit point
fort compare, Sc que le temple de la Fortune en
étoit entièrement bâti. Comme ce marbre étoit tranfparent,
le temple étoitéclairé quoiqu’on n’y eûtpoint
feit de fenêtres. Selon lui , il fe trouvoit en Cappa-
doce , & il en rencontra encore en Allemagne, en
France Sc en Angleterre, dans la province de Derby.
Voye{ Hill’s natural hifiory o f fojfils.
PHENICIE, , ( Géog. anc. ) Phoenicia, province de
Syrie, dont les limites n’ont pas toujours été les mêmes.
Quelquefois on lui donne l’étendue du nord au
midi, depuis Orthofie jufqu’à Pélufe; d’autresfois on
la borne du côté du midi au mont Carmel, & à Pto-
lémaïde. Il eft certain qu’anciennement, c’eft-à-dire,
depuis la conquête de la Paleftine par les Hébreux ,
elle etoit affez bornée, Sc ne poffédoit rien dans le
pays des Philiftins , qui occupoient prefque tout le
terreim, depuis le nx>nt Carmel, le long de la Méditerranée,
jufqu’aux frontières de l’Egypte. Elle a v o it .
auffi très-peu d’étendue du côté de fa terre , parce
que les Ifraëlites qui occupoient la Galilée la ref-
ferroient fur la Méditerranée. Ainfi lorfqu’on parle
de la Phénicie, il faut bien diftinguer le tems. Avant
que Jofué eût fajt ,1a conquête de la Paleftine, tout
ce pays étoit occupé par les Chananéens fils de Cham,
partagés en onze familles, dont la plus puiffante étoit
celle de Chanaan, fondateur de Sidon , & chef des
Chananéens proprement dits, auxquels les Grecs
donnent le nom de Phéniciens.
Ils fe maintinrent long-tems dans l’indépendance;
mais enfin ils furent aflùjettis par les rois d’Aflyrie &:
par ceux de Chaldée. Ils obéirent enfuite fucceffive-
vement aux Perfes , aux Grecs & aux Romains , Sc
aujourd’hui la Phénicie eft foumife aux Othoma'ns ,
n’ayant point eu de rois de leur nation, ni de forme
d’état indépendant depuis trois mille arts ; car les rois
que les Affyriens , les Chaldéens, les Perfes, les
Grecs Sc les romains y ont quelquefois laiffés,étoient
tributaires de ces conquérans, Sc n’exerçoient qu’un
pouvoir emprunté.
Les principales villes de Phénicie étoient Sidon
T y r , Ptolémaïde , Ecdippe , Sarepta , Bérythe ,
Biblis , Tripoli, Ofthofie, Simire, Arade. Les Phéniciens
poflédoient auffi anciennement quelques villes
dans le Liban, Sc perfonne n’ignore que Carthage
fut une de leurs premières colonies.
Quelquefois les auteurs grecs comprennent toute
la Judée fous le nom de Phenicie. Dans les anciennes
notices eccléfiaftiques , on diftingue la Phénicie de
deflùs la mer , Sc la Phénicie du Liban. L’une étoit
dans les terres , Sc l’autre fur le bord de la mer. Hérodote
, tiv. IV. ch. civ. dit que les Phéniciens habitèrent
d’abord fur la mer Rouge, & que de-là ils
vinrent s’établir fur la Méditerranée entre la Syrie
Sc l’Egypte.
Le nom de Phénicie ne fe trouve point dans l’Ecriture
, dans les livres écrits en hébreu , mais feulement
dans ceux dont l’original eft g rec, comme les
Machabées & les livres du nouveau Teftament. L’hébreu
dit toujours Chanaan. Moïfe fait venir les Phéniciens
de Cham , qui peupla l’Egypte & les pays
voifins. S. Matthieu quiécrivoit en hébreu ou enfy-
riaque, appelle chananéenne, une femme que S. Marc
qui écrivoit en grec , a appellée fyro-phénicienne,
ou phénicienne de Syrie , pour la diftinguer des
Phéniciens d’Afrique, ou des Carthaginois.
On dérive le nom de phénicien, ou de palmiers, ap-
pellés en grec phoinix, qui font communs dans la
Phénicie ; ou d’un tyrien , nommé Phoenix, dont
parle la fable, ou de la mer Rouge, des bords de laquelle
on prétend qu’ils étoient venus.Phoenix fignifie
quelquefois rouge ; d’où vient puniceus Sc phceniceus
color. ■
On attribue aux Phéniciens plufieurs belles inventions.
Par exemple , l’art d’écrire. Le poète Lucain
s’exprime ainfi :
Phtznices primi , famee f i creditur, aufi
Manfuram rudibus vocem fignare figuris.
C’eft-à-dire : « Les Phéniciens, fi l’on en croit la tra-
» dition , furent les premiers qui fixèrent par des
» lignes durables les accens fugitifs de la parole ».
On dit de plus, qu’ils ont les premiers inventé la navigation
, le trafic, l’Aftronomie, les voyages de long
cours. Bochart a montré , par un travail incroyable
, qu’ils avoient envoyé des colonies, & qu’ils
avoient laiffé des veftiges de leur langue dans prefque
toutes les îles Sc toutes les côtes de la Méditerranée.
Ils ont les premiers habité Pile de Délos. Leur tra-'
fie avec les Grecs introduifit chez ce peuple la corruption
Sc le luxe. Leurs colonies portèrent dans les
lieux où elles s’établirent le culte de Jupiter Ammon,
d’Ifis, Sc des déeffes-meres. Ils furent les feuls au
commencement qui euflent la liberté de trafiquer
avec l’Egypte. Dès le régné de Nécos , ils firent le
tour de l’Afrique , Sc en connurent les côtes méridionales.
Ils échangèrent fur les côtes d’Efpagne lq
1er & ïè cuivre contre de l’or Sc de l’argent qu’ils recevoient
en retour.
On peut ajouter qu’ils ont ouvert le commercé
'des îles britanniques. Quelques modernes ont voulu
faire honneur aux Grecs des commencemens de ce
commerce ; mais outre qu’il eft très-incertain que les
Grecs Payent jamais fait, Strabon dit nettement que
les Phéniciens Pont Commencé , Sc qu’ils le faifoient
feuls ; termes précis qui détruifent toutes les conjectures
des modernes en faveur des Grecs, Sc de toute
autre nation.
. Strabon nous donne le détail de ce commerce. Les
Phéniciens, dit-il, portoient auxîles britanniques de
la vaiffellé de terreI du f e l , toutes fortes d’inftru-
mens de fer ou de cuivre, Sc ils recevoient en échange
des peaux, des cuirs & de Pétain : mais il y a apparence
que ce commerce etoit plus etendu ; car le
même Strabon nous dit dans un autre endroit que ces
îles étoient fertiles en blé Sc en troupeaux ; qu’elles
avoient des mines d’or , d’argent & de fer, Sc que '
toutes ces chofes faifoient partie de leur commerce,
•auffi-bien que lès peaux, les efclavés, & les chiens
même qui étoient excellens pour la chaffe, Sc dont
•les Gaulois , quelquefois auffi les peuples de Posaient
fe fervoient à la guerre. Quoi qu’il en foit de
l’étendue de ce commerce, il eft certain que celui de
l ’étain feul étoit une fource inépuifable de richeffes
pour les Phéniciens. {Le Chevalier d e Ja u c o u r t .')
PHENICIENS, Philofophie des, ( Hifi. de la Phi-
lofop. ) voici un peuple intéreffé, turbulent, inquiet,
. qui ofe le premier s’expofer fur des planches fragiles,
traverfer les mers, vifiter les nations, lui porter fes
connoiffances Sc fes 'produirions, prendre les leurs ,
& faire de fa contrée le centre de l’univers habite.;,,
. Mais ces entreprifes hardies ne fe forment point fans
l ’invention des fciences Sc des arts. L’Aftronomie ,
la Géométrie, la Méchanique, la politique font donc
fort anciennes chez les Phéniciens.
Ces peuples ont eu des philofophes & même de
nom. Mofchusou Mochus eft de ce nombre. Il eft dit
de Sidon. Il n’a pas dépendu de Poffidonius qu’on ne
dépouillât Leucippe & Democrite de l’invention du
fyftème atomique en faveur du philofophephénicien ;
mais il y a mille autorités qui réclament contre le té-
, moignage de Poffidonius.
Après le nom de Mofchus, c’eft celui de Cadmus
qu’on rencontre dans les annales de la philofophie
phénicienne. Les Grecs le font fils du roi Agénor ;
les Phéniciens, plus croyables fur un homme de leur
nation, ne nous le donnent que comme l’intendant
de fa maifon. La Mythologie dit qu’il fe fauva de la
cour d’Agénor avec Harmonie , célébré joueufe de
flûte , qu’il aborda dans la Grece, Sc qu’il y fonda
une colonie. Nous n’examinerons pas ce qu’il peut y
. avoir de vrai Sc de feux dans cette fable. Il eft certain
qu’il eft l’inventeur de l’alphabet grec, Sc que ce fer-
vice feul exigeoit que nous en fiffions ici.quelque
mention.
Il y eut entre Cadmus Sc Sanchoniaton, d’autres
philofophes ; mais il ne nous refte rien de leurs ouvrages.
Sanchoniaton eft très-ancien. Il écrivoit avant l’ere
troienne. Il touchoit.au tems de Moïfe. Il étoit de Bi-
blos. Ce qui nous refte de fes ouvrages eft fuppofé.
.Voici fon fyfteme de cofmogonie.
L’air ténébreux , l’efprit de l’air ténébreux Sc le
chaos font les principes premiers de l’univers.
Ils étoient infinis, & ils ont exifté long-tems avant
qu’aucune limite les circonfcrivit.
Mais l’efprit aima fes principes ; le mélange fe fit ;
Jes chofes fe lièrent; l’amour naquit Sc le monde
commença.
L’efprit ne connut point fa génération.
L’efprif liant les chofes engendra mot.
Tome X II.
Mot eft , félon quelques-uns, le limoft; félon d’autres,
la putréfaftion d’une maffe aqueufe.
Voilà l’origine de tous les germes , Sc le principe
de toutes les chofes ; de-là fortirent des animaux
privés d’organes Sc de fens qui devinrent avec le
tems des êtres intelligens, contemplateurs du ciel ; ils
étoient fous la forme d’oeufs.
Après la production de mot, fuivit celle du foleil,
de la lune Sc des autres aftres.
De l’air éclairé parla mer Sc échauffé par la terre,
il réfulta les v ents, les nuées Sc les pluies.
Les eaux furent féparées par la chaleur du foleil,
Sc précipitées dans leur lieu ; ô c ily eut des éclairs Sc
du tonnerre.
A ce bruit les animaux affoupis font réveillés ; ils
fortent du limon Sc rempliffent la terre, l’air Sc la
mer , mâles Sc femelles.
Les Phéniciens font les premiers d’entre les hommes
; ils ont été produits du vent Sc de la nuit.
Voilà tout ce qui nous a été tranfmis de la philo*
fophie des Phéniciens. C ’eft bien peu de chofe. Se*
roit-ce que l’efprit de commerce eft contraire à celui
de la philofophie ? Ser©it-ce qu’un peuple qui ne
voyage que pour s’enrichir, ne fonge guere à s’inf-
truire ? Je le croirois volontiers. Que l’on comparé
les elfaims incroyables d’européens qui ont pafle de
notre monde dans celui que Colomb a découvert ,
avec ce que nous connoitfons de l’hiftoire naturelle
des contrées qu’ils ont parcourues , Sc l’on jugera»
Que demande un commerçant qui defeend de fon
vaiffeau fur un rivage inconnu, eft-ce quel dieu adorez
vous? avez-vous un rôi ? quelles font vos lois ?
Rien de cela. Mais avez-vous de l’or ? des peaux ? dit
coton ? des épices ? Il prend ces fubftances, il donne
les fiennes en échange ; Sc il recommencé cent fois la
même chofe fans daigner feulement s’informer de ce
qu’elles fon t, comment on les recueille. Il fait ce
qu’elles lui produiront à fon retour, Sc il ne fe fou*
ciepas d’en apprendre davantage. Voila le commer*
çant hollandois .Et le commerçant françois ? Il demande
encore , vos femmes font-elles jolies ?
PHENINDE, f. f. ( Sphérifiiq. des anciens. ) nom
d’un jeu chez les anciens Romains, nommé plus
communément la petite balle. Ce jeu fe jouoit avec
ime petite balle que les joueurs fe poufloient, mais
en tâchant de fe tromper , faifant femblant de vouloir
la j etter à l’u n , Sc cependant la jettant à l’autre*
Voye^ S p h ê r i s t i q u e
PHOENIX, f. m. ( Hiß. nat. fabul. ) oifeâü merveilleux
qui , félon les idées populaires, vivoit plu*
fleurs flgcles , Sc en mourant produifoit de la moelle
defes os un petit ver qui formoitun nouveaupheenix*
Les Egyptiens, dit Hérodote dans fon Euterpe ,
ont un oiieau qu’ils eftiment facré, que je n’ai jamais
vu qu’en peinture. Auffi ne le voit-on pas fouvent en
Égypte, puifque, fi l’on en croit ceux d’Héliopolis.,
il ne paroit chez eux que de cinq en cinq flecles, Sc
feulement quand fon pere eft mort. Ils difent qu’il
eft de la grandeur d’une aigle,qu’il a une belle houpe
fur la tête , les plumes de fon cou dorées, les autres
pourprées, la queue blanche mêlée de pennes incarnates
, des yeux étincellans comme des étoiles. Lorf-
que chargé d’années , il voit fa fin approcher, il fe
forme un nid de bois Sc de gommes aromatiques ,
dans lequel il meurt. De la moelle de fes os il naît un
ver d’où fe forme un autre photnix. Le premier foin
de celui-ci eft de rendre à fon pere les honneurs de
la fépulture ; Sc voici comme il s’y prend, félon lé
même Hérodote.
Il forme avec de la myrrhe une maffe en forme
d’oeuf : il eflaie enfuite en la foulevant, s’il aura affez
de force pour la'porter : après cet effai, il creufe
cette maffe , y dépofe le corps de fon ^pere , qu’il
couvre encore de myrrhe ; & quand il 1 a rendue du
F R r r ij