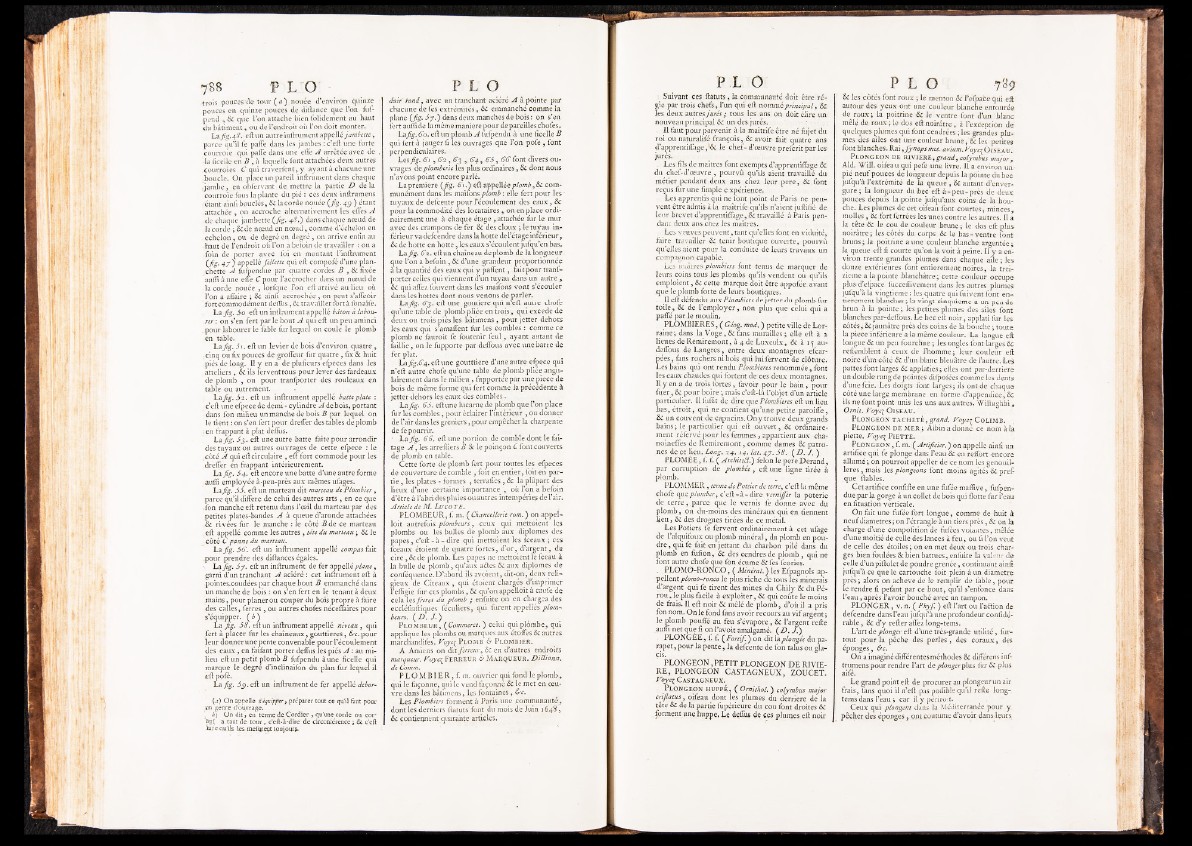
trois pouces'de tour ( a ) nouée d’environ quinze
pouces en quinze pouces de diftance que l’on ful-
pend | 8c que l’on attache bien folidement au haut
du bâtiment, ou de l’endroit oii l’on doit monter.
La fig.48. eft un autre inftrument appelle jambetu,
parce qu’il fe paffe dans les jambes : c’eft une forte
courroie qui paffe dans une effe A arrêtée avec de
-la ficelle en B , à laquelle font attachées deux autres
.courroies. C qui traverfent,y ayant à chacune une
boucle,. On place un pareil inftrument dans chaque
.jambe, en obfervant de mettre la partie D de la
courroie fous la plante du pié : ces deux inftrumens
■ étant ainfi bouclés , 8c la corde nouée (fig. 49 ) étant
.attachée , on accroche alternativement les effes A
, de chaque jambette (fig .48.) dans chaque noeud de
la corde ; 8c de noeud en noeud, comme d’échelon en
. échelon, ou de degré en degré , on arrive enfin au
■ haut de l’endroit oh l’on a beloin de travailler : on a
,foin de porter avec foi en montant l’ihftrument
(fig. 4y ) appellé fellette qui eff compofé d’une planchette
A luîpendue par quatre cordes B , 8c fixée
aufli à une efle C pour l’accrocher dans un noeud de
la corde nouée , lorfque l’on eff arrivé au lieu oîi
l’on a affaire ; 8c ainfi accrochée , on peut s’affeoir
.'fortcommodément deffus, 8c travailler fort à fonaife.
La fig. 60 eit un inftrument appellé bâton à labou-
. rer : on s’en fert par le bout A qui eft un peu aminci
. pour labourer le fable fur lequel on coule le plomb
en table.
La fig. 3 /. eft un levier de bois d’environ quatre ,
; cinq ou fix pouces de groffeur fur quatre, fix & huit
pies de long. Il y en a de plufieurs efpeces dans les
atteliers , 8c ils ferventtous pour lever des fardeaux
de plomb , ou pour tranfporter des rouleaux en
table ou autrement.
La fig. 3 a. eft un inftrument appellé batte plate :
c’eft une efpece de demi - cylindre A de bois, portant
dans fon milieu un manche de bois B par lequel on
le tient : on s’en fert pour dreffer des tables de plomb
; en frappant à plat deffus.
La fig. 3 3. eft une autre batte faite pour arrondir
des tuyaux ou autres ouvrages de cette efpece : le
.côté A qui eft circulaire , eft fort commode pour les
.dreffer en frappant intérieurement.
La fig. S 4. eft encore une batte d’une autre forme
aufïi employée à-peu-près aux mêmes ufages.
La fig. 33. eft un marteau dit marteau de Plombier,
parce qu’il différé de celui des autres arts , en ce que
.fon manche eft retenu dans l’oeil du marteau par des
petites plates-bandes A à queue d’aronde attachées
,8c rivées fur le manche : le côté B de ce marteau
eft appellé comme les autres , tête du marteau ; & le
.côté C panne du marteau.
La fig. 36'. eft un inftrument appellé compas fait
.pour prendre des diftances égales.
La fig. 5y. eft un inftrument de fer appellé plane,
garni d’un tranchant A aciéré : cet inftrument eft à
.pointes.coudées par chaque bout B emmanché dans
un manche de bois : on s’en fert en le tenant à deux
mains, pour planer ou couper du bois propre à foire
des calles, ferres , ou autres choies néceffaires pour
s’équipper. ( b )
La fig. 58. eft un inftrument appellé niveau , qui
fert à placer fur les chaîneaux, gouttières, &c. pour
leur donner une pente convenable pour l’écoulement
des eaux , en foifant porter deffus les piés A : au milieu
eft un petit plomb B fufpendu â une ficelle qui
marque le degre d’inclinaifon du plan fur lequel il
eft pofé.
La fig. 3 c). eft un inftrument de fer appellédebor-
(<*) On appelle s'équipper,.un genre d’ouvrage. préparer tout çe qu’il faut pour
\ï gh( ) aO tann dt idte, etno utre,r mc’ee fdt-eà C-doirred idere ,c qiruc’ounnfeé rceonrcdee ; o8uc cc’oerf-t iniie qu’ils les mefureot toujours*
doir rond, avec un tranchant aciéré A à pointe par
chacune de les extrémités, 8c emmanché comme la
plane (fig. 5y.) dans deux manches de bois : on s’en
fert aufli de la même maniéré pour de pareilles chofes.
Lafig. 60. eft un plomb A l'ufpendu' à une ficelle B
qui fert à jauger fi les ouvrages que l’on pofe , font
perpendiculaires.
Les fig. 6 1 , 6 2 ,6 3 , €4, 65, 6 6 font divers ou?
vrages de plomberie les plus ordinaires, 8c dont nous
n’avons point encore parlé.
La première ( fig. 61.) eft appellée plomb, 8c communément
dans les -maifons plomb : elle fert pour les •
tuyaux de defeente pour l’écoulement des eaux, 8c
pour la commodité des locataires, on en place ordinairement
une à chaque étage »attachée fur le mur
avec des crampons de fer 8c des doux ; letuVau inférieur
va defeendre dans la hotte de l’étage inférieur,
8c de hotte en hotte, les eaux s’écoulent jufqu’en bas.
La fig. 62. eft un chaîneau de plomb de la longueur
que l’on a befoin , 8c d’une grandeur proportionnée
à la quantité des eaux qui y paffent, fait pour tranfporter
celles qui viennent d’un tuyau dans un autre ,
8c qui affez fouvent dans les maifons vont s’écouler
dans les hottes dont nous venons de parler.
La fig. 63. eft une goutiere qui n’eft autre choie
qu’une table de plomb pliée entrois, qui excede de
deux ou trois piés les bâtimens , pour jetter dehors
les eaux qui s’amaffent fur les combles : comme ce
plomb ne fauroit fe foutenir fe u l, ayant autant de
faillie, on le fupporte par deffous avec une barre de
fer plat.
La fig.64. eft une goutttiere d’une autre efpece qui
n’eft autre chofe qu’une table de plomb pliée angu-
lairement dans le milieu, fupportee par une piece de
bois de même forme qui fert comme la précédente à
jetter dehors les eaux des combles,.. - ;-
La fig. 65. eft une lucarne de plomb que l’on place
fur les combles, pour éclairer l’intérieur , ou donner
de l’air dans les greniers » pour empêcher la charpenté
de fe pourrir.
• La fig. 66. eft une portion de comble, dont le faîtage
A , les arreftiers B & le poinçon C font couverts
de plomb en table.
Cette forte de plomb fert pour toutes les efpeces
de couverture de comble , foit en entier, foit en partie
, les plates - formes , terraffes , 8c la plûpart des
lieux d’une certaine importance , oii l’on a befoin
d’être à l’abri des pluies ou autres intempéries de l’air.
Article de M. LVCOTE.
PLOMBEUR, f. m. ( Chancellerie rom. ) on appel-
loit autrefois plombeurs, ceux qui mettoient lçs
plombs ou les bulles de plomb aux diplômes des
papes, c’eft - à - dire qui mettoient les fceaux ; ces
îceaux étoient de quatre fortes, d’or, d’argent, de
cire, 8c de plomb. Les papes ne mettoient le fceau à
la bulle de plomb, qu’aux a êtes 8c aux diplômes de
conféquence.D’abord ils avoient, dit-on, deux religieux
de Cîteaux, qui étoient chargés d’imprimer
l’effigie fur ces plombs, 8c qu’on appelloit à caufe de
cela les freres du plomb ; enfuite on en chargea des
eçcléfiaftiques féculiers, qui furent appellés plombeurs.
( D . J. ) P l o m b e u r , (Commerce.') celui qui plombe, qui
applique les plombs ou marques aux étoffes 8c autres
marchandifes. Voye[ Pl o m b & Pl o m b ie r .
A Amiens on dit /erreur, &Cen d’autres endroits
marqueur. Voye.£ Fe RREUR & MARQUEUR. Diclionn.
de Comm.
P L O M B IE R , f. m. ouvrier qui fond le plomb,
qui le façonne, qui le vend façonné 8c le met en. oeuvre
dans les bâtimens, les fontaines, &c.
Les Plombiers forment à Paris une .communauté,,
dont les derniers ftatuts font du mois de Juin 1648,
8c contiennent quarante articles.
; Suivant ces ftâtuts, la communauté doit être régie
par trois chefs, l’un qui eft nommé principal, 8c
les deux autres jurés ; tous les' ans on doit élire un
nouveau principal 8c un des. jurés.
. Il faut pour parvenir àlamaîtrife être né fujet du
roi ou naturalifé françois,.8c avoir foit quatre ans
d’apprentiffage ,*8c le chef- d’oeuvre preferit- par les
jurés.
. Les fils de maîtres font exempts d’apprentiffage 8c
du chef-d’oeuvre , pourvu qu’ils aient travaillé du
métier pendant deux ans chez leur pere, 8c font
reçus fur une fimple e xpérience.
Les apprentis qui ne font point de Paris ne peuvent
être admis à la maîtrife qu’ils n’aient juftifié de
leur brevet d’apprentiffage, 8c travaillé à Paris pendant
deux ans chez les maîtres.
Les veuves peuvent, tant qu’ elles font en viduité, '
faire travailler 8c tenir boutique ouverte, pourvu
qu’elles aient pour la conduite de leurs travaux un
compagnon capable.
Les maîtres plombiers font tenus de marquer de
Jeurs coins tous les plombs qu’ils vendent ou qu’ils
emploient, 8c cette marque doit être appofée. avant
que le plomb forte de leurs boutiques.
Il eft défendu aux Plombiers de jetter du plomb fur
toile, 8c de l’employer, non plus que celui qui a
paffé par le moulin.
PLOMBIERES, ( Géog. mod. ) petite ville de Lorraine;
dans la Vo ge , 8cfans murailles; elle eft à 2
lieues de Remiremont, à 4 de Luxeulx, 8c à 15 au-
deffous de Langres, entre deux montagnes efear-
pées, fans roGhers ni bois qui lui fervent de clôture.
Les bains qui ont rendu Plombières renommée, font
les eaux chaudes qui fortent de ces deux montagnes.
Il y en a de trois fortes, favoir pour le bain, pour
fuer, 8c pour boire ; mais c’eft-là l’objet d’un article
particulier. Il fuffit de dire que Plombières eft un lieu
bas, étroit , qui ne contient qu’une petite paroiffe,
8c un couvent de Capucins. On y trouve deux grands
bains; le particulier qui eft ouvert, 8c ordinairement
réfervé pour les femmes, appartient aux cha-
noineffes de Remiremont, comme daines 8c patrd-
nes de ce lieu. Long. 2 4. 14. lat. 4y. 58. (D . J . )
PLOMÉE, 1. f. ( Architecl.) félon le pere Derand,
par corruption de plombée, eft une ligne tirée à
plomb.
PLOMMER, terme de Pottier de terre, c’eft la même
chofe que plomber, c’eft - à - dire vernijfer la poterie
de terre, .parce que le vernis fe donne avec du
plomb, ou du-moins des minéraux qui en tiennent
lieu, 8c des drogues tirées de ce métal.
Les Potiers fe fervent ordinairement à cet ufoge
de l’alquifoux ou plomb minéral, du plomb en poudre
, qui fe foit en jettant du charbon pilé dans du
plomb en fufion, 8c des cendres de plomb , qui ne
font autre chofe que fon écume 8c fes feories.
. PLOMO-RONCO, ( Minéral. ) les Efpagnols appellent
plomo-ronco le plus riche de tous les minerais
d’argent qui fe tirent des mines du Chily 8c du Pérou
, le plus facile à exploiter, 8c qui coûte le moins
de frais. Il eft noir 8c mêlé de plomb, d’où il a pris
fon nom. On le fond fans avoir recours au v if argent ;
le plomb pouffé au feu s’évapore, 8c l’argent refte
aufli net que fi on l’avoit amalgamé. (D . J.)
PLONGÉE, f. f. ( Ford/.') on dit la plongée du parapet,
pour la pente, la defeente de fon talus ou gla-
cis.
PLONGEON, PETIT PLONGEON D E RIVIER
E , PLONGEON CASTAGNEUX, ZOUCET.
Foyei CASTAGNEUX.
PLONGEON HUPPE, ( Ornithol. ) colymbus major
(riflatus, oifeau dont les plumes du derrière de la
tête 8c de la partie fupérieure du cou font droites 8c
forment une huppe. Le deffus de ces plumes eft noir
8c le s c ô t é s fo n t r o u x ; l e m en ton 8c P e fp a è e q u i e ft
a u to u r des y e u x o n t u n e c o u le u r b la n c h e e n to u r é e
deA r o u x ; la p o it r in e 8c le v e n t r e fo n t d’u n b lan c
m ê lé d e r o u x ; le d o s e ft n o i r â t r e , à l’e x d e p t io n d e
q u e lq u e s p lum e s q u i fo n t c e n d r é e s ; le s g ran d e s p lu m
e s d e s a i le s o n t u n e c o u le u r b r u n e , 8c le s p e t ite s
fo n t b lan c h e s . R a i ,/ynops met. avium. Poye^ O i s e a u .
PLONGEON DE RIVIERE, grand, colymbus major y
Aid. Will. oifea u qui pefe une livre. Il a environ ua-
pié neuf pouces de longueur depuis la pointe du bec
jufqu’à l’extrémité de la queue , 8c autant d’envergure;
la longueur du bec eft à-peu-près de deux
pouces depuis la pointe jufqu’aux coins de la bouche.
Les plumes de cet.oifeaii font courtes» minces,
molles, 8c fort ferrées les unes contre les autres. Il a
la tête 8c le cou de couleur brune; le dos eft plus
noirâtre; les côtés du. corps 8c le bas-ventre font
bruns ; la poitrine a une couleur blanche argentée ;
la queue eft fi courte qu’on la voit à peine. Il y a environ
trente grandes plumes dans chaque aile ; les
douze extérieures font entièrement noires, la treizième
a la pointe blanchâtre; cette couleur occupe
plus d’efpace fueeefîivement dans les autres plumes
jufqu’à la vingtième : les quatre qui fiiivent font entièrement
blanches ; la vingt-cinquieme a un peu de
brun à la pointe ; les petites plumes des aîles font
blanches par-deflous. Le bec eft noir, applati fur les
côtés; 8c jaunâtre près des coins de la bouche ; toute
la piece inférieure a la même couleur. La langue eft
longue 8c un peu fourchue ; les ongles font larges 8c
reflèmblènt à ceux de l’homme; leur couleur eft
noire d’im'eôté 8c d’un blanc bleuâtre de l’autre. Les
pattes font larges Sc applaties ; elles ont par-derriere
un double rang de pointes difpolées comme les dents
d’une feie. Les doigts font larges; ils ont de chaque
côté une large membrane en forme d’appendice, 8c
ils ne font point unis les uns aux autres. Wiilughbi,
Omit. Foyei OlSEAU.
P l o n g e o n t a c h e t é , grand. Voye^ C o l im b .
P l o n g e o n d e m e r ; Albin a donné ce nom à la
piette. Voye^ P i e t t e .
P l o n g e o n , f. m. ( Artificier. ) on appelle ainfi un
artifice qui fe plonge dans l’eau 8c en reffort encore
allumé ; on pourroit appeller de ce nom les genouillères
, mais les plongeons font moins agités 8c prefi
que llables.
Cet artifice confifte en une fiifée maflive, fulpen-
due par la gorge à un collet de bois qui flotte fur l’eau
en fituation verticale.
On fait une fufée fort longue, comme de huit à
neuf diamètres ; on l’étrangle à un tiers près, 8c on l'a
charge d’une compofîtion de fufées volantes, mêlée
d’une moitié de celle des lances à feu, ou fi l’on veut
de celle des étoiles ; on en met deux ou trois charges
bien foulées 8t bien battues, enfuite la valeur de
celle d’un piftolet de poudre grenée, continuant ainfi
jufqu’à ce que le cartouche foit plein à un diamètre
près ; alors on achevé de le remplir de fable, pour
le rendre fi pefant par ce bout, qu’il s’enfonce dans
l’eau, après l’avoir bouché avec un tampon.
PLONGER, v . n . ( Phyfi. ) e ft l’ a r t o u l’a& io n d e
d e fe e n d r e dans l’ eau ju fq u ’ à u n e p ro fo n d e u r c o n fid é -
r a b l e , 8c d’y r e f te r a ffe z lo n g - tem s .
L’art de plonger eft d’une très-grande utilité, fur-
tout pour la pêche des perles, des coraux, des
éponges, &c.
On a imaginé différentes méthodes 8c différens inftrumens
pour rendre l’art de plonger plus fur 8c plus
aifé.
Le grand point eft de procurer au plongeurunair
frais, fans quoi il n’eft pas poflîble qu’il refte long-
tems dans l’eau ; car il y périroit.
Ceux qui plongent dans la Méditerranée pour y,
pêcher des éponges, ont coutume d’avoir dans-leurs