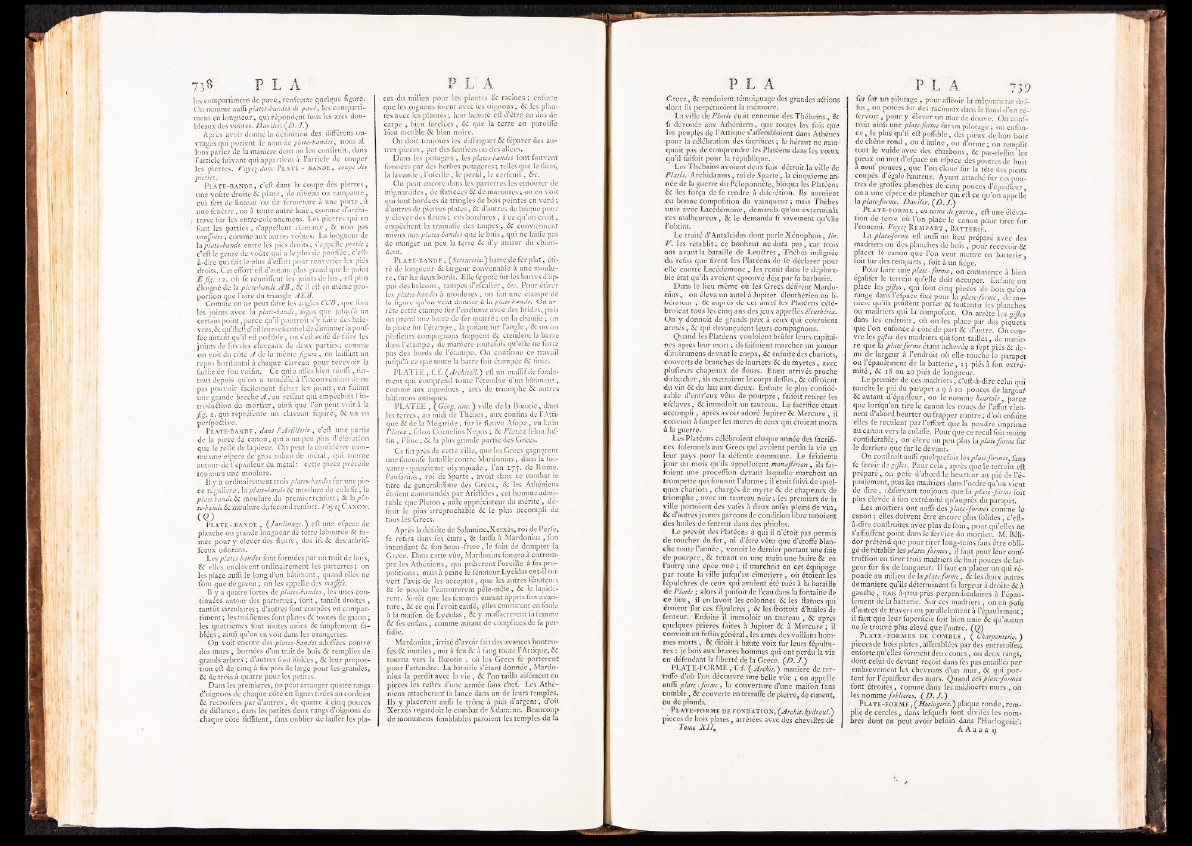
lés compartimens de pavé, renferme quelque figure.
On nomme aufliplates-bandes de pavé, les comparai-
mens en longueur, qui répondent fous les arcs doubleaux
des voûtes. Daviler fD. J.)
Après avoir donné la définition des differerts ouvrages
qui portent le nom de plate-bandes, nous al
Ions parler de la maniéré dont on les confirait, dans
l’article, fuivant qui appartient à l’article de couper
les pierres. Voye£ donc Pl a t e - bande , coupe des
Pl a t e -b a n d e , c’eft dans la coupe dés pierres,
une voûte droite 6c plane, de niveau ou rampante,
qui fert de linteau ou de fermeture à une porte, à
une fenêtre, ou à toute autre baie, comme d’archi-
( trave fur les entre-colonnemens. Les pierres qui en
font lès parties, s’appellent claveaux, & non pas
vouloirs , comme aux autres voûtes. La longueur de
la plate-bande entre les pies droits, s’appelle portée ;
c’ eftle genre de voûte qui a le plus de pouflee, c’eft-
à-dire qui fait le plus d’effort pour renv.erfer les piés
droits. Cet effort eft d’autant plus grand que le point
E fig. 22. oit fe réunifient les joints de lits, eft plus
éloigné de la plate-bande A B , 6c il eft en même proportion
que l ’aire du triangle AEB .
Comme on ne peut faire les angles CCB, que font
l'es joints avec la plate-bande, aigus que jufqu’à un
certain point, parce qu’il pourroit s’y faire des baie-
vres,& qu’il eft d’ailleurs eiîentiel de diminuer la pouf
fée autant qu’il eft poflible, on s’eftavife de faire les
joints de lits des claveaux de deux parties ; comme
on voit du côté A de la même figure , en laiflant un
repos horifontal à chaque claveau pour recevoir la
faillie de fon voifin. Ce qui a aflèz bien réufli, fur-
tout depuis qu’on a remédié à l’inconvénient de ne
pas pouvoir facilement ficher les joints, en faifant
une grande breche A , au reflaut qui empêchoit l’in-
troduftion du mortier, ainfi que l’on petit voir à la
fig. 2. qui repréfente un claveau féparé, 6c un en
perfpeaive.
- P l a t e -b a n d e , dans ü Artillerie-, c’eft une partie
de la pieçe de canon, qui a un peu plus d’élévation
que le refte de lapiece. On peut la confidérer comme
une efpece de gros ruban de .métal, qui tourne
autour de l’épaifleur dii métal : cette piece précédé
toujoursTune mou lu re."
Il y a ordinairement trois plates-bandes fur une piece
régulière; la plate-bande 6c moulure de culafîe; la
plate bande 6c moulure du premier renfort ; & la plate
bande 6c moulure du fécond renfort. Voye{ C a n o n .
(Q)
Pl a t e - b a n d e , ( Jardinage. ) eft une efpece de
planche Ou-grande longueur de terre labourée & filmée
pour y élever des fleurs, des ifs 6c des arbrif-
feaux odôrâns.
Les plates-bandes font formées par un trait de buis,
6c elles enclavent ordinairement les parterres ; on
les place aufli le long d’un bâtiment, quand elles ne
font que de gazon; on les appelle des majjifs.
Il y a quatre fortes de plutes-bandes, lés unes continuées
autour des parterres, font, tantôt droites ,
tantôt circulaires ; d’autres font coupées en compartiment
; lés troifiemes font plates & toutes de gazon ;
les quatrièmes font toutes unies 6c Amplement fa-
blées, âirifi qu’on en voit dans les orangeries.
" On Voit encore des plates-bandes adoffées contre
des murs , bornées d’un trait de buis 6c remplies de
grands arbres ; d’autres font ifolées, & leur proportion
eft de cinq à fix pies de large pour les grandes,
6c de trois à quatre pour les petites.
Dans les premières, on peut arranger quatre rangs
d’oignons de chaque côté en lignes tirées au cordeau
& recroifées par d’autres , de quatre à cinq pouces
de diftance ; dans les petites deux rangs d’oignons de
. chaque côté fuffifent, fans Oublier de laiffer les placés
du milieu pour les plantes 6c racines ; enfortc
que les oignons foiefot avec les oignons, 6c les plantes
avec les plantes ; leur beauté eft d’être en dos de
carpe , bien lardé es, 6c que la terre en paroiffe
bien meuble & bien noire.
On doit toujours les diftinguer 6c féparer des au-'
très pièces, par des fentiers ou des allées.
Dans les potagers , les plates-bandes font fouvent
formées par des herbes potagères ; telles que le rhim,
la lavande, l’ofeille , le perfil, le cerfeuil, &c.
On peut encore dans les parterres les entourer de
mignardifes, de ftaticées 6c de maroutes ; on en voit
qui font bordées de tringles de bois peintes en verd ;
d’autres de pierres plates, 6c d’autres-de brique pour
y élever des fleurs ; ces bordures , à ce qu’on croit,
empêchent la trainaflè des taupes, 6c conviennent
mieux aux plates-bandes que le buis, qui ne laifle pas
de manger un peu la terre 6c d’y attirer du chiendent.
Plate-bande , (Serrurerie.) barre de fer plat, étiré
de longueur & largeur convenable à une moulure
, fur les deux bords. Elle fe pofe fur les barres d’appui
des balcons, rampes d’efcalier, &c. Pour étirer'
les plates-bandes à moulures , on fait une étampe de
la figure qu’on veut donner à la plate-bande. On arrête
cette étampe fur l’enclume avec des brides, puis
on prend une barre de fer quarré ; on la chauffe ; on
la place fur l’étaitfpe , la pofant fur l’angle, 6c un ou
plufieurs compagnons frappent 6c étendent la barre
dans l’étampe, de maniéré toutefois qii’elle ne forte
pas des bords de l’étampe. On continue ce travail
jufqu’à ce que toute la barre foit étampée 6c finie.
PLATÉE, f. f. ( Architeci.) eft un maffif de fondement
qui comprend toute l’étendue d’un bâtiment,
comme aux aqueducs , arcs de triomphe 6c autres
bâtimens antiques.
PLATÉE , ( Géog. anc.') ville de la Bceotie, dans
les terres, au midi de Thèbes, aux confins de l’Atti-
que 6c de la Mégaride, fur le fleuve Afopè, en latin
Plateæ, félon Cornélius Nepos ; 6c Platæee félon Juf-
tin, Pline, 6c la plus grande partie des Grecs.
Ce fut près de cette ville, que les Grecs gagnèrent
,une fameufe bataille contré Mardonius, dans la foi-
xante- quinzième olympiade , l’an 275. de Rome.
Paufanias , roi de Sparte , avoit dans ce combat le
titre de généraliflime des Grecs, 6c les Athéniens
étoient commandés par Ariftides , cet homme admirable
que Platon, jufte appréciateur du mérite , définit
le plus irréprochable 6c le plus accompli de
tous les Grecs.
Après la défaite de Salamine,Xerxès, roi de Perfe,
fe retira dans fes états , & laifla à Mardonius , fon
intendant 6c fon beau-frere , le foin de dompter la
Grece. Dans cette vûe, Mardonius fongea à corrompre
les Athéniens-, qui prêtèrent l’oreille à fes pro-
pofitions ; mais à peine le fénateur Lycidas eut-il ouvert
l’avis de les accepter, que les autres fénateurs
6c le peuple l’entourerent pêle-mêle-, 6c le lapidèrent.
Si-tôt que les femmes eurent appris fon avan-
ture, 6c ce qui l’avoit caufé, elles coururent en foule
à la maifon de L ycidas, 6c y mafiacrerent fa femme
6c fes enfans, comme autant de complices de fa perfidie.
Mardonius, irrité d’avoir fait des avances-honteu-
fes 6c inutiles, mit à feu 6c à fang toute i’Attique, 6c
tourna vers la Boeotie , oii les Grecs fe portèrent
pour l’attendre. La bataille s’étant donnée, Mardonius
la perdit avec la v ie , 6c l’on tailla aifémerit en
pièces les reftes d’une armée fans chef. Les Athéniens
attachèrent fa lance dans un de leurs temples.
Ils y placèrent aufli le trône à piés d’argent, d’oii
Xerxès regardoit le combat de Salamine. Beaucoup
de monumens femblables paroient les temples de la
•Grece, 6c rendoient,témoignage des grandes aérions
■ dont ils perpétuoient la mémoire.
La ville de Platée étoit ennemie des Thébains, 6c
-fi dévouée aux Athéniens, que toutes les fois que
les peuples de l’Attique s’aflèmbloient dans Athènes
pour la célébration des facrifices; le héraut ne man-
•quoit pas de comprendre les Platéens dans les voeux
qu’il faifoit pour la république.
• Les Thébains avoient deux fois détruit la Ville de
Platée* 1 Àrchidamus, roi de Sparte, la cinquième année
de la guerre du Péloponnèfe, bloqua les Platéens
6c «les força de fe rendre à diferétion. Ils auroient
eu bonne compofition du vainqueur ; mais Thèbes
unie avec Lacédémone, demanda qu’on exterminât
res malheureux, & le demanda fi vivement qu’elle
i ’obtint.
Le traité d’Antalcidas dont parle Xénophon, liv.
V. les rétablit ; ce bonheur ne dura pas, car trois
■ ans avant la bataille de Leu êtres, Thèbes indignée
'du refus que firent les Platéens de fe déclarer pour
«lie contre Lacédémone , les remit dans le déplorable
état qu’ils avoient éprouvé déjà par fa barbarie.
Dans le lieu même oû les Grecs défirent Mardo-
àiius, on éleva un autel à Jupiter éleuthérien ou libérateur
, 6c auprès de cet autel les Platéens célé-
broient tous les cinq ans des jeux appellés éleuthéria.
-On y donnoit de grands prix à ceux qui couroient
armés, 6c qui devançoient leurs compagnons.
Quand les Platéens vouloient brûler leurs capitaines
après leur mort ; ils faifoient marcher un joueur
d’inftrumens devant le corps, & enfuite des chariots,
•couverts de branches de lauriers 6c de myrtes, avec
plufieurs chapeaux de fleurs. Etant arrivés proche
du bûcher, ils mettoient le corps defliis, 6c offroient
du vin 6c du lait aux dieux. Enfuite le plus cortfidé-
rable d’entr’eUX vêtu de pourpre, faifoit retirer les
efclaves, 6c immoloit un taureau. Le facrifîce étant
accompli, après avoir adoré Jupiter 6c Mercure, il
Convioit à fouper les meres de ceux qui étoient morts
■ à la guerre.
Les Platééns célébroient chaque année des facrifi-
ces folemnels aux Grecs qui avoient perdu la vie en
leur pays polir la défenfe eômriiune. Le feiziemè
jour du mois qu’ils appelloitnt itionafiérioh, ils fàr-
ioient une proceflion devant laquelle marchoit un
trompette qui fonnoit l’alarme ; il étoit fuivi de quelques
chariots, chargés de myrte 6c de chameaux de
triomphe, avec un taureau noir ; les premiers de la
Ville portoient des vafes à deux anfes pleins de v in ,
Sc d’àutrés jëiinés garçons de-condition libre tenoient
des huiles de fenteur dans dès phioles.
Le prévôt des Platéens à qui il n’étoit paspermis
de toucher du f e r , ni d’être vêtu que d’etoffe blanche
toute l’année, venoit le dernier portant uhe fâïè
•de pourpre, 6c tenant en Une main une buire & eti
l ’autre uhe épëé nue- ; il marchoit en cet équipage
par toute la ville jufqu’àù cimetiere, oii étoiènt les
fépulchres de ceux qui avoient été tués à la bataille
de Platée ^ alors il puifoit de l’eau dans la fontaine dé
c e lieu , il en-iavoit les Colonnes & lés ftatuesqui
•étoient fur ces fépulçres j 6c les frottoit d’huilëS' de
fenteur. Enfuite il imriiqloit un taureau , &• après
quelques-prières faites «V Jupiter 6c à Mercure ; il
convioit aù feftin général, les âmes des vaillattS hommes
morts., & difoit à haiite voix fur leurs féptiltir-
res t je bois-aux'bravés hohïiheS qui ont pefdüla viè -
en défendant la liberté de là Grece. (D. /.)
PLATE,-FORME , f. fr '( Arckh. ) maniéré de ter- ’
ÿaffe d’qûToh dëcoiivre une belle vûe ; on appelle '
aufli plate * forme, .la couverture d’une maifon Tans
comble, 6c couverte en terraffe de pierre, de cimen t, :
bu de plomb;
* | P l ate-forme de fondation, (Anhit;hydtaul.)
pièces de bois plates, arrêtées avec des chevilles de
Point X I I ,
fer fùf- un pilotage , poiir afleoïr la maçonnerie def-
Uts -, on potées fur des radinaux dans le tond d’uA réservoir
, pour y élever un mur de douve. On tonf-
trmt tànii rme plaKiforme fur un pilotage.{ 6n enfonce
plus qu’il eft poflible, des pieu* de bon bois
de chene rond , ou d aulne, ou d’orme ; on remplit
tout le vuideavec des charbons, 6c par-deflus les
pieux on met d’efpace en efpace des poutres de huit
à neuf pouces, que l’on cloue fur la tête des pieux
coupés d’égale hauteür. Ayant attaché fur ces pou*
très de grofles planches de cinq pouces d’épaifleur,
on a une efpece de plancher qui eft ce qu’on appelle
la plate-forme. Daviler. (D . ƒ.)
P l a t e -f o r m e , en terme de guerre, e f t u h e é lé v a -
t io n d e t e r r e o u l ’o n p la c e le c a n o n p o u r t ir e r fu r
l ’ en n em i. Foye^ R e m p a r t , B a t t e r i e .
La plate-forme eft aufli un lieu préparé avec des
madriers ou des planches de bois , pour recevoir 6c
placer le canon que l’on veut mettre en batterie >
foit fur des remparts, foit à un flége.
( Pour faire une plate- forme, on commence à bieh
egalifer le terrein qu’elle doit ôccuper. Enfuite on
place les gifles, qui font cinq piecés dé .bois qu’on
range dans 1 efpace fixe pour la plate-forme, dé maniéré
qu’ils piuffènt porter & foùtentir les planches
ou madriers qui la compofent. On arrête les gifles
dans les endroits , où on les place par des piquets
que l’on enfonce à côté de part 6c d’autre. On couvre
les gifles des madriers qui font taillés, de maniéré
que la plateforme étant achevée a fept piés 6c demi
de largeur à l’endroit où elle touche le parapet
ou l’épaulement de la batterie, 13 piés à fon extrémité
, 6c 18 ou zo piés de longueur.
Le premiêr de ces madriers, c’eft-à-dire celui qui
touche le pié du parapet a cj à 10 pouces dé largeùf
6c autant d epaiffeur, on le nomme heurtoir, parce
que lorfiju’on tire le canon les roues de l’affût viennent
d’abord heurter ou frapper contre ; d’où enfuite
elles fe reculent par l’effort que la poudre imprime
au canon vers la culaffe. Pour que ce recul foit moins
confidérable, on éleve un peu plus la plateforme fur
le derrière que fur le devant. -- ' "
On confirait aufli quelquefois les plate fdnnes\ fans
fe fervir de gifles. Pour cela, après que.le terrein eft
préparé, on pofe d’abord le heurtoir au pié de l ’épaulement,
puis les madriers dans l’ordre qu’on vient
de dire , obfervant toujours que la plate forme f o i't
plus élevée à fon extrémité qu’âuprès du parapet.
Les mortiers ont aufli des plate -formes comme îô
Canon ; elles doivent être encore plus folidés, c’èft-
à-dire conftruites avec plus dé'foin, pouf qu’elles ne
s’affaiffent point dans le feryiee du mortier. M. Béli-
dor prétend que pour tirer long-tems fans être obligé
d? rétablir les plates formes, il faut pour leur conf-
truélioh eh tirer trois madriers de huit p:diicês dé largeur
fur fix de longueur. Il faut en placer un qui réponde
au milieu de la plate fornïe, 6c lès deux autres
de maniéré qu’ils déterminënt fà lafgëur à droite 6c à
pau^iëy tous à-peu-près perpendiculaires à Tépaù-
femèrit de la batterie. Sur ces madriers , ôri eh pofe
d’autres dé travers ou pàràllelemérit à rèpaulement’;
i l faiFt qùe. lèur fuperfici'e foit bien unie & qu’aucun
ne. fe trouvé plus élevé que l’autre.1 (Q)
TLAîrE-TaRMES DÊ COMBLE, ( Charpenterie.)
pièces de bois plates , vâ'fFémbléës par des entretoifes;
enforte qii’ëlles forment deux eours, ou deux rangs,
d<3ht celui de devant reçoit dans fes pas entailles pa_r
embrevement leS cheVrÔhs d’un mur, & qui portent
furfl’ép'âiffeur des müfs. Quand cês plaie-formés
font étroites, COmm'é dans' lésmédioçfes mursT, on
les nomme fablieres. ^ D-. J. )
P l a t e - f o r m e , ( ÈorlogerU.7 plaque ronde, remplie
de cercles, dans lëfqüëls font divifés les nombres
dont oïl peut avôir béfôin dans THotflogeïfë'î
A A a a a ij