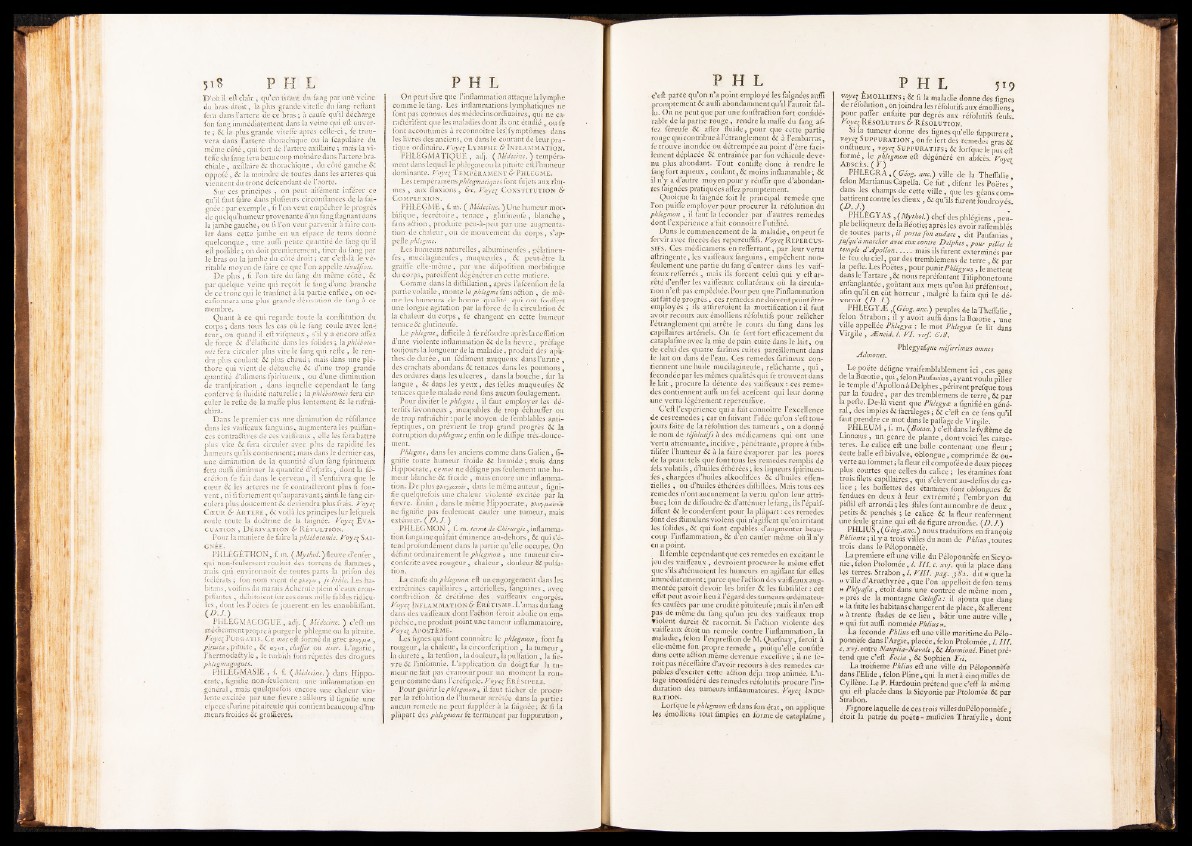
5iS P H L D ’où il eft clair , qu’en tirant du fang par unè veine
du bras droit, la plus grande vîteffe du fang reliant
fera dans l’artere de ce bras ; à caufe qu’il décharge
l'on fang immédiatement dans la veine qui eft ouverte
; 6c la plus grande vîtefle après cëlle-ci, fe trouvera
dans l’artere thorachique ou la fcapulaire du
même cô té, qui fort de l’artere axillaire ; mais la vî-
teffe du fang fera beaucoup moindre dans l’artere brachiale
, axillaire 6c thorachique, du côté gauche 6c
oppofé, 6c la moindre de toutes.dans les arteres qui
viennent du tronc defcendant de l’aorte.
Sur ces principes , on peut aifément inférer ce
qu’il faut faire dans plufieurs circonftances.de la fai-
gnée : par exemple, fi l’on veut empêcher le progrès
de quelqu’humeur provenante d’un fang ftagnant clans
la jambe gauche, ou li l’on veut parvenir à faire couler
dans cette jambe en un efpace de tems donné
quelconque , une aufti petite quantité de fang qu’il
eft poflible ; on doit premièrement, tirer du fang par
le bras ou la jambe du côté droit ; car c’eft-là le véritable
moyen de faire ce que l’on appelle révuljion.
De plus , fi l’on tire du fang,du même côté, &
par quelque veine qui reçoit le fang cl’une branche
de ce tronc qui le tranfmet à la partie enflée, on oc-
cafionnera une plus grande dérivation de fang à ce
membre.
Quant à ce qui regarde toute la conftitution du
corps ; dans tous les cas où le fang coule avec lenq
leur, ou quand il eft vifqueux, s’il y a encore aflez
de force & d’élafticité dans les folides ; la phlébotomie
fera circuler plus vite le fang qui refte , le rendra
plus coulant 6c plus chaud ; mais dans une pléthore
qui vient de débauche 6c d’une trop grande
quantité d’alimens fpiritueux , ou d’une diminution
de tranfpiration , dans laquelle cependant le fang
conferve fa fluidité naturelle ; la phlébotomie fera circuler
le refte de la maffe plus lentement 6c le rafraîchira.
Dans le premier cas une diminution de réftftance
dans les vaiffeaux fanguins,.augmentera les puifian-
ces contra&ives de ces vaiffeaux , elle les fera battre
plus vite 6c fera circuler avec plus de rapidité les
humeurs qu’ils contiennent; mais dans le dernier cas,
une diminution de la quantité d’un fang fpiritueux
fera aufti diminuer la quantité d’efprits, dont la fé-
crétion fe fait dans le cerveau, il s’enfuivra que le
coeur 6c les arteres ne fe contracteront plus u fou-
vent , ni fi fortement qu’auparavant ; ainfi le fang circulera
plus doucement 6c deviendra plus frais. Foyer
C oeur & Artere , 6c voilà les principes lur lefquels
roule toute la doctrine de la feignée. Foye^ Év a cuation
, D érivation & Révult io n.
Pour la maniéré de faire la phlébotomie. Foye[ SAIGNÉE,
PHLÉGÉTHON, f. m. ( Mytkol. ) fleuve d’enfer,
qui non-feulement rouloit des torrens de flammes ,
mais qui.environnoit de toutes parts la prifon des
fcélérats ; fon nom vient de tpteyu , je brûle. Les ha-
bitans, vôifins du marais Achérufe plein d’eaux crou-
pifîantes , débitaient fur ces eaux mille fables ridicules
, dont les Poètes fe jouèrent en les ennobliffant.
CD .J .)
PHLEGMAGOGUE, adj. ( Médecine. ) c’eft un
médicament propre à purger le phlegme ou la pituite.
Foye^ Purgatif. Ce mot eft forme du grec ipMy/xa ,
pituita, pituite , 6c ctyav, chajfer ou tirer. L ’agaric,
l’hermodaclyle, le turbith font réputés des drogues
phlegmagogues.
PHLEGMASIE , f. f. {M édecine.') dans Hippo-
. crate, lignifie non-feulement une inflammation en
général, mais quelquefois encore une chaleur violente
excitée par une fievre; ailleurs il fignifïe une
efpece d’urine pituiteufe qui contient beaucoup d’humeurs
froides 6c grofïieres.
P H L
On peut dire que l’inflammation attaque la lymphe
comme le fang. Les inflammations lymphatiques ne
font pas connues des médecins’ordinaires, qui ne ca-
ra&érifent que les maladies dont ils ont étudié , ou le
font accoutumés à reconnoitre les] fymptômes dans
les livres des anciens, ou dans le courant de leur pratique
ordinaire. Foyei Lymphe & Inflammation.
PHLEGMATIQUE , adj. ( Médecine. ) tempérament
dans lequel le phlegme ou la pituite eftl’humeur
dominante. Foye{ T empérament & Phlegme.
Les tempéramensphlegmatiques font fujets aux rhumes
, aux fluxions, &c. Foye{ C onstitution &
Complexion.
PHLEGME, f. m. ( Médecine. ) Une humeur morbifique
, fecrétoire, tenace , glutineufe, blanche ,
fans a&ion, produite peu-à-peu par une augmentation
de chaleur, ou de mouvement du corps, s’appelle/
»/t/s»/««!.
Les humeurs naturelles, albumineufes , gélatineu-
fe s , mucilagineufes, muqueufes , 6c peut-être la
graille elle-même, par une difpofition morbifique
du corps, paroiflent dégénérer en cette matière.
Comme dans la diftillation, après l’afcenfton de la
partie volatile, monte le phlegme fans a&ion , de même
les humeurs de bonne qualité qui ont fouffert
une longue agitation par la force de la circulation &
la chaleur du corps, le changent en cette humeur
tenace 6c glutineufe.
Le phlegme, difficile à fe réfoudre après la cefîatipn
d’une violente inflammation & de la fievre, préfage
toujours la longueur de la maladie, produit des aph-
thes de durée, un fédiment muqueux dansl’urmeS
des crachats abondans 6c tenaces dans les poumons,
des ordures dans les ulcérés , dans la bouche, fur la
langue , 6c dans les y e u x , des felles muqueufes 6c
tenaces que le malade rend fans aucun foulagement.
Pour divifer le phlegme , il faut employer les dé-
terfifs favonneux , incapables de trop échauffer ou
de trop rafraîchir : par le moyen de femblables anti-
feptiques, on prévient le trop grand progrès 6c la
corruption du phlegme; enfin on le diflïpe très-doucement.
Phlegme, dans les anciens comme dans Galien, lignifie
toute humeur froide & hiimide ; mais dans
Hippocrate, ce mot ne défignepas feulement une humeur
blanche 6c froide , mais encore une inflammation.
De plus tpte'y/j.a.dv, dans le même auteur, lignifie
quelquefois une chaleur violente excitée par la
fievre. Enfin , dans le même Hippocrate, <pMyp.a'm7v
ne lignifie pas feulement caufer une tumeur, mais
exténuer. (D .J . )
PHLEGMON , f. m. terme de Chirurgie, inflammation
fanguine qui fait éminence au-dehors, 6c qui s’étend
profondément dans la partie qu’elle occupe. On
définit ordinairement le phlegmon , une tumeur cir-
confcrite avec rougeur, chaleur , douleur 6c pulfa-
tion.
La caufe du phlegmon eft un engorgement dans les
extrémités capillaires , artérielles, languines , avec
conftriftion 6c érétifme des vaiffeaux engorgés.
Foyei Inflammation & Érétisme. L ’amas du fang
dans des vaiffeaux dont l’a&ion feroit abolie ou empêchée,
ne produit point une tumeur inflammatoire.
Foyei A posté me.
Les fignes qui font connoître le phlegmon, font la
rougeur, la chaleur, la cirçonfcription , la tumeur ,
la dureté , la tenfion, la douleur, la pulfation , la fievre
6c l’infomnie. L’application du doigt fur la tumeur
ne fait pas évanouir pour un moment la rougeur
comme dans l’éréfipele. Voyt{ Érésipele.
Pour guérir le phlegmon, il faut tâcher de procurer
la rélolution de l’humeur arrêtée dans la partie :
aucun remede ne peut fuppléer à la faignée; & fi la
plupart des phlegmons fe terminent par liippuration,
P H L
c ’eft parce qu’on n’a point employé les faignées auflï
promptement 6c aufti abondamment qu’il l’auroit fallu.
On ne peut que par une fouftra&ion fort confidé-
rable de la partie rouge, rendre la maife du fang af-
fez féreufe 6c allez fluide, pour que cette partie
rouge qui contribue à l’étranglement & à l’embarras,
fe trouve inondée ou détrempée au point d’être facilement
déplacée 6c entraînée par fon véhicule devenu
plus abondant. Tout confifte donc à rendre le
fang fort aqueux, coulant, 6c moins inflammable ; 6c
il n’y a d’autre moyen pour y réufîir que d’abondantes
faignées pratiquées aflez promptement.
Quoique la faignée foit le principal remede que
l’on puiffe employer pour procurer la réfolution du
phlegmon , il faut la féconder par d’autres remèdes
dont l’expérience a fait connoître l’utilité.
Dans le commencement de la maladie, on peut fe
ferviravec fuccèsdes repercufîifs. Foye^ R e p e r c u s -
s i f s . Ces médicamens en refferrant, par leur vertu
aftringente, les vaiffeaux fanguins, empêchent non-
feulement une partie du fang d’entrer dans les vaiffeaux
reflèrrés , mais ils forcent celui qui y eft arrêté
d’enfler les vaiffeaux collatéraux oii la circulation
n’eft pas empêchée. Pour peu que l’inflammation
ait fait de progrès, ces remedes ne doivent point être
employés ; ils attireroient la mortification : il faut
avoir recours aux émolliens réfolutifs pour relâcher
l’étranglement qui arrête le cours du fang dans les
capillaires artériels. On fe fert fort efficacement du
cataplafme avec la mie de pain cuite dans le lait, ou
de celui des quatre fermes cuites pareillement dans
le lait ou dans de l’eau. Ces remedes farineux contiennent
une huile mucilagineufe, relâchante , q u i,
fécondée par les mêmes qualités qui fe trouvent dans
le lait, procure la détente des vaiffeaux : ces remedes
contiennent aufti un fel acefcent qui leur donne
une vertu légèrement repereuffive.
C ’eft l’expérience qui a fait connoître l’excellence
de ces remedes ; car enfuivant l’idée qu’on s’eft toujours
faite de la réfolution des tumeurs , on a donné
le nom de réfolutifs à des médicamens qui ont une
vertu atténuante, incifive, pénétrante, propre à fub-
îilifer l’humeur 6c à la faire évaporer par les pores
de la peau : tels que font tous les remedes remplis de
fels volatils, d’huiles éthérées ; les liqueurs fpiritueu-
fe s , chargées d’huiles alkoolifées 6c d’huiles effen-
îielles , ou d’huiles éthérées diftillées. Mais tous ces
remedes n’ont aucunement la vertu qu’on leur attribue
; loin de diffoudre 6c d’atténuer le fang, ils l’épaif-
fiffent 6c le condenfent pour la plupart : ces remedes
font des ftimulans violens qui n’agifient qu’en irritant
les folides, 6c qui font capables d’augmenter beaucoup
l’inflammation, & d’en caufer même où il n’y
en a point.
Il femble cependant que ces remedes en excitant le
jeu des vaiffeaux , devroient procurer le même effet
que s’ils afténuoient les humeurs en agiffant fur elles
immédiatement ; parce que l’a&ion des vaiffeaux augmentée
paroît devoir les brifer 6c les fubtilifer : cet
effet peut avoir lieu à l’égard des tumeurs oedémateu-
fes caufées par une crudité pituiteufe; mais il n’en eft
pas de même du fang qu’un jeu des vaiffeaux trop
violent durcit 6c racornit. Si l’aûion violente des
vaiffeaux étoit un remede contre l’inflammation, la
maladie, félon l’expreflion de M. Q uefnay, feroit à
elle-meme fon propre remede , puifqu’elle confifte
dans cette aâiqn même devenue exceffive ; il ne feroit
pas néceflàire d’avoir recours à des remedes capables
d’exciter çette a&ion déjà trop animée. L’u-
fage inconfidéré des remedes réfolutifs procure l’induration
des tumeurs inflammatoires. Foye[ In d u r
a t i o n .
Lorfque \ephlegmon eft dans fon état, on applique
les émolliens tout Amples en forme de çataplafme,
P H L 519
voy e{.É molliens ; & fi la maladie donne des fignes
de réfolution, on joindra les réfolutifs aux émolliens,
pour paffer enfuite par degrés aux réfolutifs feuls.
F 9ye{ R ésolutifs & R ésolution.
Si la tumeur donne des fignes qu’elle fuppurera
voye[ Suppuration , on fe fert des remedes gras 6c
on&ueux, voye^ Su ppu rat ifs; 6c lorfque le pus eft
forme, le phlegmon eft dégénéré en ahfeès. Foyer
A bscés. ( T ) J x
PHLEGRA, ( Geog. anc.) ville de la Theflalie,
félon Martianus Capella. Ce fut , difent les Poètes
dans les champs de cette ville , que les géans com-
M tiM tcom re les dieux, 6c qu’ils furent foudroyés.
PHLÉGYAS , (.Mythol.) chef des phlégiens, peuple
belliqueux delà Béotie; après les avoir raffemblés
de toutes parts, il porta fon audace , dit Paufanias
jufqu'à marcher avec eux contre Delphes, pour piller le
temple d'Apollon........mais ils furent exterminés par
le feu du ciel, par des tremblemens de terre , 6c par
la pefte. Les Poètes, pour punir Phlégyas, le mettent
dans leTartare ,& nous repréfentent Tifiphone toute
enfanglantee, goûtant aux mets qu’on lui préfentoit,
afin qu’il en eût horreur , maigre la faim qui le dé-
voroit. (Z). J.)
PHLEGYÆ fGéog. anc.) peuples de la Theflalie
félon Strabon ; il y avoit aufti dans la Boeotie , une
ville appellée Phlegya : le mot Phlegyce fe lit dans
Virgile , Æneid. I. FI. verf. Ci 8.
Admonet,
Phlegyaf^ac miferrimus ornnes
Le poète défigne vraifemblablement i c i , ces *ens
de la Boeotie, qui, félon Paufanias, ayant Voulu piller
le temple d’Apollon àDelphes, périrent prefque tous
par la foudre, par des tremblemens de terre, 6c par
la pefte. De-là vient que Phlegyce a fignifié en général
, des impies 6c facrileges ; 6c c’eft en ce fens qu’il
faut prendre ce mot dans le paflage de Virgile.
IPHLEUM , f. m, (Botani) c’eft dans le lyftème de
Linnæus , un genre.de plante, dont voici les caractères.
Le calice eft une balle contenant une fleur ;
cette balle eft bivalve, oblongue, comprimée 6c ouverte
au fommet ; la fleur eft compofée de deux pièces
plus courtes que celles du calice ; les étamines font
trois filets capillaires , qui s’élèvent au-defliis du calice
; les boflèttes des étamines font oblongues 6c
fendues en deux à leur extrémité ; l’embryon du
piftil eft arrondi ; les ftiles font au nombre de deux ,
petits & penches ; le calice 6c la fleur renferment
une feule graine qui eft de figure arrondie. (D.J .)
PHLIUS, (Géog.anc.) nous traduifons en ffançois
Phlionte ; il y a trois villes du nom de Phlius, toutes
trois dans le Péloponnèfe.
La première eft une ville du Péloponnèfe enSicyo-
nie, félon Ptolomee, l . III. c. xvj. qui la place dans
les terres. Strabon , /. FIII. pag. j 8z. dit « que la
» ville d’Aroethyrée , que l’on appelloit de fon tems
» Phlyajia, étoit dans une contrée de même nom,
» près de la montagne Cctlojfa il ajouta que dans
» la fuite les habitans changèrent de place, 6c allèrent
» à trente ftades de ce lieu , bâtir une autre v ille ,
» qui fut auffi nommée Phlius».
La fécondé Phlius eft une ville maritime du Péloponnèfe
dans l’Argie, placée, félon Ptolomée, /. I II.
c, xvj. entre Nauplia-Navale, 6c Hormioné. Pinet prétend
que c’eft Focia , 6c Sophien Yri.
La troifieme Phlius eft une ville du Péloponnèfe
dans i’Elide , félon Pline, qui la met à cinq milles de
Cyllène. Le P. Hardouin prétend que c’eft la même
qui eft placée dans la Sicyonie par Ptolomée 6c par
Strabon.
J’ignore laquelle de ces trois villesduPéloponnèfe ,
étoit la patrie du poète - muficien Thrafylle, dont