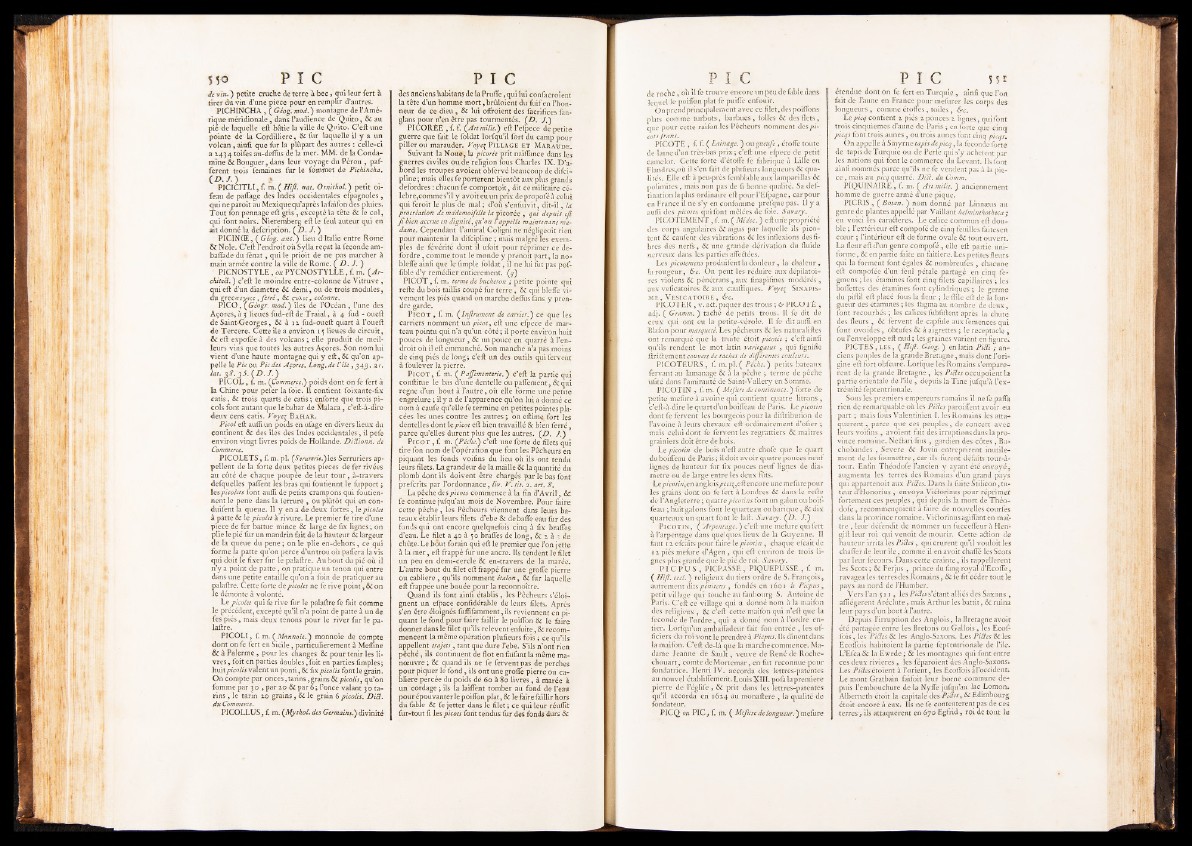
Je vin.') petite cruche de terre à bec , qui leur fert à
tirer du vin d’une piece pour en remplir d’autres.
PICHINCHA , ( Géog. mod. ) montagne de l’Amérique
méridionale , dans l’audience de Quito, 8c au
pie de laquelle eft bâtie la v ille de Quito. C’eft une
pointe de la Cordilliere, 8c fur laquelle il y a un
volcan., ainfi que fur la plupart des autres : celle-ci
a 2434 toifes au-deffus de la mer. MM. de la Conda-
mine 8c Bouguer, dans leur voyage du Pérou , paf-
ferent trois femaines fur le fommet de Pichincha.
W Ê ÈM è . . . .
PICICITLI, f. m. ( Hiß. nat. OrnithoL ) petit 01-
feau de palfage des Indes occidentales efpagnoles ,
qui ne paraît au Mexique qu’après lafaifon des pluies.
Tout Ion pennage eft gris, excepté la tête 8c le col,
qui font noirs. Nieremberg eft le feul auteur qui en
ait donné la defcription. ( D . J. )
PICINCE, ( Géog. anc. ) lieu dltalie entre Rome
& Noie. C’eft l’endroit où Sylla reçut la fécondé am-
baflade du fénat, qui le prioit de ne pas marcher à
main armée contre la ville de Rome. ( D . J . )
PICNOSTYLE, ou PYCNOSTYLLE, f. m. {Ar-
chitecl. ) c’eft le moindre entre-colonne de Vitruve ,
ui eft d’un diamètre 8c demi, ou de trois modules,
u grecmxvoç , ferré , 8c çv\oç, colonne.
P ICO , ( Géogr. mod.) îles de l’Océan , l’une des
Açores, à 3 lieues fud-eft de Traial, à 4 fud - oueft
de Saint-Georges, & à 12 fud-oueft quart à l’oueft
de Tercere. Cette île a environ 15 lieues de circuit,
ôc eft expofée à des volcans ; elle produit de meilleurs
vins que toutes les autres Açores. Son nom lui
vient d’une haute montagne qui y eft, 8c qu’on appelle
le Pie ou Pic des Açores. Long, de Vile , 14a. 21.
L . S S .^ .< D . J . )
P ICO L , f. m. {Commerce.) poids dont on fe fert à
la Chine pour pefer la foie. Il contient foixante-fix
catis, 8c trois quarts de catis ; enforte que trois pi-
cols font autant que le bahar de Malaca, c’eft-à-dire
deux cens catis. Voye\ Bahar.
Picol eft aufliun poids en ufage en divers lieux du
continent 8c des îles des Indes occidentales, il pefe
environ vingt livres poids de Hollande. Diclionn. de
Commerce.
PICOLETS, f. m. pl. {Serurerie.)les Serruriers appellent
de la forte deux petites pièces de fer rivées
au côté de chaque poupée de leur tou r, à-travers
defquelles paffent les bras qui foutiennt le fupport ;
1 espicolets font aufli de petits crampons qui foutien-
nent le pene dans la ferrure , ou plutôt qui en con-
duifent la queue. Il y en a de deux fortes, le picolet
à patte 8c le picolet à rivure. Le premier fe tire d’une
piece de fer battue mince 8c large de fix lignes; on
plie lepié fur un mandrin fait de la hauteur 8c largeur
de la queue du pene ; on le plie en-dehors , ce qui
forme la patte qu’on perce d’untrou où paffera la vis
qui doit le fixer fur le palaftre. Au bout du pié où il
n’y a point de patte, o;i pratique un tenon qui entre
dans une petite entaille qu’on a foin de pratiquer au
palaftre. Cette forte de picolet ne fe rive point, & on
le démonte à volonté.
Le picolet qui fe rive fur le palaftre fe fait comme
le précédent, excepté qu’il n’a point de patte à un de
fes p iés, mais deux tenons pour le river fur le palaftre.
PICOLI, f. m. ( Monnoie. ) monnoie de compte
dont on fe fert en Sicile, particulièrement à Meffine
& à Palerme , pour les changes 8c pour tenir les livres
, foit en parties doubles, foit en parties fimples;
huitpicolis valent un ponti, 8c fixpicolis font le grain.
On compte par onces, tarins, grains 8c picolis, qu’on
fomme par 30 , par 20 8c par 6; l’once valant 30 tarins
, le tarin 20 grains, 8c le grain 6 picolis. Dicl.
du Commerce.
PICOLLUS, f. m. (Mythol. des Germains.) divinité
des anciens habitans de la Pruffe, qui lui confacroient
la tête d’un homme mort, brûloient du fuif en l’honneur
de ce dieu, 8c lui offraient des facrifices fan-
glans pour n’en être pas tourmentés. {D. J.)
PICORÉE , f . f. {Art milité) eftl’efpece de petite
guerre que fait le foldat lorfqu’il fort du camp pour
piller ou marauder. Voye{ Pillage et Maraude.
Suivant la Noue, la picorée prit naiffance dans les
guerres civiles ou de religion fous Charles IX. D ’abord
les troupes avoient obfervé beaucoup de difci-
pline; mais elles fe portèrent bientôt aux plus grands
defordres : chacun fe comportoit, dit ce militaire célébré,
comme s’il y avoiteuun prix de propofé à celui
qui ferait le plus de mal ; d’où s’enfuivit, dit-il, la.
procréation de mademoifelle la picorée , qui depuis ejl
J i bien accrue en dignité, qu'on üappelle maintenant madame.
Cependant l’amiral Coligni ne négligeoit rien
pour maintenir la difcipline ; mais malgré les exemples
de févérité dont il ufoit pour réprimer ce de-
fordre, comme tout le monde y prenoit part, la no-
bleffe ainfi que le fimple foldat, il ne lui fut pas pof-
fible d’y remédier entièrement, {q)
PICO T , f. m. terme de bûcheron ,* petite pointe qui
refte du bois taillis coupé fur terre, 8c qui bleffe vivement
les piés quand on marche defliis fans y prendre
garde.
Pic o t , f. m. {Injlrument de carrier.) ce que les
carriers nomment un picot, eft une efpece de marteau
pointu qui n’a qu’un côté ; il porte environ huit
pouces de longueur, 8c un police en quarré à l’endroit
où il eft emmanché. Son manche n’a pas moins
de cinq piés de long; c’eft un des outils qui fervent
à foulever la pierre.
PiCOT, f. m. ( Paffementerie. ) c’eft la partie qui
conftitue le bas d’une dentelle ou paffement, 8c qui
régné d’un bout à l’autre, où elle forme une petite
engrelure ; il y a de l’apparence qu’on lui a donné ce
nom à caufe qu’elle fe termine en petites pointes placées
les unes contre les autres ; on eftimq fort les
dentelles dont le picot eft bien travaillé & bien ferré ,
parce qu’elles durent plus que les autres. {D . J.)
Pic o t , f. m . {Pêche.) c’eft une forte de filets qui
tire fon nom de l’opération que font les Pêcheurs en
piquant les fonds voifins du lieu où ils ont tendu
leurs filets. La grandeur de la maille 8c la quantité du
plomb dont ils doivent être chargés par le bas font
prefcrits par l’ordonnance, liv. V. tit. 2. art. 8.
Lapêchedespicots commence à là fin d’Avril , &
fe continue jufqu’au mois de Novembre. Pour faire
cette pêche, les Pêcheurs viennent dans leurs bateaux
établir leurs filets d’ebe 8c de baffe eau fur des
fonds qui ont encore quelquefois cinq à fix braffes
d’eau. Le filet a 40 à 50 braffes de long, 8c 2 à } de
chute. Le bout forain qui eft le premier que l’on jette
à la mer, eft frappé fur une ancre. Ils tendent le filet
un peu en demi-cercle 8c en-travers de la marée.
L’autre bout du filet eft frappé fur une groffe pierre
ou cabliere , qu’ils nomment étalon, 8c fur laquelle
eft frappée une bouée pour la reconnoître.
Quand ils font ainfi établis , les Pêcheurs s’éloignent
un efpace confidérable de leurs filets. Après
s’en être éloignés fuffifamment, ils reviennent en piquant
le fond pour faire faillir le poiffon 8c le faire
donner dans le filet qu’ils relevent enfuite, 8c recommencent
la même opération plufieurs fois ; ce qu’ils
appellent trajets , tant que dure l’ebe. S’ils n’ont rien
pêché, ils continuent de flot en faifant la même manoeuvre
; 8c quand ils ne fe fervent pas de perches
pour piquer le fond, ils ont une groffe pierre ou cabliere
percée du poids dé 60 à 80 livres , à marée à
un cordage ; ils la laiffent tomber au fond de l’eau
pour épouvanter le poiffon plat, 8c le faire faillir hors
du. fable 8c fe jetter dans le filet ; ce qui leur réuflit
fur-tout fi les picots font tendus fur des fonds durs 8c
dè roche, où il fe trouve encore un peu de fable dans
lequel le poiffon plat fe puiffe enfouir.
On prend principalement avec ce filet, des poiffons
plats comme turbots, barbues , folles 8c des flets,
que pour cetteraifon les Pêcheurs nomment des pH
cots frans.
PICOTÉ , fi f. ( Lainage•. ) ou gueüfe , étoffe toute
de laine d’un très-bas prix ; c ’eft une efpece de petit’
camelot. Cette forte d’ étoffe fe fabrique à Lille en
Flandres,où il s’en fait de plufieurs longueurs 8c qualités.
Elle eft à peu-près femblableaux lamparillas 8c
polimites, mais non pas de fi bonne qualité. Sa def-
tinationla plus ordinaire eft pourl’Efpagne, car pour
en France il ne s’y en confomme prefque pas. Il y a
suffi des picotes qui font mêlées de foie. Savary.
PICOTEMENT, f. m. ( Médec. ) eft un’e propriété
des corps angulaires 8C aigus par laquelle ils picotent
8c caufent des vibrations 8c les inflexions des fibres
des nerfs, 8c une grande dérivation du fluide
nerveux dans les parties affeftées.
Les picotemens produifent la douleur , la chaleur,
la rougeur, &c. On peut les réduire aux dépilatoires
violens 8c pénétrans , aux finapifmes modérés ,
aux veficatoires 8c aux cauftiques. Voyeç S in a p is m
e , V é s i c a t o i r e , &c.
PICO TER, v. aft. piquer des trous ; & PICOTÉ ,
adj. ( Gramm. ) tache de petits trous. Il fe dit de
ceux qui ont eu la petite-vérole. Il fe dit aufli en
Blafon pour marqueté. Les pêcheurs 8c les naturaliftes
ont remarqué que la truite étoit picotée ; c’eft ainfi
qu’ils rendent le mot latin variegatus , qui fignifîe
ftrifrement couvert de taches de différentes couleurs.
PICOTEURS , f. m. pl. ( Pêche. ) petits bateaux
fervant au lamanage & a la pêche ; terme de pêche
ufité dans l’amirauté de Saint-Vallery en Somme.
PICOTIN , f. m. ( Mefure de continence. ) forte de
petite mefure à avoine qui contient quatre litrons ,
c’eft-à-dire le quart d’un boiffeau de Paris. Le picotin
dont fe fervent les bourgeois pour la diftribution de
l’avoine à leurs chevaux eft ordinairement d’ofier ;
mais celui dont fe fervent les regrattiers 8c maîtres
grainiers doit être de bois.
Le picotin de bois n’eft autre chofe que le quart
du boiffeau de Paris ; il doit avoir quatre pouces neuf
lignes de hauteur fur fix pouces neuf lignes de diamètre
ou de large entre les deux fûts.
Le picotin,en anglois/>£cq;, eft encore unemefurepour
les grains dont on fe fert à Londres 8c dans le refte
de l’Angleterre ; quatre picotins font un galon ou boiffeau
; huit galons font le quarteau oubarique, 8c dix
quarteaiix un quart font le laft. Savary. {D. J.)
Pic o t in , ( Arpentage. ) c’eft une mefiire qui fert
à l’àrpentage dans quelques lieux de la Guyenne. Il
faut 12 efcaits pour faire le picotin , chaque efcait de
12 piés mefure d’Agen, qui èft environ de trois lignes
plus grande que le pié de roi. Savary.
P I C P U S , PICPASSE , PIQUEPUSSE , f. m.
( Hiff. eccl. ) religieux du tiers ordre de S. François,
autrement dits penitens , fondés en 1601 à Picpus,
petit village qui touche au faubourg S. Antoine de
Paris. C’eft ce village qui a donné nom à la maifon
dès religieux, & c’eft cette maifon qui n’eft que la
fécondé de l’ordre , qui a donné nom à l’ordre entier.
Lorfqu’un ambaffadeur fait fon entrée , les officiers
du roi vont le prendre à Picpus. Ils dînent dans
la maifon. C ’eft de-là que la marche commence. Madame
Jeanne de Sault, veuve de René de Roche-
chouart, comte deMortemar, en frit reconnue pour
fondatrice. Henri IV. accorda des lettres-patentes
au nouvel établiffemerit. Louis XIII. pofa la première
pierre de l’églife, & prit dans les lettres-patentes
qu’il accorda en 1624 au monaftere , la qualité de
fondateur.
PICQ ou PIC , f, m, ( Mefure de longueur. ) mefure
êtendué dont on fe fert en Turquie , ainfi que l’on
fait de l’aune en France pour mefurer les corps des
longueurs , comme étoffes , toiles &c.
Lepicq contient 2 piés 2 pouces 2 lignes, qui font
trois cinquièmes d’aune de Paris ; en forte que cinq
picqs font trois aunes, ou trois aunes font cinq picqs.
On appelle à Smyrne tapis depicq, la fécondé forte
de tapis de Turquie ou de Perfe qui s’y achètent par
les nations qui font le commerce du Levant. Ils (ont
ainfi nommes parce qu’ils ne fe vendent pas à la pièce
, mais au picq quarré. Dicl. du Comm.
BIQUINAIRE , f. m. ( Art miHt. ) anciennement
homme de guerre armé d’une pique.
PICRIS, ( Botan. ) nom donné par Linnæus au
genre de plantes appellé par Vaillant helminthotheca ;
en voici les carafteres. Le calice commun eft double
; l’ extérieur èft compofé de cinq feuilles faites en
coeur ; l’intérieur eft de forme ovale & tout ouvert.
La fleur eft d’un genre compofé , elle eft partie uniforme,
& en partie faite en faitiere. Les petites fleurs
qui la forment font égales & nombreufes , chacune
eft compofée d’un feul pétale partagé en cinq fe-
gmens ; les étamines font cinq filets capillaires ; les
boffettes des étamines font cylindriques ; le germe
du piftil eft placé fous la fleur ; le ftile eft de la longueur
des étamines ; les ftigma au nombre de deux,
font recourbés ; les calices fubfiftent après la chute
des fleurs , & fervent de capfule aux femences qui
font ovoïdes, obtufes & à aigrettes ; le réceptacle >
ou l’enveloppe eft nud ; les graines varient en figure*
PICTES , les , ( Hiß. Géog. ) en latin Picli ; anciens
peuples de la grande Bretagne, mais dont l’origine
eft fort obfcure. Lorfque lès Romains s’emparèrent
de la grande Bretagne , les Picles occupoient la
partie orientale de Pile , depuis la Tirie jufqu’à l’extrémité
feptentrionale.
Sous les premiers empereurs romains il ne fe paffa
rien de remarquable où les Picles paroiffent avoir eu
part ; mais fous Valentinien I. les Romains les attaquèrent
, parce que ces peuples, de concert avec
leurs voifins , avoient fait des irruptions dans la province
romaine. Neélaiidius , gardien des côtes , Bu.*
chobandes , Severe & Jovin entreprirent inutilement
de les fôume'ttre, car ils furent défaits tour-à-*
tour. Enfin Théodofe l’ancien y ayant été envoyé,
augmenta les terres des Romains d’un grand pays
qui appartenoit aux Picles. Dans la fuite Stilicon, tuteur
d’Honorius , envoya Viélorinus pour réprimer
fortement ces peuples, qui depuis la mort de Théodofe
, recommençaient à faire de nouvelles courfes
dans la province romaine. Vièiorinus agiffant en maître
, leur défendit de nommer un fucceffeur à Hen-
gift leur roi qui venoit de mourir. Cette aftion de
hauteur irrita les Picles , qui crurent qu’il vouloit les
chaffer de leur île , comme il en avoit chaffé les Scots
par leur fecours. Dans cette crainte, ils rappellerent
les Scots ; & Ferjus , prince du fang royal d’Ecoffe,
ravagea les terres des Romains, & fe fit céder tout le
pays au nord de l’Humber.
Vers l’an 511 , les Picles s’étant alliés des Saxons ,
aflïégerent Aréclute, mais Arthur les battit, &: ruina
leur pays d’un bout à l’autre.
Depuis l’irruption des Anglois ,_la Bretagne avoit
été partagée entre les Bretons ou Gallois, les Ecofr
fois, les Picles & les Anglo-Saxons. Les Picles 8c les
Ecoffois habitoient la partie feptentrionale de l’île.
L’Efca 8c la Ewede.; & les montagnes qui font entre
ces deux rivières , les féparoient des Anglo-Saxonsi
Les Picles étoient à l’orient, les Ecoffois à l’occident»
Le mont Gratbain faifoit leur borne commune depuis
l’embouchure de la Nyffe jufqu’au lac Lomon.
Alberneth étoit la capitale des Picles, 6c Edimbourg
étoit encoré à eux. Ils ne fe contentèrent pas de ces
terres , ils attaquèrent en 670 Egfrid, rqi de tout le