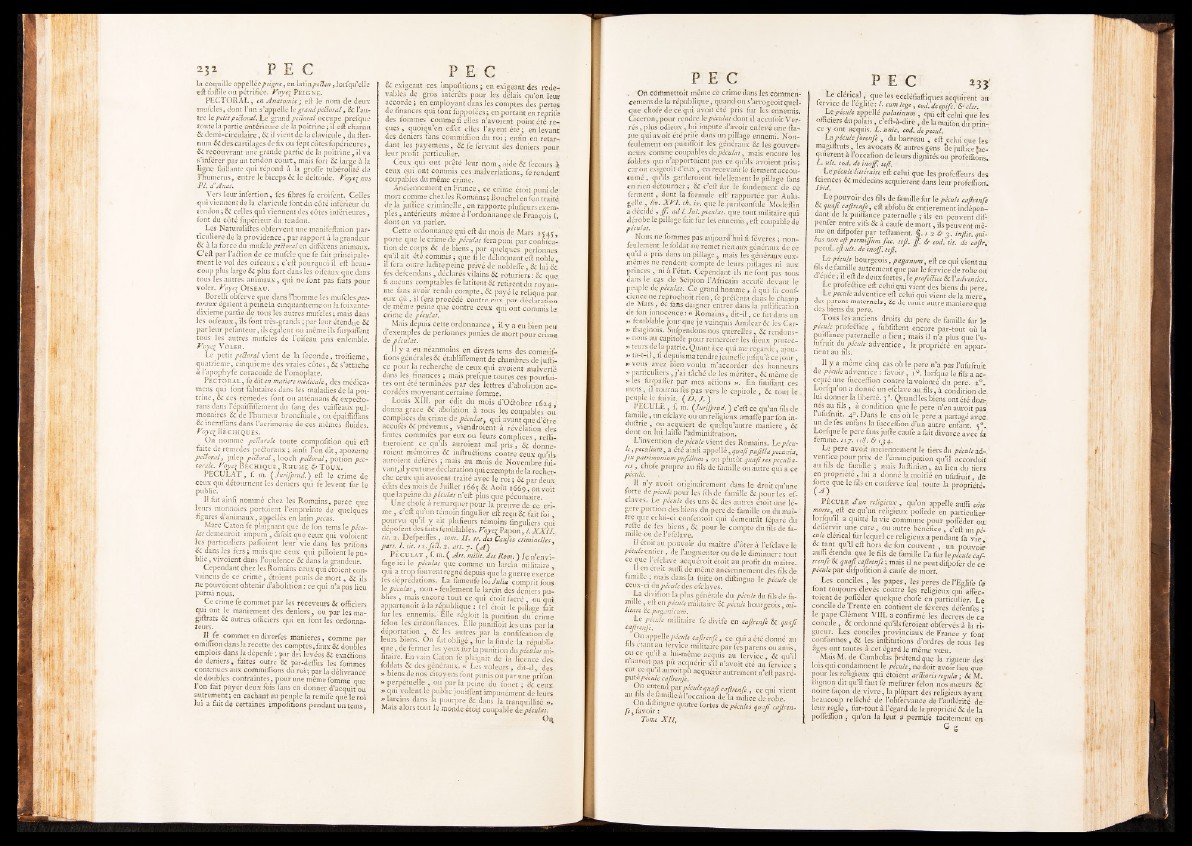
la coquille appellée peigne, en latinptclen, lorfqu’ elle
eft foflîle ou pétrifiée. Foye[ Peigne.
PECTORAL , en Anatomie ; eft le nom de deux
mufcles, dont l’un s’appelle 1 e grand pectoral, 8c l’autre
le petit pectoral. L e grand peBoral occupe prefque
toute la partie antérieure de la poitrine ; il eft charnu
& demi-circulaire, & il vient de la clavicule, du fter-
num 8c des cartilages de fix ou fept côtes fupérieures,
& recouvrant une grande partie de la poitrine, il va
s’inférer par un tendon court, mais fort 8c large à la
ligne faillante qui répond à la groffe tubérofité de
l’humems, entre le biceps 8c le deltoïde. Foyer no$
PI. d'Anat.
Vers leur infertion, fes fibres fe croifent. Celles
qui viennent de la clavicule font du côté inférieur du
tendon ; 8c celles qui viennent des côtes inférieures,
font du côté fupérieur du tendon.
Les Naturaliftes obfervent une inanifeftation particulière
de la providence, par rapport à la grandeur
& à la force du mufcle peBoral en différens animaux.
C ’eft par l’aûion de ce mufcle que fe fait principalement
le vol des oifeaux ; c’eft pourquoi il eft beaucoup
plus large 8c plus fort dans les oifeaux que dans
tous les autres animaux, qui ne font pas faits pour
voler. Foyei OlSEAU.
Borelli obferve que dans l’homme les mufcles pectoraux
égalent à peine la cinquantième ou la foixante-
dixieme partie de tous les autres mufcles ; mais dans
les oifeaux, ils font très-grands ; par leur étendue 8c
par leur pefanteur, ils égalent ou même ils furpaffent
tous les autres mufcles de l’oifeau pris enfemble.
Foyei V oler.
Le petit peBoral vient de la fécondé, troifieme, 1
quatrième, cinquième des vraies côtes, 8c s’attache i à l’apophyfe coracoïde de l’omoplate.
Pe c to r al , fe dit en matière médicale, des médica- :
mens qui font falutaires dans les maladies de la poitrine,
8c ces remedes font ou atténuans & expe&o-
rans dans l’épaiftiflement du fang des vaiffeaux pulmonaires
8c de l’humeur bronchiale, ou épaifliflans
& incraflans dans l’acrimonie de ces mêmes fluides.
V o y e { Béchiques.
On nomme peBorale toute compofition qui eft
faite de remedes peôoraux ; ainfi l’on dit, apozeme
jreBoral, julep peBoral, looch peBoral, potion pectorale.
Foyei Béchiquf., R hume & T o u x .
PÉCULA T , f. m. ( Jurifprud.) eft le crime de
ceux qui détournent les deniers qui fe lèvent fur le
public.
Il Ait ainfi nommé chez les Romains, parce quç
leurs monnoies portoient l’empreinte de quelques
figures d’animaux, appellés en latin pecus.
Marc Caton fe plaignant que de fon tems le pécu-
lat demeuroit impuni, difoit que ceux qui voloient
les particuliers pafioient leur vie dans les prifons
& dans les fers ; mais que ceux qui pilloient le public
, vivoient dans l’opulence & dans la grandeur.
Cependant chez les Romains ceux qui étoient convaincus
de ce crime, étoient punis de mort, & ils
ne pquvoient obtenir d’abolition : ce qui n’a pas lieu
parmi nous.
Ce crime fe commet par les receveurs & officiers
qui ont le maniement des deniers, ou par les ma-
giftrats & autres officiers qui en font les ordonnateurs.
Il fe commet en diverfes maniérés, comme par
©miflîon dans la recette des comptes, faux & doubles
emplois dans la dépenfe ; par des levées & exaftions
de deniers, faites outre & par-deffus les fommes
contenues aux commiflions du roi; par la délivrance
dédoublés contraintes, pour une même fomme que
l’on fait payer deux fois fans en donner d’acquit ou
autrement ; en cachant au peuple la remife qué le roi
lui a fait de certaines impofitions pendant un tems,
Sz exigeant ces. impofitions ; en exigeant des rede-*
vables de gros intérêts pour les délais qu’on leur
accorde ; en employant dans les comptes des pertes
de finances qui font fuppofées ; en portant en reprife
des fommes comme fi elles n’avoient point été reçues
, quoiqu’en effet elles Payent été ; en levant
des deniers fans commifiion du roi ; enfin en retar-
dant les payemens, 8c fe fervant des deniers pour
leur profit particulier.
Ceux qui ont prêté leur nom, aide &: fecours à
ceux qui ont commis c es malversations, fe rendent
coupables du même crime.
Anciennement en France, ce crime étoit, puni de
mort comme chez les Romains ; Bouchel en fon traité
de la juftice criminelle, en rapporte plufieurs exemples
, antérieurs même à l’ordonnance de François I.
dont on va parler.
Cette ordonnance qui eft du mois de Mars 1 J45,
porte que le crime de péculat fera puni par confil'ca--
tion de corps & de biens, par quelques perfonnes
qu’il ait été commis ; que fi le délinquant eft noble,
il fera outre ladite peine privé de nobleffe, 8c lui 8c
fes defeendans, déclarés vilains & roturiers : & que
fi aucuns comptables fe latitent 8c retirent du royaume
fans avoir rendu compte, 8c payé le reliqua par
eux d u , il fera procédé contre eux par déclaration
de même peine que contre ceux qui ont commis le
crime de péculat.
. Mais depuis cette ordonnance, il y a eu bien peu
d’exemples de perfonnes.punfa de mort pour crusse
de péculat.
Il y a eu néanmoins en divers tems des commil-
lions générales & ctabütïément de chambres, de julii-
c,e pour la recherche de ceux qui àyoient malverfé
dans f a finances ; mais prefque toutes ces pourfui-
tes ont été terminées par dés, lettres d'abolition accordées
rnoyenant certaine fomme.
Louis XIII. par cciit du mois d'Octobre 1624 ’
donna grace &, abolition à tous les coupables ou
complices du crime de péculat, qui avant que d’être1
accufes & prévenus, viendroient à révélation des
fautes commifes par eux ou leurs complices, refti-
tueroient^ ce.qu’ils auroient mal pris . & ' donner
soient mémoires & irJiracKons contre ceux qu’iis
auroient déférés ; mais au mois de N o ren ÿ re '& i.
vant.il y eut une dëclaration qui exempta de là recher-'
che ceux qui avoient traité avec le roi ; & par deux
édits des mois de Juillet 1665 & Août 1669, on voit"
que la peine d\\ péculat n’eft plus que pécuniaire..
Une chofèfï remarquer pour la preuve de ce cri-,
m e , c’ell qu’un témoin fingulier eft reçu & fait .foi
pourvu qu’il y ait plufieurs témoins fmguliers qui
dépofent des fats femblables. Voye{ Papon, l. X X I I .
titez. Defpeiffes, .mm.. II. tr. des Caufes criminelles^
part. I. tit. iz.Jcéï.z. art.-/. (.4)
i ’t c v i . vT , f. m. ( j4rt. milit. des Rom. J Je îi’èiivi-
. fage ici le péculat que comme un larcin militaire
qui a trop fouvent régné depuis que la guerre exerce
les déprédations. La fameufeloi/u&.cpmpritfous
le péculat,. n ÿ i - feulement lelarcin des deniers,
blics , mais .encore tout ce qui étoit facré, ou qui
appartenoit à la république : tel étoit le pillage sut
fiirles ennemis.^ Elle regloit la punition du crime,
félon les ciljeonftances. Elle puniffoit les uns parla
déportation , & f a autres par la confifeation de
leurs biens. On fiit obligé , fur la fin de la républi»
que, de fermer les yeux furla punition du péculat mi-’
htaire. En vain .Caton fe plaignit de la licence des,
Mdats & des généraux. « Les voleurs , dit-il, des
: » biens de nq|, Citoyens font punis ou par une p’rifon
>• perpétuelle , ou par la peine du fouet ; & ceux
» qui volent le public jouiffent impunément de leurs
»larcms clans la pourpre dans ,1a tranquillité, ».
Mai$ alors tout lç monde étoit coupable de péculat.
P E C
, Oh côihmettoit même cè crinie dans les cômmeii-
remens de la république, quand on s’arrogeoitquelque
chofe de ce qui avoit été pris; fur les- ennemis.
Çiceron,pour rendre le péculat dont il accufoit Ver-
rés , plus odieux, lui impute d’avoir enlevé une fta-
îue qui avoit étéprife dans un pillage ennemi. Non- i
feulement on puniffoit les généraux & lgs gouverneurs
comme coupables de péculat, mais encore les
foldats qui n’apportoient pas ce.qiifils1 avoient pris ;
caron exigeoit d’eux, en recevant le ferment accoutumé
, qu’ils garderoient fidellement le pillage fans
en rien détourner ; & c’eft fur le fondement de eè
ferment, dont la formule eflf rapportée par Aulu-
geile » tiv. X F I. ch. iv. que le jürifconfule Modeftin
a décidé , ff. ad l. Jul. péculat. que tout militaire qui
dérobe le pillage fait fur les ennemis, eft coupable dé
péculat. ’ ■
Nous ne fommes pas aujourd’hui fi féveres ; non-
feulement le foldat ne remet rien aux généraux de ce-
qu’il a pris dans un pillage, mais les généraux eux-
mêmes ne rendent compte de leurs pillages ni aux
princes , ni à l’état. Cependant ils ne font pas tous
dans le Cjis de Scipion l’Africain accufé devant le
peuple de péculat. Ce grand homme, à qui fa eonf-
çience ne reprochoit rien, fe préfénta dans le champ
de Mars, & farts daigner entrer dans la juftification
de fon innocence,: « Romains, dit-il, ce Ait dans un
» femblable jour que je vainquis Amilcar 8c les Car-
»> thaginois. Sufpendons nos querelles, & rendons-
>» nous au capitole pour remercier les dieux protec-
» teui-s de la patrie. Quant àce qui me regarde, ajou-
» ta-t-il, fi depuis ma tendre jeuneffe jufqu’à ce jou r,
»> vous avez! bien voulu m’accorder des honneurs
» particuliers , j’ai tâché de les mériter, & même dé
» les ffurpaffer par mes aérions ». En Aniffant oes
mots, il tourna fes pas vers le capitole , & tout le ,
peuple le fuivit. (D . J. )
PÉCULE , f. m. (Jurifprud. ) c’eft ce qu’un fils de
famille, un efclave ou un religieux amaffe par fon in-
duftne , ou acquiert de qiielqu’autre maniéré , &
dont on lui laiffe l’adminiitration;
L’invention de pécule vient des Romains. Le pécule
,ptculium,z été ainfi appellé,quafipufillapecunia,
feu patrimoniumpujillum , ou plutôt quajî res peculia-
ris , chofe propre au fils de famille ou autre qui a ce
pécule. ^ ,
11 n’y avoit originairement dans le droit qu’une
forte de pécule pour les fils de famille & pour les ef-
claves. Le pécule des uns 8c des autres etoit une légère
portion des biens du pere de famille ou du maî-
tr n^Ue n ï|H H con^ento^ cllli demeurât féparé dû
refte de fes biens, 8c pour le compte du fils de famille
ou de l’efclave.
Il etoit au pouvoir du maître d’ôter à l’efclave le
pécule entier, de l’augmenter ou de le diminuer : tout
ce que l’efclave acquéroit étoit au profit du maître.
Il en etoit aufli de même anciennement des fils de
famille ; mais dans la fuite on diftingua le pécule de’
ceux-ci du pécule des efclaves.
La divifion la plus générale du pécule du fils de famille
, eft en pécule militaire 8c pécule bourgeois, mi-
htare 8cpaganicum.
. Le pécule militaire fe divife en caflrenle & quafi
çajtrenfe. J J
On appelle pécule çajtrenfe, ce qui a été donné au
nls étant au fervice militaire par fes parens ou amis,
ou ce qu il a lui-même acquis au fervice, & qu’il
n auroit pas pu acquérir s’il n’avoit été au fervice ;
car ce q u il auroitpu acquérir autrement n’eft pas ré-
put e pécule çajtrenfe. r
1 arPecuée^naji çajtrenfe , ce qui vient
au fiis de fanul[e à 1 occafion de la milice de robe.
fe H H qU3tre f0rtCS de Meutes quafi cajtren-
Tome X l f
P E C 235
Le clérical, que les eccléfiaftïques acquirent au
1er vice de 1 églife: L. cum lege, çod. deepifc.&'cUr. "
Le pécule appellé palatinum , qüi eft celui que les
officiers du palais, c’eft-à-dirè , de lamaifon du prince
y ont acquis. L. unie. cod. de pecul.
Lzpécule forenfe , du barreau , eft celui’ que les
magiftrats, les avocats 8c autres gens Se juftice {acquièrent
à l’occafion de leurs dignités ou profitons.
L. ult. cod. de inoffi tefi. -
L e pécule'littéraire eft celui que les profeffeurs des
fciences & médecins acquièrent dans leur pïofefîiorf.'
Ibid. r
Le pouvoir 'des fils de fanillë fur ie-jricuU càfirmfe
1 <tuaJj caf i repfe , eft abfolu & entièrement indépendant
de lapuiffance paternelle ; ils en peuvent dif-
penfer entre vifs & à caufe de mort, ils peuvent même
en difpofer par teftament. §. 1 2 & 3 . inflii. qui-'
bus non eft permiffum fac. tejl. f . & cod. tit. de catirJ
pecul .eft ult. de inojf. tejl. ■
ni fil WM bourgeois § P*g«num, eft ce qui vient âu
nls de.famili.e autrement que par le fervice de robe ou
d epee ; il eft de deux fortes , 1e profeBice 8c Y adventice.
Le profeérice eft celui qui vient des biens du pere.
Le pécule adventice eft celui qui vient de la mere ,
des parens maternels, 8c de toute autre maniéré que
des biens du pere. ■ ^
Tous les-anciens droife dtl^pere dë famille fur le
pecrtU jinrectice , fubfillent .ehcofé par-tout oii l;t
ptiiffance paternelle' a lieu ; mais il n’a plus que l’u-
fufruit du pécule adventice , la ^propriété .en 'appar-
tient au fils.- 1 . r . : r i '
I Iy fj. h>ême cinq 'ci%ohle pere n’à.pas l’ufufruit '
de pécule adventice : favoîrp®«. lSfque le'fils a ac-’
; 'cçpteijne fucceffiofl, Gonttç layolante dulper&vliy.
Lorfqû’6a^.dpJiné un efclaveïau, fils, à eSodition d e
lui donner la liberté. 3°. Quand fabieps. ont été don.-
nes fa fils jga ,fanclitiô:n'que lêjpére rn’en àuroït pW
l’ufufriût. 4». Dans le cas oii !•„• pere a parlaeé avec
un de fes enfàns la fuccelfiop d’un aiitre enfant. M
Lorfque le pérefans jviftë catifè afilit.divbrce avec fa
femme. / ty. 1181 & 13 4.
Le pere avoit anciennement le tiers du pécule ad-.'
ventice pour prix de l’émancipation qu’il accordoit
. au fi's de famille ; mais Juftinien, au lieu du tiers
en propriété, lui a donné la moitié en ufufruit, de
forte que le fils en conferve feul toute la propriété.
PÉCULE d'un religieux, qu’on appelle aufli côte
morte, eü. ce qu’un religieux poffede en particulier
lorfqu’il a quitté la vie commune pour pofféder 011'
deffervir une cûre, ou autre bénéfice , c’eft un pécule
clérical fur lequel ce religieux a pendant fa vie -
8c tant qu’il eft hors de fon couvent , un pouvoir
aufli étendu que le fils de famille l’a fur le pécule caf-
trenfe 8c quajî çajtrenfe ; mais il ne peut difpofer de ce
pécule par difpofition à caufe de mort.
Les conciles , les papes , les peres d e l’Eglife fè
font toujours elevés contre les religieux qui affec-
toient de pofféder quelque chofe en particulier. Le
concile de Trente en contient de féveres défenfes *
le pape Clément VIII. a confirmé les decrets de ce
concile , 8c ordonné qu’ils feroient obfervés à la rigueur.
Les conciles provinciaux de France ÿ font
conformes, & les inftitutions d’ordres de tous les
âges ont toutes à cet égard le même voeu.
MaisM. de Cambolas prétend que la rigueur des
lois qui condamnent le.pécule, ne doit avoir lieu que:
pour les religieux qui étoient arBioris régules ; & M.
Bignon dit qu’il faut fe mefurer félon nos moeurs 8c
notre façon de vivre, la plupart des religieux ayant
beaucoup relâché de l’obfervance de l’auftérité d é:
leur règle, fur-tout à l’égard de la propriété 8c de la.
poffeflîon, qu’on la leur a permife tacitement en'
G