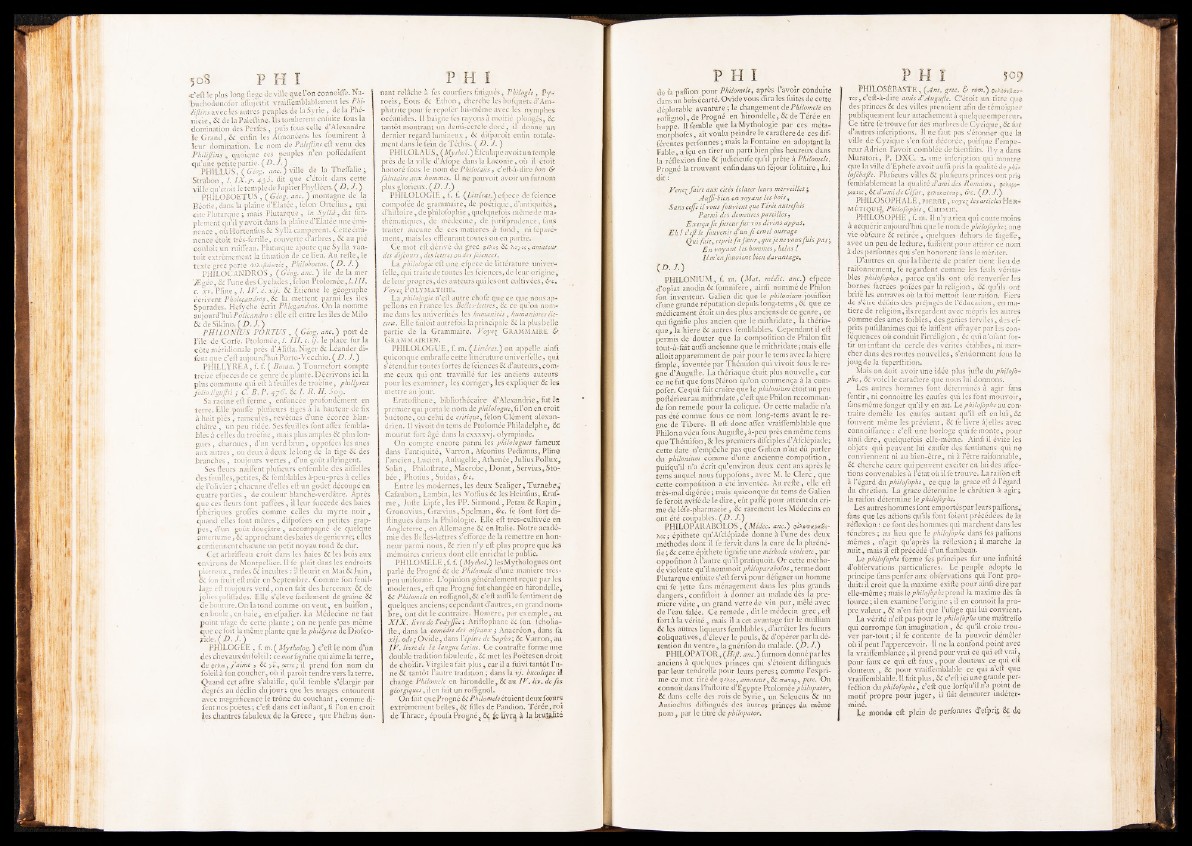
.c’ eft le plus long fiege de ville que l’on connoiffe. Nabuchodonofor
affujettit vraiffemblablement les Phi-
Mftinsxvec les autres peuples de la Syrie, de la Phénic
ie, & de la Paleftine. Ils tombèrent enfuite fous la
domination des Perfes , puis fous celle d’Alexandre
le Grand l 8c enfin lés Afmonéens les fournirent à
leur domination. Le nom de Paleftine eft venu des
Philiflins, quoique ces peuples n en poffedaflent
qu’une petite partie. (D . J. )
PHILLUS, ( Géog. anc. ) ville de la Theffalie ;
Strabon, L IX. p. 43S. dit que c,’étoit dans cette
ville qu’étoit le temple de Jupiter Phylléen. ( D . J . )
PH1LOBOETUS , ( Géog. anc A montagne de la
Béotie, dans la plaine d’Elatée, félon Ortelius , qui
cite Plutarque ; mais Plutarque, in Sylld , dit Simplement
qu il y avoit dans la plaine d’Elatee une emi-
nence, oùHortenfius&: Sylla campèrent. Cette éminence
étoit très-fertile, couverte d’arbres, 8c au pié
conloit un ruilfeau. Plutarque ajoute que Sylla van-
toit extrêmement la fituation de ce lieu. Au relie, le
texte grec porte <I>/àc/3oiW gV , Philobouos. (D . J .)
PHILOCANDROS , ( Géog. anc. ) île de la mer
’Ægée, 8c l’une des Cyclades, félon Ptolomée, l. III.
c. XV. Pline, l. IV. c. xij. 8c Etienne le géographe
écrivent Pholecandros, 8c la mettent parmi les îles
Sporades. Hefyche écrit Phlegandros. On la nomme
aujourd'hui Policandro : elle eft entre les îles de Milo
8c de Sikino. ( D . J. )
PHILONIUS PORTUS , ( Géog. anc. ) port de
n ie de Corfe. Ptolomée, /. I II. c. ij. le place fur la
côte méridionale près d’Alifta. Niger 8c Léander di-
fent que c’ eft aujourd’hui Porto-V ecchio. ( D . J . ) ,
PHILLYREA, f. f. ( Botan. ) Toiirnefort compte
treize efpeces de ce genre de plante. Décrivons ici la
plus commune qui eft à feuilles de troëfne, phillyrea
folio liguflri ; C. B. P . 4 j6 .8 c I. R. H. ioc).
Sa racine eft ferme , enfoncée .profondément en
terre. Elle pouffe plufieurs tiges à la hauteur de fix
à huit piés , rameufes, revêtues d’une écorce blanchâtre
, un peu ridée. Ses feuillés font affez Semblables
à celles du troëfne, mais plus, amples & plus longues
, charnues, d’un verd brun, oppofées les unes
aux autres, ou deux à deux le long de la tige 8c des
branches , toujours vertes , d’un goût aftringent.
Ses fleurs naiffent plufieurs enfemble des aiffelles
des feuilles, petites, 8c Semblables à-peu-près à celles
de l’olivier ; chacune d’elles eft un godet découpé en
quatre parties , de couleur blanche-verdâtre. Après
que ces fleurs font paffées , il leur fuccède des baies
iphériques groffes comme celles du myrte noir ,
quand elles font mûrés, difpofées en petites grappes
, d’un goût douçâtre , accompagne de quelque
amertume, 8c approchant des baies de genievre; eues
contiennent chacune un petit noyau rond 8c dur.
Cet arbriffeau croît dans les haies 8c les bois aux
environs de Montpellier. Il fe plaît dans les endroits
pierreux, rudes 8c incultes : il fleurit en Mai & Juin,
8c fon fruit eft mûr en Septembre. Comme fon feuillage
eft toujours verd, on en fait des berceaux 8c de
jolies paliffades. Elle s’élève facilement de graine &
de bouture. On la tond comme on veut, en buiffon ,
en boule, en haie,, en efpalier. La Médecine ne fait
point ufage de cette plante ; on ne penfe pas même
que cefoit la même plante que la phillyrea deDiofco-
yide. (D . J . )
PHILOGÉE , f. m. ( Mytholog. ) c’eft le nom d’un
des chevaux du foleil : ce mot fignifie qui aime la terre,
de (fixa, j ’aime , 8c y», terre; il prend fon nom du
foleil à fon coucher, où il paroît tendre vers la terre.
Quand cet aftre s’abaiffe, qu’il femble s’élargir par
degrés au déclin du jour; que les nuages entourent
avec magnificence le trône du couchant, comme di-
fent nos poètes ; c’eft dans cet inftant, fi l’on en croit
les chantres fabuleux de la G rece, que Phébus donnant
relâche à fes courfiers fatigués, Philogée , Py-
roeis, Eous 8c Ethon, cherche les bofquets d’Am-
phitrite pour fe repofer lui-même avec les nymphes
ôcéanides. il baigne fes rayons à moitié plongés, 8c
tantôt montrant un demi-cercle doré, il donne un
dernier regard lumineux, 8c difparoît enfin totalement
dans le fein de Téthis. (D . J . )
PHILOLAUS, (Mythol.) Efculape avoitun temple
près de la ville d’Àfope dans la Laconie, où il étoit
honoré fous le noin de P kilo laits, c’eft-à-dire bon &
J'alutaire aux hommes. Il ne pouvoit avoir un furnom
plus glorieux. (D . J.)
PHILOLOGIE , f. f. (Littérat.) efpece de fcience
compofée de grammaire, de poétique, d’antiquités.,
d’hiftoire, de philofophie, quelquefois même de mathématiques
, de médecine, de jurifprudence, fans
traiter aucune de ces matières à fond, ni féparé-
ment, mais les effleurant toutes ou en partie.
Ce mot eft dérivé du grec tpixoç 8c Xoyoç, amateur,
des difeours, des lettres ou des Jciences.
La philologie eft une efpece de littérature univer-
felle, qui traite;de toutes les fciences, de leur origine,'
de leur progrès, des auteurs qui les ont cultivées, 6*c.
Voyei POLYMATHIE.
La philologie n’eft autre chofe que ce que nous appelions
en France les Belles-lettres, 8c ce qu’on nomme
dans les univerfités les humanités, humaniores Ut-
terce. Elle faifoit autrefois la principale 8c la plus belle
partie de la Grammaire. Voyeç G r a m m a ir e 6*
G r a m m a ir ie n .
PHILOLOGUE, f. m. (Littérat.) on appelle ainfi
quiconque embraffe cette littérature univerfelle, qui
s’étend fur toutes fortes de fciences 8c d’auteurs, comme
ceux qui ont travaillé fur les anciens auteurs
pour les examiner, les corriger-, les expliquer 8c les
mettre au jour.
Eratofthene, bibliothécaire d’Alexandrie, fut le
premier qui porta le nom de philologue, û l’on en croit
Suétone, ou celui de critique, félon Clément alexan-
drien. Il vivoit du tems de Ptolomée Philadelphe, 8c
mourut fort-âgé dans la cxxxxvj. olympiade.
On compte encore parmi les philologues fameux
dans l’antiquité, Yarron, Afconius Pedianus, Pline
l’ancien, Lucien, Aulugelle, Athenée, Julius Pollux,
Solin, Philoftrate, Macrobe, D onat, Servius, Sto-
. b ée, Photius , Suidas, &c.
Entre les modernes, les deux Scaliger,Turnebe,’
Cafaubon, Lambin, les Voflius 8c les Heinfius, Eraf-
me, Jufte Lipfe, les PP. Sirmond, Petau 8c R apin,
Gronovius, Grævius, Spelman, &c. fe font fort di-
ftingués dans la Philologie. Elle eft très-cultivée en
Angleterre, en Allemagne 8c en Italie. Notre académie
des Belles-lettres s’efforce de la remettre en honneur
parmi nous, 8c rien n’y eft plus propre que les
mémoires curieux dont elle enrichit le public.
PHILOMELE,f. f. (Mythol.) les Mythologues ont
parlé de Progné 8c de Philomele d’une maniéré très-
peu uniforme. L’opinion généralement reçue par les
modernes, eft que Progné fut changée en hirondelle,’
8c Philomele en roflignol, 8c c’eft auflile fentiment de
quelques anciens; cependant d’autres, en grand nombre,
ont dit le contraire. Homere, par exemple, au
X IX . livre de Podyjfée ; Ariftophane 8c fon fcholia-
fte, dans la comédie des oifeaux ; Anacréon, dans fa
xij. ode; O vide, dans Vépître de Sapho; 8c Varron, au
IV . livre de la langue latine. Ce contrafte forme une
double tradition fabuleufe, 8c met les Poëtes en droit
de choifir. Virgile a fait plus, car il a fuivi tantôt l’une
8c tantôt l’autre tradition ; dans la vj. bucolique i!
change Philomele en hirondelle, 8c au IV. liv. de fes
géorgiques, il en fait un roflignol.
On fait que Progné 8c Philomele étoient deux foeurs
extrêmement belles, 8c filles de Pandion. Téré e,roi
de Thrace, époiifa Progné z 8^ Uyr^ à la bruîaJité
dé fa paflion pour Philomele, après l’avoir conduite
dans un bois écarté. O vide vous dira les fuites de cette
déplorable avanture ; le changement d e Philomele en
roflignol, de Progné en hirondelle, 8c de Tërée en
huppe. 11 femble que la Mythologie par ces méta-
morphofes, ait voulu peindre le cara&ere de ces différentes
perfonnes ; mais la Fontaine en adoptant la
Fable, a fçu en tirer un parti bien plus heureux dans
la réflexion fine 8c judicieufe qu’il prête à Philomele.
Progné la trouvant enfin dans un féjour folitaire, lui
dit :
Vene^ faire aux cités éclater leurs merveilles ;
AuJJî-bien en voyant les bois,
Sans ceffe i l vous fouvientque Térée autrefois
Parmi des demeures pareilles ,
Exerça fa fureur fur vos divins appas.
Eh l J eft le fouvenir efunJi cruel outrage
Qui fait, reprit fa foeur, que je ne vous fuis pas;
En voyant les hommes, helas !
I l m’en fouyient bien davantage.
(D. J . )
PHILONIUM, f. m. (Mat. médit, anc.) efpece
d’opiat anodin 8c fomnifere, ainfi nommé de Philon
fon inventeur. Galien dit que le pliilonium jouiffoit
d’une grande réputation depuis long-tems, 8c que ce
médicament étoit un des plus anciens de ce genre, ce
qui fignifie plus ancien que le mithridate, la thériaq
ue , la hiere 8c autres femblables. Cependant il eft
permis de douter que la compofition de Philon fût
tout-à-fait aufli ancienne que le mithridate ; mais elle
alloit apparemment de pair pour le tems avec la hiere
Ample, inventée par Thémifon qui vivoit fous le régné
d’Augufte. La thériaque étoit plus nouvelle, car
ce nefi.it que fous Néron qu’on commença à la corn-
pofer. Ce qui fait croire que le philonium étoit un peu
poftérieur au mithridate, c’eft que Philon recommande
fon remede pour la colique. Or cette maladie n’a
pas été connue fous ce nom long-tems avant le régné
de Tibere. Il eft donc affez vraiffemblable que
Philon a vécu fous Augufte, à-peu près .en même tems
que Thémifon,& les premiers difciples d’Afclépiade;
cette date n’empêche pas que Galien n’ait dû parler
du philonium comme d’une ancienne compofition,
puifqu’îl n’a écrit qu’environ deux cent ans après le
tems auquel nous fuppofons, avec M. le Clerc, que
cette compofition a été inventee. Au refte, elle eft
très-mal digérée ; mais quiconque du tems de Galien
fe feroit avrféde le dire, eût pafle pour atteint du crime
de léfe-pharmacie, 8c rarement les Médecins en
ont été coupables. (D . J.)
PHILOPARABOLOS, (Médec. anc.) <pi\™rapafio*
xoç; épithete qu’Afclépiade donne à l’une des deux
méthodes dont il fe fervit dans la cure de la phréné-
fie; 8c cette épithete fignifie une méthode violente, par
oppofition à l’autre qu’il pratiquoit. Or cette méthode
violente qu’il nommoit pliiloparabolos, terme dont
Plutarque enfuite s’eft fervi pour défigner un homme
qui fe jette fans ménagement dans les plus grands
dangers, confiftoit à donner au malade désola première
vifite, un grand verre de vin pur, mêlé avec
de l’eau falée. Ce remede, dit le médecin grec, eft
fort à la vérité , mais il a cet avantage fur le mulfum
8c les autres liqueurs femblables, d’arrêter les fueurs
coliquatives, d’élever le pouls, 8c d’opérer parla détention
du ventre, la guérifondu malade. (D . J.)
PHILOPATOR, (Hift. anc.) furnom donné par les
anciens à quelques princes qui s’étoient diftingués
par leur tendreffe pour leurs peres ; comme l’exprime
ce mot tiré de epixoç, amateur, 8c 77*7«p, pere. On
connoît dans l’hiftoire d’Egypte Ptolomée philopator,
8c dans celle des rois de S y r ie , un Seleucus 8c un
Antiochus diftingués des autres princes du même
pom, par le titre de philopator.
PHÎLOSÉBASTE, (Ant. grec. & rom.) tpiXi&ifixir*
toç , c’eft-à-dire amis d’Augufe. C’étoit un titre que
des princes 8c des villes prenoient afin de témoigner
publiquement leur attachement à quelque empereun
Ce titre fe trouve fur des mafbres de Gyzique, 8c fur
d’autres infcriptionS. Il ne faut pas s’étonner que la
ville de Cyzique s’en foit décorée, puifque l’empereur
Adrien l’avoit combléè de bienfaits. Il y a dans
Muratori, P. DXC. z. une infeription qui montre
que la ville d ’Ephefe avoit aufli pris la qualité de phi*
lofébafte. Plufieurs villes 8c plufieurs princes ont pris
femblablement la qualité d’ami des Romains, <pi\opo-
y.ctioç, 8c d’amide Céfir, tpiXozctiircip, &c. (D. J.)
PHILOSOPHALE, p ie r r e , voyeç lès articles H e r *
MÉTIQUEj, Philofophie, CHIMIE.
PHILOSOPHE, f. m. Il n’y a rien qui coûte moins
à acquérir aujourd’hui que le nom de philofoplie-, une
vie obfcure 8c retirée , quelques dehors de fageffe,
avec un peu de le&ure, fuflifent pour attirer ce nont
à des perfonnes qui s’en honorent fans le mériter;
D’autres en qui la liberté de penfer tient lieu de
raifonnement, fe regardent comme les feuls véritables
philofophes, parce qu’ils ont ofé renyerfer les
bornes facrées pofées par la religion, 8c qu’ils ont
brifé les entraves où la foi mettoit leur raifon. Fiers
de s’être défaits des préjugés de l’éducation, en matière
de religion, ils regardent avec mépris les autres
comme des âmes foibles, des génies ferviles, des ef*
prits pufillanimes qui fe laiffenr effrayer par les con-*
féquences oii conduit l’irréligion, 8c quin’ofant for-
tir un inftant du cercle des vérités établies, ni marcher
dans des routes nouvelles, s’endorment fous le
joug de la fuperftition.
Mais on doit avoir une idée plus jufte du philofo-»
phe, 8c voici le carattere que nous lui donnons.
Les autres hommes font déterminés à agir fans
fentir, ni connoître les caufes qui les font mouvoir,
fans même fonger qu’il y en ait. Le philofophe au contraire
démêlé les caufes autant qu’il eft en lu i, 8c
fouvent même les prévient, 8c fe livre àjelles avec
connoiffance : c’eft une horloge qui fe monte, pour
ainfi dire, quelquefois elle-même. Ainfi il évite les
objets qui peuvent lui caufer des fentimens qui ne
conviennent ni au bien-être, ni à l’être raifonnable,
8c cherche ceux qui peuvent exciter en lui des affections
convenables à l’état où il fe trouve. La raifon eft
à l’égard du philofophe, ce que la grâce eft à l’égafd
du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir^
la raifon détermine le philojophe.
Les autres hommes font emportés par leurs pallions,'1
fans que les aérions qu’ils font foient précédées de la
réflexion : ce font des hommes qui marchent dans les
ténèbres ; au lieu que le philofophe dans fes pallions
mêmes , n’àgit qu’après la réflexion ; il marche la
nuit, mais il eft précédé d’un flambea'u.
Le philofophe forme fes principes fur une infinité
d’obfervations particulières. Le peuple adopte le
principe fans penfer aux obfçrvations qui l’ont produit:
il croit que la maxime exifte pour ainfi dire par
elle-même ; mais le philofophe prend la maxime dès fa
fource ; il en examine l’origine ; il en connoît la propre
valeur, & n’en fait que l’üfage qui lui convient»
La vérité n’eft pas pour le philofophe une maîtreffe
qui corrompe fon imagination , 8c qu’il croie trouver
par-tout ; il fe contente de la pouvoir démêler
où il peut l’appercevoir. Î1 ne la confond point avec
la vraiffemblance ; il prend pour vrai cè qui eft vrai,
pour faux ce qui eft faux, pour douteux ce qui eft
douteux , 8c pour vraiffemblable ce qui n’eft que
vraiffemblable. Il fait plus, 8c c’eft ici une grande per-
feérion du philofophe, c’eft que lorfqu’il n’a point de
motif propre pour juger, il fait demeurer indeter-
miné. u 0 .
L e m o n d e eft p le in de p e r fo n n e s d e fp r t f 8i d e