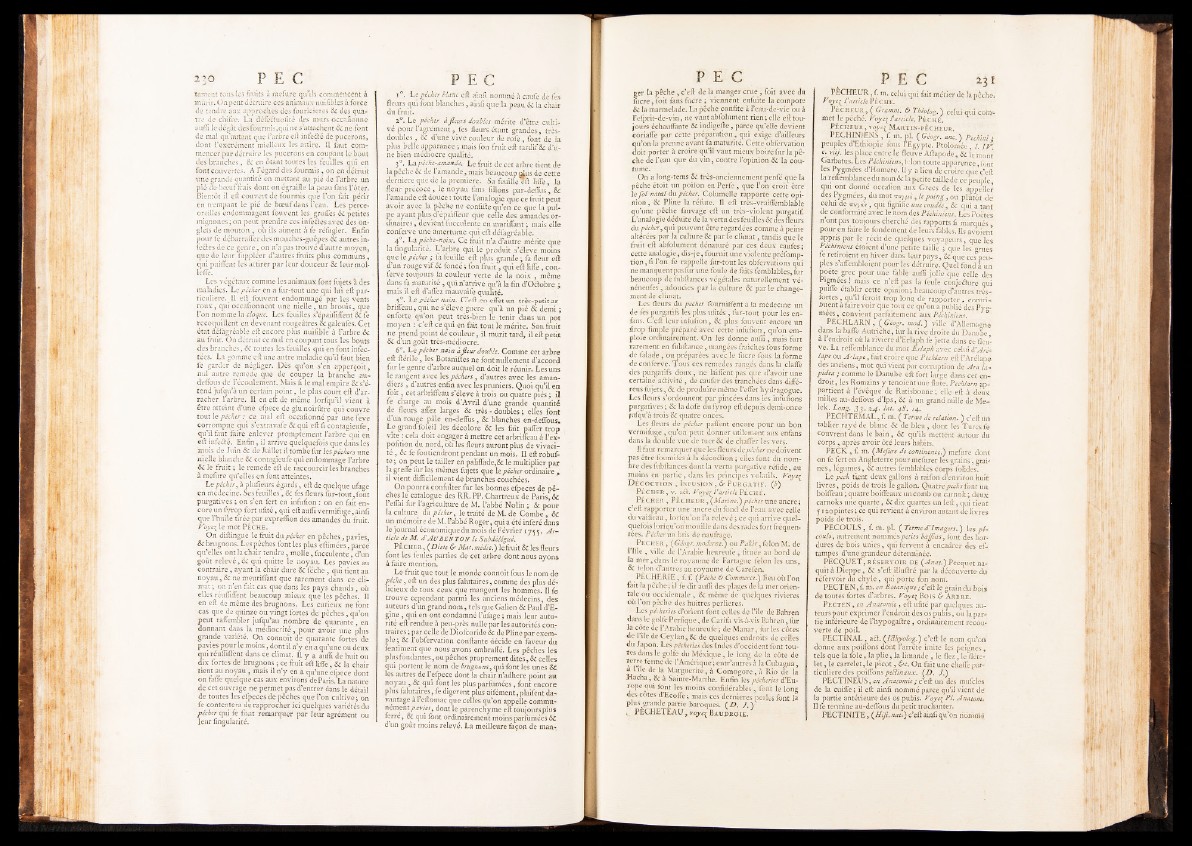
tament tous les fruits à mefure qu’ils commencent à
mûrir. On peut détruire ces animaux nuifibies à force
de tendre aux approches des fouricieres & des quatre
de chifre. La défe&uofité des murs occafionne
aufli le dégât des fourmis,qui ne s’attachent &: ne font
de mal qu’autant que l’arbre eft infeûé de pucerons,
dont l’excrément mielleux les attire. Il faut cç?nr
mencer par détruire les pucerons en coup'ant le bout
des branches , & en ôtant toutes les feuilles qui en
font couvertes. A l’égard des fourmis, on en détruit
une grande quantité en mettant au pié de l’arbre un
pié ae boeuf frais dont on égraille la peau fans l’ôte.r.
Bientôt il eft couvert de fourmis que l’on fait périr
en trempant le pié de boeuf dans l’eau. Les perce-
oreilles endommagent fouvent les groffes Sc petites
mignones; on peut prendre ces infeétes avec des onglets
de mouton , où ils aiment à fe réfugier. Enfin
pour fe débarraffer des mouches-guêpes Sc autres infectes
de ce genre, on n’a pas trouvé d’autre moyen,
que de leur fuppléer d’autres fruits plus communs,
qui puiffent les attirer par leur douceur & leurmol-
leffe.
Les végétaux comme les animaux font fujets â des
maladies. Le pêcher en a fur-tout une qui lui eft particulière.
Il eft fouvent endommagé par les vents
ro u x , qui occafionnent une nielle, un brouis, que
l’on nomme la cloque. Les feuilles s’épaifliffent & fe
recoquillent en devenant rougeâtres Sc galeufes. Cet
état défagréable eft encore plus nuifible à l’arbre Sc
au fruit. On détruit ce mal en coupant tous les bouts
des branches, Sc toutes les feuilles qui en font infectées.
La gomme eft une autre maladie qu’il faut bien
fe garder de négliger. Dès qu’on s’en apperçoit,
nul autre remede que de couper la branche au-
deffous de l’écoulement. Mais fi le mal empire & s’étend
jufqu’à un certain point, le plus court eft d’arracher
l’arbre. Il en eft de même lorfqu’il vient à
être atteint d’une efpece de glu noirâtre qui couvre
tout le pêcher : ce mal eft occafionné par une feve
corrompue qui s’extravafe & qui eft fi contagieufe,
qu’il faut faire enlever promptement l’arbre qui en
eft infecté. Enfin, il arrive quelquefois que dans les
mois de Juin Sc de Juillet il tombe fur les pêchers une
nielle blanche Sc contagieufe qui endommage l’arbre
Sc le fruit ; le remede eft de raccourcir les branches
à mefure qu’elles en font atteintes.1
Le pêcher, à plufieurs égards, eft de quelque ufage
en médecine. Ses feuilles, Sc fes fleurs fur-tout,font
purgatives ; on s’en fert en infufion : on en fait encore
un fyrop fort ufité, qui eft aulfi vermifuge,ainfi
que l’huile tirée par expreflion des amandes du fruit.
Voye^ le mot Pêche.
On diftingue le fruit du pêcher en pêches, pavies,
& brugnons. Les pêches font les plus ellimées, parce'
qu’ elles ont la chair tendre, molle, fucculente, d’un
goût relevé, & qui quitte le noyau. Les pavies au
contraire, ayant la chair dure & féche , qui tient au
noyau, & ne meuriffant que rarement dans ce climat
; on n’en fait cas que dans les pays chauds , oîi
elles réufliflent beaucoup mieux que les pêches. Il
en eft de même des brugnons. Les curieux ne font
cas que de quinze ou vingt fortes de pêches, qu’on
peut raffembler jufqu’au nombre de quarante, en
donnant dans la médiocrité, pour avoir une plus
grande variété. On connoît de quarante fortes de
pavies pour le moins, dont il n’y en a qu’une ou deux
oui réufliflent dans ce climat. Il y a aufli de huit ou
dix fortes de brugnons ; ce fruit eft liffe, Sc la chair
tient au n oyau, mais il n’y en a qu’une efpece dont
on faflfe quelque cas aux environs de Paris. La nature
de cet ouvrage ne permet pas d’entrer dans le détail
de toutes les efpeces de pêches que l’on cultive ; on
fe contentera de rapprocher ici quelques variétés du
pêcher qui fe font remarquer par leur agrément ou
leur fingularité.
i °. Le pêcher blanc eft ainfi nommé à caufe de fes
fleurs qui font blanches, ainfi que la peau Sc la chair
du fruit.
S 2.°- Le pêcher à fleurs doubles mérite d’être cultivé
pour l’agrément, fes fleurs étant grandes, très-
doubles , Sc d’une vive couleur dè ro fe, font de la
plus belle appârance ; mais fon fruit eft tardif & d’une
bien médiocre qualité.
30. La peche-amande. Le fruit de cet arbre tient de
la pèche & de 1 amande, mais beaucoup jflus de cette
dernierequede la première. Sa feuille eft lifle, la
fleur précoce , le noyau fans filions par-defliis, &
1 amande eft douce : toute l’analogie que ce fruit peut
avoir avec la pêche ne confifte qu’en ce que la pulpe
ayant plus d’épaiffeur que celle des amandes ordinaires
, devient lucculente en muriflant ; mais elle
conferve une amertume qui eft défagréable.
4°. La pêche-noix. Ce fruit n’a d’autre mérite que
la fingularité. L’arbre qui le produit s’élève moins
que le pécher ; fa feuille eft plus grande ; fa fleur eft
d’un rouge v if Sc foncé ; fon fru it, qui eft lifle , con,-
ferve toujours la couleur verte de la noix , même
dans fa maturité , qui n’arrive qu’à la fin d’Oètobre ;
mais il eft d’affez mauvaife qualité.
5°* Le pêcher nain. C’eft en effet un très-petit ar-
briffeau, qui ne s’eleve guere qu’à un pié Sc demi ;
enforte qu’on peut très-bien le tenir dans un pot
moyen : c ’eft ce qui en fait tout le mérite. Son fruit
ne prend point de couleur, il mûrit tard, il eft petit
Sc d’un goût très-médiocre.
6°. Le pêcher nain à fleur double. Comme cet arbre
eft fterile , les Botaniftes ne font nullement d’accord
fur le genre d’arbre auquel on doit le réunir. Les uns
le rangent avec les pêchers, d’autres avec les amandiers
, d’autres enfin avec les pruniers. Quoi qu’il en
fo it , cet arbrifleau s’élève à trois ou quatre piés ; il
fe charge au mois d’Avril d’une grande quantité
de fleurs affez larges Sc très - doubles ; elles font
d un rouge pâle en-deffus , & blanches en-deffous.
Le grand foleil les décolore Sc les fait paffer trop
vite : cela doit engager à mettre cet arbrifleau à l ’ex-
pofition du nord, où les fleurs auront plus de vivacit
é , & fe foutiendront pendant un mois. II eft robuf-
te ; on peut le tailler en paliffade,& le multiplier par
la greffe fur les mêmes fujets que le pêcher ordinaire I
il vient difficilement de branches couchées.
On pourra confulter fur les bonnes efpeces de pêches
le catalogue des RR. PP. Chartreux de Paris, Sc
l’effai fur l’agriculture de M. l’abbé Nolin ; & pour
la culture du pêcher, le traité de M. de Combe, Sc
un mémoire de M. l’abbé Roger, qui a été inféré dans
le journal économique du mois de Février 1755. Article
de M. d ’A ü B E N T O N le Subdélégué.
PECHER, (Diete & Mat. médic.') le fruit Sc les fleurs
font les feules parties de cet arbre dont nous ayons
à faire mention.
Le fruit que tout le monde connoît fous le nom de
pêche , eft un des plus falutaires, comme des plus délicieux
de tous ceux que mangent les hommes. Il fe
trouve cependant parmi les anciens médecins, des
auteurs d’un grand nom, tels que Galien Sc Paul d’E-
gine, qui en ont condamné l’ufage ; mais leur autorité
eft rendue à peu-près nulle par les autorités contraires
; par celle de Diofcoride Sc de Pline par exemple
; Sc l’obfervation confiante décide en faveur du
lentiment que nous avons embraffé. Les pêches les
plus fondantes, ou pêches proprement dites, Sc celles
qui portent le nom de brugnons, qui font les unes Sc
les autres de l’efpece dont la chair n’adhere point au
noyau , Sc qui font les plus parfumées, font encore
plus falutaires, fe digèrent plus aifément,plaifent da-»
vantage à l’ eftomac que celles qu’on appelle communément
pavies, dont le parenchyme eft toujours plus
f^rrc •> & qui font ordinairement moins parfuriiées Sc
d un goût moins relevé. La meilleure façon de manger
ja pêche , c’ eft de la manger ente , foit avec du
fiicre, foit fans fücre ; viennent enfuite la compote
& la marmelade. La pêche confite à l’eau-de-vie oit à
l’efprit-de-vin, ne vaut abfolument rien; elle eft toujours
échauffante Sc indigefte, parce qu’elle devient
coriaffe par cette préparation, qui exige d’ailleurs
qu’on la prenne avant fa maturité. Cette obférvation
doit porter à croire • qu’il vaut mieux boire fur la pêche
de l’eau que du v in , contre l’opinion & 'la coutume.
On a long-tems & très-anciennement penfé que la
pêche étoit un poifon en Perfe , que l’on croit être
le fol natal du pêcher. Columelle rapporte cette opinion,
Sc Pline la réfute. Il eft très-vraiffemblable
qu’une pêche fauvage eft un très-violent purgatif.
L’analogie déduite de la vertu des feuilles & des fleurs
du pêcher, qui peuvent être regardées comme à peine
altérées par la culture Sc par le climat, tandis que le
fruit eft abfolument dénaturé par ces deux caufes;
cette analogie, dis-je, fournit une violente préfomp-
tion, fi l’on fe rappelle fur-tout les obfervations qui
ne manquent pas fur une foule de faits femblables, fur
beaucoup de fubftances végétales naturellement vé-
néneufes, adoucies par la culture Sc par le changement
de climat.
Les fleurs du pêcher fourniffent à la médecine un
de fes purgatifs les plus ufités , fur-tout pour les en-
fans. C’eft leur infufion, Sc plus fouvent encore un
firop fimple préparé avec cette infufion, qu’on emploie
ordinairement. On lès donne aufli, mais fort
rarement en fubftance, mangées fraiches fous forme
de falade , ou préparées avec le fucre fous la forme
de conferve. Tous ces remedes rangés, dans la claffe
des purgatifs doux, ne laiffent pas que d’avoir une
certaine activité , de caufer des tranchées dans diffé-
rens fujets, Sc de produire même l’effet hydragogue.
Les fleurs s’ordonnent par pincées dans les infufions
purgatives ; Sc la dofe du fyrop eft depuis demi-once
jufqu’à trois Sc quatre onces.
Les fleurs de pêcher paffent encore pour un bon
vermifuge , qu’on peut donner utilement aux enfans
dans la double vue de tuer Sc de chaffer les vers.
Il faut remarquer que les fleurs d & pêcher ne doivent
pas être foumifes à la déco&ion ; elles font du nombre
des fubftances dont la vertu purgative réfide, au
moins en partie, dans les principes volatils. Voye£
D é co c t io n , Infusion , & Pu r g a t if , (b)
Pé ch er , v. a£t. Voye^ l'article PÉCHÉ.
Pecher , Pêcheur , (Marine.) pêcher une ancre;
c’eft rapporter une ancre du fond de l’eau avec celle
du vaifleau, lorfqu’on l’a relevé ; ce qui arrive quelquefois
lorlqu’on mouille dans des rades fort fréquentées.
Pêcher un bris de naufrage.
Pecher* , 'f Géogr. moderne?) ou Pakir, félon M. de
l’Ifle , ville de l’Arabie heureufe, fituée au bord de
la mer, dans le royaume de Fartague félon les uns,
& félon d’autres au royaume de Carefen.
PÊCHERIE, f. f. ( Pêche & Commerce.) lieu où l’on
fait la pêche; il fe dit aufli des plages de la mer orientale
ou occidentale , Sc même de quelques rivières
où l’on pêche des huitres perlieres.
Les pêcheries d’orient font celles de l’île de Bahren
dans le golfe Perfique, de Carifa vis-à-vis Bahren, fur
la cote de l’Arabie heureufe ; de Manar, furies côtes
de lhle de C eylan, & de quelques endroits de celles
du Japon. Les pêcheries des Indes d’occident font toutes
dans le golfe du Méxique, le long de la côte de
1 1 ! ^Amérique ; entr’autres à la Cubagua,
à 1 île de la Marguerite, à Comogore, à Rio de la
Hacha, & à Sainte-Marthe. Enfin les pêcheries d’Europe
cjui font les moins confidérables , font le long
des cotes d’Ecoffe ; mais ces dernieres perles font la
plus grande partie baroques. ( D . J \
^ PÊCHETEAU , voye^ Baud ro ie.
PÊCHEUR, f. m. celui qui fait métier dé ia pêche»
Foyei Varticle PÊCHE.
Pécheur , ( Gramnï. & Théoiog. ) celui qiii commet
le péché. Voye^Varticle. Péché.
Pêcheur, voye^ Martin-pêcheur.
PÉCHIN1ENS , f. m. pl. ( Géogr. anc. ) Pechini i
peuples d’Ethiopie fous l’Egypte. Ptolomée , l. TFi
c. viij. les place entre le fleuve Aftapode, & le mont
Garbatus. Les Péchiniens, félon toute apparence, font
les Pygmées d’Homere. Il y a lieu de croire que’ c’eft
la réflemblance du nom & la petite taille de ce peuple*
qui ont donné occafion aux Grecs de lés appelle^
des Pygmées , du mot , le poing, ou plûtôt dé
celui de , qui fignifie une coudée, & qui a tant
de conformité avec le nom des Péchihiens. Les Poètes
n’ont pas toujours cherché des rapports fi marqués *
pour en faire le fondement de leurs fables. Ils avoieht
appris par le récit de quelques voyageurs, que les
Péchiniens étoient d’une petite taille ;"que les <mies
fe retiroient en hiver dans leur pays , & que ces peiu
pies s’aflembloient pour les détruire. Quel fond à un
poète grec pour une fable aufli jolie que celle des
Pigmées ! mais ce n’eftpas la feule çonjeâuré qui
puifle établir cette Opinion; beaucoup d’âutres très-
fortes , qu’il feroit trop long de rapporter , contribuent
à faire voir que tout ce qu’on a publié des Pygmées
, convient parfaitement aux Péchiniens.
PECHLARN, ( Géogr. mod. ) ville d’Allemagné
dans la baffe Autriche, ïiir la rive droite du Danube
à l’endroit où la riviere d’Erlaph fe jette dans ce fleu=
ve. La reffemblance du mot Erlaph avec celui d'Aré-
lape ou ArLape, fait croire que Pechlarn eft l’Arélape
des anciens, mot qui vient par corruption de Ara la-
pidea ; comme le Danube eft fort large dans cet endroit,
les Romains y tenoientune flote. Pechlarn appartient
à l’évêque de Ratisbonne; elle eft à deux
milles au-deffous d’Ips, & à un grand mille de Me-
lek. Long. J j . 2.4. lat. 48. 14.
PECHTEMAL, f. m. ( Terme de relation. ) c’eft Un
tablier rayé de blanc St de bleu, dont les Turcs fe
couvrent dans le bain, & qu’ils mettent autour dit
corps , après avoir ôté leurs habits.
P E C K , f. m. (Mefure de continence.) mefure dont
on fe fert ert Angleterre pour mefurer les grains, graines,
légumes, & autres femblables corps folides.
Le peck tient deux gallons à raifon d’environ huit
livres, poids de trois le gallon. Quatïepscks font un
boiffeau ; quatre boiffeaux un comb ou carnok ; deiix
carnoks une quarte, & dix quartes un left, qui tient
5120 pintes ; ce qui revient à environ autant de livres
poids de trois.
PECOULS , f. m. pl. ( Terme d'imagers. ) les pé-
côuls, autrement nommés petits bafflns, font des bor*
dûtes de bois unies, qui fervent à encadrer des ef-
tampes d’une grandeur déterminée.
PECQÜET, réservoir de (Anat.) Pecquet naquit
à Dieppe , & s’eft illuftré par la découverte du
réfervoir du ch y le, qui porte fon nom.
PECTEN, f. m. en Botanique ; c’eft le grain du bois
de toutes fortes d’arbres. Voye^ Bois & Arbre.
Pecten , en Anatomie, eft ufité par quelques auteurs
{jour exprimer l’endroit des, os pubis, ou la partie
inférieure de l’hypogaftre, ordinairement recôiu
verte de poil.
PECTINAL , a&. ( Iclhyolog.) c’eft le nom qu’on
donne aux poiffons dont l’arrête imite les peignes,
tels que la lo le, la p lie, la limande , le fiez, le fléte-
le t , le Carrelet, le picot, &c. On fait une chaffeparticulière
des poiffons peclinazix. (J). J.y
PECTINEUS, en Anatomie ; c’eft un des mufcleS
dè la Cuiffe ; il eft ainfi nommé parce qit’ii vient dé
là partie antérieure des Os pubis. Foye^ P l. Anatotht
Il fe termine au-deffous du petit trochanter.
PECTINITE, {dlifl. nati) c’eft ainfi qu’on riômniê