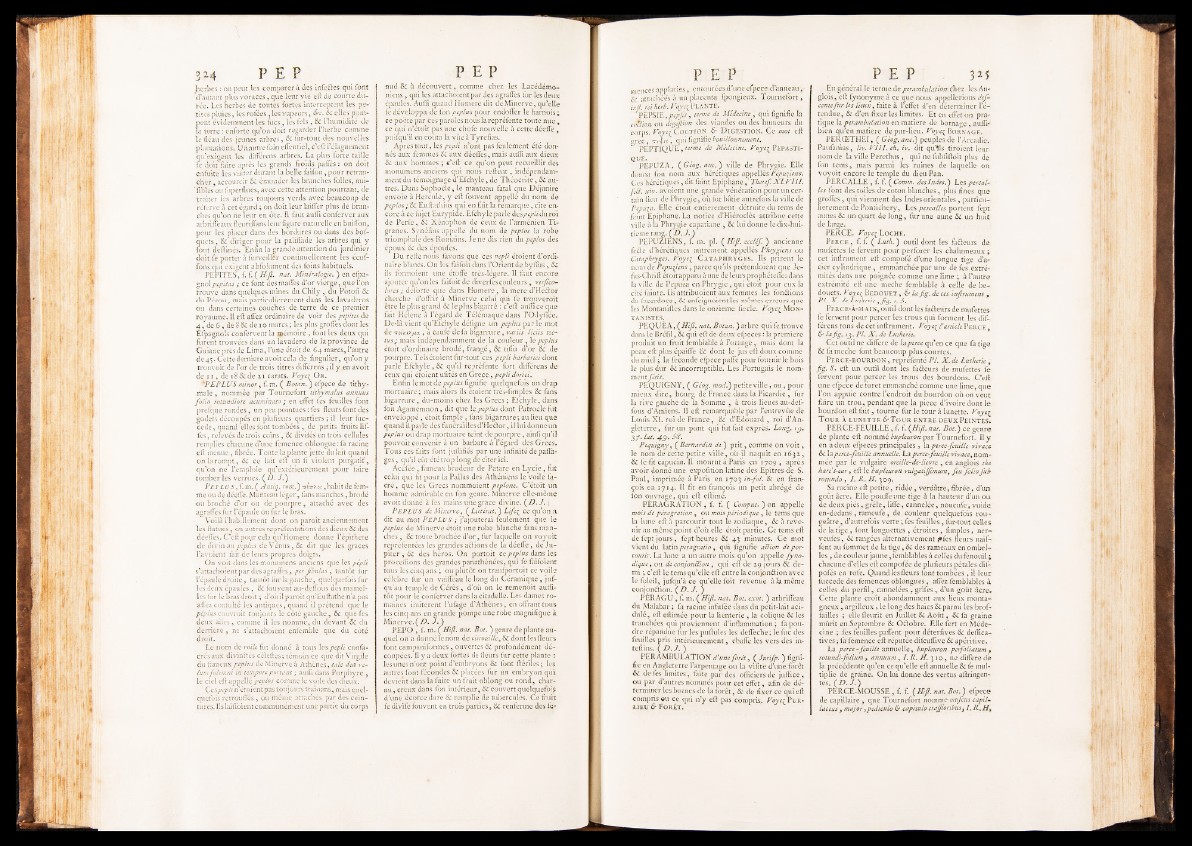
3M P E P
gerbes : on peut les comparer à des infeftes qui font
d’autant plus voraces, que leur vie eft de courte durée.
Les herbes de toutes fortes interceptent les pe--
lit es pluies, lesrofées , les vapeurs, &c. & elles pompent
évidemment les fucs, les fels , & Phumidite de
la terre : enforte qu’on doit regarder l’herbe comme
le fléau des jeunes arbres, 8c fur-tout des nouvelles
plantations. Un autre foin effentiel, c’eft l’élaguement
qu’exigent les difFérens arbres. La plus forte taille
fe doit faire après les grands froids pafles : on doit
enfuite les viüter durant la belle faifon, pour retrancher
accourcir 8c émonder les branches folles, nui-
‘ fibles ou fuperflues, avec cette attention pourtant, de
traiter les arbres toujours verds avec beaucoup de
réferve à cet égard ; on doit leur lailfer plus de branches
qu’on ne leur en ôte. Il faut aufii conferver aux
arbrifleaux fleuriffans leur figure naturelle en buifl'on,
pour les placer dans des bordures ou dans des bof-
quets, 8c diriger pour la paliffade les arbres qui y
ïont deftinés. Enfin la grande-attention du jardinier
döit fe porter à furveillër continuellement les écuf-
fons qui exigent abfolument des foins habituels.
PEPITES, f. f. ( Hfl. r.at. Minéralogie. ) en efpa-
gnol pepitas ; ce font des mafl'es d’or v ierge, que l’on
trouve dans quelques mines du Chily , du Potofi Sc
du Pérou, mais particulièrement dans les lavaderos
ou dans certaines couches de terre de ce premier
royaume. Il eft affez ordinaire de voir des pepites de
4 , de 6 , de 8 & de i o marcs ; les plus groffes dont les
Efpagnols confervenf la mémoire, font les deux qui
furent trouvées dans un lavadero de la province de
Guianeprèsde Lima, l’une étoitde 64 marcs,l’autre
de 4 5. Cette derniere avoit cela de fingulier, qu’on y
trouvoit de l’or de trois titres difFérens ; il y ,en avoit
de 1 1 , de 18 & de 1 1 carats. Voyeç Or.
*PEPLUS minor, f. m. ( Botan. ) efpece de tithy-
male , nommée par Tournefort tithymalus annuus
folio rotundiors, acuminato ; en effet les feuilles font
prefque rondes, un peu pointues : fes fleurs font des
godets découpés en plufieurs quartiers ; il leur fuc-
cede, Quand elles font tombées , de petits fruits lift
fes, relevés de trois coins, & divifés en trois cellules
remplies chacune d’une femence oblonguerfa racine
eft menue, fibrée. Toute la plante jette du lait quand
on la rompt, 8c ce lait eft im fi violent purgatif,
qu’on ne l’emploie qu’ extérieurement pour faire
tomber les verrues. (D . / .)
P EF L u S f . m. ( rtntiq. rom.') wtVxoj, habit de femme
ou de déeffe. Manteau léger, fans manches, brodé
ou broché d’or ou de pourpre, attaché avec des.
agraffes fur l’épaule ou fur le bras.
Voilà l’habillement dont on paroit anciennement
les ftatues, ou autres repréfentations des dieux 8c des
déeffes. C ’ eft poyr cela qu’Homere donne l’épithete
de divin au peplus de Vénus , 8c dit que les grâces
l’a voient fait de leurs propres doigts.
On voit dans les monumens anciens que les pépli
s’attachoient par des agraffes, per fibulas , tantôt fur
l’épaule droite, tantôt fur la gauche, quelquefois fur
les deux épaules , 8c fouvent au-deffous des mamelles
fur le bras droit ; d’oiiil paroît qu’Euftathe n’a pas
affez confulté les antiques, quand il prétend que le
peplus couvroit toujours le côté gauche , 8c que fes
deux ailes, comme il les nomme, du devant 5c du
derrière , ne s’attachoient eftfemble que du côté
droit.
Le nom de voile frit donné à tous les pepli confa-
crésaux divinités céleftes; témoin ce que dit Virgile
du fameux peplus de Minerve à Athènes, talé deoe vélum
folemni in tempore portant ; aufli dans Porphyre ,
le ciel eft appellé peplos comme le voile des dieux.
Cespepit n’étoient pas toujours traînans, mais quelquefois
retrouffés, ou même attachés par des ceintures.
Ilslaifî’oient communément une partie du corps
P E P
nud 8c à découvert, comme chez les Lacédémoniens,
qui les attachoient par des agraffes fur les deux
épaules. Aufli quand Homere dit de Minerve, qu’elle
fe développa de fon peplus pour endoffer le harnois ;
ce poëte par ces paroles nous la repréfente toute nue,
ce qui n’etoit pas une chofe nouvelle à cette déeffe ,
puifqu’il en coûta la vûeàTyrefias.
Après tout, les pepli n’ont pas feulement été donnés
aux femmes 8c aux déeffes, mais aufli aux dieux
8c aux hommes ; c’eft ce qu’on peut recueillir des
monumens anciens qui nous relient, indépendamment
du témoignage d’Efchyle, de Thcocrite, 8c autres.
Dans Sophocle, le manteau fatal que Déjanire
envoie à Hercule, y eft fouvent appelle du nom de
peplos; 8c Euftathius qui en fait la remarque, cite encore
à ce fujet Eurypide. Efchyle parle des pepli du roi
de Perle, 8c Xénophon de ceux de l’arménien Ti-
granes. Synéfius appelle du nom de peplos la robe
triomphale des Romains. Je ne dis rien du peplos des
époux 8c des époufes.
Du relie nous favons que ces pepli étoient d’ordinaire
blancs. On les fàifoit dans l’Orient de byffus, 8c
ils formoient une étoffe très-légere. Il faut encore
ajouter qu’on les faifoit de diverfes couleurs , verjîco-
lores ; deforte que dans Homere, la mere d’Heflor
cherche d’offrir à Minerve celui qui fe trouveroit
être le plus grand 8c le plus bigarré : c’eft aufli ce que
fait Hélene à l’égard de Télémaque dans l’Odyflee.
De-là vient qu’Eichyle défigne un peplus par le mot
de ntoÎkiX/xu , à caufe de fa bigarrure, variis liciis tec-
tus; mais indépendamment de la' Couleur , le peplus
étoit d’ordinaire brodé, frangé, 8c tiffu d’or 8c de
pourpre. Tels étoient fur-tout ces pepli barbarici dont
parle Efchyle , 8c qu’il repréfente fort difFérens de
ceux qui étoient ufités en Grece, pepli dorici.
Enfin le mot de peplus lignifie quelquefois un drap
mortuaire ; mais alors ils etoient très-frmples 8c fans
bigarrure, du-moins chez les Grecs ; Efchyle, dans
fon Agamemnon, dit que le peplus dont Patrocle fut
enveloppé , étoit Ample , fans bigarrure ; au lieu que
quand il parle des funérailles d’He&or, il lui donne un
peplus ou’drap mortuaire teint de pourpre, ainfi qu’il
pouvoit convenir à un barbare à l’égard des Grecs.
Tous ces faits font juftifiés par une infinité de paffa-
ges, qu’il eut été trop long de citer ici.
Acéfée , fameux brodeur de Patare en Lycie , fut
celui qui fit pour la Pallas des Athéniens le voile fa-
cré , que les Grecs nommoient peplone. C ’étoit un
homme admirable en fon genre. Minerve elle-même
avoit donné à fes mains une grâce divine. ( D . J. )
P e p l u s de Minerve, ( Littéral. ) Life%_ ce qu’on a
dit au mot P e p l u s ; j’ajouterai feulement que le
peplus de Minerve étoit une robe blanche fans manches
, 8c toute brochée d’o r , fur laquelle on voyoit
repréfentées les grandes actions de la déeffe, de Jupiter
, 8c des héros. On portoit ce peplus dans les
proceflîons des grandes panathénées, qui fe faifoient
tous les cinq ans ; ou plutôt on tranfportoit ce voile
célébré fur un vaiffeau le long du Céramique , juf-
qu’au temple de Cérès , d’où on le remenoit auffi-
tôt pour le conferver dans la citadelle. Les dames romaines
imitèrent l’ufage d’Athènes, en offrant tous
les cinq ans en grande pompe une robe magnifique à
Minerve.(Z>. J .)
PEPO , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) gènre de plante auquel
on a donné le nom de citrouille, 8c dont les fleurs
font campaniformes, ouvertes 8c profondément dé-
. Coupées. Il y a deux fortes de fleurs fur cette plante :
les unes n’ont point d’embryons 8c font ftériles; les
autres font fécondes 8c placées fur un embryon qui
devient dans la fuite un fruit oblong ou rond, charnu,
creux dans fon intérieur, 8c couvert quelquefois
d’une écorce dure 8c remplie de tubercules. Ce fruit
fe divife fouvent en trois parties, 8c renferme des fe-
P E P
snences applaties, entourées d’une efpece d’anneau, -
& attachée's à un placenta fpongieux. Tournefort,
in(l..reihtrb.Voyc{ PLANTE.' ' < , \
PEPSIE, pepjis, terme de Médecine , qui lignifie la
coction ou digeflion des viandes ou des humeurs du
corps. Hoyei Coction & D igestion. Ce mot eft
orec TTi-J-sç, qui fignifie bouillonnement.
° PEPTIQUE, terme 'de Médecine. Voye{ PepASTIQUE.
PEPUZA, ( Géog. a ne. ) ville de Phrygie. Elle
donna fon nom aux hérétiques appellés Pépufens.
Ces hérétiques, dit faint Epiphane, Theref. XLVH I.
fecl. xiv. avoient une grande vénération pour un certain
lieu de Phrygie, oii fut bâtie autrefois la ville de
Pepu{a. Elle étoit entièrement détruite du tems de
frint Epiphane. La notice d’Hiéroclès attribue cette
ville à la Phrygie capatiane , 8c lui donne le dix-hui-
tieme rang. ( D. J. )
PEPUZIENS, f. m. pl. ( Hifl. eccléf. ) ancienne
fe£te d’hérétiques autrement appellés Phrygiens ou
Cataphryges. Voyeç C ata ph r yg e s . Ils prirent le
nom de Pepufiens, parce qu’ils prétendoient que Je-
fus-Chrift étoit apparu à une de leurs prophétefles dans
la ville de Pepüza en Phrygie, qui étoit pour eux la
cité fainte. Ils attribuoient aux femmes les fondions
du facerdoce, 8c enfeignôientles mêmes erreurs que
les Montaniftes dans le onzième fiecle. Voye^ Mon-
TANISTES.
PEQUÉ A , ( Hifl. nat. Botan. ) arbre qui fe.trouve
dans le Bréfil, 8c qui eft de deux efpeces : la première
produit un fruit femblable à l’orange, mais dont la
peau eft plus épaiffe 8c dont le jus eft doux comme
du miel ; la fécondé efpece paffe pour fournirle bois
le plus dur 8c incorruptible. Les Portugais le nomment
Jetisi
PEQUIGNY, ( Géog. mod.) petite ville , ou , pour
mieux dire, bourg de France dans la Picardie , fur
la rive gauche de la Somme , à trois lieues au-deffous
d’Amiens. Il eft remarquable par l’entrevûe de
Louis XI. roi de France, 8c d’Edouard , roi d’Angleterre
, fur un pont qui fut fait exprès. Long. ic). .37- Ut. 4ÿ. iiV " ' 4 V • ;TC Pequigny, ( Bernardin de ) pr it, comme on v o i t ,
le nom de cette petite v ille , où il naquit en 1632,
8c fe fit capucin. Il mourut à Paris en 1709, après
avoir donné une expofition latine des Epîtres de S.
Paul, imprimée à Paris en 1703 in-fol. 8c en fran-
çois en 1714. Il fit en françois un petit abrégé de
ion ouvrage, qui eft eftimé.
PÉRAGRATION, f. f. ( Comput. ) on appelle
mois de péragration, ou mois périodique , le tems que
la lune eft à parcourir tout le zodiaque, 8c à revenir
au même point d’où elle étoit partie. Ce tems eft
de fept jours, fept heures 8c 43 minutes. Ce mot
vient du latin peragratio, qui fignifie action de por-
courir. La lune a un autre mois qu’on appelle fyno-
dique, ou de conjonction , qui eft de 29 jours 8c demi
; c’eft le tems qu’elle eft entre la conjfinêlion avec
le foleil, jufqii’à ce qu’elle foit revenue à la même
conjonction. (D . J. )
PÊRAGU, f. m. (Hifl. nat. Bot. exot. ) arbriffeau
du Malabar ; fa racine infùfée dans du petit-lait acidulé,
eft eftimée pour la lienterie , la colique 8c les
tranchées qui proviennent d’inflammation ; fa poudre
répandue Air les puftules les deffeche ; le fuc des
feuilles pris intérieurement, cbaffe les vers des in-
teftins. f D . J. )
PERAMBULATION d'une forêt, ( Jurifp. ) fignifie
en Angleterre l’arpentage ou la vifite d’une forêt
8c de fes limites, faite par des officiers de juftice ,
ou par d’autres nommés pour cet effet, afin de déterminer
les bornes de la forêt, 8c de fixer ce qui eft
compris ou ce qui n’y eft pas compris.. Voye^_ Pur-
l ie v & Forêt.
P E P 325
En général le terme de ptrambulaùon t hez lès An-«
glois, eft fynonyme à ce que; nous appellerions def-
cerne fur les lieux, faite à l’effet d’ en déterminer l’étendue,
8c d'en fixer les limites. Et en effet on pratique
la perambulation en matière de bornage aufli'
bien qù’en matière depur-lieu. Voye^ Bornage.
PEROETHEI, ( Géog. âne.) peuples de l’Arcadie*
Paufanias, liv. VIIL. ch. iv. dit qu’ils tiroient leur
nom de la ville Perethus , qui ne fubfiftoit plus de
fon tems, mais parmi les ruines de laquelle on
voyoit encore le temple du dieu Pan.
PERCALLE , f. f. ( Comin. des Indes.) Les perçai-
les font des toiles de coton blanches, plus fines que
groffes , qui viennent des Indes orientales, particulièrement
de Pontichery, Les percalUs portent fept
aunes 8c un quart de long, fur une aune 8c un huit
de large.
PERCE. Voyc%_ L o c h e .
Perce , f. f. ( Luth. ) outil dont les fiaôeitrs de
mufettes fe fervent pour perforer les chalumeaux ;
cet infiniment eft compofé d’une longue tige d’acier
cylindrique, emmanchée par une de fes, extrémités
dans une poignée comme une lime ; à l’autre
extrémité eft une meche femblable à celle de be-
douets. Voyei BEDO U E T , & la fig. de ces inltrumens ,
Pl. X . de Lutherie , fig. 1.5.
Perce-à-main, outil dont les fadeurs de mufettes
fe fervent pour percer les trous qui forment les dif-
férens tons de cet infiniment. Voyc{ l'article Per ce ,
& la fig. ig. P l. X . de Lutherie.
Cet outil ne différé de la perce qu’en ce que fa tige
8c fa meche font beaucoup plus courtes.
Perce-bourdon , reprefenté Pl. X . de Lutherie,
fig. 8. eft un outil dont les fadeurs de mufettes fe
fervent pour percer les trous des bourdons. C’eft
une efpece de foret emmanché comme une lime, que
l’on appuie contre l’endroit du bourdon où on veut
faire un trou, pendant que la piece d’ivoire dont le
bourdon eft fait, tourne fur le tour à lunette. Foyer
T our à lunette & T our entre deux Peintes.
PERCE-FEUILLE, f. f. (Hifl. nat. Bot.) ce genre
de plante eft nommé bupleuron par Tournefort. Il y
en a deux efpeces principales, la perce feuille vivace
8c la perce-feuille annuelle. La perce-feuille vivace, nommée
par le vulgaire oreille-de-lievre , en anglois tli»
hares-ear , eft le bupleuron vulgatifimum, feu folio fub
rotundo > I. B. H. 309.
Sa racine eft petite, ridée, verdâtre, fibrée, d’un
goût âcre. Elle pouffe une tige à la hauteur d’un ou
de deux piés, grêle, liffe, cannelée, noueufe, vuide
en-dedans , rameufe , de couleur quelquefois rougeâtre
, d’autrefois verte ; fes feuilles, fur-tout celles
de la tige , font longuettes , étroites , Amples, ner-
veufes, 8c rangées alternativement j»fes fleurs naif-
fent au fommet de la tige, 8c des rameaux en ombelles
, de couleur jaune, femblables à celles du fenouil ;
chacune d’elles eft compofée de plufieurs pétales dif-
pofés en rofe. Quand les fleurs font tombées , il leur
fiiccede des femences oblongues, affez femblables à
celles du perfil, cannelées , grifes, d’un goût âcre.
Cette plante croît abondamment aux lieux montagneux
, argilleux, le long des haies 8c parmi les brofr
failles ; elle fleurit en Juillet 8c A oû t, 8c fa graine
mûrit en Septembre 8c Oftobre. Elle fert en Médecine
; fes feuilles paffent pour déterfives 8c deflica-
tives ; fa femence eft réputée difeuflive 8c apéritive.
La perce-feuille annuelle, bupleuron perfoliatum
rotundi-folium, annuum, I. R. H. 310, ne différé de
la précédente qu’en ce qu’elle eft annuelle 8c fe multiplie
de graine. On lui donne des vertus aftringen-
tës. (D .J . )
PERCE-MOUSSE , f. f. (Hifl. nat. Bot. ) efpece
de capillaire , que Tournefort nomme mttfeus capil-
laceus 3 major 3pcdiculo & capitulo craffioribus3 /, R, H,