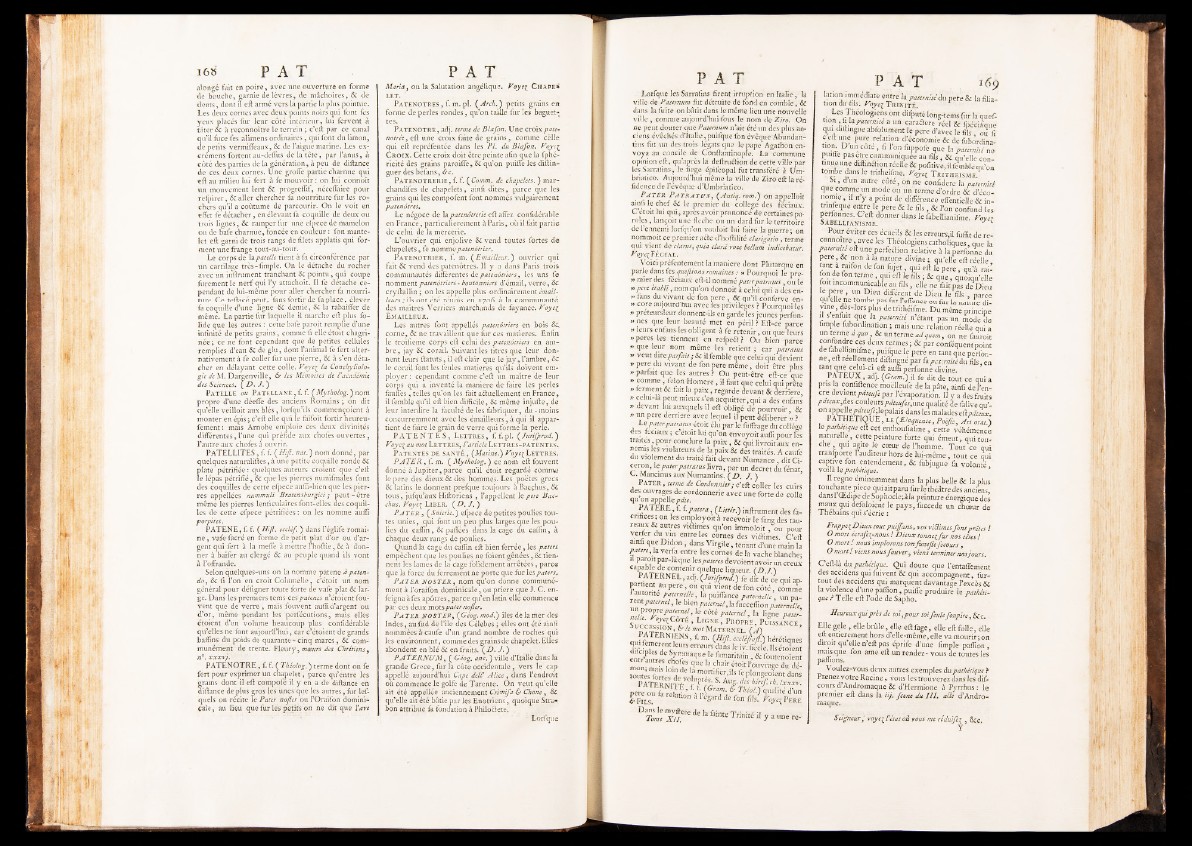
alongé fait en poire, avec une ouverture en forme
de bouclie, garnie de lèvres, de mâchoires, & de
dents, dont il eft armé vers la partie la plus pointue.
Les deux cornes avec deux points noirs qui font fes
yeux placés fur leur côté intérieur, lui fervent à
tâter & à reconnoître le terrein ; c’eft par ce canal
qu’il fuce fes alimens ordinaires , qui font du limon,
de petits vermiffeaux, & de l’aigue marine. Les ex-
crémens fortent au-deffus de la tête, par l’anus, à
côté des parties de la génération, à peu de diftance
de ces deux cornes. Une groffe partie charnue qui
eft au milieu lui fert à fe mouvoir : on lui connoît
un mouvement lent & progreflif, néceffaire pour
refpirer, & aller chercher fa nourriture fur les rochers
qu’il a coutume de parcourir. On le voit en
effet fe détacher, en élevant fa coquille de deux ou
trois ligues, & ramper fur une efpece de mamelon
ou de bafe charnue, foncée en couleur : fön mante-
let eft garni de trois rangs de filets applatis qui forment
une frange tout-au-tour.
Le corps de la patelle tient à fa circonférence par
un cartilage très-fimple. On le détache du rocher
avec un infiniment tranchant & pointu, qui coupe
fixement le nerf qui l’y attachoit. Il fe détaché cependant
de lui-même pour aller chercher fa nourriture.
Ce teftacé peut, fans fortir de fa place, élever
fa coquille d’une ligne & demie, & la rabaiffer de
même. La partie fur laquelle il marche eft plus fo-
lide que les autres : cette bafe paroit remplie d’une
infinité de petits grains, comme fi elle étoit chagrinée
; ce ne font cependant que de petites cellules
remplies d’eau & de glu, dont l’animal fe fert alternativement
à fe coller fur une pierre, & à s’en détacher
en délayant cette colle. Voye^ la Conchyliologie
de M. Dargenville, 6* les Mémoires de l'académie
des Sciences. ( D . J.')
Patelle ou Pa tel lane, f. f. (Mytkolog.) nom
propre d’une déeffe des anciens Romains ; on dit
qu’elle veilloit aux blés, lorfqu’ils commençoient à
monter en épis ; c’eft elle qui le faifoit fortir heureu-
fement: mais Arnobe emploie ces deux divinités
différentes, l’une qui préfide aux chofes ouvertes,
l’autre aux chofes à ouvrir.
PATELLITES, f. f. ( Hiß. nat. ) nom donné, par
quelques naturaliftes, à une petite coquille ronde &
plate pétrifiée : quelques auteurs croient que c’eft
le lépas pétrifié, & que les pierres numifmales font
des coquilles de cette efpece aufli-bien que les pierres
appellées nummuli Bratensburgici ; peut - être
même les pierres lenticulaires font-elles des coquilles
'de cette efpece pétrifiées : on les nomme aufli
porpites.
PATENE, f. f. (Hiß. eccléf. ) dans l’églife romaine
, vafe facré en forme de petit plat d’or ou d’argent
qui fert à la meffe à mettre l’hoftie, & à donner
à Baifer au clergé & au peuple quand ils vont
à l’offrande.
Selon quelques-uns on la nomme patene à paten-
do, & li l’on en croit Columelle, c’étoit un nom
général pour défigner toute forte de vafe plat & large.
Dans les premiers tems ces patents n’étoient fou-
vent que de v er re, maislfouvent aufli d’argent ou
d’or, même pendant les ‘persécutions, mais elles
étoient d’un volume beaucoup plus confidérablë
qu’elles ne font aujourd’hui, car c’étoient de grands
baflins du poids de quarante - cinq marcs , & communément
de trente. Fleury, moeurs des Chrétiens, 72°. xxxvj. • 1
PATENOTRE, f. f. ( Théolog. ) terme dont on fe
fert pour exprimer un chapelet, parce qu’entre les
grains dont il eft compofé il y en a de diftance eh
diftance déplus gros les unes que les autres, fur lef-
quels on recite le Pater noßer öu l’Oraifon dominicale,
au lieu que fur les petits on ne dit que l’ave
Maria t ou la Salutation angélique. Toye^ C hapes
LET.
Patenôtres , f. m. pl. ( Arch. ) petits grains en
forme de perles rondes, qu’on taille fur les baguet«
tes'.
Pa ten otre, adj. terme de B lo f on. Une croix pate-
notrée, eft une croix faite de grains, comme celle
qui eft repréfentée dans les Pl. du Blafon. H>yc^
C ro ix . Cette croix doit être peinte afin que la fphé-
ricité des grains paroiffe, & qu’on puiffe les diftin-
guer des befans, &c.
Patenotrerie , f. f. ( Comm. de chapelets. ) mar-
chandifes de chapelets, ainli dites, parce que les
grains qui les compofent font nommés vulgairement
patenôtres.
Le négoce de la patenotrerie eft allez confidérablë
en France, particulièrement à Paris, où il fait partie
de celui de la mercerie.
L’ouvrier qui enjolive & vend toutes fortes de
chapelets, fe nommepatenôtiier.
Paten otrier, f. m. ( Emailleur. ) ouvrier qui
fait & vend des patenôtres. Il y a dans Paris trois
communautés différentes de patenôtriers, les uns fe
nomment patenôtriers - boutonniers d’émail, verre, &
cryftallin ; on les appelle plus ordinairement émail-
leurs ; ils ont été réunis en 1706 à la communauté
des maîtres Verriers marchands de fayance. Voye£
Émailleur.
Les autres font appellés patenôtriers en bois Sc.
corne, & ne travaillent que fur ces matières. Enfin
le troifieme corps eft celui des patenôtriers en ambre
, jay & corail. Suivant les titres que leur donnent
leurs ftatuts, il eft clair que le ja y , l’ambre, &
le corail font les feules matières qu’ils doivent employer
: cependant comme c’eft un maître de leur
corps qui a inventé la maniéré de faire les perles
faillies , telles qu’on les fait actuellement en France ,
il femble qu’il eft bien difficile, & même injufte, de
leur interdire la faculté de les fabriquer, du - moins
concurremment avec les émailleurs, à qui il appartient
de faire le grain de verre qui forme la perle.
P A T E N T E S , L ettres , f. f. pl. ( Jurifprud. )
Voyci au mot LETTRES, l'article LETTRES-PATENTES.
Patentes de santé , (Marine.') Voye{ Lettres.
P A T E R , f. m. ( Mytholog. ) ce nom eft fouvent
donné à Jupiter, parce qu’il étoit regardé comme
le pere des dieux & des hommes. Les poètes grecs
& latins le donnent prefque toujours à Bacjhus, &
tous, jufqu’aux Hiftoriens , l’appellent le pere Bat*
chus. Voyei LiBER. (D . J . )
P A t e r , ( Soierie. ) efpece de petites poulies toutes
unies, qui font un peu plus larges que les poulies
du caflin, & paffées dans la cage du caflïn, à
chaque deux rangs de poulies.
Quand la cage du caflin eft bien ferrée, les paters
empêchent que les poulies ne foient gênées, & tiennent
les lames de la cage folidement arrêtées, parce
que la force du ferrement ne porte que fur les paters.
P a t e r n o s t e r , nom qu’on donne communément
à l’oraifon dominicale, ou priere que J. C. en-
feigna à fes apôtres, parce qu’en latin elle commence
par ces deux mots paternofier.
P a t e r n o s t e r , (Géog. mod. ) îles de la mer des
Indes, au fud de l’île des Célebes ; elles ont été ainfî
nommées à caufe d’un grand nombre de roches qui
les environnent, comme des grains de chapelet. Elles
abondent en blé & en fruits. (D . J .)
PATERNUM, ( Géog. anc. ) ville d’Italie dans la
grande Grece, fur la côte occidentale, vers le cap
appêllé aujourd’hui Cape dell’ Alice , dans Tendrait
où commence le golfe de Tarente. On veut qu’elle
ait été appellée anciennement Crimifa & Chone, &
qu’elle ait été bâtie par les Enotriens, quoique Stra-
bon attribue fa fondation à Philoélete.
Lorfque
Lorfque les Sarrafins firent irniption en Italie , la
ville de Patemum fut détruite de fond en comble, &
dans la fuite on bâtit dans le même lieu une nouvelle
v ille , connue aujourd’hui fous le nom de Zéro. On
ne peut douter que Paternum n’ait été un des plus anciens
évêchés d’ Italie, puifque fon évêque Abundan-
tius fut un des trois légats que le pape Agathon envoya
<tu concile de Conftantinôpîe. La commune
opinion .eft , qu’après la deftruélion de cette v ille par
les Sarrafins, le fiege épifcopal fut transféré à Um-
briatico. Aujourd’hui même la ville de Ziro eft la ré-
fidence de l’évêque d’Umbriatico.
P a t é r P a t r a t u s , (Antiq. rom.) on appelioif
ainfi le chef & le premier du College des féciaux.
C’etoit lui qui, après avoir prononcé de certaines paroles
, lançoit une fléché ou un dard fur le territoire
de l’ennemi lorfqu’on vouloit lui faire la guerre ; on
nommoit ce premier adle d’hoftilité clarigàtio, terme
qui vient de clarus, quia clara voce bellum indicebaluti
Voyei F é c i a l . '
Voici préfentement la maniéré dont Plutarque en
parle dans fes quefiions romaines : » Pourquoi le pre-
» mier des féciaux eft-il nommé paterpatratus , ou lé
»pere établi, nom qu’on donnoit à celui qui a des en-
» fans du vivant de fon pere , & qu’il conferve en-
» core aujourd’hui avec fes privilèges ? Pourquoi les
» préteursleur donnent-ils en garde les jeunes perfon-
» nés que leur beauté met en péril ? Eft-ce parce
» leuis enfans les obligent à fe retenir, ou que leurs
» peres les tiennent en refpeft ? Ou bien parce
»que leur nom même les retient ; car patratus
» veut dite parfait ; & il femble que celui qui devient
» pere du vivant de fon pere meme, doit être plus
» parfait que les autres ? Ou peut-être eft-ce que
» comme, félon Homere , il faut que celui qui prête
» ferment & fait la pa ix, regarde devant & derrière,
» celui-là peut mieux s’en acquitter, qui a des enfans
» devant lui auxquels il eft obligé de pourvoir, &
» un pere derrière avec lequel il peut délibérer» ?
Lyaerpatratus étoit élu par le fuffrage du collège
des féciaux ; c’étoit lui qu’on envoyoit aufli pour les
traites pour conclure la paix, & qui livrait aux ennemis
les violateurs de la paix & des traités. A caufe
du violement du traité fait devant Numance dit Ci-
ceron, le pater patratus livra, par un decret du fénat,
Mancinus aux Numantins. (D . J . )
P a t e r , terme de Cordonnier; c’eft coller les cuirs
des ouvrages de cordonnerie avec une forte de colle
qu on appelle pâte.
PATERE, f. f. paiera, (tiuér.) infatment t e fa-
crifices ; on les employoit i recevoir le fan» des taureaux
& autres viâimes qu’on imrnoloit, ou pour
verfer du vm eiitreTes cornes des viftimes. C’eft
amfi que Didon, dans Virgile, lenant d’irnë main la
paterc,W v e îft entre les cornes de 1a vache blanche;
il paroit par-là que les paiercs dévoient avoir un creux
capable de contenir quelque liqueur. (D J Y
PATERNEL, adj. (Jurifpmd.) fe dit de ce qui appartient
au pere, où qui vient de fon côté, commè
1 autorité paternelle, lapuiffince patcrndU un^oa-
rent paternel y le bien p a t e r n e l ,h f^ B io n p a Æ
■ g n l côt® i n , la ligné pater-
S u ^ ’ LlGNE’ P r0 p r e> Puissance,
n ? Ï S IONI & * mo‘ Ma ternel H |
PATERNIENS, f. m. (Hijl. ea/éL/l.) hérétiques ■ h h n i le i M «s i n
— famaritaih , & fotrtdhoienf
B U B E I que la chair étoit Pouvrage du dé-
M Ü B f f l Io” . * !? mortifier,ils feplongeoîent dans
i i iM B iM H s. au», des mm mm
pere où rehf ’ H H ^ Thial.) qualité d’un
S f iiT ° ” à 1W & fon 6ts. h y i i Pere
Tome <le ix{^nte B y â nue te-'
lafon immédiafè entré l ip a l e r n i t é du.péfe & la filia-
tion du fils. Hoyer^ T rin ité.
Les^héolôgiensipnt aifputélohgftèiifsTuflaqUef. mimmmaÆ m H H WHIIB
quii dfthngiie abfolument le pere d’avedlé fils ou fi
ce ft uqq pure .relation-dl&OHomie & de fubordinatiorn
D un cô te, fi lonfuppofe que la patlmhl ne
puifie pas erre communiquée au fils, & qu’elle con
H H U U S E B & pofitiyeilfeurblé qu’on
tombe dansle tritheifme. T ritheisme!* -
S i , d’un autre côfé on ne coniiderc la paternité
que comme un îhôffi ou u»’ ;érHe d’ordre Se d’écq-,
notmè, il ri y a point de d ïff& iiç e efferitielle & intrmfeque
entrelé pere & l’on confond les,
petlonrtes. C eft donner dans le Sbellianifine. F o y e r
SABELLIANISME. ' ' J ^
Pour éviter cés écuals & les erreurs,il fuffit de re-
connoure, avec les Théologiens catholiques, que H
paretniK ëft ùne'perfeaion relative i la perfonîte du:
p ete, & non à la natqrq divine; qu’elle eft réelle
tant à raifôn de fon fi,jet, qnieft le p ere, qujà rai’
fon de fon terme , qui èft le Sis ; & que, quoiqu’elle
fort incommunicable au Bis , elle ne 6 it p is deDieti
le pere , un Dieu différent de t>ieu, je fils -, riareg
D elle" e ?omb« pàLiùt i effence ou fur la nature di-
vme, dès-lors plus de^tjithéaine. Du même principe
il s enfùit que la patepnue p'étant pas un mode de
lnpple lubordination ; mais^une relation réelle qui a
un terme a quo , 8c un terme adquem, on ne fauroit
confondre ces deux reimes; & par cooféquentpoint
de lapelliantfme, puifque le pere en tant que perfon-
ne, eft reetlement diftmgué par i a p a r r n ü i ia fils, en
tant que Celiïi-ci eft nerfqrine divine.
PA TEU X , adj. t e dit de tout ce quia
pris la confiftence moëlleufe de la pâte, ainfi de l’encre
devientpâteufe par l’évaporation. Il y a des fruits
p â te u x , d e s couleurs p â teufes, une qualité de falive qu-
0n^P^f < pdteufe'Jte paiais dans les malades eft pâteux,.
PATHETIQUE, LE (E lo q u en c e , P o è fie, A r t orat.)
le pathétique eft cet enthoufiafme , cette véhémence
naturelle , cette peinture forte qui émeut, qui touY
ch é , qui agite le coeur de l’homme. Tout ce qui
tranfporte 1 auditeur hors de lui-même, tout ce qui
captive fon entendement, & fubjugue fa volonté
VOïla le pathétique.
P fêgnè éminemment dans la plus belle & là plus
toiichante piece qui ait paru furie théâtre des anciens,
dansl OEdipe de Sophoclejàla peinture énergique des
maux qui cefoloicnt le pays, fuccedc un choeur de
‘I‘héba:ns qui,s’écrie *.
Frappe^ D i e u x mut p u iffan s , v os victimes f o n t p i lle s !
O mort éc rafei-m u s / D i e u x to n n c { fu r n o s t lte s !
O m o r t J n ous implorons to rtfu n ejtefscows , ' ' i;
O m an ! viens rwusfatever, r ien s terminer nos jo tù s ,
C’eft-lâ du pathétique. Qui doute que Pentaffemént
des açcideris qui fuivent & qui accompagnent, fur-
tout déVàccidenS qui marquent davantage l’excès &
la violence d’une paffion, puiffe produire le pathéei-
que é Telle eft l’ôde de Sapho.
Heureux qui prés de to iy fp u r to ifeu le j o i l fm , & c. ,
Elle gele ,, elle brille, elle eft fage ’ elle eft folle , elle
eft entièrement hors d’elle-même, elle va-rtiourir; on
diroit qu’elle n’eft pas éprife d’une fifflple paffion ,
ntais,que fon, ame eft un rendez - vous de toutes les
pallions.
Voulez-Vous deux autres exemples du pathétique ?
Prenez votre Racine, vous les trouverez dans les dif*
cours d Andromaque & d’Hermione à Pyrrhus : le
premier eft dans la i i j . fe en e du I I I . acte d’Andromaque.
Seigneur, voye^Cétat où vous me reduife{ , &c.
Y