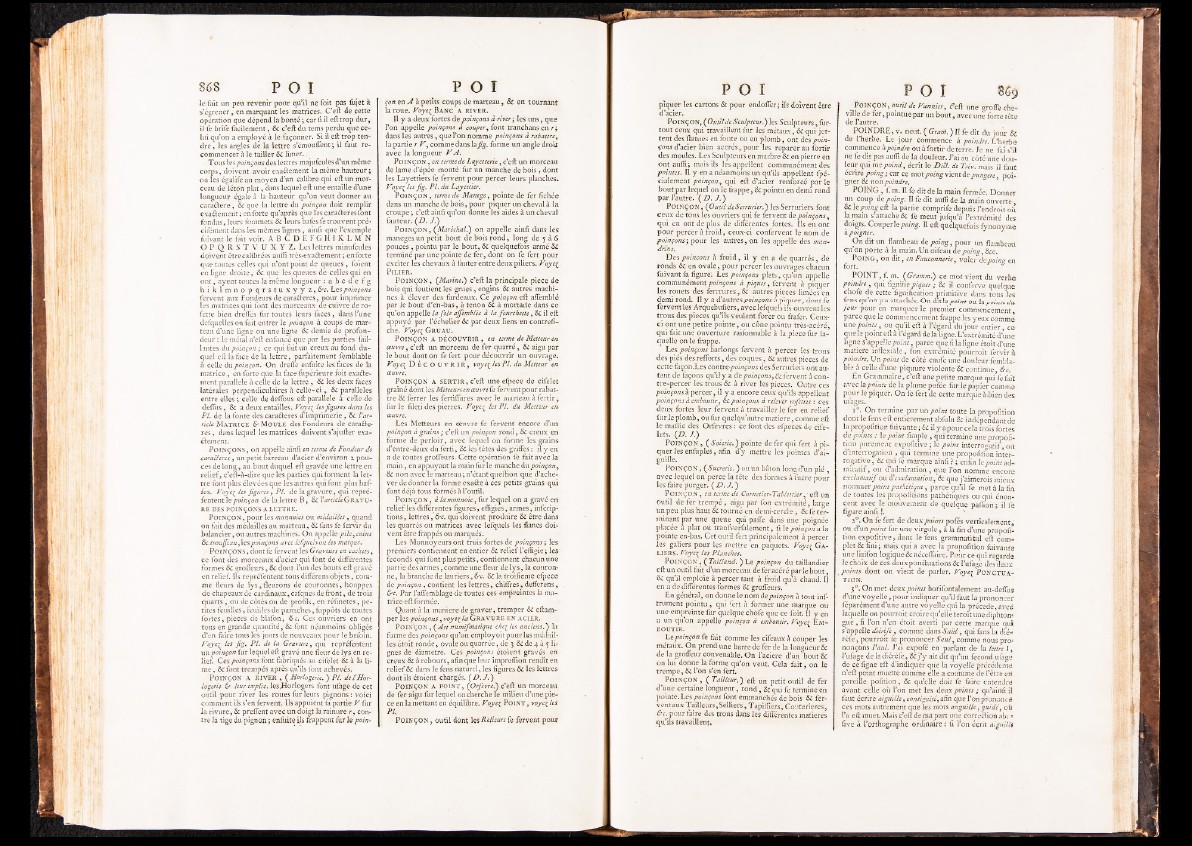
le fait un peu revenir pour qu’il ne foit pas fujet à
s’égrener, en marquant les matrices. C’eft de .cette
operation que dépend la bonté ; car fi il eft trop dur,
il fe brife facilement, 6c c’eft du tems perdu que celui
qu’on a employé à le façonner. Si il eft trop tendre
, les angles de la lettre s’émouffent ; il faut recommencer
à le tailler 6c limer..
T ous les poinçons des lettres majufcules d’un même
corps, doivent avoir exaftement la même hauteur ;
on les égalife au moyen d’un calibre qui eft un morceau
de létôn plat, dans lequel eft une entaille d’une
longueur égale à la hauteur qu’on veut donner au
caraôere, 6c que la lettre du poinçon doit remplir
exaûement; en forte qu’après que les carafteres font
fondus, leurs fommets 6c leurs bafesfe trouvent pré«
cifément dans les mêmes lignes, ainfi que l’exemple
fuivant le fait voir. A B C D E F G H I K . L M N
O P Q R S T V U X Y Z . Les lettres minufcules
doivent être calibrées auffi très-exaélement ; enforte
que toutes celles ciui n’ont point de queues, foient
en ligne droite, 6c que' les queues de celles qui en
on t, ayent toutes la même longueur : a b c d e f g
h i k l m n o p q r s t u x y y z , &c. Les poinçons
fervent aux Fondeurs de caraéleres, pour imprimer
les matrices qui font des morceaux de cuivre de ro-
fette bien dreffés fur toutes leurs faces , dans l’une
defquelles on fait entrer le poinçon à coups de marteau
d’une ligne ou une ligne 6c demie de profondeur
: le métal n’eft enfoncé que par les parties {aillantes
du poinçon ; ce qui fait un creux au fond duquel
eft la face de la lettre, parfaitement femblable
à celle dit poinçon. On dreffe enfuite les faces de la
matrice, en forte que. la face fupérieure foit exactement
parallèle à celle de la lettre, 6c les deux faces
latérales perpendiculaires à ce lle - c i, 6c parallèles
entre elles ; celle de deffous eft parallèle à celle de
défiais, 6c a deux entailles. Voye[ Us figures dans Us
Pl. de la fonte des caraôeres d’imprimerie, 6c Car-
ticU M a t r i c e & M o u l e des Fondeurs de caractères
, dans lequel les matrices doivent s’ajufter exactement.
P o i n ç o n s , on appelle ainfi en terme de Fondeur de
caractères , un petit barreau d’acier d’environ i pouces
de long, au bout duquel eft gravée une lettre en
relief, c’eft-à-dire que les parties qui forment la lettre
font plus élevées que les autres qui font plus baffes.
Voyei Us figures , Pl. de la gravure, qui repré-
fentent le poinçon de la lettre B, 6c Y article G r a v u r
e DES POINÇONS A LETTRE.
P o i n ç o n , pour les monnaies ou médailles, quand
on fait des médailles au marteau, 6c fans fe fervir du
balancier, ou autres machines. On appelle pile, coins
6c trou ffeau, les poinçons avec leCquels on les marque.
POIN ÇO N S , dont fë fervent les Graveurs en cachets,
ce font des morceaux d’acier qui font de différentes
formes & groffeurs, & dont l’un des bouts eft gravé
en relief. Ils repréfentent tous différens objets, comme
fleurs de lys,fleurons de couronnes, houppes
de chapeaux de cardinaux , cafques de front, de trois
quarts , oii de côtés ou de profils, en réfinetes, petites
feuilles, feuilles de panaches, fuppôts de toutes
fortes, pièces de blafon, 6 c. Ces ouvriers en ont
tous en grande quantité, 6c font néanmoins obligés
d’en faire tous les jours de nouveaux pour le befoin.
Voye%_ Us fig. Pl. de la Gravure, qui repréfentent
un poinçon fur lequel eft gravé une fleur de lys en relief.
Ces poinçons font fabriqués au cifelet & à la lime
, & font trempés après qu’ils font achevés*
POIN ÇON A RIV ER , ( Horlogerie. ) Pl. de ÜHorlogerie
6* leur explic. les .Horlogers font ufage de cet
outil pour river les roues fur leurs pignons : voici
comment ils s’en fervent. Ils appuient fa partie V fur
la rivure, & preffent avec un doigt la rainure r, contre
la tige du pignon ; enfuite ils frappent fur le poinçon
en A à petits coups de marteau, & en tournant
la roue. Voye^ B a n c a r iv e r .
Il y a deux fortes de poinçons à river ; les uns, que
l’on appelle poinçons à couper, font tranchans en r;
dans les autres, que l’on nomme poinçons à rabattre,
la partie r V , comme dans lafig. forme un angle droit
avec la longueur V A .
P o i n ç o n , en terme de Layetterie, c’eft un morceau
de lame d’épée monté fur un manche de bois, dont
les Layettiers fe fervent pour percer leurs planches*
Voye^ Us fig. Pl. du Layettier.
P o i n ç o n , terme de Manege, pointe de fer fichée
dans un manche de bois, pour piquer un cheval à la
croupe ; c’eft ainfi qu’on donne les aides à un cheval
fauteur. (2?. /.)
P o i n ç o n , (Maréchal.) on appelle ainfi dans les
maneges un petit bout de bois rond, long de 5 à 6
pouces , pointu par le bout, 6c quelquefois armé &
terminé par une pointe de fer, dont on fe fert polir
exciter les chevaux à fauter entre deux piliers. Voye%
P i l i e r .
P o i n ç o n , (Marine.) c’eft la principale piece de
bois qui foutient les grues, engins 6c autres machines
à élever des fardeaux. Ce poinçon eft aflfemblé
par le bout d’éîi-bas, à tenon 6c à mortaife dans ce
qu’on appelle la foie ajfemblée à la fourchette, & il eft
appuyé par l’échelier 6c par deux liens en contrefi-
che. Voye^ G r u a u .
P o in ç o n a d é c o u v r i r , en terme de Metteur en
oeuvre, c’eft un morceau de fer quarré, 6c aigu par
le bout dont on fe fert pour découvrir un ouvrage.
Voye^ D É C O U V R I R , voye^ Us Pl. du Metteur en
oeuvre.
P o i n ç o n a s e r t i r , c’eft une efpece de cifelet
grainé dont les Metteurs en oeuvre fe fervent pour rabattre
& ferrer les fertilfures avec le marteau à fertir,
fur le fileti des pierres. Voyeç Us PL du Metteur en
oeuvre.
Les Metteurs en oeuvre fe fervent encore d’un
poinçon àgrains ; c’eft un poinçon rond, 6c creux en
forme de perloir, avec lequel on forme les grains
d’entre-deux du ferti, & les têtes des griffes : il y en
a de toutes groffeurs. Cette opération fe fait avec la
main, en appuyant la main fur le manche du poinçon,
6c non avec le marteau; n’étant queftion que d’achever
de donner la forme exafte à ces petits grains qui
font déjà tous formés à l’outil.
P o i n ç o n , à lamonnoie, fu r l e q u e l o n a g r a v é en
r e l i e f le s d iffé ren te s f ig u r e s , e f f ig ie s , a rm e s , in fc r ip -
t io n s , l e t t r e s , &c. q u i d o iv e n t p ro d u ir e & ê t r e d an s
le s q u a r ré s o u m a tr ic e s a v e c le fq u e ls le s flanc s d o iv
e n t ê t r e frap p é s o u m a rqu é s .
Les Monnoyeurs ont trois fortes de poinçons ; les
premiers contiennent en entier 6c relief l’effigie ; les
féconds qui font plus petits, contiennent chacun une
partie des armes, comme une fleur de ly s , la couronne,
la branche de lauriers, &c. 6c la troifieme efpece
de poinçon, contient les lettres, chiffres, defferens ,
&c. Par l’affemblage de toutes ces empreintes la matrice
eft formée.
Quant à la m a n ié r é d e g r a v e r , t r em p e r 6c e ftam -
p e r le s poinçons, voye^ la G r a v u r e En a c i e r .
P o i n ç o n , (Art numifmatique cheç Us anciens.) la
forme des poinçons qu’on employoit pour les médailles
étoit ronde, ovale ou quarrée, de 3 6c de 4 à 5 lignes
de diamètre. Ces poinçons étoient gravés en
creux 6c à rebours, afin que leur impreffion rendît en
relief6c dans le fens naturel, les figures 6c les lettres
dont ils étoient chargés. (D .J .)
P o i n ç o n a p o in t , (Orfevre.) c’ eft un morceau
de fer aigu fur lequel on cherche le milieu d’une piece
en la mettant en équilibre. Voye\ P o in t , voyelles
P l:
P o i n ç o n , outil dont les Relieurs fe fervent pour
piquer les cartons & pour endoffer; ils doivent être
d ’acier.
P o in ç o n , (Outilde Sculpteur?) les Sculpteurs, fur-
tout ceux qui travaillent fur les métaux, 6c qui jettent
des ftatues en fonte ou en plomb, ont des poinçons
d’acier bien acérés, pour les reparer au fortir
des moules. Les Sculpteurs en marbre 6c en pierre en
ont auffi; mais ils les appellent communément des
pointes. Il y en a néanmoinsfrn qu’ils appellent fpé-
rialement poinçon, qui eft d’acier renforcé par le
bout par lequel on le frappe, 6c pointu en demi rond
par l’autre. (D . J .)
P o i n ç o n , (Outil de Serrurier.) les Serruriers font
ceux de tous les ouvriers qui fe fervent de poinçons,
qui en ont de plus de différentes fortes. Ils en ont
pour percer à froid, ceux-ci confervent le nom de
poinçons ; pour les autres, on les appelle des mandrins.
Des poinçons à froid, il y en a de quarrés, de
fonds 6c en ovale, pour percer les ouvrages chacun
fuivant fa figure'. Les poinçons plats, qu’on appelle
communément poinçons à piquer, fervent à piquer
les rouets des ferrrures, 6c autres pièces limées’en
demi rond. Il y a d’autres poinçons à piquer, dont fe
fervent les Arquebufiers, avec lefquels ils ouvrent les
trous des pièces qu’ils veulent forer ou frafer. Ceux-
c i ont une petite pointe, ou cône pointu très-acéré,
qui fait une ouverture raifonnable à la pièce fur laquelle
on le frappe.
Les poinçons barlongs fervent à percer les trous
des piés des refforts, dés coques, 6c autres pièces de
cette façon.Les contre-poinçons des Serruriers ont autant
de façons qu’il y a dé poinçons, & fervent à con-
tre-percer lès trous 6c à river lés pièces; Outre ces
poinçons à percer, il y a encore ceux qu’ils appellent
poinçons à emboutir, 6c poinçons à relever rofettes : ces
deux fortes leur fervent à travailler le fer en relief
fur le plomb, oufur quelqu’autre matière, comme eft
le maftic des Orfèvres : ce font dès efpecéS de cife-
lets. (D . J.)
POIN ÇO N , ( Soierie. ) p o in te de fe r q u i fe r t à p iq
u e r le s e n fu p le s , a fin d’y m e t tr e le s p o in te s d ’a ig
u ille .
P O IN ÇO N , (Sucrerie. ) ou un bâton long d’un pié ,
avec lequel on perce la tête des formes à fucre pouf
les faire purger. ( D . J . )
PoiNÇO N , en terme de Cornetier-TabUttier,~ eft ûh
Outil de fer trempé, aigu par fort extrémité, large
Un peu plus haut 6c tourné en demi-cercle , 6c fe terminant
par une queue qui paffe dans une poignée
placée à plat Où tranfverfalement, fi le poinçon a la
pointe en-bas. Cet outil fert principalement à percer
les galiers pour les mettre en paquets. Voye^ Ga -
LIERS. Voye\_ lis Planches.
P o i n ç o n , ( Tailland. ) Le poinçon du taillandier
eft un outil fait d’un morceau de fer acéré parle bout,
6c qu’il emploie à percer tant à froid qu’à chaud. Il
en a dé différentes formes 6c groffeurs.
En général, on donne le nom de poinçon à tout infr
trument pointu, qui fert à former une marque ou
une empreinte fur quelque chofe que ce foit. Il y en
a un qu’on appelle poinçon à emboutir. Voye? EMBOUTIR.
he poinçon fe fait comme les cifeaux à couper les
métaux. On prend une barre de fer de la longueur &
delà groffeur convenable. On Tarière d’un bout &
on lui donne là forme qu’on veut. Cela fa it , on le
trempe, 6c l’on s’en fert.
P o i n ç o n , ( Tailleur.) eft un petit outil de fer
d’une certaine longueur, rond, 6c qui fe terminé en
pointe. Les poinçons font emmanchés de bois 6c fervent
aux T ailleurs, Selliers, Tapiffiers, Couturières,
&c. pour faire des trous dans les différentes matières
qu’ils travaillent,
POINÇON, outil de Vannier, tfeft une groffè chè-
ville de fer, pointue par un bout, avec une forte tête
de l’autre.
POINDRE , y. iiéut. ( GrarA. ) ïl fe dit du jour 6c
de l’herbe. Le jour Commence à poindre. L’herbe
commence à poindre ou à fortir de terre. Je ne fai s’il
ne fe dit pas auffi de là douleur. J’ai au côté une douleur
qui mepoind, écrit le D'ici, de Trév. mais il faut
écrire poing ; car ce mot poing vient de pungere, poi-
'gner 6c non poindre.
POING, f. m. Il fe dit de la main fermée. Donner
Un Coup de poing. Il fe dit auffi de la main ouverte ,
6c lé poing eft la partie comprife depuis l’endroit oit
la main s’attache & fe meut jufqu’à l’extrémité des
doigts. Couper lé poing. Il eft quelquefois fynonyme
à poigner.
On dit un flambeau de poing, pour ün flambeau
qu’On porte à la main. Un oifeau de poing, 6cc.
P o in g , on dit, en Fauconnerie, voler dé poing en
fort. °
POINT, f. m. (Gfàmm.) ce mot vient du yerbû
poindre , qui fignihé piquer ; 8c il conferve quelque
chofe de cette lignification primitive dans tous les
lens qu on y a attaches. On dit le point ou la pointe du
jour pour en marquer le premier commencement,
parce que le commencement frappe les yeux comme
une pointe, ou qu’il eft à l’égard du jour entier, ce
que le point eft à 1 egard de la ligne. L’extrémité d’une
ligne s’appellep oint, parce que fi la ligne étoit d’une
matière inflexible, fon extrémité pourroit fervir à
poindre. Un point de côté caufe une douleur femblable
à celle d’une piquure violente 6c continue, &c.
En Grammaire, c’eft une petite marqué qui fêlait
avec h pointe de la plume pofée fur le papier comme
pour le piquer. On fe fert de cette marque à-bien des
ufages.
i°. On terminé par Un point toute la proposition
dont le fens eft entièrement abfolu 6c indépendant de
la propofition fuivante ; 6c il y a pour cela trois fortes
de points ; lé point fimple , qui termine une propofition
purement expofitive ; le point interrogatif oit
d’irtterrogâtion , qui termine une propofition interrogative
, 6c qui fe marqué ainfi ? ; enfin le p o in t é
mitatif, ou d’admiration , que Ton nomme encore
exclatnatif ou d’exclamation, & que j’aimerois mieux
nommer point pathétique, parce qu’il fe met à la firt
de toutes les proportions pathétiques ou qui énoncent
avec le mouvement de quelque paffion; il fâ
figure ainfi !. s
20. On fe fert de deux points pofés verticalement,
qu d’un point fur urïe virgule, à la fin d’une propofi*
tion expofitive, dont le fens grammatical eft complet
& fini ; mais qui à avec la propofition fuivants
Une liaifon logique &néceffaire. Pour Ce qui regarde
le choix de ces deux p onctuâtions 6c l’ufage des deux
points dont on vient de parier. Voye^ P o n c t u a -
t io n .
30. On met deux points horifontalement au-deffuà
d’une voyelle, pour indiquer qu’il faut la prononcer
féparément d’une autre voyelle qui la précédé, avec
laquelle on pourroit croire qu’elle teroit une diphtongue
, fi Ton n’en étoit averti par cette marque qui
s’appelle diéréft, comme dans Saul, qui fans la dié-
rèle, pourroit fe prononcer Saul, comme nous prononçons
Paul. J’ai expbfé en parlant de la lettre I ,
l’ufage deladiérèfe, & j’y ait dit qu’un fécond ufage
de ce ligne eft d’indiqiièr que lâ voyelle précédente
n’eft point muette comme elle a coutume de l’être eii
pareille pofition, & qu’elle doit fe frire entendre
avant celle oii Ton met les deux points ; qu’aiftfi il
faut écrire aiguille f contiguïté, afin que Tort prononcé
ces mots autrement que les mots anguille, guidé, ch
Vu eft muet. Mais c’eft de ma part une correction abi »
five à f orthographe ordinaire : fi Ton écrit aïguUU