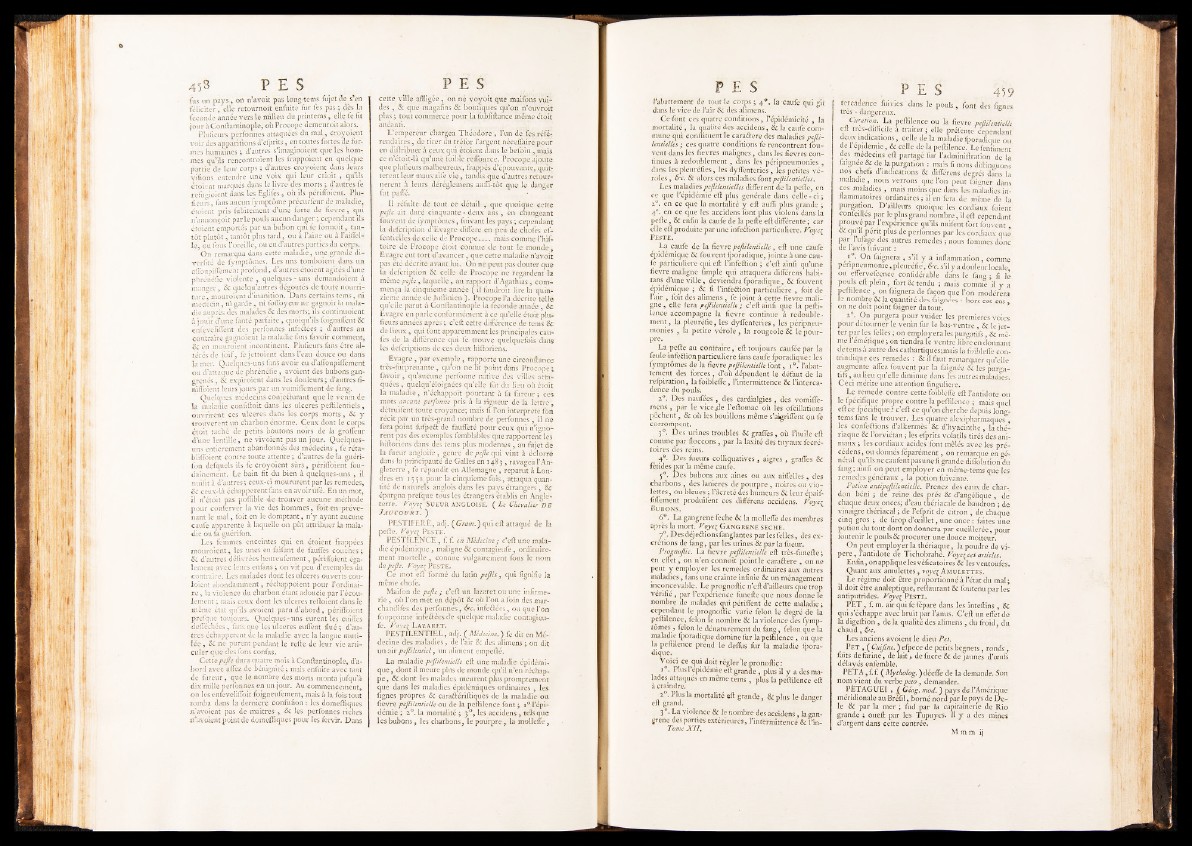
b
o
S
458 P E S
fus un pa ys, on n’avoit pas long-tems fujet de s’ en
féliciter , elle retournoit enfuite lur fes pas ;,dès la
fécondé année vers le milieu du printems, elle fe fit
jour à Conftantinople, où Procope demeuroit alors.
Plufieurs perfonnes attaquées du mal, croÿoient
•voir des apparitions d’efprits, en toutes fortes de formes
humaines ; d’autres s’imaginoient que les hommes
qu’ils rencontroient les frappoient en quelque
partie de leur corps ; d’autres croÿoient dans leurs
yifions entendre une voix qui leur crioit , qu ils
étoient marqués dans le livre des morts ; d’autres fe
refù«ioient dans les Eglifes, où ils périfl'oient. Plufieurs
fans aucun fymptôme précurfeur de maladie,
étoient pris fubitement d’une forte de fievre, qui
n annonçoit parle poids aucun danger ; cependant ils
étoient emportés par un bubon qui fe formoit, tantôt
p lutôt, tantôt plus tard, ou à l’aine ou à l’aiflèl-
le, ou fous l’oreille, oiren d’autres parties du corps.
On remarqua dans cette maladie, une grande di-
verfité de fymptômes. Les uns tomboient dans un
aflouoiflèment profond, d’autres étoient agités d’une
phrénéfie violente , quelques - uns demandoient à
manger, 8c quelqu’autres dégoûtés de toute nourriture
, mouroient d’inanition. Dans certains tems, ni
médecin, ni garde, ni fofibyeur ne gâgnoit la maladie
auprès des malades 6c des morts; ils continuoient
à jouir d’une fanté parfaite, quoiqu’ils foignafl'ent 8c
ênfeveliiTent des perfonnes infsftées ; d’autres au
contraire gagnoient la maladie fans favoir comment,
tk en mouroient incontinent. Plufieurs fans être altérés
de foif, fe jettoient dans l’eau douce ou dans
la mer. Quelques-uns fans avoir eu d’afloupiflèment
çu d’attaque de phrénéfie , avoient des bubons gangrenés
, 8c expiroient dans les douleurs ; d’autres fi-
nifîoient leurs jours par un vomiflèment de fang.
Quelques médecins conje&urant que le venin de
la maladie confiftoit dans les ulcérés peftilentiels,
ouvrirent ces ulcérés dans les corps morts, 8c y
trouvèrent un charbon énorme. Ceux dont le corps
étoit taché de petits boutons noirs de la groflèur
d’une lentille, ne vivoient pas un jour. Quelques-
uns entièrement abandonnés des médecins , fe réta-
blifloient contre toute attente ; d’autres de la guéri-
fon defquels ils fe croÿoient sûrs, périfl'oient fou-
dainement. Le bain fit du bien à quelques-uns , il
nuifit à d’autres ; ceux-ci moururent par les remedes,
6c ceux-là échappèrent fans en avoir üfé. En un mot,
il n’étoit pas poflible de -trouver aucune méthode
pour conlerver la vie des hommes, foit en prévenant
le mal, foit en le domptant, n’y ayant aucune
caufe apparente à laquelle on pût attribuer la maladie
ou fa guérifon.
Les femmes enceintes qui en étoient frappées
mouroient, les unes en faifant de faufles couches ;
8c d’autres délivrées heureufement, périfl'oient également
avec leurs enfans ; on v it peu d’exemples du
contraire. Les malades dont les ulcérés ouverts coûtaient
abondamment, réchappoient pour l’ordinaire
, la violence du charbon étant adoucie par l’écoulement
; mais ceux dont les ulcérés reftoient dans le
même état qu’ils avoient paru d’abord, périfl'oient
prefque toujours. Quelques-uns eurent les cuiflès
cieflechées, fans que les ulcérés euflent flué ; d’autres
échappèrent de la maladie avec la langue mutilée
, 8c ne purent pendant le refte de leur vie articuler
que des fons confus..
Cettepefle dura quatre mois à Conftantinople, d’abord
avec afl’ez de bénignité ; mais enfuite avec tant
de fureur, que le nombre des morts monta jufqu’à
dix mille perfonnes en un jour. Au commencement,
on les enievelifloit foigneufement, mais à la fois tout
tomba dans la derniere confufion : les domeftiques
n’avoient pas de maîtres , 8c les perfonnes riches
ifayoient point de domeftiques pour les fervir. Dans
P E S
cette ville affligée, ,on né voyoit que maifons vuî-
des , & que magafins 8c boutiques qu’on n’ouvroit
plus ; tout commerce pour la fubfiftance meme étoit
anéanti.
L’empereur chargea Théodore , l’un clefes réfé^
rendaires, de tirer du tréfor l’argent néceflaire pour
en diftribuer à ceux qui étoient dans le befoin, mais
ce n’étoit-là qu’une foible reflource. Procope ajoute
que plufieurs malheureux, frappés d’épouvante, quittèrent
leur mauvaife v ie , tandis que d’autres retournèrent
à leurs déréglemens aufli-tôt que le danger
fut pâlie. •
Il réfulte de tout ce détail , que quoique cette
pefle ait duré cinquante - deux ans , en changeant
fouvent de fymptômes, fuivant les pays ; cependant
la defeription d’Evagre différé en peu de choies ef-
fentielles de celle de Procope. . . . mais comme l’hifi-
toire de Procope étoit connue de tout le monde ;
Evagre eut tort d’avancer, que cette maladie n’avoit
pas été décrite avant lui. On ne peut pas douter que
fa defeription 8c celle de Procope ne regardent la
même pefle , laquelle, au rapport d’Agathias, commença
la cinquième année ( il faudroit lire la quinzième
année de Juftinien ). Procope l’a décrite tellé
qu’elle parut à Conftantinople la fécondé année , 8c
Evagre en parle conformément à ce qu’elle étoit plufieurs
années après ; c’eft cette différence de tems 8c
de lieu x, qui font apparemment les principales califes
de la différence qui fe trouve quelquefois dans
les deferiptions de ces deux hiftoriens.
Evagre, par exemple , rapporte une circonftance
très-fùrprenante , qu’on ne lit point dans Procope ;
fa voir, qu’aucune perfonne native des villes attaquées
, quelqu’éloignées qu’elle fût du lieu où étoit
la maladie, n’échappoit pourtant à fa fiiréur ; ces
mots aucune perfonne pris à la rigueur de la lettre ,
détruifent toute croyance; mais fi l’on interprète fori
récit par un très-grand nombre de perfonnes , il rïè
fera point fufpeft de fauflèté pour ceux qui n’ignorent
pas des exemples femblables que rapportent les
hiftoriens dans des tems plus modernes , au fùjet dé
la fueur angloife, genre de pefle qui vint à éclorré
dans la principauté de Galles en 1483 , ravagea l’Am
gleterre , fe répandit en Allemagne , reparut.à Londres
en 15 5 i. pour la cinquième fois, attaqua quantité
de naturels anglois dans les pays étrangers , 8c
épargna prefque tous les étrangers établis en Angleterre.
Voÿe{ S u e u r ANGLOISE. ( Le Chevalier DE
J A U C OU R T . )
PESTIFÉRÉ, a d j. {Gram.) q u i e ft a t ta q u é d e la
p e f t e . Voye{ P e s t e .
PESTILENCE, f. f. en Médecine ; c’eft une maladie
épidémique, maligne 8c contagieufe, ordinairement
mortelle , connue vulgairement fous le nom
dQ pefle. Voye{ P e s t e .
Ce mot eft formé du latin pejlis, qui fignifîe la
Piêrne chofe.
Maifon de pelle ; c’eft un lazaret ou une infirmerie
, où l’on met en dépôt 8c où l’on a foin des mar-
chandifes des perfonnes, &c. infeélées, ou que l’on
foupçonne infe&ées de quelque maladie contagieufe.
Foye{ L a z a r e t .
PESTILENTIEL, adj. {Médecine.') fe dit en Médecine
des maladies, de l’air 8c des alimens ; on dit
un air peflilentiel, un aliment empefté.
La maladie peflilentielle eft une maladie épidémique
, dont il meure plus de monde qu’il n’en réchappe
, 8c dont les malades meurent plus promptement
que dans les maladies épidémiques ordinaires , les
lignes propres 8c caraftériftiques de la maladie ou
fièvre peflilentielle ou de la peftilence font ; i° l’épidémie
; 20. la mortalité ; 30, les accidens , tds que
les bubons, les charbons, le pourpre., la mollefle,
P E S
Esbattement de tout le corps ; 4®. la caufe qui gît
dans le vice de l’air 8c des alimens.
Ce-font ces quatre conditions, l’épidémicité , la
mortalité, la qualité des accidens, 8c la caufe commune
qui conftituent le caraûere des maladies pefli-
lentiélles ; ces quatre conditions fe rencontrent fou-
vent dans les fievres malignes, dans les fievres continues
à redoublement, dans les péripneumonies ,
dans les pleuréfies, les dyflenteries, les petites véroles
, &c. 8r-alors ces maladies fontpeftilcndelks.
Les maladies peflilentielles different de la pefte, en
ce que l’épidémie eft plus générale dans ce lle-ci ;
20. en ce que la mortalité y ëft aufli plus grande ;
40. en ce que les accidens font plus violens dans la
pefte, 8c enfin la caufe de la pefte eft differente ; car
elle eft produite par une infe&ion particuliere. Voye^
P e s t e .
La caufe de la fievrë peflilenûelli, eft iinë caufe
épidémique Sc fouvent fporadique, jointe à une cau-
fe particuliere qui eft l’infeftion ; c’eft ainfi qu’une
fievre maligne Ample qui attaquera differens habitons
d’une v ille , deviendra fporadique, 8c fouvent
épidémique ; 8c fi l ’infe&ion particuliere , foit de
l’air , foit des alimens, fe joint à cette fievre maligne
, elle fera peflilentielle ; c’eft ainfi que la peftilence
accompagne la fievre continue a redouble ment
, la pleuréfie, les dyflenteries, les péripneumonies
, la petite vérole , la rougeole 8c le pourpre.
La pefte au contraire,'eft toujours cauféepar la
feule infection particuliere fans caiife fporadique : les
fymptômes de la fievre peflilentielle font, i° . l’abattement
des forces , d’où dépendent le défaut de la
refpiration, la foiblefle, l’intermittence 8c l’intercadence
du pouls.
20. Des naufées , des Cardialgies , des vomifle-
mçns , par le vice .de l’eftomac où les ofcillations
pêchent, 8c où les bouillons même s’aigriflent ou fe
corrompent.
. 30. Des urines troubles 8c graflès, où l’huile eft
comme par floçcons, par la laxité des tuyaux fecré-
toires des reins.
/ 4°- Des fueurs colliquatiyes, aigres , graflès 8c
fétides par la même caufe.
50. Des bubons aux aines ou aux aiflèlles , des
charbons , des lanières de pourpre , noires ou violettes,
ou bleues ; l’âcreté des humeurs 8c leur épaif-
fiflèment produifent ces differens accidens. Voye^
B u b o n s .
6®. La gangrené feche 8c la mollefle des membres
après la mort. Poye{ G a n g r e n é s e c h e .
7°. Des déje&iohs fanglantes par les felles, des ex-
cretions de fang, par les urines 8c par la fueur.
Prognoftic. La fievre peflilentielle eft très-fiinefte ;
en effet , on n’en connoît point le caraétere , on ne
peut y employer les remedes ordinaires aux autres
maladies, lans une crainte infinie 8c un ménagement
inconcevable. Le prognoftic n’cft d’ailleurs que trop
vérifié , par l’experience funefte que nous donne le
nombre de malades qui périflènt de cette maladie ;
cependant le prognoftic varie félon le degré de la
peftilence, félon le nombre 8c la violence des fymp-
tomes, félon le dénaturement du fang, félon que la
maladie fporadique domine fur la peftilence , ou que
la peftilence prend le defliis fur la maladie fpora*-
dique.
Voici ce qui doit régler *le pronoftiç:
1 • Élus 1 epidemie eft grande , plus il y a des malades
attaqués en même tems , plus la peftilence eft
à craindre.
2 . Plus la mortalité eft grande, 8c plus le danger
eft grand.
3 0. La violence 8c le nombre des accidens, la gangrené
des parties extérieures , l’intèrmittencé 8c T’in-
Tome XII,
P E S 459
tercadence fuivies dans le pouls, font des lignes
très - dangereux.
Curation. La peftilence ou la fievre peflilentielle
eft tres-difficile à traiter ; elle préfente cependant
deux indications, celle de la maladie fporadique ou
de l’epidemie, 8c celle de la peftilence. Lefentiment
des médecins eft partagé fur l’adminiftration de la
faignée 8c de la purgation : mais fi nous diftinaUOns
nos chefs d’indications 8c differens degrés dans la
maladie, nous verrons que l’on peut iaigner dans
ces maladies , mais moins que dans les maladies inflammatoires
ordinaires ; il en fera de même de la
purgation. D ’ailleurs quoique les cordiaux foient
confeillés par le plus grand nombre, il eft cependant
prouve par l’experience qu’ils nuifent fort fouvent
8c qu’il périt plus de perfonnes par les cordiaux que
par I’ufage des autres remedes ; nous fommes donc
de 1 ’avis fuivant :
1 . On faignera , s’il y a inflammation, comme
peripneumonie, pleuréfie, &c. s’il y a douleur locale,
ou effervefcence confidérable dans le fana ; fl Je
pouls eft plein, fort 8c tendu ; mais comme il y a
peftilence , on faignera de façon que l’on modérera
le nombre 8c la quantité des faignees : hors ces cas
on ne doit point faigner du tout.
20. On purgera pour vuider les premières voies
pour détourner le venin fur le bas-ventre , 8c le jet-
tef par les felles ; on employerales purgatifs, 8c même
l’émétique ; on tiendra le ventre libre en donnant
de tems à autre des cathartiques;mais la foiblefle con-
trindique ces remedes : 8c il faut remarquer qu’elle
augmente aflèz fouvent par la faignée 8c les purgatifs
, au lieu qu’elle diminue dans les autres maladies.
Cèci mérite une attention finguliere.
Le remede. contre cette foiblefle eft l’antidote ou
le fpécifique propre contre la peftilence ; mais quel
eft ce fpécifique? c’eft ce qu’on cherche depuis long-
tems fans le trouver. Les quatre alexipharmaques ,
les conférions cl’alkermès 8c d’hyacinthe , la thériaque
8c l’orviétan ; les efprits volatils tirés des animaux
; les cordiaux acides font mêlés avec les pré-
cédens, qu donnés féparément, on rémarque en général
qu’ils ne caufentpasunefi grande diflolution du
fang ; ainfi on peut employer en même-tems'que les
remedes généraux , la potion fuivànte.
Potion antipeflilentielle. Prenez des éaux de chardon
béni ; de reine des près 8c d’angélique , de
chaque deux onces; d’eau thériacale de baudron ; de
vinaigre thériacal ; de l’efprit de citron , de chaque
cinq gros ; de firop d’oeillet, une once : faites une
potion du tout dont on donnera par cueillerée , pour
loutenir le pouls 8c procurer une douce moiteur.
On peut employer la thériaque, la poudre de vipère
, l’antidote de Tichobrahe. Voye^ces articles.
Enfin, on applique les véficatoires 8c les ventoufes.
Quant aux amulettes, voye{ A m u l e t t e s .
Le régime doit être proportionné à l’état du mal;
il doit être analeptique, reftaurant 8c foutenu par les
antiputrides. Voye{ P e s t e .
P E T , f. m. air qui fe fépare dans les inteftins , 8c
qui s’échappe avec bruit par l’anus. C’eft un effet de
la digeftion , delà qualité des alimens , du froid, du
chaud, &c.
Les anciens avoient le dieu Pet.
Pet , ( Cuiflne. ) efpece de petits begnets, ronds,
faits de farine, de lait, de fucre 8c de jaunes d’oeufs
délayés enfemble.
PE TA , f.f. {Mytholog. ) déeflè de la demande. Son
nom vient du verbe peto , demander.
PÉTAGUEI , X Géog. mod. ) pays de l’Amérique
méridionale au Bréfil, borné nord par le pays de De-
le 8c par la mer ; fud par la capitainerie de Rio
grande ; oueft par les Tupuyes. Il y a des mines
d’argent dans cette contrée.
M m m ij