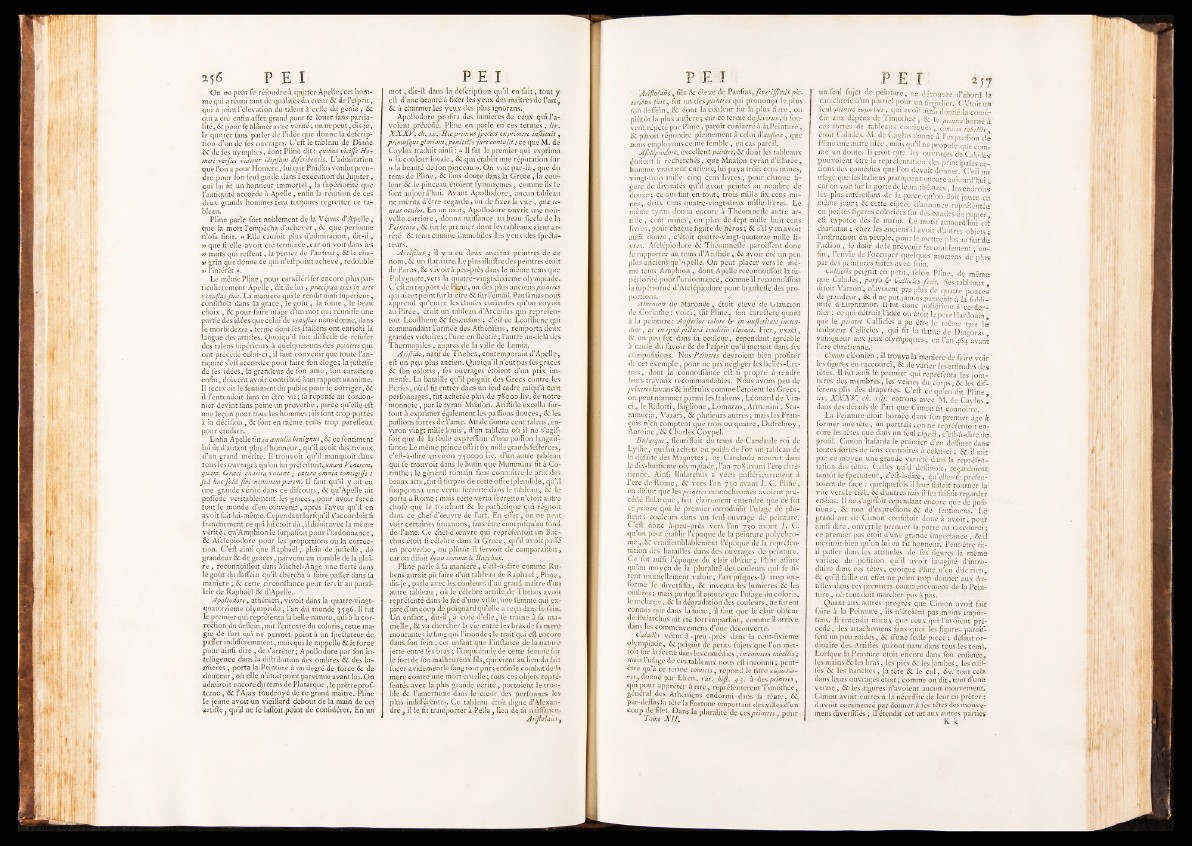
On ne peut fe refondre à quitter Apelie ; cet homme
qui a réuni tant de qualités du coeur & de l’efprit,
qui a joint l’élévation du talent à celle du génie, 8c
qui a été enfin aflez grand pour fe louer fans partialité
, & pour fe blâmer avec vérité ; on ne peut, dis-je,
le quitter fans parler de l’idée que donne la defçrip-
îion d’un de fes ouvrages. C ’efl le tableau de Diane
8c de fes nymphes, dont Pline dit : quibits vkifje Ho-
meri ver fus videtur idipfum defcribentis. L’admiration
<p.ie l’on a pour Homere, lui que Phidias voulut prendre
pour ton feul guide dans l’exécution du Jupiter,
qui lui fit un honneur immortel, la fupériorité que
l ’antiquité accorde à Apelie, enfin la reunion de ces
deux grands hommes fera toujours regretter ce tableau.
Pline parle fort noblement de la Vénus d’Apelie,
que la mort l’empêcha d’achever, 8c que perfonne
n’ofa finir. « Elle caufoit plus d’admiration, dit-il,
» que fi elle avoit été terminée, car on voit dans les
» traits qui refient, la penfée de l’auteur ; & le cha-
s> grin que donne ce quin’eflpoint achevé, redouble.
» l’intérêt ».
Le même Pline, pour caraclérifer encore plus particulièrement
Apelie, dit de lu i, prcecipua ejusin arte
venufias fuit. La maniéré qui le rendit ainfi fupérieur,
confifloit dans la grâce, le goût, la fonte , le beau
choix, 8c pour faire ufage d’un mot qui réunifie une
partie des idées que celui de venufias nous donne, dans
le morbidezza, terme dont les Italiens ont enrichi la
langue des artifles. Quoiqu’il toit difficile de refiifer
des talens fupérieurs à quelques-uns des peintres qui
ont précédé celui-ci, il faut convenir que toute l’antiquité
s’efl accordée pour faire ton éloge ; la jufleffe
de fes idées, la grandeur de ton ame, ton caractère
enfin, doivent avoir contribué à un rapport unanime.
Il recevoit le fentiment du public pour fe corriger, 8c
il l’entendoit fans en être vû ; fa réponfe au cordonnier
devint fans peine un proverbe, parce qu’efle,efl
une leçon pour tous les hommes ; ils font trop portés
à la décifion, 6c font en même tems trop pareflèux
pour étudier.
Enfin Apelie fut in cemulis benignus, 8c ce fentiment
lui fit d’autant plus d’honneur, qu’il avoit des rivaux
d’un grand mérité. Il trouvoit qu’il manquoit dans
tous les ouvrages qù’on lui préfentoit, unam Venerem,
quant Graci charita vocant ; calera omnia contigijfe :
fed hac foLâ Jibi nemineniparent. Il faut qu’il y ait eu
une grande vérité dans ce difcours, 6c qu’Apelie ait
pofledé véritablement les grâces, pour avoir forcé
tout le monde d’en convenir, après l’aveu qu’il en
avoit fait lui-même. Cependant lorfqu’il s’accordoit fi
franchement ce qui lui étoit dû, il difoit avec la même
vérité, qu’Amphion le furpafîoit pour l’ordonnance,
8c Afclépiodore pour les proportions ou la correction.
C ’efl ainfi que Raphaël, plein de jufleffe, de
grandeur 6c de glaces, parvenu au comble de la gloire
, reconnoiffoit dans Michel-Ange une fierté dans
le goût dudeflëin qu’il chercha à faire pafler dans fa
maniéré ; 6c cette circonftance peut fervir au parallèle
de Raphaël 6c d’Apelle.
Apollodore, athénien, vivoit dans la quatre-vingt-
quatorzieme olympiade, l’an du monde 3 596. Il fut
le premier qui repréfènta la belle nature, qui à la cor-
redion du deflein,mit l’entente du coloris,cette magie
de l’art qui ne permet point à un fpe&ateur de
pafler indifféremment, mais qui le rappelle 6c le force
pour ainfi dire , de s’arrêter; Apollodore par fon intelligence
dans la diflribution des ombres 6c des lumières
, porta la Peinture à un degré de force 6c de
douceur, oii elle n’étoit point parvenue avant lui. On
admiroit encore-dû tems de Plutarque, le prêtre prof-
tern é, 8c l’Ajax foudroyé de ce grand maître. Pline
le jeune avoit im vieillard debout de la main de cet
artiffe f qu’il ne fe laflçit point de confidérer. En un
mot, dit-il dans la defcription qu’il en fait, tout y
efl d’une beauté à fixer les yeux des maîtres de l’art,
6c à çharmer les yeux des plus ignorans.
Apollodore profita des lumières de ceux qui l’a-!
voient précédé. Pline en parle en ces termes, liv.
X X X V . ch. ix. Hic primus fpecies exprimere influait ,
primufqtte gloriam, penicillo jure contulit : ce que M. de
Caylus traduit ainfi : « Il fut le premier qui exprima .
» la couleur locale, 6c qui établit une réputation'fur
» la beauté de fon pinceau ». On voit par-là, que du
tèms de Pline, 6c fans doute dans la Grece, la couleur
6c le pinceau étoient fynonymes, comme ils le
font aujourd’hui. Avant Apollodore, aucun tableau
ne mérita d’être regardé, ou de fixer la vue , quæ tentât
oculos. En un mot, Apollodore ouvrit une nouvelle
carrière, donna naiflance au beau fiecle de la
Peinture, 8c fut le premier dont les tableaux aient arrêté
6c tenu comme immobiles les yeux des fpedateurs.
Arcéfilas ; il y a eu deux anciens peintres de ce
nom ,6c un flatuaire.Le plus illuflre des peintres étoit
de Paros, 6c v ivoit à peu-près dans le meme tems que
Polygnote,vers la quatre-vingt-dixieme olympiade.
Ç ’efl au rapport de Pjjne,un des plus anciens peintres
qui aient peint fur la cire 8c fur l’email. Paufanias nous
apprend qu’entre les chofes curieufes qu’on voyoit
au Pirée, étoit un tableau d’Arcéfilas qui repréfen-
toit Léoflhene 6c fes,enfans ; c’efl ce Léoflhene qui
commandant l’armée des Athéniens, remporta deux
grandes victoires ; l’une en Béotie ; l’autre au-delà des
Thermopiles , auprès de la ville de Lamia.
Arifiide, natif de Thebes, contemporain d’Apelle,
efl un peu plus ancien. Quoiqu’il n’eût pas fes grâces
6c fon coloris, fes ouvrages étoient d’un prix im-
menfe. La bataille qu’il peignit des Grecs contre les
Perfes, où il fit entrer dans un feul cadre jufqu’à cent
perfonnages, fut achetée plus de 78000 liv. de notre
monnoie, par le tyran Mnafon. A riflicle excella fur-:
tout à exprimer également les paflions douces, 6cles
paflions fortes de l’ame. Attale donna cent talens, environ
vingt mille louis , d’un tableau où il ne s’agif-
foit que de la feule expreflion d’une paflion languif-
fante. Le même prince offrit fix mille grands fefberces,
c’efl-à-dire environ 750000 liv. d’un autre tableau
qui fe trouvoit dans le butin que Mummius fit à Corinthe;
le général romain fans connoître le prix des
beaux arts ,fut fi furpris de cette offre fplendide, qu’il
foupçonna une vertu 'fecrette dans le tableau,, 8c le
porta à Rome ; mais cette vertu fecrette n’étoit autre-
chofe que le /touchant 6c le pathétique qui régnoit
dans ce chef-d’oeuvre de l’art. En effet, on ne peut4
voir certaines fituations, fans être ému jufqu’au fond
de l’ame. Ce chef-d’oeuvre qui repréfentoit un Bac-
chus étoit fi célébré dans la Grece, qu’il avoit paffe
en proverbe , ou plûtôt il fervoit de comparaifon y
caron difoit beau comme Le Bacçhus.
Pline parle à fa maniéré , c’efl-à-dire comme Rubens
auroit pû faire d’un tableau de Raphaël ; P line,
dis-je, parle avec les couleurs d’un grand maître d’un
autre tableau , où le célébré artifle de Thebes avoit
repréfenté dans le fac d’une ville,une femme qui expire
d’un coup de poignard qu’elle a reçu dans le fein.
Un enfant, dit-il, à côté d’elle, fe traîne à fa mai
melle, 6c va chercher la vie entre les bras de fa mere
mourante : le fang qui l’inonde ; le trait qui efl encore
dans fon fein ; cet enfant que l’inflance de la nature
jette entre fes bras ; 1’inquiétude de cette femme fur
le fort de fon malheureux fils, qui vient au lieu du lait
fucer avidement le fang tout pUr; enfin le combat de la
mere contre une mort cruelle; tous ces objets repré-
fentés avec la plus grande vérité, portaient le trou-:
ble 8c l’amertume dans le coeur des perfonnes les
plus indifférentes. Ce tableau étoit digne d’Alexandre
, il le fit tranfporter à Pella, lieu de fa naifïance.j
Arifialaüs f
!Arifiolaüs| fils 8c éleve de Pmüasffevenßniispic-
toribus fu it, fut un dèspeintres qui prononça le plus
ton deflein, 8c dont la couleur fut la plus fiere-, o u .
plûtôt la plus auflere car ce terme de feverus, fi fou-
vent répété par Pline , paroît confacréà la,Peinture ,-
6c paroît répondre pleinement à celui d’äußere, que
nous employons ce me femble, en cas pareil.
Afclépiodore, excellent peintre, 8c dont les tableaux
étoient fi recherchés, que Mnafon tyrand’Elatée,•
homme vraiment curieux, lui paya trois cens mines,
vingt-trois mille cinq cens livres, pour chaque figure
de divinités qu’il avoit peintes au nombre de
douze-; ce qui fait en tout, trois mille fix cens mines,
deux cens quatre-vingt-deux mille livres. Le
même tyran donna encore à Théomnefle autre artifle
, cent mines, ou plus de fept mille huit cens
livres, pour chaque figure de héros ; 6c s’il y en avoit
aufli douze, c’étoit quatre-vingt-quatorze mille livres.
Afclépiodore 6c Théomnefle paroiflent donc
fie rapporter au tems d’Ariflide, 6c avoir été un peu
plus anciens qu’Apelie. On peut placer vers le même
tems Amphion, dont Apelie reconnoiffoit la fupériorité
pour l’ordonnance, comme il reconnoiffoit
îa fupériorité d’Afclépiodore pour lajufleffe des proportions.
<
Athenion de Maronée, étoit éleve de Glaucion
de Corinthe : vo ic i, dit Pline, fon caraélere quant
à la peinture : Außerior colore & in aufieritate jucun-
dior, ut in ipsâ piclurâ eruditio eluceat. Fier , exaél,
6c un peu fec dans fa couleur, cependant agréable
à caufe du favoir 6c de l’efprit qu’il mettoit dans fes
compofitions. Nos Peintres devroient bien profiter
de cet exemple, pour ne pas négliger les belles-Let-
tres, dont la connoiffance efl fi propre à rendre
leurs travaux recommandables. Nous avons peu de
peintres favans 6c inflruits comme l’étoient les Grecs ;
on peut nommer parmi les Italiens, Léonard de Vinci
, le Ridotti, Bagiione, Lomazzo, Armenini, Sca-
ramucia, Vazari, & plufieurs autres ; mais les François
n’en comptent que trois ou quatre, Dufrefnoy,
Antoine, 6c Charles Coypel.
Bularque, fleuriffoit du tems de Candaiile roi de
Lydie, qui lui acheta au poids de l’or un tableau de
là défaite des Magnetes ; or Candaule mourut dans
là dix-huitiemë 'olympiade, l’an 708 avant l’ere chrétienne.
Ainfi Bularchus a vécu poflérieurement à
Pere de Rome, 6c vers l’an 730 avant J. C. Pline,
en difant que les peintres monochromes avoient précédé
Bularquè, fait clairement entendre que ce fut
ce peintre qui le premier introduifit l’ufage de plufieurs
couleurs dans un feul ouvrage de peinture.
C’efl donc à-peu-près vers l’an 730 avant J. C.
qu’on peut établir l’époque de la peinture polychrome
, 6c vraifl'emblablement l’époque de la repréfen-
tation des batailles dans des ouvrages de peinture.
Ce fut aufli l’époque du clair obfcur; Pline affure
qu’au moyen de la pluralité des couleurs qui fe firent
mutuellement valoir, l’art jufques-là trop uniforme
fe diverfifia, 8c inventa les lumières 8c les
ombres ; mais puifqu’il ajoute que l’ufage du coloris,
le mélange, 6c la dégradation des couleurs, ne furent
connus que dans la fuite, il faut que le clair obfcur
de Bularchus ait été fort imparfait, comme il arrive
dans les commencemens d’une découverte.
Caladès vécut à-peu-près dans la cent-fixieme
olympiade, 6c peignit de petits fujèts que l’on mettoit
fur la fcene dans les comédies, in conticis tabellis;
mais l’ufage de'ces tableaux nous efl inconnu ; peut-
etre qu’à ce terme conticis, répond le titre mpwS'ïv-
7e î., donné par Elien, var. hiß. 43. à des peintres,
qui poiir apprêter à rire,. repréfenterent Timothée,
general des Athéniens endormi dans fa tente, 6c
par-deffus fa tête la Fortune emportant des villes d’un
coup de filet. Dans la pluralité de ces peintres, pour
Tome X I I .
• uft:feul Ittjet de: peinture, 'on décéùvre â’abofcT lit f JatachYefe d’un pluriel pour un fînguliér. C’étoitun
• feul Jmata m ^ Sm , qmavoit ainfi donné'lâ cpiÀé-
d iia t ix dépens de Timothée , & l e ^ W b o r n ë - à '
ees. fortes, de.tableaux comiques j iotiitcis tabeltis
etoit Caladès, M. de (Darius donne à l’expreflion de
Pline une autre idée, mais qu’il ne propofe que comme
un doute. Il croit «ue les ouvrages de Caladès
pouvoient être la îepréfcntation des principales actions
des comédies que l'on devoit donner. O'êft nn
ufage que les Italiens pratiquent encore aujourd’hui ;
car on voit fur la porte dé leurs théâtres , les éndroitî
les plus intéreffans de la.piec'eqtft® doitjouer ce'
même jour ; êc cette clpecc d’annonce repréfentée
en petites figures coloriées fur des bandes de papier '
eû expofée.dès le matin, t e motif aùj*rd-’hii#êft
charlatan ; chez les anciens il avoit d’autres objets ;
l’inftruaion te|)é*iple;.potirfe mettre plus au fait dé
l’affion , le delir de le prévenir favorablement ; en.
fin, l’envie de l’occuper quelques montons de plus
par des peintures faites avec foin,
Calliclès peignit en petit, félon Pline, de même
que Caladès, parva & Calliclès fecit. Ses tableaux,
difoit Varron, n’avoient pas plus de quatre pouces
de grandeur, 6c il ne put jamais parvenir à la fubli-
mite d’Euphranor. Il fut donc poflérieur à ce dernier
; ce qui détruit Viciée où étoit le pere Hardouin '
que le peintre Calliclès a pu être le même que le
fculpteur Calliclès , qui fit la flatue de Diagoras j
vainqueur aux jeux olympiques, en l’an 464&avant
l’ere chrétienne.
Cimon cléonien ; il trouva la maniéré de faire voir
les figures en raccourci, 6c de varier les attitudes des
têtes. Il fut aufli le premier qui repréfenta les jointures
des membres, les' veines du corps, 6c les dif-
férens plis des draperies. C’efl ce qu’en dit Pline "■
liv. X X X V . ch. viij. entrons avec M. de Caylus^
dans des détails de l’art que Cimon fit connoître.
La Peinture étoit bornée dans fon premier âge k
former une tête, un portrait ; on ne repréfentou encore
lès têtes que dans un feul afpeél, c’èfl-à-dire de
profil. Cimon hafarda le premier d’en-defliner dans
toutes fortes de fens contraires à celui-ci ; 6c il mit
par ce moyen une grande variété dans la repréfen-
tation des têtes. Celles qu’il deffinoit, regardoient
tantôt lé fpe&ateur, c’efl-à-dire, qu’elles fe préfen-
toientde face : quelquefois il leur fàifoit tourner la
vûe vers le ciel, 6c d’autres fois il les faifoit regarder
en-bas. Il ne s’agifloit cependant encore que de pofi-
tions, 6c non d’expreflions 8c de fentimens. Le
grand art de Cimon confifloit donc à avoir, pour
ainfi dire, ouvert le premier la porte au raccourci;
ce premier pas étoit d’une grande importance , 6c il
méritoit bien qu’on lui en fit honneur. Peut-être fit-
il pafler dans les attitudes -de' fës figurés-la même
variété de pofition qu’il avoit imaginé d’introduire
dans ces têtes, quoique Pline n’en dife rien,
6c qu’il faille en effet ne point trop donner aux Artifles
dans ces premiers commencemens de la Peinturé
, où tout doit marcher pas à pas.
Quant aux autres progrès que Cimon avoit fait
faire à la Peinture, ils n’étoient pas moins impor-,
tans. Il entendit mieux que ceux qui l’avoient précédé,
les. attachemens fans quoi les figures paroif-
fent un peu roides, 8c d’une feule piece ; défaut ordinaire
des Artifles qui ont paru dans tous les tems.
Lorfque la Peinture etoit encore dans fon enfance,
les mains 8c les bras, les piés 6cdes jambes, lescuif-
fes 8c les hanches ; la tête 6c le co l, &c. tout cela
dans leurs ouvrages étoit; comme on d it, tout d’une
venue , ôc les figures; n’avoient aucun mouvement.
Çimôn avoit entrevu la néceflité de leur en prêter :
il avoit commencé par donner à fes têtes des mouve-
ihcns diverfifiés ; il étendit cet art aux autres parties
K k