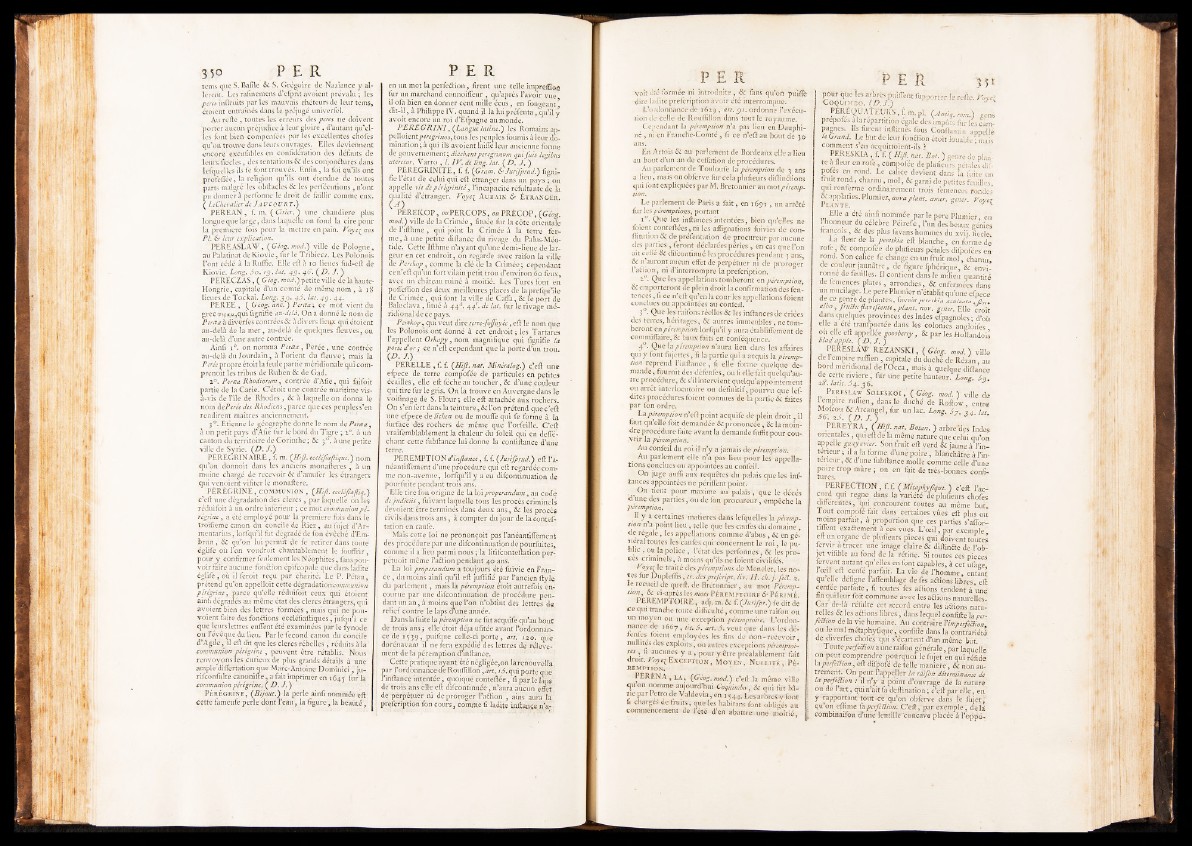
3 5° P E R
tems que S. Baffle 8c S. Grégoire de Naziance y alldem.
Les rafinemens d’efprit avoient prévalu ; les
verts inftrdits par les mauvais rhéteurs de leur tems,
étoient entraînés dans le préjugé univerfel.
Au refte , toutes lés erreurs des peres ne doivent
'porter'âucun préjudice à leur gloire , d’autant qu’elles
font bien compenfées par les excellentes cnofes
■ qü’on trouve dans leurs ouvrages. Elles deviennent
encore excusables en confidération des défauts de
leurs fiecles, des tentations & des conjonctures dans
lefquelles ils fe font trouvés. Enfin, la foi qu’ils ont
prôfèffée, la religion qu’ils ont étendue de toutes
parts malgré les obftacîes 8c les perfécutions, n’ont
pu donner à perfonne le droit de faillir comme eux.
( LeChevalier de JÀv Cou RT.)
PEREAN , f. m. ( Cirier. ) une chaudière plus
longue que large, dans laquelle on fond la cire pour
la première fois pour la mettre en pain. Voye^ nos
Pl. & leur explicatioh.
P E R E A S L A A Y , ( G log. mod.) ville de Pologne,
au Palatinat deKiovie, fur le Tribiecz. Les Polonois
l’ont cédé à la Ruffie. Elle eft à io lieues fud-eft de
Kiovie. Long. 5o. i f . lat. 4CJ. 46. ( D . J. )
PERÉCZAS, ( Géog. mod.)' petite ville de la haute-
Hongrie, capitale d’un'eomté de même nom, à 18
lieues de Tockai. Long, g o.. 4 J .lat. 49. 44.
PERÉE , ( G log. anc.) Pem'a ; ce mot vient du
grec w-êpoiju,qui Signifie au-delà. On a donné le nom dè
Percea à diverfes contrées & à divers lieip: qui étoient
au-delà de la mer, au-delà de quelques fleuves, ou
au-delà d’une autre contrée.
Ainfi i°. on nomma Pe«2Æ,’Perée, une contrée
au-delà du Jourdain, à l’orient du fleuve ; mais la
Perle propre étoit la feule partie méridionale qui com-
prenoit les tribus de Ruben 8c de Gad.
2°. Peraa Rhodiorum, contrée d’Afie, qui faifoit
partie de la Carie. C’étoit une contrée maritime vis-
à-vis de l’île de Rhodes , 8c à laquelle on donna le
nom dePerle des Rhodiens, parce que ces peuples s’en
rendirent maîtres anciennement.
3 °. Etienne le géographe donne le nom de Pensa.,
à un petit pays d’Afie fur le bord du Tigre ; 20. à un
canton du territoire de Corinthe; 8c 30. à une petite
ville de Syrie. (D . J.)
PEREGRINAIRE, f. m. (Hiß. ecclèfiafiique.) nom
qu’on donnoit dans les anciens monafteres ,‘ à un
moine chargé de recevoir 8c d’amufer les étrangers
qui venoient vifiter le monaftere.
PÉRÉGRINE, COMMUNION , {Hiß. eccléfiaftiq.)
c’ eft une dégradation des clercs , par laquelle ôn les
réduifoit à im ordre inférieur ; ce mot communion pl-
régrine , a été employé pour la première fois dans le
troifieme canon du concile de Riez, au fujèt d’Ar-
mentarius, lorfqu’il fut dégradé de fon évêché d’Em-
brun, 8c qu’on lui permit de fe retirer dans toute
églife où l’on voudroit charitablement le Souffrir
pour y confirmer feulement les Néophites, fans pouvoir
faire aucune fonction épifcopale que dans ladite
églifè , où il feroit reçu par charité. Le P. Pétau
prétend qu’on appelloit cette dégradation communion
plrlgrine, parce qu’elle réduifoit ceux qui étoient
ainfi dégradés au même état des clercs étrangers, qui
avoient bien des lettres formées , mais qui ne pou-
voient faire des fondions eccléfiaftiques, jufqu’à ce
que leurs lettres euffent été examinées par le lynode
ou l’évêque du lieu. Par le fécond canon du concile
d’Agde , il eft dit que les clercs rébelles réduits à la'
communion plrlgrine , peuvent être rétablis. Nous
renvoyons les .curieux de plus grands détails à une
ample differtation que Marc-Antoine Dominiçi,' ju-
rifconfultè canonifte, a fait imprimer en 1645 fit fi la
communion plrlgrine. ( D . J. )
PÉRÉGRINE, (Bijotit.) la perle ainfi nommée eft
cette fameufe perle dont l’eau , la figure, la beauté,
P E R
en un mot la perfeérion, firent une telle imprefliQô
fur un marchand connoiffeur , qu’après l’avoir vue
il ofa bien en donner cent mille écus, en fongeant \
dit-il, à Philippe IV. quand il la luipréfenta, qu’il y
avoit encore un roi d’Ëfpagne au monde.
P ERE G R IN I , {Langue latine.) les Romains ap-
pelloient peregrinos, tous les peuples fournis à leur domination
; à qui ils avoient laifie leur ancienne forme
de gouvernement; dicebant peregrinum qui fuis legibus
uteretur. Varro , 7. ÎV. deling, lac. (D . J .)
PÉREGRINITE, f. f. (Gram. & Jurifprud.) lig n ifie
l ’e ta t d e c e lu i q u i e f t e t r a n g e r dans u n p a y s ; ,o n
a p p e lle vie de plrigrinitl, l’ in c a p a c ité r é fu ltan te d e la
q u a lité d’ é tr an g e r . Foyer A u b a in & É t r a n g e r .
U ) :: 1 ■:
PEREICOP, okPERCOPS, ouPRÊCOP, (Géog.
mod.) ville de la Crimée, fituée fur la côte orientale
de l’ifthme , qui joint la Crimée à la terre ferme
, à une petite diftanec du rivage du Palus-Méo-
tide. Cette Ifthme n’ayant qu’une demi-lieue de largeur
en cet endroit, on regarde avec raifon la ville
de Perekop, comme la clé de la Crimée; cependant
ce n’eft qu’un fort vilain petit trou d’environ 60 feux,
avec un châtçau ruiné à moitié. Les Turcs font en
poffeflion des deux meilleures places de la prefqu’île
de Crimée, qui font la ville de Caffa, 8ç le port de
Baluclava, fitué à 44e1. 44'. de lat. fur le rivage méridional
de ce pays.
Perekop, qui veut ddre ierre-fujfoyle, eft le nom que
les Polonois Ont donné à cet endroit; les Tartares
l’appellent Orhapy, nom magnifique qui lignifie la
porte dor ; ce n’eft cependant que la porte d’un trou.
1 ■ ■ mm m WÊI
PERELLE , f. f. (Hijl. nat. Minlralog.) c?eft une
efpece de terre compofée dè particules en petites
écailles, elle eft féche au toucher, & d’une couleur
qui tire fur le gris. On la trouvé en Auvergné dans le
voifinage de S. FlOur ; elle eft attachée aux rochers.
On s’en fert dans la teinture, & l’on prétend que c ’eft
une efpece de lichen Ou de moufle qui fe forme à. la
furfacè dés rochers de même que l’orfeille. C ’eft
vraifemblablement la chaleur du foleil qui en defle-
chant cette fubftance lui donne la'conliftance d’uiie
terre.
PEREMPTION d'inflance, f. f. (Jurifprud.) eft l’a-
néantiffemènt d’une procedure qui eft regardée comme
non-avenue, lorfqu’il y a eu difeontinuation de
pourfuite pendant trois ans.
Elle tire fon origine dè la lóiproperanditm. au codé
de jadiciis , fuivant laquelle tous les procès criminels
dévoient être terminés dans deux ans, & les procès
civils dans trois ans, à compter du jour de la contef-
tation en caufe.
Mais cette loi ne prononçoit pas l’anéantiflement
des procédure par une difeontinuation de pourfuites,
comme il a lieu parmi nous ; la litifeonteftation per-
petuoit même l’aérion pendant 40 ans.
La loi propcrandum a toujours été fuivie en France
, du moins ainfi qu’il eft juftifié par l’ancien ftyle
du parlement, mais là péremption étoit autrefois encourue
par une difeontinuation de procédure pendant
un an, à moins que l’on n’obtînt des lettres de
relief contre le laps d’une année.
Dans la fuite la péremption ne fut acquife qu’au bout
de trois ans ; elle étoit déjà ufitée avant l’ordonnance
de 153,9 , puifque celle-ci porte, art. 120. que
dorénavant il ne fera expédié des lettres de rélevc-
ment de la péremption d’inftance.
Cette pratique ayant été négligée,on larenouvéila
par l’ordonnance de Rouflillon, art. i3. qui porte que
l’inftance intentée, quoique conteftée, fi par le laps
de'trois ans elle eft difeontinuée, n’aura aucun effet
de perpétuer ni de proroger l’aéion , ains aura la
prefeription fon cours, comme fi ladite inftançe n’a-
P E R
Voit été formée ni introduite , & fans qu’on puiïfe
dire ladite prefeription avoir été interrompue.
L’ordonnance de 1629, art. '91. ordonne i’exécir-
tion de celle de Rouflillon dans tout lé royaume.
Cependant la plremption n’a pas lieu en Dauphiné
, ni en Franche-Comté, fi ce n’eft au bout de 30
•ans. ~
En Artois & au parlement de Bordeaux elle a lieu
au bout d’un an de ceflation de procédures.
Au parlement de Touloufe la plremption de 3 ans
a lieu, mais on obferve fur cela plufieurs diftinftions
qui font expliquées par M. Bretonnier au mot plremption.
Le parlement de Paris a fait, èn 16 9 1 , un arrêté
fur les plremptions, portant
i° . Que les inftances intentées, bien qu’elles ne
foient conteftéès, ni les aflignations fiiivies de con-
ftitution & de préfentation de procureur par aucune
des parties , feront déclarées peries , en cas que l’on
ait ceflé & difeontinué les procédures pendant 3 ans
& n’auront aucun effet de perpétuer ni de proroger
l’aftion, ni d’interrompre la prefeription.
20. Que les appellations tomberont en plremption,
8c emporteront de plein droit la confirmation des fen-
tences, fi ce n’ëft qu’en la cour les appellations foient
conclues ou appointées au confeil.
3 °. Que les raifons réelles & les inftances de criées
des terres, héritages, 8c autres immeubles, ne tomberont
en plrcmption lorfqu’il y aura établiffement de
commiffaire, 8c baux faits en conféquence.
4°. Que la plremption n’aura lieu dans les affaires ■
qui y font fujettes , f i la partie qui a acquis la plremp- \
don reprend l’inftance, fi elle forme quelque demande,
fournit des defenfes, ou fi elle fait quelqu’au-
tre procédure, 8c s’il intervient quelqu’âppointement
ou arrêt interlocutoirè ou définitif, pourvu que lef- 1
dites procédures foient connues de la partie 8c faites
par fon ordre.
La plremption n’eft point acquife de plein droit, il
faut qu’elle foit demandée 8c prononcée, 8c la moindre
procédure faite avant la demande fuffit pour cou-,
■ Vrir la plremption.
Au confeil du roi. il n’y a jamais de plremption.
Au parlement elle n’a pas lieu pour les-appellations
conclues ou appointées au confeil.
On juge auflî aux requêtes du palais que lés infi
tances appointées ne périffent point.
^ On tient pour maxime au palais, que le décès
<1 une des parties, ou de fon procureur, empêche la
péremption.
Il y a certaines matières dans lefquelles la plremption
n’a point lieu, telle que les caufes du domaine ,
de régale, les appellations comme d’abus, 8c en général
toutes les caufes qui"concernent le ro i, le public
, oiyla police , l’état des perfonnes, 8c les procès
criminels , à moins qu’ils ne foient civilifés.
Voye^ le traité des plremptions de Menelet, les no*-
tes fur Dupleflis, tr. desprefeript. liv. II. ch. j.fecl. 2.
Iè recueil de queft. de Brétonnier, au mot Plremp-
don, 8c ci-après les mots Péremptoire & Périmé.
PÉREMPTOIRE, adj. m. 8c f. {Jurifpr.) fe dit de
c e qui tranche toute difficulté, comme une raifon ou
un moyen ou une exception péremptoire. L’ordonnance
de- 1667 > tiu J- art- veut que dans les dé-
fenles foient employées les fins.de nOn-recevoir,
nullités des exploits, ou autres exceptions pérehiptoi-
res , fi aucunes y a , pour y être préalablement fait \
droit. Voye^ Ex c e p t io n , Mo y e n , Nu l l it é , Péremption.
PÉRÉNA , l a , (Géog. mod.) c’eft la même ville |
qu on nomme aujourd’hui-Coquimbô , 8c qui fut bâ- i
tie par Petro de Valdevia, en 1544. Les'arbres y font •
fi charges de fruits, que les habitans font obligés au :-
commencement de l’été d’en abattre-uné' moitié
P E R m
pôür que les arbres puiffent fupporter le refte j w -
i C o q u jm c o . (JD.J.) ■ 1
! ; ^ERÊQUATEÜ'RS , f. m. pi. (yinùq. «em
prepoies J h répartition égale des impôts furies cam-
, pagnes. Ils ftiteni irtftîtvres fous Öonftantin appellé
' U Gr“ " i- Le but de leur fphâion étoit louable ; mais
comment s’en acquittoient-ils ?
PERESKIA, f. f. ( Hiß. mu. Bot. ) genre de plante
à fleur en rofe, compofcc de plufieurs pétalesdif-
pofes en rond. Le calic,e devient dans la fuite un
fi utt fond, chàrhiï, mol, & garni de petites feuilles
qui renferme ordinairement trois femences fondes
Siapplaties. Plumier, nova v/a/il, amer, eener Verve?
Pl.as.TK. 1 ' J t
Elle a été ainii nommée par le père Plumier en
I honneur du célébré Péirefc, l’un des beaux génies
II ançois, Se des plus iavans hommes du xvij. fîecle,
La flete ‘d'ë1^M ßerestäa éfl blan.che, en forme dè
rofe , & cômpdfée de plufièiifs pétales difpo'fées' en
rond. Son calice fe changé en Un fruit m ol, charnu
demouleur jaunâtre, de figuré fphériqué,&: environne
de feuilles: Il pghtieht dans le milieu quantité
detemènçés plates, arrondies, & enfermées dans
un mucilage'. Le pere Plumier n’établit qu’une efpeeé
de ce genre de plantes, favoir pereskia aeuhata, flore
eeUo , früHûfiavefcente, plant, nov. gener. Elle croît
dans quelques provinces des Indes efpagnoles f d ’où
b H I b S tnmfpqnéë'c.ms les‘fcoloniès, änglöifes
oit elle eft appellce goosteny, & par les Hollandoi^
t/aj applc. (D . J. f ■ "
PËRESLAV RË2 ANSKL, 1 Géog. mod.) ville
de 1 emçire ruflîejl, .capitale du ditché de Rézan au
bord méridional de l’Oc ca, mais à quelque diftance
de cette nviér’e , fiir une petite‘hauteur. Long i d '
28. Latit. 04. 36. 6 J *
Pereslaw SoLéskoi , ( Géog. mod. ) ville de
1 empire ruffien, dans le duché de Roftow, entra
Mofcou 8c Arcangel, fur un lat. Long. S j 34 lat
$6. 26. (D . J . ) 5 *
PEREYRA, ( Hiß. nat. Botan. )• arbre*des Indes
orientales, qui eft aè la même nature que celui qu’on
appelle guayavier. Son fruit eft verd 8c jaune à l’in-
terieur ; il a la forme d’uné poire, blanchâtre à I’im
terreur, 8c d’une fubftance molle comme celle d’une
poire trop mûre ; on en fait de très-bonnes confitures.
PERFECTION , f. f. (Métaphyfique. ) c’eft I’aç-*
Ci°r? fiui regne dans la variété de plufieurs chofes
differentes, qui coflcourent toutes au même butl
Tout compote fait dans certaines vues eft plus ou
moins parfait, à proportion que ces parties s’affor-
tiflent exaélément à ces vues. L’oe il, par exemple
eft un organe de phifieufs pièces qui doivent toutes
fervir à tracer une image claire & diftinéte de l’objet
vifible au fond de la rétine. Si toutes cés pièces^
fervent autant qu’elles en font capables, à cet ufage 1 oeil eft cenfe parfait. La vie de l’homme, entant
qu’elle défigfte l’affemblage de fes aérions libres eft
cenfée parfaite, fi toutes fes aérions tendent à une
fini qui leur foit commune avéc les aérions naturelles.
Car de-là réfulte cet accord entre les aérions natù-
i-elles & les aérions libres, dans lequè'l .confîftë la^r-
feclion de la vie humaine. Au contraire l’Imperfection,
Ou le mal métaphyfique, confific dans la contrariété
de diverfes chofes'qui s’écartent d’un même but.
Toute perfection a une raifon générale, par laquelle
on peut comprendre pourquoi lefujet èh qüiréfide
la perfection, eft difpofé dë telle maniéré, 8c non autrement.
On peut Tappeltet 7ß rafoh déterminante de
la perfection : il n’y a pbint d’ouvrage de la nature
olidè 1 art, qui n’ait fa deftination ; c’eft par elle, en
y rapportant tout 1 ce qu’ôn obfèrve dans le fujét
qu’on eftime faperfetlion:..C’eft, 'par exemplè, delà
combinaifon d’uiîé lentillô''côncavs placée à l’oppô