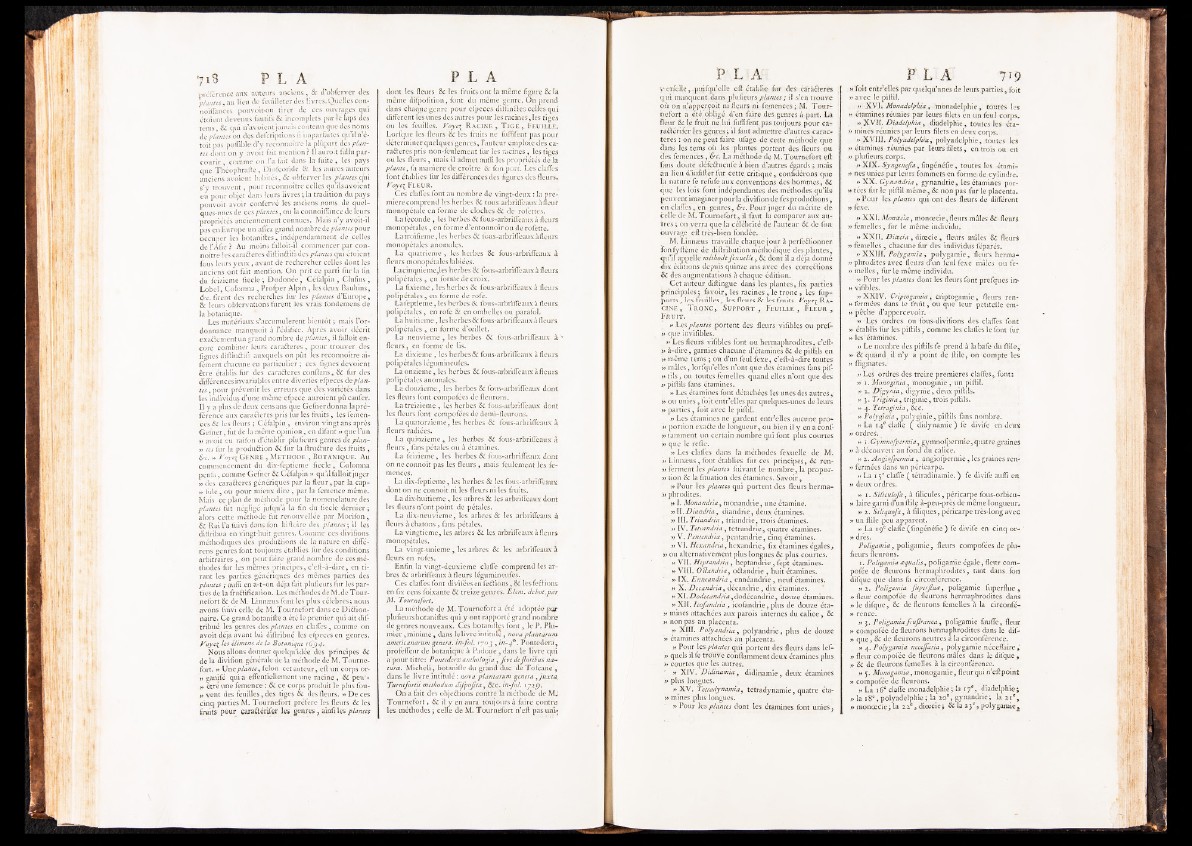
préférence aux auteurs anciens, & cl’obferver d;es
plantes, au lieu de feuilleter des livres. Quelles con-
noiffanees pouvoit-on tirer de ces ouvrages qui
étoient devenus fautifs & incomplets par le laps des
tems, & qui n’avoient jamais contenu que des noms
Replantes ou des defcriptions fi imparfaites qu’il n’é-
toit pas poffible d’y reconnoitre la plupart des plantes
dont on y avoir fait mention ? Il auroit fallu parcourir
, comme on l’a fait dans la fuite, les pays
que Théophralle, Diofcoride & les autres auteurs
anciens avoient habités, & obferver les plantes qVii
s’y trouvent, pour reconnoître celles qu’ils avoient
eu pour objet dans leurs livres ; la tradition du pays
pouvoit avoir confervé les anciens noms de quelques
unes de ces plantes, ou la connoiffance de leurs
propriétés anciennement connues. Mais n’y avoit-il
pas en Europe un affez grand nombre Replantes pour
occuper les botaniftes, indépendamment de celles
de l’Afie ? Au moins falloit-il commencer par con-
noître lescaraéteres diftinftifs des plantes qui étoient
fous leurs y e u x , avant de rechercher celles dont les
anciens ont fait mention. On prit ce parti fur la fin
du feizieme fiecle ; Dodonée, Céfalpin , Clufius ,
Lobel, Colomna, Profper Alpin , les deux Bauhins,
&c. firent des recherches fur les plantes d’Europe,
& leurs obfervations furent les vrais fondemens de
la botanique. *
• Les matériaux s’accumulèrent bientôt ; mais l’ordonnance
manquoit à l’édifice. Après avoir décrit
exactement un grand nombre,de plantes, il falloit encore
combiner leurs cara&eres, pour trouver des
lignes diftinétifs auxquels on put les reconnoître ai-
fément chacune en particulier ; ces fignes dévoient
être établis fur des carafteres conftans, & fur des
différences invariables entre diverfes efpeces Replantes
, pour prévenir les erreurs que des variétés dans
les individu^ d’une même efpece auroient pû caufer.
Il y a plus de deux cens ans que Gefner donna la préférence
aux cara&eres pris lur les fruits , les femen-
ces & les fleurs ; Céfalpin , environ vingt ans après
Gefner fut de la même opinion, en difant » que l’un
» avoir eu raifon d’établir plufieurs genres de plan-
» tes fur la produôion & fur la flruChire des fruits ,
& c . » Voy e{ G enre , Méthode , Botanique. A u
commencement du dix-feptieme fiecle, Colomna
penia, comme Gefner & Céfalpin » qu’il falloit juger
» des carafteres génériques par la fleur , par la cap-
» fuie, oti pour mieux dire , par la femence même.
Mais ce plan de méthode pour la nomenclature des
plantes fut négligé jufqu’à la fin du fiecle dernier ;
alors cette méthode fut renouvellée par Morifon,
&: Rai l’a fuivi dans fon hiftoire des plantes ; il les
diltribua en vingt-huit genres. Comme ces düvifions
méthodiques des productions de la nature en diffé-
rens genres font toujours établies fur des conditions
arbitraires , on peut faire grand nombre de ces méthodes
fur les mêmes principes, c’eft-à-dire, en tirant
les parties génériques des mêmes parties des
plantes ; aufli en a-t-on déjà fait plufieurs fur les parties
de la fructification. Les méthodes de M.de Tour-
nefort & de M. Linnæus font les plus célébrés; nous
avons fuivi celle de M. Tournefort dans ce Dictionnaire.
Ce grand botanifte a été le premier qui ait distribué
les genres des plantes en claffes , comme on
avoit déjà avant lui diftribué les efpeces en genres.
Voye%_ les élémens de la Botanique 1694.
Nous allons donner quelqu’idée des principes &
de la divifion générale de la méthode de M. Tournefort.
» Une plante, félon cet auteur, eft un corps or-
» ganifé qui a effentiellement une racine , & peu‘-
» etre une femence : & ce corps produit le plus fou-
,> vent des feuilles, des tiges & des fleurs. » De ces
cinq parties M. Tournefort préféré les fleurs & les
fruits pour caraCtérifer les genres, ainfi les plantes
dont les fleurs & les fruits ont la même figure & la
même difpofition, font du même genre. On prend
dans chaque genre pour efpeces diftinCtes celles qui
different les unes des autres pour les racines, les tiges
ou les feuilles. V oy e{ R a c in e , T ig e , Feuille.
Lorfque les fleurs & les fruits ne fuflifent pas pour
déterminer quelques genres, l’auteur emploie des ca-
raCteres pris non-feulement fur les racines , les tiges
ou les fleurs, mais il admet aufîi les propriétés de la
plante, fa maniéré de croître & fon port. Les claffes
font établies fur les différences des figures des fleurs.
Voye{ Fleur.
Ces claffes font au nombre de vingt-deux : la première
comprend les herbes ÔC tous arbriffeaux àfleui*
monopétale en forme de cloches & de rofettes.
La Içconde , les herbes & fous-arbriffeaux à fleurs
monopétales, en forme d’entonnoir ou de rofette.
Latroifieme,les herbes ôc fous-arbriffeaux à flairs
monopétales anomales.
La quatrième, les herbes & fous-arbriffeaux à
fleurs monopétales labiées.
La cinquième,les herbes & fous-arbriffeaux à fleurs
polipétales , en forme de croix.
La fixieme, les herbes & fous-arbriffeaux à fleurs
polipétales, en forme de rofe.
Lafeptieme, les herbes & fous-arbriffeaux à fleurs
polipétales, en rofe & en ombelles ou parafol.
La huitième, les herbes & fous-arbriffeaux à fleurs
polipétales , en forme d’oeillet.
La neuvième , les herbes & fous-arbriffeaux à s
fleurs , en forme de lis.
La dixième, les herbes & fous-arbriffeaux à fleurs
polipétales légumineufes.
La onzième, les herbes & fous-arbriffeaux à fleurs
polipétales anomales.
La douzième, les herbes & fous-arbriffeaux dont
les fleurs font compofées de fleurons.
La treizième , les herbes & fous-arbriffeaux dont
les fleurs font compofées de demi-fleurons.
La quatorzième, les herbes & fous-arbriffeaux à
fleurs radiées.
La quinzième , les herbes & fous-arbriffeaux â
fleurs , fans pétales ou à étamines.
La feizieme, les herbes & fous-arbriffeaux dont
on ne connoit pas les fleurs, mais feulement les fe-
mences.
La dix-feptieme, les herbes & les fous-arbriffeaux
dont on ne connoit ni les fleurs ni les fruits.
La dix-huitieme, les arbres & les arbriflèaux dont
les fleurs n’ont point de pétales.
La dix-neuvieme, les arbres & les arbriffeaux à
fleurs à chatons, fans pétales.
La vingtième, les arbres & les, arbriffeaux à fleurs
monopétales.
La vingt-unieme, les arbres & les arbriffeaux à
fleurs en rofes.
Enfin la vingt-deuxieme claffe comprend les arbres
& arbriffeaux à fleurs légumineufes.(
Ces claffes font divifées en ferions, & les ferions
en fix cens foixante & treize genres. Elem. debot.par
M. Tournefort.
La méthode de M. Tournefort a été adoptée par
plufieurs botaniftes qui y ont rapporté grand nombre
de genres nouveaux. Ces botaniftes fon t, le P. Plumier
, minime, dans le livre intitule, nova plahtarum
atnericanaruin généra, in-fol. 1703 , in-40. Pontedera,
profeffeur de botanique à Padoue, dans le livre 'qui
a pour titre: Pontederæ anthologia, Jive deforibus natures.
Micheli, botanifte du grand duc deTofcàne',
dans le livre intitulé : nova plantarum généra yjuxta
Turnefortii methodum difpofta, &c. in-fol. 171C).
On a fait des objeftions contre la méthode de Mj
Tournefort, & il y en aura toujours à faire contre
les méthodes ; celle de M. Tournefort n’eft pas uniy
erfelle, -puifqu’elle eft établie fur des càràéteres
q ui manquent, dans plufieurs plantes ; il s’en trouve
où on n’apperçoit ni fleurs ni femences ; M. Tournefort
a été, obligé d’en faire des.genres à part. La
fleur & le fruit ne lui fuflifent. pas toujours, pour car
rafrérifer les genres ; il faut admettre d’autres caractères
: on ne peut faire ufage de cette méthode que
dans les tems oîi les plantes portent des fleurs ou
dés femencés,,'&c. La méthode de M.Tournefort eft
fans doute, défefrueufe à bien d’autres égards ; mais
âu lieu d’infifter fur cette, critique, confidérons que
la nature fe refufe aux conventions des hommes, &c
que les lois font indépendantes des méthodes qu’ils1
peuvent imaginer pour la divifion de fes productions,
en claffes,,en genres, &c. Pour juger du mérite de
celle de M. Tournefort, il faut la comparer aux autres
; on verra que la célébrité de l’auteur & de fon
ouvrage eft très-bien fondée.
M. Linnæus travaille chaque jour à perfectionner
fonfyftèmé de. diftributionméthodique des plantes,
qu’il appelle méthode fexuelle, & dont il a déjà donné
dix éditions depuis quinze ans avec des corrections
& des augmentations à chaque édition.
Cet auteur diftingue dans les plantes, fix parties
principales ; favoir, les racines , le tronc, les füp-
ports, les feuilles, les fleurs & les fruits. Poye^ R a c
in e , T r q n c , S u p p o r t , Fe u i l l e , F l e u r ,,
F r u i t .
» Les plantes portent des fleurs vifibles ou pref-
» que invifibles.
» Les fleurs vifibles font ou hermaphrodites, c’eft-
» à-dire, garnies chacune d’étamines & de piftils en
» même téms ; ou d’un feul fexe, c’eft-à-dire toutes
» mâles, lorfqu’elles n’ont que des étamines fans p if
» tils, ou toutes femelles quand elles n’ont que des
» piftils fans étamines.
» Les étamines font détachées les unes des autres ,■
» ou unies, foit entr’elles par quelques-unes de leurs
» parties, foit avec le piftil.
» Les étamines ne gardent entr’elles aucune pro-
» portion exaCte de longueur, ou bien il y en a confi
» tamment un certain nombre qui font plus courtes
» que le refte.
» Les claffès dans la méthodes fexuelle • de M.
» Linnæus, font établies fur ces principes, & ren-
» ferment les plantes fuivant le nombre, la propor-
» -tion & la fituation des étamines. Savoir,
» Pour les plantes qui portent des fleurs herma-
$> phrodites.
» I. Monandriay monandrie, une étamine.
» II. Diandria, diandrie, deux étamines.
» III. Triandria, triandrie, trois étamines.
» IV. Tetrandria, tètrandrie, quatre étamines.
» V . Pentendria, pentandrie, cinq étamines.
» VI. Hexandria, hexandrie, fix etamines égales,
» ou alternativement plus longues & plus courtes.
» VII. Heptandria, heptandrie, fept étamines.
» VIII. Oclandriay ofrandrie , huit étamines. .
» IX. Enneandria, ennéandrie, neuf étamines.
» X.Decandriaf décandrie, dix étamines.
» XI. Dodecandiia, dodécandrie, douze étamines.
»XII. Icofandria, icofandrie, plus de douze éta-
» mines attachées aux parois internes du calice, &
» non pas au placenta.
» XIII. Polyandria, polyandrie, plus de douze
» étamines attachées au placenta.
»Pour les plantes qui portent des fleurs dans lef-
» quels il fe trouve conftamment deux étamines plus.
» courtes que les autrés.
' » XIV. Didinamia, didinamie, deux étamines
» plus longues.
» X V . Tetradynamia, tetradynamie, quatre éta-
» mines plus longues.
» Pour les plantes dont lés étamines font unies,
. »'foit ehtrVlles par quélqu’une's de leurs parties, foit
» avec le piftil.
9 » !'XVL. Mçnadelp/ria., tjîbnadelphie, toutés les
» étamines réunies par leurs filets en un feul corps.
»_XVII. Diadelphia, diadelphie, toutes les éta*
» minés réunies par leurs filets en deux corps.
» XVIII. Poly'adelphia, p.olyadelphie, toutes les
» étamines réunies par leurs filets, en trois ou ert
» plufieurs. torps.
» XIX. Syngenefa, fingénéfie , toutes les étami-
» nés unies par leurs fômmets en fonne; de cylindre.
» XX. Gynandria, gynandrie, les étamines por*
» tees fur le piftil même, & non pas fur le pladenta.
. »Pour les plantes quiont des fleufs de différent
» fexe.
» XXI. Monoecia, monoecie , fleurs mâles & fleurs
» femelles, fur le même-individu.
» XXII. Dioecia , dioecïé, fleurs mâles & fleurS
» femelles , chacune fur des individus féparés.
» XXIII. Polygamia, polygamie, fleurs herma-
» phrodites avec fleurs d’un feul fexe mâles ou fe*
» melles, fiir le même individu.
» Pour les plantes dont les fleurs font prefques in*
» vifibles.
»XXIV. Criptogarniit , t riptogamie, fleurs ren*
» fermées dans le fruit, ou ‘que leur petiteffe em*
» j>êche d’appercevoir. •
» Les ordres ou foiis-divifions des claffes font
» établis fur les piftils, comme les claffes le font fur
» les' étàminès.
» Le nombre des piftils fe prend à labafe du ftile,'
» & quand, il n’y a point de ftile, on compte les
» ftigmates.;
» Les ordres des treize premières claffes, font:
» i . Monoginia, mônoginié , un piftil.
» 2. Digynia, digynie, deux piftils.
» 3. Triginia, triginie, trois piftils.
» 4. Tctraginia, oCC.
» Polyginia, polyginie, piftils fans nombre.
» La 14e claffe ( didynantie ) fe divife en deltX
» ordrei
» 1 .Gymnôjpertnia, gymnofpetmie,quatre graines
» à découvert au fond du calice.
» 1. Angiofpermid, angiofpermie, les graines ren-
>> fermées dans un péricarpe.
» La 1 5e claffe ( tétradinamie. ) fe divife aufli en
>> deux ordres.
» 1. Silicuiofaf à filicules , péricarpe fous-orbicu-
» laire garni d’un ftile à-peu-près de même longueur*
» z. Siliquofi, à filiques, péricarpe très-long avec
» un ftile peu apparent.
» La 19e claffe (fingénéfie ) fe divife en cinq or-
» dres.
Poligamia, poligamie, fleurs compofées de plufieurs
fleurons.
1. Poligamia tzqualis, poligamie égale, fleur com-
pofée de fleurons Hermaphrodites, tant dans, fon
difque que dans fa circonférence.
» z. Poligamia fuperf.ua, poligamie fuperflue ,
»fleur compofée de fleurons hermaphrodites dans
» le difque, & de fleurons femelles à la circonfé-
» rence.
» 3. Poligamia fufranea, poligamie fauffe, fleur
» compofée de fleurons hermaphrodites dans le dif-
» que, & de fleurons neutres à la circonférence.
» 4. Polygamia neceffaria, polygamie néceflàire ,
» fleur compofée de fleurons mâles dans le difque ,
» & de, fleurons femelles à la circonférence.
» 5. Monogamia, monogamie, fleur qui n’eft point
» compofée de fleurons.
» La 16e claffe monadelphie; la i7 e, diadelphie;
» la 18e, polyadelphie ; la zo% gynandrie; la 21e,
» monoecie; la 12e, dicecie; & la *3% polygamie^