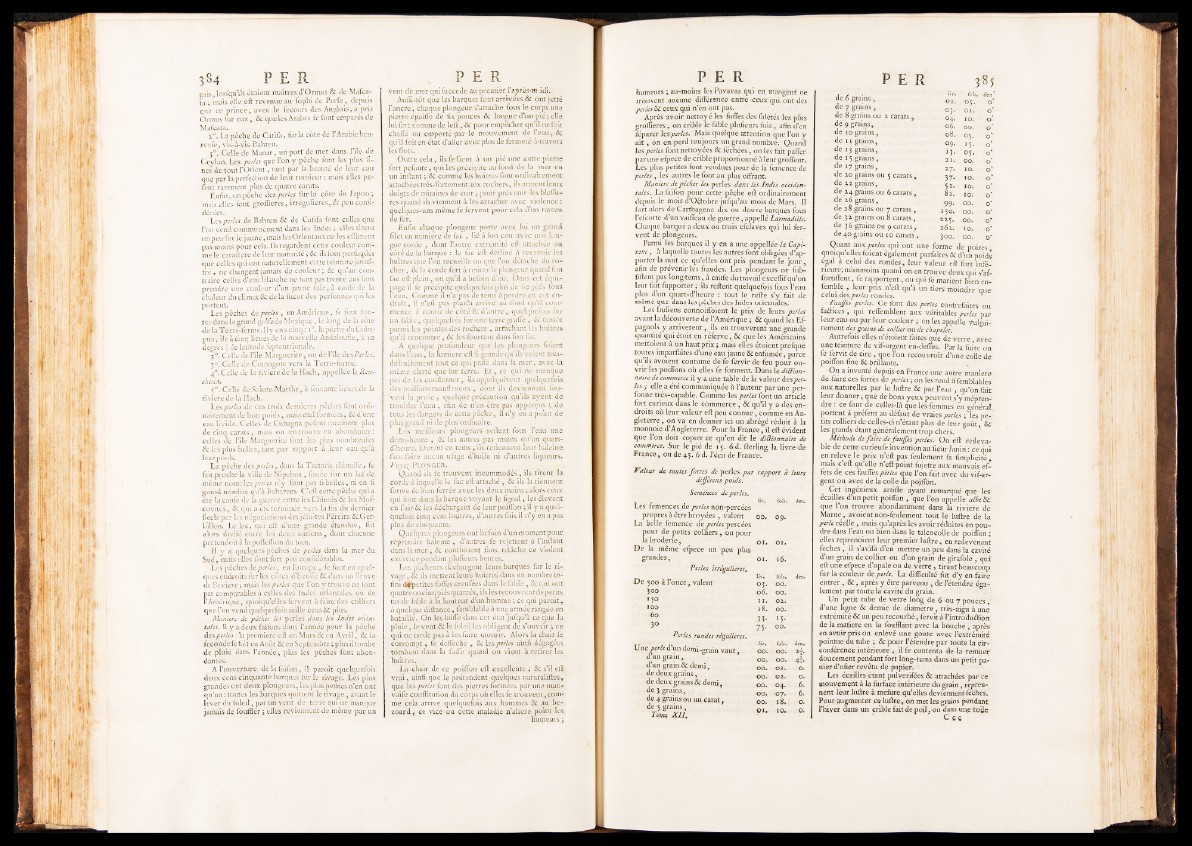
cais, lorfqu’ils étoient maîtres d’Ormus 6c de Ma'fca-
ta ; mais elle eft revenue au fophi de Perfe, depuis
que ce prince, avec le fe cours des Anglois, a pris
Ormus lur eux, 6c que les Arabes fe font emparés, de
Mafcata. . '
%°. La pêche de Catifa, fur la côte de l’Arabie heu-
reufe, vis-à-vis Bahren.
30. Celle de Manar, un port de mer dans l*île de
Ceylan. Les perles que l’on y pêche font les plus fines
de tout l’Orient, tant par la beaute de leur eau
que par laperferiion de leur rondeur : mais elles pe-
fent rarement plus de quatre carats.
Enfin, on pêche des perles fur la côte du Japon;
mais elles font groffieres, irrégulières, & peu confx-
dérées.
Les perles de Bahren 6c de Catifa font celles que
l’on vend communément dans les Indes ; elles tirent
un peu fur le jaune, mais les Orientaux ne les eftiment
pas moins pour cela. Ils regardent cette couleur comme
le caraaere de leur maturité, 6c ils font perfu^dés
que celles qui ont naturellement cette teinture jaunâtre
, ne changent jamais de couleur ; 6c qu’au contraire
celles d’eau blanche ne font pas trente ans fans
prendre une couleur d’un jaune laie, à caufe de la
chaleur du climat 6c de la fueur des perfonnes qui les
portent.
Les pêches de perles , en Amérique, fe font toutes
dans le grand golfe de Mexique, le long de la côte
de la Terre-ferme. Il y en a cinq : i°. la pêche du Cuba-
gna, île à cinq lieues de la nouvelle Andaloufie, à 10
degrés { de latitude feptentrionale.
20. Celle de 111e Marguerite, ou de 111e des Perles.
30. Celle de Gomogote vers la Terre-ferme.
4°. Celle de la riviere de la Hach, appellée la Ren-
cheria.
50. Celle de Sainte-Marthe, à foixante lieues de la
riviere de la Hach.
Les perles de ces trois dernieres pêches font ordinairement
de bon poids, mais mal formées, 6c d’une
eau livide. Celles de Cubagna pefent rarement plus
de cinq carats, mais on en trouve en abondance :
celles de l’île Marguerite font les plus nombreufes
& les plus belles, tant par rapport à leur eau qu’à
leur, poids.
La pêche d as perles, dans la Tartane chinoife, fe
fait proche la ville de Nipehoa, fituée fur un lac de
même nom r i e s n ’y font pas fi belles , ni en fi
grand nombre qu’à Baharem. C’ eft cette pêche qui a
été la caufe de la guerre entre les Chinois 6c les Mof-
covites, & qui a été terminée vers la fin du dernier
fieclepar les négociations des jéfuites Péreira &Ger-
billon. Le lac, qui eft d’une grande étendue, fut
alors divifé entre les deux nations, dont chacune
prétendoit à la poffeflion du tout. '
Il y a quélques pêches de perles dans la mer du
Sud, mais elles font fort peu confidérables.
Les pêches de perles, en Europe, fe font en quelques
endroits fur les côtes d’Ecoffe &c dans un fleuve
de Bavière ; mais les perles que l’on y trouve ne font
pas comparables à celles des Indes orientales ou de
l’Amérique, quoiqu’elles fervent à faire des colliers
que l’on vend quelquefois,mille écus 6c plus.
Maniéré de pêcher Us perlés dans les Indes orientales.
Il y a deux faifons dans l’année pour la pêche
des perles : la première eft en Mars 6c en A v ril, 6c la
fécondé fe fait en Août 6c en Septembre ; plus il tombe
de pluie dans l’année, plus les pêches font abondantes.
A l’ouverture de la faifon, il paroît quelquefois
deux cens cinquante barques fur le rivage. Les plus
grandes ont deux plongeurs, les plus petites n’en ont
qu’un : toutes les barques quittent le rivage , avant le
lever du foleil, par un vent de terre qui ne manque
jamais de fouffler ; elles reviennent de même par un
vent de mer quxfuccede au premier l’après-m idi.
Auffi-tôt que les barques font arrivées 6c ont jette
l’ancre, chaque plongeur s’attache fous le corps une
pierre épaiffe de fxx pouces 6c longue d’un pié ; elle
lui fert comme de left, 6c pour empecher qu’il ne foit
chaffé ou emporté par le mouvement de l’eau, 6c
qu’il foit en état d’aller avec plus de fermeté à-travers
les flots.
Outre cela, ils fe lient à un pié une autre pierre
fort pefante, qui les précipite au fond 'de la mer en
un inftant ; 6c comme les huitres font ordinairement
attachées très-fortement aux rochers, ils arment leurs
doigts de mitaines de cuir, pour prévenir les blefiu-
res quand ils viennent à les arracher avec violence :
quelques-uns même fe fervent pour cela d’un rateau
ae fer.
Enfin chaque plongeur porte avec lui un grand
filet en maniéré de fac , lié à fon cou avec une longue
corde , dont l’autre extréixiité eft attachée au
côté de la barque : le fac eft deftiné à recevoir les
huîtres que l’on recueille ou que l’on détache du rocher
, 6c la corde fert à retirer le plongeur quand fon
fae eft plein, ou qu’il a befoin d’air. Dans cet équipage
il fe précipite quelquefois plus de 60 piés fous,
l’eau. Comme il n’a pas de tems à perdre en cet en-,
dx'oit, il n’ eft pas plutôt arrivé avi fond qu’il commence
à courir de côté 6c d’autre, quelquefois fur
un fable, quelquefois fur une terre graffe , 6c tantôt
parmi les pointes des rochers , arfachant les huîtres
qu’il rencontre , 6c les fourrant dans fon fac.
A quelque px*ofondeur que les plongeurs foient
dans l’eau, la lumière eft fx grande qu’ils voient très-.
dxftinfteinenttout ce qui pane dans la mer, avec la
même clarté que fur terre. E t , ce qui ne manque
pas de les confterner, ils apperçoivent quelquefois
des poiftons monftrueux , dont ils deviennent fou-
vent la proie , quelque précaution qu’ils ayent de
troubler l’eau , afin de n’en être pas apperçus ; de
tous les dangers de cette pêche, il n’y en a point de
plus grand ni de plus ordinaire.
Les meilleurs plongeurs reftent fous l’ eau une
demi-heure , 6c les autres pas moins qu’un quart-
d’heure. Durant ce tems, ils retiennent leur haleine
fans faire aucun ufage d’huile ni d’autres liqueurs.
F oy e{ Pl o n g e r .
Quand ils fe trouvent incommodésils tirent la
corde à laquelle le fac eft attaché , 6c ils la tiennent
ferme 6c bien ferrée avec les deux mains ; alors ceux
qui font dans la barque voyant le lignai, les élevent
en l’air 6c les déchargent de leur poiîfon ; il y a quelquefois
cinq cens huîtres, d’autres fois il n’y en a pas
plus de cinquante.; * n . ,• ... -. •
Quelques plongeurs ont befoin d’un moment pour
reprendre haleine , d’autres fe rejettent à l’inftant
dans la mer , 6c continuent fans relâche ce violent
exercice pendant plufxeurs heures.
Les pêcheurs déchargent leurs barques fur le ri—-
vage, & ils mettent leurs huîtres dans un nombre infini
dtpetites foffes creufées dans le fable , 6c qui ont
quatre oucinqpiésquarrés , ils les recouvrent de petits.
tas de fable à:la hauteur d’un homme ; ce qui paroît,
à quelque diftance, femblable à une armée rangée en
bataille. On les laiffe dans cet état jufqu’à ce que la.
pluie, le vent 6c le foleil les obligent de s’ouvrir ; ce
qui ne tarde pas à les faire mourir. Alors la chair fe
corrompt, fe deffeche , 6c les perles ainfx dégagées
tombent dans la foffe quand on vient à retirer les,
huîtres.
La chair de ce poifton eft excellente ; 6c s’il eft:
v ra i, ainfx que le prétendent quelques naturaliftes,
que les perles font des pierres-formées par une mau-
vaife conftitution du corps 0,11 elles fe trouvent, comme
cela arrive quelquefois aux hommes 6c au be-
zoard, ce vice ou çette maladie n’altere point les,
humeurs ;
humeurs ; au-moins les Pavavas qui en mangent ne
trouvent aucune différence entre ceux qui ont des
perles 6c ceux qui n’en ont pas.
Après avoir nettoyé les foffes des faletés les plus
gromeres, on crible le fable plufieurs fois , afin d’en
féparer les perles. Mais quelque attention que l’on y
a i t , on en perd toujours un grand nombre. Quand
les perles font nettoyées 6c féchées, on les fait paffer
par une efpece de crible proportionné à leur groffeur.
Les plus petites font vendues pour de la femence de
perles , les autres le font au plus offrant.
Maniéré de pêcher les perles dans Us Indes occidentales.
La faifon pour cette pêche eft ordinairement
depuis le mois d’Oftobre jvifqu’au mois de Mars. Il
fort alors de Carthagene dix ou douze barques fous
l’efcorte d’un vaiffeau de guerre, appellé Larmadille.
Chaque barque a deux ou trois efclaves qui lui fervent
de plongeurs.
Parmi les barques il y en a une appellée la Capi-
tane, à laquelle toutes les autres font obligées d’apporter
la nuit ce qu’elles ont pris pendant le jou r,
afin de prévenir les fraudes. Les plongeurs ne fub-
fxftent pas long-tems, à caufe du travail exceffif qu’on
leur fait fupporter ; ils reftent quelquefois fous l’eau
plus d’un quart-d’heure : tout le refte s’y fait de
même que dans les pêches des Indes orientales.'.
Les Indiens connoiffoient le prix de leurs perles
avant la découverte de l’Amérique ; 6c quand les Ef-
pagnols y arrivèrent, ils en trouvèrent une grande
quantité qui étoit en réferve, 6c que les Américains
mettaient à un haut prix ; mais elles étoient prefque
toutes imparfaites d’une eau jaune &enfûmée, parcé
qu’ils avoient coutume de fe fervir de feu pour oxi-
vrir les poiffons oîi elles fe forment. Dans le dictionnaire
de commerce il y a une table de la valeur des perles
; elle a été communiquée à l’auteur par une per-
fonne très-capable. Comme les perles font un article
fort curieux dans le commerce, & qu’il y a des endroits.
oîi leur valeur eft peu connue, comme en Angleterre
, on va en donner ici un abrégé réduit à la
monnoie d’Angleterre. Pour la France, il eft évident
que 1 on doit copier ce qu’en dit le dictionnaire de
commerce. Sur le pié de 15. 6d. fterling la livre de
France, ou de 45. 6 d. l’écu de France.
Valeur de toutes fortes de perles par rapport à leurs
différens poids.
Semences de perles.
Les femences de perles non-percées
propres à être broyées , valent
La belle.femence de perles percées
pour de petits colliers, ou pour
.la broderie,
De la même efpece un peu plus
grandes,
Perles irrégulières.
De 500 à l’oiice, valent
39°
150
100
60
30
Perles rondes régulières.
Une perle d’un demi-grain vaut,
d’un grain,
d’un grain 6c demi,
de deux grains,
de deux grains 6c demi,
de 3 grains ,
de 4 grains ou un carat,
de 5 grains,
Tome X I I ,
00.
liv.
03.
06.
11.
18.
33-
75-
01.
fols. tea.
09.
01.
16.
fols. d « . ’
00.
00.
02.
OO.
I 5*
00.
! fols. 'den.
00. 2p
00. 4r*
01. 0.
02. 0.
04. 6 .
07. 6 .
l8. 0.
IOi Q,
de 6 grains,
02. 05. 0*
de 7 grains,
3* 01. 0'
de 8 grains ou 2 carats,
° 04. 10. 0*
de 9 grains,
06. 00. 0*
de 10 grains,
08. o*
de 11 grains,
09. 0*
de 13 grains,
3- ï P l I de 15 grains,
° P i 0'
21. 00. 0*
de 17 grains,
27. 10. 0*
de 20 grains ou ç carats ,
37- 10. 0*
de 22 grains,
52. 10. "O*.
de 24 grains ou 6 carats,
82. 10. o‘
de 26 grains,
99. 00. 0'
de 28 grains ou 7 carats,
150. 00. 0*
de. 3 2 grains ou 8 carats,
225. 00. O*
de 36 grains ou 9 carats, -
262. 10. 0’
Quant de 40 grains aux ou égalementu 1 qui o carats, ont pnaei fffaoirtems 300. e& d de’u 00. pno piroeisd 0'
réigeaulr quoiqu’elles perles eà; ncéealunim foient doeins sr qounadneds ,o lne uenr tvraoluevuer deeftu fxo qrut ii ns’faéf
s lfeomrtbifliee n, t,l efue rr appripxo rnt’eenftt ,q ouu’à quuni ftei emrsa rmieonint dbrieen q eune-' celui des perles rondes. n
fra leur c£ti*cnesf eau e,s ou qpueril par erse. ffCeem fbolnent td aeus xp evrtéersi tacbolnetsr efaites lgpaair
ou rement leur couleur ; on les appelplee rVleus des grains de collier ou de chapelet.
Autrefois elles n etoxent faites que de verre, avec
une teinture de vif-argent en-defîus. Par la fuite on.
fe fervit de c ire , que l’on recouvroit d’une colle de
poiffon fine de Ofani rae icnevse fnotrét 6c brillante. edse dpue ips eernle sF r aonnc lee us nreen adu ftir fee mmbalnabiélerés laeuuxr. ndaotnurneelrle,sq upea rd ele b olunfst ryee ;ppaeru lv’eeanut s’yq um’oénpr feanit
pdorer t:e ncte àf opnrté fdeen tc ealul edséTfàa uqtu dee 6ucx l evsr afeiemsm es en tits colliers de celles-ci n’etant plus dep leerulers g; olûest général , pe6c
les grands étant généralement trop chers. ■ ’ >
bleM mena irse déet hcoedtete d ce .ieOunr J aenfti nr e cdee vqiaui
lce’veeft lqeu p’erlilxe ufariiereu nn’fdee eefftt i fnavueffnetsipoenr ppoaisn ft efuuljeemttee aleus f natu xfa mfiamuvpaliics :ietéf,
gfeetns td oeu c aesv efacu dffee sla p cerollelse qduee p lo’ojfnfo fna.it avec du vif-arécaCilelet
s idn’guénn pieeutixt paoritfiffoten ,a yqaunet l’roenm aaprqpuelél eq ualeb el 6esc Mquaer nl’eo,n atvrooiuevnet naobno-fnedualmemmeennt t toduant sl el al urfitvriee rdee dlea pderrel ed raénesl lle’e a, um oauis b qieun’a dparènss llees taavlcooirc roéldleu ditee sp eonif pfoonu ;
feellcehse rse ,p riel nso’aievnifta l edu’ern p rmemetiterre luunft pree,u edna nresd leav ceanvaintét edf’ut unn ger aeifnp edcee cdo’lolpiearl eo ouu d d’uen v gerrarein , dtier agnirtà bfoealeu ,c oquupi feunrt rlear c ,o u6lce,u arp dreè sp eyr lêet.r eL paa drvifefnicuu l,t éd efi l.i’té tde’ynd erne féagiare
lemUenn t ppeatri tt otuubtee lad ec avveirtére d luo gnrga idne. 6d’une ligne & demie de diamètre , t roèsu- a7i gpuo uàc uens e, ‘ edxe tlraé mmiattéi è&re u enn p leau froeucfofularnbté a, vfeecrv liat àb lo’iunctrhoed,u afptiroèns peno ianvtuoeir d pur itsu boeu ;e n6lce pvoéu urn le’é tgeonûdtree pavare ct ol’uetxet rléam ciitré
cdoonufcéermenecnet pinetnédriaenut rfeo r, t illo fneg -ctoenmtes ndtaan sd eu nlà p reetimt upear
nieLre ds’ oéfciearil rleesv êéttua ndté p pualvpeierirf.ées & attachées par ce nmeonut vleemure lnutf àtr ela à f umrfeafcuer ei nqtéur’eielluerse d deuvi genranienn,t Lreépcrheéns.
lP’hoiuvre aru dgamnse nutner ccrei blulef tfraei,t daen p moeilt, l eosu gdraaninss i up\een tdoainlet Ccc