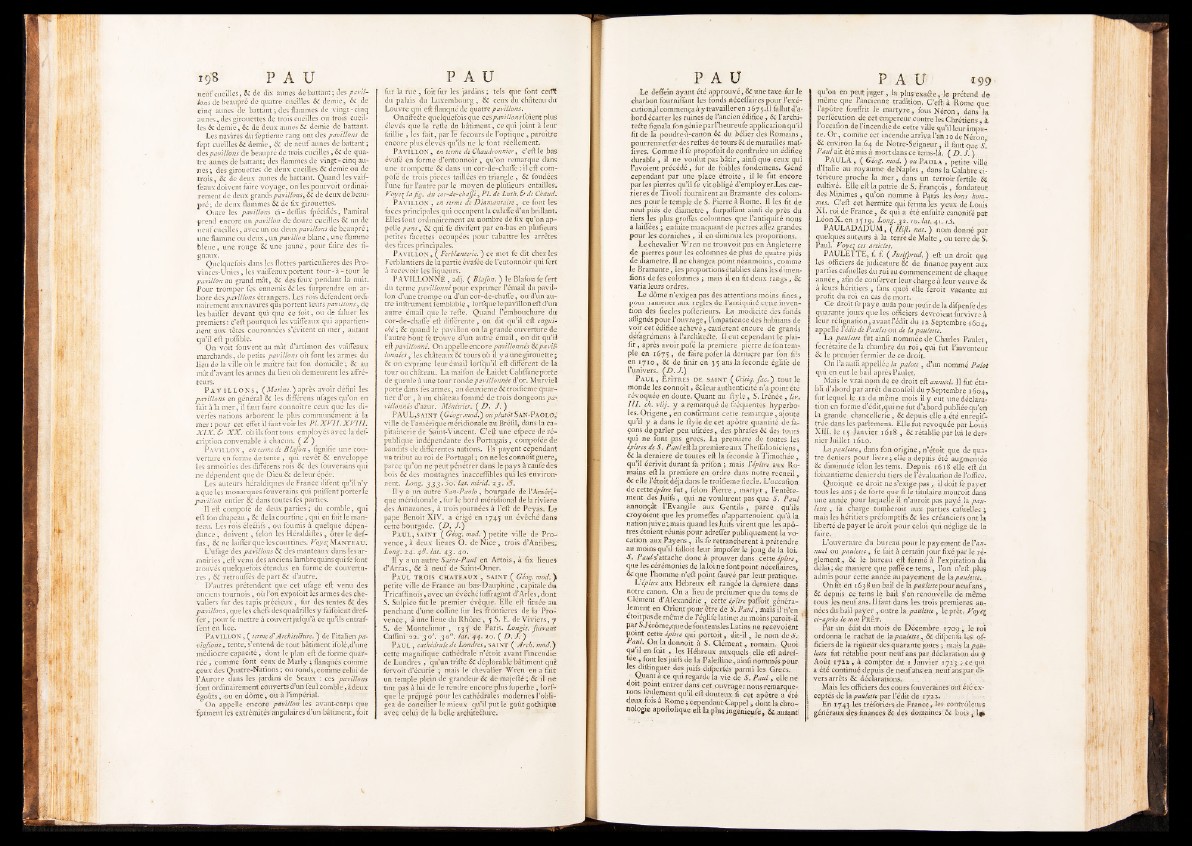
neùf cueilles, 8c de dix aunes de battant; des pavillons
de beaupré de quatre cueilles 8c demie, & de
cinq aunes de battant ; des flammes de vingt-cinq
aunes, des girouettes de trois cueilles ou trois cueilles
& demie, & de deux aunes 8c demie de battant.
Les navires du feptieme rang ont des pavillons de
Lept cueilles 8c demie, 8c de neuf aunes de battant ;
des pavillons de beaupré de trois cueilles, & de quatre
aunes de battant; des flammes de vingt-cinq aunes
; des girouettes de deux cueilles & demie ou de
trois, 8c de deux aunes de battant. Quand les vaif-
feaux doivent faire voyage, on les pourvoit ordinairement
de deux grands pavillons, & de deux de beaupré
; de deux flammes & de fix girouettes.
Outre les pavillons ci - deffus fpécifiés, l’amiral
prend encore un pavillon de douze cueilles 8c un de
neuf cueilles, avec un ou deux pavillons de beaupré ;
une flamme ou deux, un pavillon blanc, une flamme
bleue, une rouge 8c une jaune, pour faire des fi-
gnaux.
Quelquefois dans les flottes particulières des Pro-
vinces-Unies, les vaiifeaux portent tou r-à -tour le
pavillon au grand mât, 8c des feux pendant la nuit.
Pour tromper fes ennemis & les furprendre on arbore
des pavillons étrangers. Les rois défendent ordinairement
aux navires qui portent leurs pavillons, de
les haiffer devant qui que ce foit, ou de faluer les
premiers : c’eft pourquoi les vaiifeaux qui appartiennent
aux têtes couronnées s’évitent en mer, autant
qu’il eft poffible.
On voit fonvent au mât d’artimon des vaiifeaux
marchands, de petits pavillons oli font les armes du
lieu de la ville où le maître fait fon domicile ; 8c au
mât d’avant les armes du lieu ou demeurent les affréteurs..
P a v i l l o n s , ( Marine. ) après avoir défini les
pavillons en général & les différens ufages qu’on en
fait à la mer, il faut faire connoître ceux que les di-
verfes nations arborent le plus communément à la
mer: pour cet effet il faut voir les PL X V II. X V III.
X IX . & X X . oh. ils font tous employés avec la def-
cription convenable â chacun. ( Z )
P a v i l l o n en terme de Blafon, lignifie une couverture
en forme de tente , qui revêt & enveloppe
les armoiries des différens rois 8c des fouverains qui
ne dépendent que de D ieu& de leur épée.
Les auteurs héraldiques de France difent qu’il n’y
a que les monarques fouverains qui puilfent porterie
pavillon entier 8c dans toutes fes parties.
Il eft compofé de deux parties ; du comble, qui
eft fon chapeau, & de la courtine, qui en fait le manteau.
Les rois éleftifs , ou fournis à quelque dépendance
, doivent, félon les Héraldiftes, ôter le deffus
, & n e lailfer que les courtines. Voye{ Manteau.
L’ufage des pavillons 8c des manteaux dans les armoiries
, eft venu des anciens lambrequins qui fe font
trouvés quelquefois étendus en forme de couvertures
, 8c retroulfés de part 8c d’autre.
D’autres prétendent que cet ufage eft venu des
anciens tournois, où l’on expofoit.les armes des chevaliers
fur des tapis précieux, fur des tentes & des
pavillons, que les chefs des quadrilles y faifdiènt dref-
fer pour fe mettre à couvert jufqu’à ce qu’ils entraf-
fent en lice.
PAVILLON, ( terme (TArchitecture. ) de l’italien pa-
vigüone, tente, s’entend de tout bâtiment ifolé,d’une
médiocre capacité, dont le plan eft de forme quar-
r é e , comme font ceux de Marly ; flanqués comme
ceux des Quatre-Nations ; ou ronds, comme eelüi de
l’Aurore dans les jardins de Seaux : ces pavillons
font ordinairement couverts d’un féul comble, à deux
égouts, ou en dô'mè, ou à'l’impérial.
On appelle encore pavillon les avant-corps que
ifprmenties extrémités angulaires d’un bâtiment, foit
fur la rue , foit fur les jardins ; tels que font ceiflf
du palais du Luxembourg , 8c ceux du château du'
Louvre qui eft flanqué de quatre pavillons.
On affecte quelquefois que ces pavillons foient plus
élevés que le refte du bâtiment, ce qui joint à leur
faillie , les fait, par Te fecours de l’optique, paroître
encore plus élevés qu’ils ne le font réellement.
PAVILLON, en terme de Chaudronnier, c’eft le bas
évafé en forme d’entonnoir , qu’on remarque dans
une trompette & dans un cor-de-chaffe : il eft compofé
de trois pièces taillées en triangle , & foudées
l’une fur l’autre par le moyen de plufieurs entailles.
Voyc^ la fig. du cor-de-chajje, Pl. de Luth. & de Chaud.
Pavillon , en terme de Diamantaire, ce font les
faces principales qui occupent la culaffe d’un brillant.
Elles lont ordinairement au nombre de fix qu’on appelle
pans, & qui fe divifent par en-bas en plufieurs
petites facettes ecoupées pour rabattre les arrêtes
des faces principales.
Pavillon , ( Ferblanterie. ) ce mot fe dit chez les
Ferblantiers de la partie évafée de l’entonnoir qui fert
à recevoir les liqueurs.
PAVILLONNÉ , adj, ( Blafon. ) le Blafon fe fert
du terme pavillonné pour exprimer l’émail du pavillon
d’une trompe ou d’un cor-de-chaffe, ou d’un autre
infiniment femblable, lorfque le pavillon eft d’un
autre émail que .le refte. Quand l’embouchure du
cor-de-chaffe eft différente, on dit qu’il eft engui-
ché ; 8c quand le pavillon ou la grande ouverture de
l’autre bout fe trouve d’un autre émail, on dit qu’il
eft pavillonné. On appelle encore pavillonnés 8cpaviü-
lonnies, les châteaux & tours où il y a une girouette ;
& on exprime leur émail lorfqu’il eft différent de la
tour ou château. La maifon de Laidet Califfane porte
de gueule à une tour ronde pavillonnée d’or. Murviet
porte dans fes armes , au deuxieme 8c troifieme quartier
d’or , à un château fommé de trois dongeons pa\
villonnés d’azur. Ménétrier.. ( D . J . )
PAUL,sa in t (Géogr.mod.) ou plutôt San-Paolo,'
ville de l’amérique méridionale au Bréfil, dans la capitainerie
de Saint-Vincent. C ’eft une efpece de république
indépendante des Portugais, compofée de
bandits de differentes nations. Ils payent cependant
un tribut au roi de Portugal ; on ne les connoit guere,
parce qu’on ne peut pénétrer dans le pays à caufe des
bois & des montagnes inacceflîbles qui les environnent.
Long. 3 3 3 S 0 . lat. ntérid. 23. a5.
Il y a un autre San-Paolo, bourgade de l’Amérique
méridionale, fur le bord méridional de la riviere
des Amazones, à trois journées à l’eft de Peyas. Le
pape Benoît XIV. a érigé en 1745 un évêché dans
cette bourgade. {D. J.')
Pa u l , saint ( Géog.rnod. ) petite ville de Provence
, à deux lieues O. de N ice, trois d’Antibes;
Long. 24. 48. lat. 43. 40.
Il y a un autre Saint-P’aul en Artois, à lix lieues
d’Arras, 8c à neuf de Saint-Omer.
Paul trois ch âteaux , saint ( Géog. mod. y
petite ville de France au bas-Dauphiné , capitale du
Tricaftinois, avec un évêchéfuffragant d’Arles,dont
S. Sulpice fi.it le premier évêque. Elle eft fituée au
penchant d’une colline fur les. frontières de la Pro-
vence, à une lieue du Rhône, 5 S. E. de Viviers, 7
S. de Montelimar , 13^ de Paris. Longit. fuivartt
Caflini 22. 3 or. 3011. lat 1' 44. 20. ( D . J. )
Paul , cathédrale de Londres, SAINT ( Arck. fnod.y
cette magnifique cathédrale n’étoit avant l’incendie
de Londres , qu’un trifte &C déplorable bâtiment qui
fervoit d’écurie ; mais le chevalier ‘Wren en a fait
un temple plein de grandeur & de majefté ; 8c il ne
tint pas à lui de le rendre encore plus fuperbe , lo rfque
le préjugé pour les cathédrales modernes l’obligea
de concilier le mieux qu’il put le goût gothique
avec celui de la belle architecture.
Le deflein ayant été approuvé, 8c une taxe fur le
charbon fourniffant les fonds néceffaires pour l’exécution,
il commença à y travailler en 167 5.11 fallut d’abord
écarter les ruines de l’ancien édifice, 8c l’archi-
teéte fignala fon génie par l’heureufe application qu’il
fit de la poudres-canon & du bélier des Romains ,
pourrenverfer des reftes de tours 8c de murailles maf-
fîves. Comme il fe propofoit de conftruire un édifice
durable , il ne voulut pas bâtir, ainfi que ceux qui
l’avoient précédé, fur de foibles fondemens. Géné
cependant par une place étroite, il le fut encore
parles pierres qu’il fe vit obligé d’employer.Les carrières
de Tivoli fournirent au Bramante des colomnes
pour le temple de S. Pierre à Rome. Il les fit de
neuf piés de diamètre , furpaffant ainfi de près du
tiers les plus grofles colomnes que l’antiquité nous
a laiffées ; enfuite manquant de pierres affez grandes
pour les corniches, il en diminua les proportions.
Le chevalier W ren ne trouvoit pas en Angleterre
.de pierres pour les colomnes de plus de quatre piés
de diamètre. Il ne changea point néanmoins, comme
le Bramante, les proportions établies dans les çlimen-
fions de fes colomnes ; mais ii en fit deux rangs , 8c
varia leurs ordres.
Le dôme n’exigea pas des attentions moins fines,
pour ramener aux réglés de l’antiquité cette invention
des fiecles poftérieurs. La modicité des fonds
affignés pour l’ouvrage, l’impatienGe .des habitans de
voir cet édifice achevé, caufèrent encore de grands
defagrémens à l’archite&e. Il eut cependant le plai-
fir , après avoir pofé la première pierre de fon temple
en 1675, faire pofer la derniere par fon fils
en 17 10 , &c de finir en 3 5 ans la fécondé églife de
l’univers. (D . J.)
Pa u l , Èpîtres üe saint ( Critiq. fac. ) tout le
monde les eonnoît, & leur authenticité n’a point été
révoquée en doute. Quant au f ty le , S. Irénée, liv.
I II. ch, vïij. y a remarqué de fréquentes hyperboles.
Origene, en confirmant cette remarque, ajoute
qu’il y a dans le ftyle de cet apôtre quantité de façons
de parler peu ulitées, des phrafes & des tours
qui ne font pas grecs. La première de toutes les.
épîtres de S. Paul eft la première aux Theffaloniciens,
& la dérniere de toutes eft la fécondé à Timothée ,
qu’il écrivit durant fa prifon ; mais Ÿépure aux Romains
eft la première en ordre dans notre recueil,
& elle l’étoit déjà dans le troifieme fiecle. L’occâlion
de cette épître fu t , félon Pierre , martyr , l’entêtement
des Juifs , qui ne voulurent pas que S. Paul
annonçât l’Evangile aux Gentils, parce qu’ils
croyôient que les promeffes n’appartenoient qu’à la
nation juive ; mais quand les Juifs virent que les apôtres
étoient réunis pour adreffer publiquement la vocation
aux Pâyéns, ils fe retranchèrent à prétendre
au moins qu’il fàlloit leur impofer le joug de la lo i..
S. Paul f attache donc à prouver dans cette épître,
que les cérémonies de la loi ne font- point néceffaires,
oc que l’homme n’eft point jfauvé. par leur pratique.
L’épître aux Hébreux eft rangée la derniere, dans
notre canon. On a lieu de préfumer que du teins de
Clement d’Alexandrie . cette épître paflbit généralement
en Orient pouf être de' S. Paul, mais il n’en ,
etoitpas de môfnO de l’églife latine: au moins paroît-il ^
par S.Jerome,qüe de fontënisles Latins- ne recevoient
point cettJe épître qui portoit, dit-il, le nom de-O’c
Paul, On la donnoit à S. Clément, romain. Quoii
qu il en fait , les Hébreux auxquels'.elle eft ,adt*ef-i
iee » font les'juifs de la Paleftiney ainfi nommés pour
les diftinguer des juifs' tlifperfés parmi les Grecs; :
, Q^la«t à ce qui regarde la vie de S. Paul * elle né
doit point entrer dans cef; ouvrage: nous remarque-,
rons feulement qu’il eft douteux ii cet apôtre a été-
deux fois à Rome ; cependant-Gappel, dont la chronologie
apoftolique eft la. plus ingénieufe , &. .aut4nt[
qu’on en peitt juger, la plus exafre, -le prétend de
meme que l’ancienne tradition. C’eft: à Rome que
1 apôtre fouffht le martyre, fous Néron ; dans la
perfécution decet empereur contre les Chrétiens à
l’occafion de l’incendie de cette ville qu’il leur impute.
O r , comftie cet incendie arriva l’an 10 dé Néron :
& environ .la 64 de Notre-Seigneur ^ il faut que S,
Paul ait été mis à mort dans ce tems-îà. ( D . J. )
PAULA , ( Géog. mod. ) ou Paola , petite vUlè
d’Italie au royaume de Naples , dans la Calabre ci-
térieure proche la mer, dans un terroir fertile &
cultive. Elle eft la patrie de S; François , fondateur,
des Mi/nmes , qu on nomme à Paris les bons hom-.
mes. Ç’eft cet hermite qui ferma les yeux de Louis
XI. roi de France, & qui a été enfuite canonifé par
LéonX. en 15 . 1 . 9 * rip.lat. 41. ià. ; ,
PAULADADUM, ( Hiß. nat. ) nom donné par
quelques auteurs à la terre de Malte, ou terre de S.
Paul. Voye{ ces articles.
PAULETTE, f. f. ( îurifprud. y eft un droit que
les officiers de judicature & de finance payent aux
parties cafuelles du roi au commencement dè chaque
année , afin de conferver leur charge à leur veuve
a leurs heritiers , fans quoi elle feroit vacante ail
profit du roi en cas de mort.
Ce droit fe paye, aufli pour .jouir de la difpenfe des
quarante jours que les officiers devroient furvivre à
leur réfignation,avantl’éd.it du n Septembre 1604,
appellé Y édit de Paulet OU de la paulette.
La paulette fut ainfi nommée de Charles Paulet,
fecrétaire de ia chambre du ro i, qui fut l’inventeur
8c le premier fermier de ce droit.
On l’a aufli appellée la palote , d’un nommé Pâlot
qui en eut le bail après Paulet.
Mais le vrai nom dé ce droit eft annuel. Il fut étâ?
bli d’abord par arrêt du confeil du 7 Septembre 1604*
fur lequel le .iz du même mois il y eut une déclaration
en forme d’édit,qui ne fut d’abord publiée qu’eii
la grande chancellerie, & depuis elle a été enregistrée
dans les parlemens. Elle frit révoquée par Louis
XIII. le 15, Janvier 1618 , 8c rétablie par lui le dernier
Juillet i6zo.
La paulette, dans fön origine, n’étoit que de quatre
deniers pour livre ; elle a depuis été augmentée
8c diminuée félon lestems. Depuis 1618 elle eft.du
foixantieme denier du tiers de' l’évaluation de l’office»
Quoique ce droit ne s’exige pas , il doit fe payer
tous les ans ;- de forte que fi le titulaire mouroit dans
une année pour laquelle il n’auroit pas payé la paulette
, fa charge tombêroit aux parties cafuelles ;
mais les héritiers préfomptifs & les créanciers ont la
liberté de payer le droit pour celui qui néglige de le
faire,
L’ouvertitre. du bureau pour le payement de Y annuel
ou paulette, fe fait à certain jour fixé par le réglement
, 8c le bureau eft ferbie à l’expiration du
délai; de maniéré que paffé ce tems , l’on n’eft .plus
admis pour cette année,àu payement de la paulette., ■
Oft fit en 16381m bail de la paillette pour neuf ans ,
& depuis ce tems lé bail s’eft renouvelle dé même
tous les neuf ans. Il faut dans lesi trois premières an-s
nées du bail pay er , outre la paulette, le prêt. Voye%
ci-après le mot PRÊT.
Par un édit dû mpis de Décembre ijo tp f .le ro|
ordonna le rachat de la paulette, 8c difpenfa leà officiers
de la rigûeür des quarante jours ; mais la paillette
fut rétablie pour neüf ans par. déclaration du p
Août -172z,' à compter dû 1 Janvier 17I3 ; çe; qui
a été continué1 depuis de neufahs en neuf ans par divers
arrêts & déclarations. ; . , .
. Mais lés officiers des cours fouverâinês onï'ét'e éx-
ceptés de la paulette l ’édit de 17Ü .
. En 1743 les tréfcfriérsde France ,- les contrôleurs
généraux des finances & des domaines \8c bois, 1«*