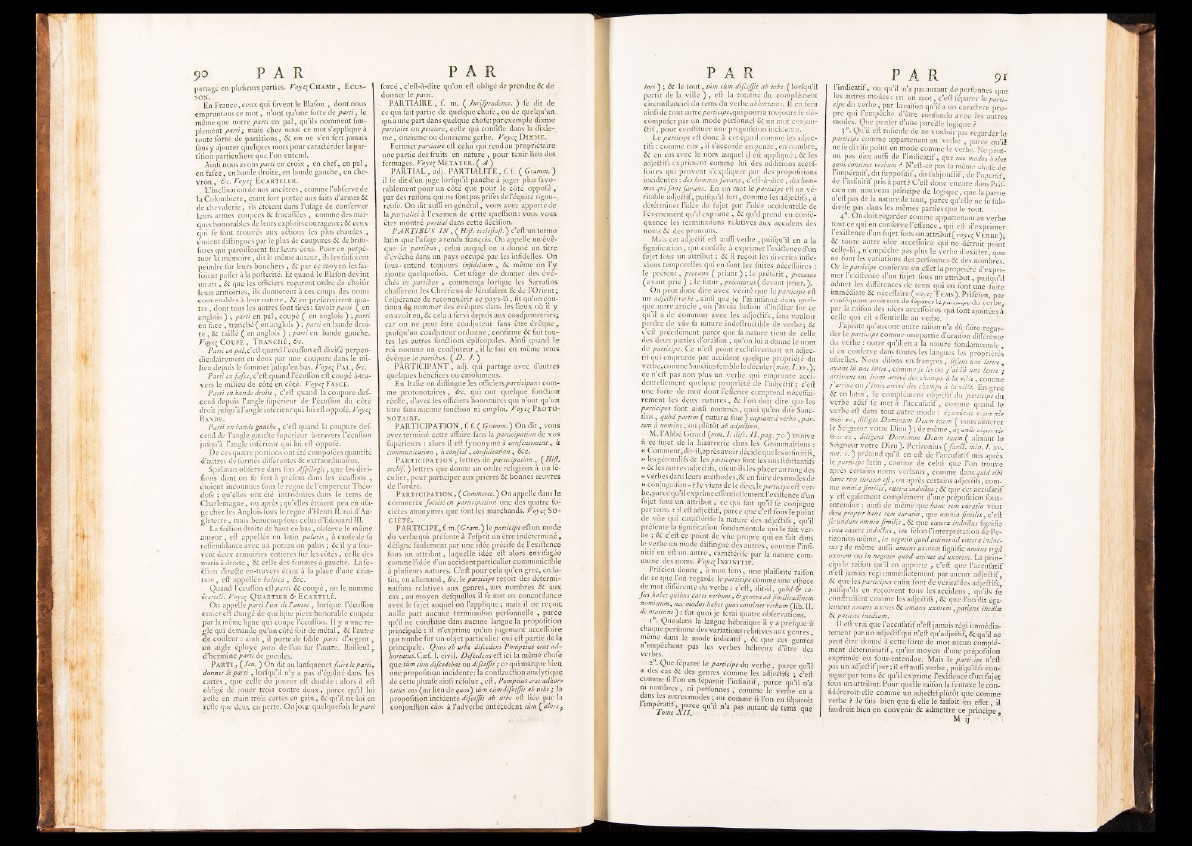
If
partagé en plufieurs parties. Voye{ C hamp , ECUSSON.
En France, ceux qui favent le Blafon , dont nous
empruntons ce m ot, n’ont qu’une forte de parti, le
même que notre parti en pal, qu’ils nomment Amplement
parti; mais chez nous ce mot s’applique à
toute forte de partitions, & on ne s’en fert jamais
fans y ajouter quelques mots pour cara&érifer la partition
particulière que l’on entend.
Ainli nous avons parti en croix , en chef, en p a l,
en fafce, en bande droite, en bande gauche, en chevron
, &c. Voyc{ ECARTELER.
L’inclination de nos ancêtres, comme l’obferve de
la Colombiere, étant fort portée aux faits d’armes &
de chevalerie, ils étoient dans l’ufage de conferver
leurs armes coupées & fracaffées , comme des marques
honorables de leurs exploits courageux; & ceux
qui fe font trouvés aux actions les plus chaudes ,
etoient diftingués par le plus de coupures & debrifu-
fures qui paroiffoient fur leurs écus. Pour en perpétuer
la mémoire, dit le même auteur, ils les faifoient
peindre fur leurs boucliers , & par ce moyen les fai-
foient paffer à la poftérité. Et quand le Blafon devint
un art, & que les officiers reçurent ordre de choifir
leurs armoiries, ils donnèrent à ces coups des noms
convenables à leur nature, & en prefcrivirent quatre
, dont tous les autres font tirés : favoir parti ( en
anglois ). ; parti en pa l, coupé ( en anglois ) ; parti
en face , tranché ( en anglois ) ; parti en bande droite
, & taillé ( en anglois ) ; parti en bande gauche.
Voyt{ Coupé , T ranché, &c.
Parti en pal,c’eft quand l’écuffoneft divifé perpendiculairement
en deux par une coupure dans le milieu
depuis le fommet jufqu’en bas. Voye^ Pal , &c.
Parti en fafce, c’ eft quand l’écuffon eft coupé à-travers
le milieu de côte en côté. Voye{ Fasce.
Parti en bande droite , c’eft quand la coupure def-
cend depuis l’angle fupérieur de l’écuflbn du côté
droit jufqu’à l’angle inferieur qui luieftoppofé. Voye^
Bande.
Parti en bande gauche , c’ eft quand là coupure def-
cend de l’angle gauche fupérieur à-travers l’écuflbn
jufqu’à l’angle inférieur qui lui eft oppofé.
De ces quatre portions ont été compofées quantité
d’autres de formes différentes & extraordinaires.
Spelman obferve dans fon Afpilogie, que les divi-
fions dont on fe fert à préfent dans les écuffons ,
étoient inconnues fous le régné de l’empereur Théo-
dofe ; qu’elles ont été introduites dans le tems de
Charlemagne, ou après ; qu’elles étoient peu en ufa-
ge chez les Anglois fous le regrie d’Henri IL roi d’Angleterre
, mais beaucoup fous celui d’Edouard III.
La feftion droite de haut en bas, obferve le même
auteur, eft appellée en latin palaris, à caufe de fa
reffemblance avec un poteau ou palus ; & il y a fou-
vent deux armoiries entières fur les côtés, celle des
maris à droite, & celle des femmes à gauche. La fe-
clion direfte en-travers étant à la place d’une ceinture
, eft appellée baltica , &c.
Quand l’écuffon eft parti-& coupé, on le nomme
•écartelé. Voye{ QUARTIER 6* ECARTELÉ.
On appelle parti l'un de Vautre , lorfque l’écuffon
entier eft chargé de quelque piece honorable coupée
par la même ligne qui coupe l’écuffon. Il y a une réglé
qui demande qu’un côté foit de métal, & l’autre
de couleur : ainfi , il porte de fable parti d’argent,
un aigle éployé parti de l’un fur l’autre. Bailleul,
d’hermine parti de gueules.
Pa r t i , ( Jeu. ) On dit au lanfquenet faire le parti,
donner le parti, lorfqu’il n’y a pas d’égalité dans les
cartes , que celle du joueur eft double : alors il eft
obligé de jouer trois contre deux, parce qu’il lui
refte en main trois cartes en gain, & qu’il ne lui en
refte que deux en perte. On jou£ quelquefois le parti
forcé , c’ eft-à-dire qu’on eft obligé de prendre & dé
donner le parti.
PARTIAIRE, f. m. ( Jurifprudence. ) fe dit de
ce qui fait partie de quelque chofe, ou de quelqu’un,
qui aime part dans quelque chofe: par exemple dixme
partiaire ou per der e, celle qui confifte dans la dixie-.
me, onzième ou douzième gerbe. Voye£ D ixme.
Fermier partiaire eft celui qui rend au propriétaire
une partie des fruits en nature , pour tenir lieu des
fermages. Voye[ Mé t ay er. ( A )
PARTIAL, adj. PARTIALITÉ, f. f. ( Gramm. )
il fe dit d’un juge lorfqu’il panche à juger plus favorablement
pour un côté que pour le côte oppofé ,
par des raifons qui ne font pas prifes de l’équité rigou-
reufe. On dit-auffi en général, vous avez apporté de
la partialité à l’examen de cette queftion: vous vous,
êtes montré partial dans cette décifion.
PARTIBUS IN , f Hiß. eccléfiafi. ) c’eft un terme
latin que l’ufage a rendu françois. On appelle un évêque
in partibus , celui auquel on a donné un titre
d’évêché dans un pays occupé par les infîdelles. On
fous-entend toujours infidelium , & même on l’y
ajoute quelquefois. Çet ufage de donner des évêchés
in partibus , commença lorfque les Sarrafins
chafferent les Chrétiens de Jérufalem Sc de l’Orient;
l’efpérance de reconquérir ce pays-là, fit qu’on continua
d$ nommer des évêques dans les lieux où il y
enavoit eu, & cela a fervi depuis aux coadjutoreri.es;
car on ne peut être coadjuteur fans être évêque ,
puifqu’un coadjuteur ordonne, confirme & fait toutes
les autres fonctions épifcopales. Ainfi quand le
roi nomme un coadjuteur , il le fait en même tems
évêque in partibus. ( D . J. )
PARTICIPANT, adj. qui partage avec d’autres
quelques bénéfices ou émolumens.
En Italie on diftingue les officiersparticipans com-.
me protonotaires, &c. qui ont quelque fon&iont
réelle, d’avec les officiers honoraires qui n’ont qu’un
titre fans aucune fonction ni emploi. Voye{ Pro to -
no ta ir e .
PARTICIPATION, f. f. ( Gramm. ) On d i t , vous
avez terminé cette affaire fans la participation de vos
fupérieurs : alors il eft fynonyme à confentement., à
communication , à confeil, confultation, &c.
Pa r t ic ip a t io n , lettres de participation, (ÂÏ/?.‘
eccléf. ) lettres que donne un ordre religieux à un fe-
culier, pour participer aux prières & bonnes oeuvres
de l’ordre.
Pa r t ic ipat io n , ( Commerce. ) On appelle dans le
commerce fociété en participation une des quatre (o-
ciétés anonymes que font les marchands. Voyei So-
CIÉTÉ.
PARTICIPE, f. m JG ram.') le participe eft un mode
du verbe qui préfente à l’efprit un être indéterminé ,
défigné feulement par une idée précife de l’exiftence
fous un attribut, laquelle idée eft alors envifagéè
comme l’idée d’un accident particulier communicàble
à plufieurs natures. C ’eft pour cela qu’en grec, en latin,
en allemand, &c. le participe reçoit des détermi-
naifons relatives aux genres, aux nombres & aux
cas , au moyen defquelles il fe met en concordance
avec le fujet auquel on l’applique ; mais il ne reçoit
nulle part aucune terminaifon perfonnelle , parce
qu’il ne conftitue dans aucune langue la propofition
principale: il n’exprime qu’un jugement acceffoire
qui tombe fur un objet particulier qui eft partie de la
principale. Quos ab urbe difcedens Pompeius erat ad-
hortatus. Cæf. I. civil. Difcedens eft ici la même chofe
que tîim cum difcedebat ou difcejjit ; ce qui marque bien
une propofition incidente: la conftruftion analytique
de cette phrafe ainfi réfolue, eft, Pompeius erat.adhor*
tatus eos (au lieu de quos) tum cum difcejjit ab urbe ; la
propofition incidente difcejjit ab urbe eft liée par la
conjonftion ciim à l’adyerbe antécédent tum ( tilors ?
lors ) ; & le tout, tùm cum difcejjit ab urbe ( lorfqu’il
partit de la ville ) , eft la totalité du complément
circonftanciel du tems du verbe abhortatus. .11 en fera
ainfi de tout autre participe, qui pourra toujours fe dé-
compofer par un mode perfonnel & un mot conjon-
d i f , pour conftituer une propofition incidente. -
Le participe eft donc à cet égard comme les adjectifs
: comme eux , il s’accorde en genre, en nombre,
& en cas avec le nom auquel il eft appliqué ; & les
adjedifs expriment comme lui des additions accef-
foires qui peuvent s’expliquer par des propositions
incidentes r: des hommes favans, c’eft-à-dire , des hommes
qui font favans. En un mot le participe eft un yé-
ritable adjedif, puifqu’il fert, comme les adje&ifs, à
détérminer l’idée du fujet par l’idée accidentelle de
l’évenement qu’il exprime , & qu’il prend en confé-
quence les terminaifons relatives aux accidens des
noms & des pronoms.
Mais cet adje&if eft auffi verbe , puifqu’il en a la
fignification, qui confifte à exprimer l’exiftence d’un
fujet fous un attribut ; & il reçoit les diverfes inflexions
temporelles qui en font les fuites néceffaires :.
lé préfent, precans ( priant ) ; le prétérit, precatus
(ayant prié ) ; le futur, précaturus( devant prier. ).
On p eut donc dire avec vérité que le participe eft
un adjeclif-v&rbe , ainfi que je l’ai infinué dans quelque
autre article , où j’âvois. befoin d’infifter fur ce
qu’il a de commun avec les ad je ftifs, fans vouloir
perdre de vue fa nature indeftruélible de verbe ; &
c’eft précifément parce que fa nature tient de celle
des deux parties d’oraifon , qu’on lui a donné le nom
d(t participe. Ce n’eft point exclufivement un adjectif
qui emprunte par accident quelque propriété du
verbe, comme Sanftius femble le décider (min. I. xv. );
ce n’eft pas non plus un verbe qui emprunte accidentellement
quelque propriété de l’adjeftif ; c’eft
une forte de mot dont l’effence comprend néceffai-
rement les deux natures, & l’on doit dire que les
participes font ainfi nommés, quoi qu’en dife Sanc-
tius, quodpartem ( naturæ fuæ ) capiantàverbo p a r tent
à no mine,ou plutôt ab adjcélivo.
M. 1 Abbe Girard (tom. I. difc. Il.pag. y o ) trouve
à ce fujet de la bizarrerie dans les Grammairiens :
« Comment, dit-il,apres avoir décidé que les infinitifs,
» les gérondifs & les participes font les lins fubftantifs
» & les autres adj e&ifs, ofent-ils les placer au rang des
» verbes dans leurs méthodes,& en faire des modes de
» conjugaifon »? Je viens de le dire; le participe eft verbe,
parce qu’il-exprime effentiellement l’exiftence d’un
fujet fous un attribut, ce qui fait qu’il fe conjugue
par tems : il eft adjectif, parce que c’eft fous le point
de -vue qui cara&érife la nature des adje&ifs, qu’il
préfente la fignification fondamentale qui lé fait verbe
; & c eft ce-point de vûe propre qui en fait dans
le verbe un mode diftingué des autres, comme l’infinitif
en eft un. autre, carà£iérifé; par la nature commune
des noms. Voÿe^Inf in it if .
Prifcien donne, àmonfens, une plaifante raifort'
de ce qued’ôn regarde tepanicipçxbnime\xne‘ë{6$ce
de mot- différente du Verbe t'c’efl-, dit-il1, tfiS'i-i c'a-'
fus habu quitus ‘ àretVerbu>n,,:(rgeHeraàdfmmtuJttitin.
nominum, nec modo s habet quos commet vtrburn (lib. II.
de oratione ) : fur quoi je ferai quatre obfervaiions.
• ï 0. Que«dans la langue 'hébraïque il y a prefque-à1
chaque perfonne des variations-relatives aux genres
meme^dans le mode indicatif, & que ces-'genres
n’empêchent-;pas les verbes- hébreux d’être des
verbes. 'v
2.0. Que feparer le participe du vérbè, parce qu?il-
a des cas &• des-.genres comme les àdje&ïfs\ e?èft-
commeTi l’on en fép'aroit l’infinitif, parce qu’il n’a
ni nombres , ni perfonnes , cOmm'e le verbe en a
dans tes autres modes ; ou Comme fi l’on en féparoit
limperatif ^ parce qu’il n’a pas autant-de tems qùè^
l’indicatif, ou cju’il n’a pas autant de perfonnes que
lesautresmodest en un mot, c’eft feparerle pfni-.
ripe du verbèq. par la raifod qu’ il a un caractère prod
pre qui i empêche, d être confondu avec les* autres
modes. Que p enfer d’une pareille logiqueü-'i
••30. Qu’ii cit ridicule de ne vouloir pas regarder le.
participe comme appartenant au iverbe , parée qu’il
neledivifc point en mode comme le verbe. Ne peut-i
! en pas diréiauffi dé‘.l ’indicattfqcquè ruc'modos'habtR
qmsmmma.mbtun i N’eïl-;ce pas la même c'.ife.do.
l’impératif, dittfeppofitif, du fubjonSif ; del’optatif >
de l’infinitif’ pris a parti C ’eft donc encore’dans Prif-:
cien un nouveau principe de. logique, quedapartie;
io’eftpas de la nature de tout,■ ■ parce qu’elle ne fe’filb-
divife pas clans les mêmes• parties quq le tout.
4®. Ondoit regarder comme appartenant ad :verbe;
tout ce qui en conferve l’effèncq, qui ell d’exprimeri
l’exiftence d’unfujpt.fous utiattribuf^j/cycrVEltBE)}!
& toute, autre idée accefl’oire. qui ne détruit point*.
I celle-là , n’empêché, pas plus le verbe d'exiller, que
ne font les variations .ié s petfontaes & des nombres.
; Or ic participe confel ve en .effet la propriété d’expri-.
mer l’exiftence ,d’un fujet. fous un attribut, puifqu’il
admet les différences de tems qui .en font une fuite
immédiate & néçeffaire ( voye;; T ems). Prifcien, par
cSféquent ay;©it toride. feparer lepamipeAtiMecbe,,
parrla raifon des ideés acceffoires qui font ajoûtëes-à.
: ceiîe qui eft eîfentieile au vetbe. •
J’aioûte cpfaucüne autre raifon-n’a dûrûùre.r.egàrc
i àepyleparticipe comme uuepartie dforaifcufdilïérénte
du ve rbe : (it:;re cju’i! on a la nature,' fonclamentaie-i,
il en conferve dans toutes les langues les 'propriétés
ufuelles. Nous difons eufranf s filifaht une lettre
. ayant lu une Lettre, commeqr lis’ ou. f a i lû uni lettre j
• arrivant OU étant arrivé des champs d la ville , comme
j'arrive ou j'étais arrivé des champs d la ville. En grec
& en latin , Je complément obje&if du participe du
verbe aftif fe met à l’accufatif, comme quand le
verbe eft dans tout autre mode : dyctnéauç K-jpiov toV [
Qiov <rv, diligés Dominum Deum tuum ( vous aimerez
le Seigneur vôtre Dieu ) :; de même, dya-nm kvùiov tov ;
©:oi' cü , diligens Dominum Daim tuum ( aimant le
Seigneur votre Dieu ). Périzonius ( fancl. min. I. xv. '
not. /. ) prétend qu’il en eft de l’accufatif mis après
le participe latin, comme de celui que l’on trouve
apres certains noms verbaux , comme dans quid dbi
hanc rem curatio ejl, on après certains adjeélifs, comme
omma Jzmilis, ccetera indoclus; & que cet aècufatif
y eft également complément d’une prépofition fous-
entendue : ainfi de même que hanc rem curatio vèut
dirQpropter hanc rem curatio , que omnià jimilis, c’eft
fecundum Qmnia Jimilis , & que ccetera indodus fignifie
circa caetera, indodus, ou félon l’interprétation de Pe-
rizonius même, in negotio quod attinet ad ccetera in doc-
tus ? dë même auffi amans üx'orem fignifie amans ergd
uxorem ou in negotio-quod attinet ad uxorem. La p rin-’
cipale raifon qu’il en apporté , c’eft que l’accufatif
n’eft jamais régi immédiatement par aucun adje&if,
& que les participes enfin font de véritables adjeôifs,;
puifau’ils en reçoivent tous les accidens, qu’ils fe
cbnftruifent comme lesadjeftifs, Sc quë Fon dit également
amans uxoris & amans uxorem ,patièns inédits
& pàtieds'inëdiarn.
Il eft vrai que l’acciifatif n’eft jamais régi immédiatement
par un adjeâif qui n’eft qu’adjeâif, &.qü’il ne ‘
peut être donné à cette forte de mot aucun complé- .
ment déterminatif, qu’-au moyen d’une prépofition
exprimée ou fous-ëntëndue. Mais lé participe n’eft:'
pas un adjeétif pur ; il eft auffi verbe , 'puifqu’iîfe côn-
jugue par teins & qu’il exprime l’exiftencë d’un fujet
fous un attribut. Pour, quelle raifon la fyntaxe.le côri-
fidéreroit:elle comme un adje£bif plutôt que comme
véfbe ? Je fais bien que-fi elle le fàifoit en effet il
faudrôit bien çn convenir & admettre ce principe ,