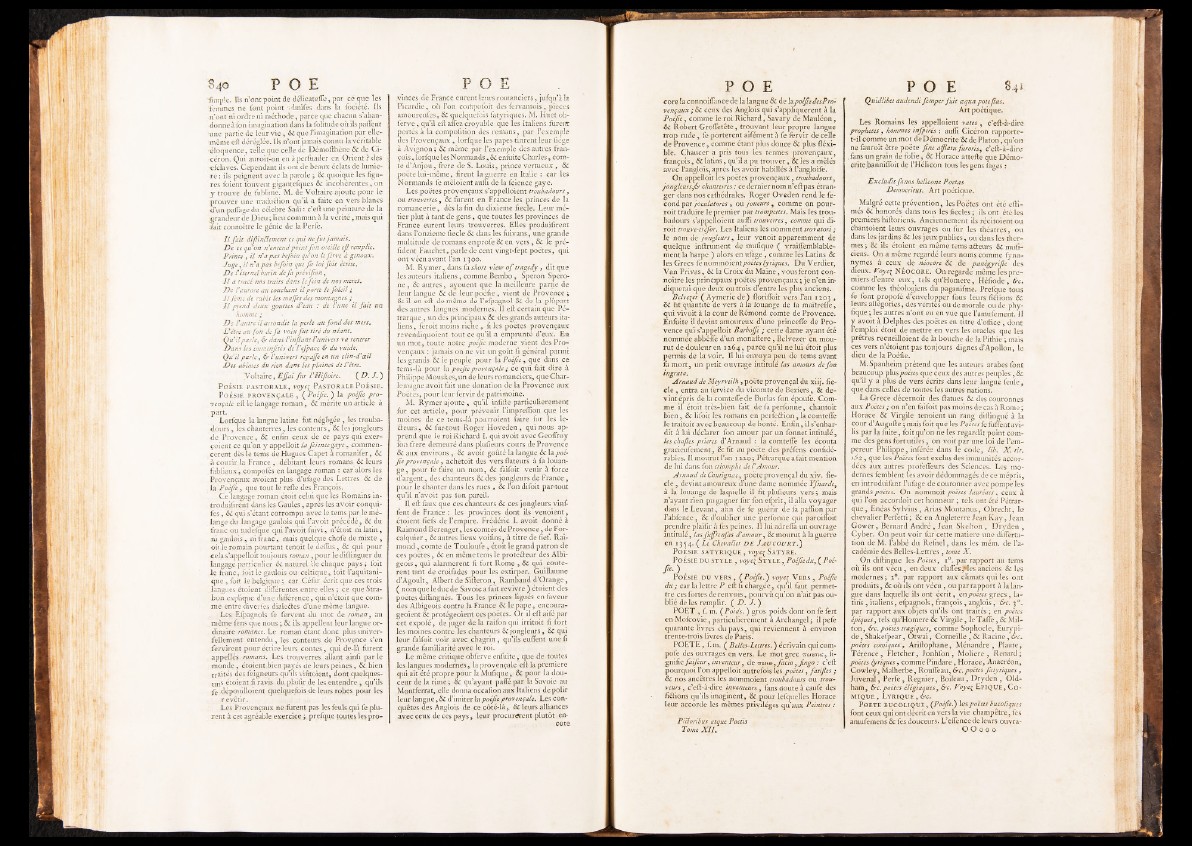
fimple. Ils n’ont point de délicateffe, par cè que les
femmes, ne font point -:dmifes dans la focieté. Ils
.n’ont ni ordre ni méthode, parce que chacun s'abandonne
à fon imagination dans la folitude où ils paflent
•une partie de leur vie , 6c que l’imagination par elle-
même eft déréglée. Us n’ont jamais connu la véritable
■ éloquence, telle que celle de Démofthène 6c de Cicéron.
Qui auroit-on en à perfuader en Orient ? des
-efclaves. Cependant ils ont de beaux éclats de lumière
: ils peignent avec la parole ; 6c quoique les figures
foient fouvent gigantefques & incohérentes, on
y trouve du fublime. M. de Voltaire ajoute pour le
.prouver une ‘traduction qu’il a faite en vers blancs
d ’un paffage du célébré Sadi : c’eft une peinture de la
^grandeur de Dieu ; lieu commun à la vérité , mais qui
fait connoître le génie de la Perfe.
II.fait difiinclement ce qui ne fut jamais.
De ce qu’on nentend point fort oreille eft remplie.
Prince , i l n’a pas befoin qu’on le ferve à genoux-.
■ Juge frf n a pas befoin que fa loi foit écrite. '
De l ’éternel burin de fa prèvifion,
I l a tracé nos traits dans le fein de nos meres.
De l ’aurore au couchant il porte le foleil ;
I l feme de rubis les mafj'es des montagnes ;
I l prend deux gouttes d’eau : de l ’une il fait un
homme ç
De Üautre il arrondit 'la perle au fond des mers.
L’être au fon de fa voix fu t tiré du néant.
(fii ï l parle, & dans l’infant l ’univers va rentrer
Dans les irnmenfités de l ’efpace & du vuide.
Qu’il parle, & l ’univers repaffe en un clin-d’oeil
Des abîmes du rien dans les plaines de l ’être.
y oltaire, Ejfai fur VHiftoire. {D . J .)
P oésie p asto r ale , voyei Pastorale Poésie.
Poésie provençale , {Poéfie. ) la poéjie provençale
eft le langage roman, 6c mérite un article à
part.
Lorfque la langue latine fut négligée, les troubadours
, les chanterres, les conteurs, 6c les jongleurs
de Provence, 6c enfin ceux de ce pays qui exer-
çoient ce qu’on y appelloit la fciencegaye., commencèrent
dès le tems de Hugues Capet à romanifer, 6c
■ à courir la France , débitant leurs romans 6c leurs
fabliaux, compofés en langage roman : car alors les
Provençaux avoient plus d’ufage des Lettres 6c de
la Poéjie, que tout le refte des François.
Ce langage roman étoit celui que les Romains in-
iroduifirent dans les Gaules, après les avoir conqui-
fe s, 6c qui s’étant corrompu avec le tems par le mélange
du langage gaulois qui l’avoit précédé, &: du
franc ou tudefque qui l’avoit fuivi, n’étoit ni latin,
ni gaulois, ni francmais quelque chofe de mixte ,
où le romain pourtant tenoit le deffus, 6c qui pour
cela s’appelloit toujours roman, pour le diftinguer du
langage particulier 6c naturel 'de chaque pays; foit
le franc, foit le gaulois ou celtique, foit l’aquitani-
que , foit le belgique ; car Céfar écrit que ces trois
langues étoient différentes entre elles ; ce que Stra-
bon explique d’une différence, qui n’étoit que comme
entre diverfes dialeCtes d’une même langue.
Les Efpagnols fe fervent du mot de roman, au
même fens que nous ; 6c ils appellent leur langue ordinaire
romance. Le roman étant donc plus univer-
fellement entendu, les conteurs de Provence s’en
fervirent pour écrire leurs contes, qui de-là frirent
appellés romans. Les trouverres allant ainfi par le
monde, étoient,bien payés de leurs peines , 6c bien
traités des feigneurs qu’ils vifitoient, dont quelques-
uns étoient fi ravis du plaifir de les entendre , qu’ils
f e dépouilloient quelquefois de leurs robes pour les
revêtir.
Les Provençaux né furent pas les feuls.qui fe plurent
à cet agréable exercice ; prefque toutes les provinces
de France eurent leurs romanciers, jufqu’ à la
Picardie, où l’on corfipofoit des fervantois , pièces
amoureufes, 6c quelquefois fatyriques. M. Huet ob-
ferve, qu’il eft affez croyable que les Italiens furent
portés à la compofition des romans, par l’exemple
des Provençaux , lorfque les papes tinrent leur fiége
à Avignon ; & même par l’exemple des autres fran-
çois, lorfque les Normands, 6c enfuite Charles, comte
d’Anjou, frere de S. Louis, prince vertueux, 6c
poète lui-même, firent la guerre en Italie : car les
Normands fe mêloient aufli de la fcience gaye.
Les poètes provençaux s’appelloient troubadours ,
ou trouverres, & frirent en France les princes de la
romancerie, dès la fin du dixième fiecle.. Leur métier
plut à tant de gens, que toutes les provinces de
France eurent leurs trouverres. Elles produilirent
dans l’onzieme fiecle & dans les fuivans, une grande
multitude de romans en profe 6c en vers, & le pré-
fident Fauchet, parle de cent vingt-fept poètes, qui
ont vécu avant l’an 1 300.
M. Rymer, dans fa short view o f tragedy, dit que
les auteurs italiens, comme Bembo, Speron Spero-
n e , 6c autres, avouent que la meilleure partie de
leur langue 6c de leur poéfie , vient de Provence ;
& i l en eft de même de l’ efpagnol 6c de la plupart
des autres langues modernes. Il eft certain que Pétrarque
, un des principaux 6c des grands auteurs italiens
, feroit moins riche , fi les poètes provençaux
revendiquoient tout ce qu’il a emprunte d’eux. En
un mot, toute notre poéjie moderne vient des Provençaux
: jamais on ne vit un goût fi général parmi
les grands 6c le peuple pour la Poéjie, que dans ce
tems-là pour la poejie provençale ; ce qui fait dire à
Philippe Mouskes, un de leurs romanciers, que Charlemagne
avoit fait une donation de la Provence aux
Poètes, pour leur fervir de patrimoine.
M. Rymer ajoute , qu’il infifte particulièrement
fur cet article, pour prévenir l’impreflion que les
moines de ce tems-là pourraient faire fur les le-
Cteurs, 6c fur-tout Roger Hoveden, qui nous apr
prend que le roi Richard I. qui avoit avec Geoffroy
fon frere demeuré dans plufieurs cours de Provence
& aux environs, 6c avoit goûté la langue & la poéjie
provençale , achetoit des vers flateurs à fa louang
e , pour fe faire un nom, 6c faifoit venir à force
d’argent, des chanteurs &des jongleurs de France,
pour le chanter dans les rues , 6c l’on difoit par-tout
qu’il n’avoit pas Ion pareil.
Il eft faux que ces chanteurs 6c ces jongleurs vinfi
fent de Frarice : les provinces dont ils venoient,
étoient fiefs de l’empire. Frédéric I. avoit donné à
Raimond Berenger, les comtés de Provence, de For-
calquier, 6c autres lieux voifins, à titre de fief. Raimond,
comte de Touloufe, étoit le grand patron de
ces poètes, & en même tems le protecteur des Albigeois
, qui alarmèrent fi fort Rome , 6c qui coûtèrent
tant de croifades pour les extirper. Guillaume
d’Agoult, Albert de Sifteron, Rambaud d’Orange,
( nom que le duc de Savoie a fait revivre ) étoient des
poètes diftingués. Tous les princes ligués en faveur
des Albigeois contre la France 6c le pape, encoura-
geoient 6c protégeoient ces poètes. Or il eft aifé par
cet expofé, de juger de la raifon qui irritoit fi fort
les moines contre les chanteurs & jongleurs, 6c qui
leur faifoit voir avec chagrin, qu’ils euffent une .fi
grande familiarité avec le roi.
Le même critique obferve enfuite, que de toutes
les langues modernes, la provençale eft la première
qui ait été propre pour la Mufique, 6c pour la douceur
de la rime ; 6c qu’ayant paffé par la Savoie au
Montferrat, elle donna oçcafion aux Italiens de polir
leur langue, 6c d’imiter la poéjie provençale. Les conquêtes
des Anglois de ce côté-là, & leurs alliances
avec ceux de ces pays, leur procurèrent plutôt encore
core ïa connoiflànce de la langue 6c de lapoéfie desPro-
vençaux ; 6z ceux des Anglois qui s’appliquèrent à la
Poéjie, comme le roi Richard, Savary de Mauléon,
6c Robert Groffetête, trouvant leur propre langue
trop rude, fe portèrent aifément à fe fervir de celle
de Provence, comme étant plus douce 6c plus fléxi-
ble. Chaucer a pris tous les termes provençaux,
françois, 6c latins, qu’il a pu trouver, & les a mêlés
avec l’anglois, après les avoir habillés à l’angloife.
On appelloit les poètes provençaux, troubadours,
jongleurs fit chanterres: ce dernier nom n’eft pas étranger
dans nos cathédrales. Roger Oveden rend le fécond
par joculatores , ou joueurs, comme on pourrait
traduire le premier par trompettes. Mais les troubadours
s’appelloient aufli trouverres, comme qui dirait
trouve-tréfor. Les Italiens les nomment trovatori ;
le nom de jongleurs, leur venoit apparemment de
quelque infiniment de mufique ( vraisemblablement
la harpe ) alors en ufage, comme les Latins &
les Grecs fe nommoientpoètes lyriques. Du Verdier,
Van Privas, 6c la C roix du Maine, vous feront connoître
les principaux poètes provençaux ; je n’en indiquerai
que deux outrais d’entre les plus anciens.
Belve{er ( Aymeric de ) floriffoit vers l’an 1103 ,
6c fit quantité de vers à la louange de fa maîtreffe,
qui vivoit à la cour de Rémond comte de Provence.
Enfuite il devint amoureux d’une princeffe de Provence
cpii s’appelloit Barbojje ; cette dame ayant été
nommee abbêffe d’un monallere, Belvezer en mourut
de douleur en 1264, parce qu’il ne lui étoit plus
permis de la voir. Il lui envoya peu de tems avant
la mort, un petit ouvrage intitulé las amours de fon
ingrata.
Arnaud de Meyrveilh, poète provençal du xiij. fiecle
, entra au fervice du vicomte de Beziers, & devint
épris de la comteffe de Burlas fon époufe. Comme
il étoit très-bien fait de fa perfonne, çhantoit
bien, 6c lifoit les romans en perfection, la comteffe
le traitoit avec beaucoup de bonté. Enfin, il s’enhardit
à lui déclarer fon amour par un fonnet intitulé,
les chajles prières d’Arnaud : la comteffe les écouta
gracieufement, 6c fit au poète des préfens confidé-
rables. Il mourut l’an 1220; Pétrarque a fait mention
de lui dans fon triomphe de l’Amour.
A r n a u d d e Coutign ac, poète provençal du xiv. fiecle
, devint amoureux d’une dame nommée Yfnarde,
à la louange de laquelle il fit plufieurs vers ; mais
n’ayant rien pu gagner fur fon efprit, il alla voyager
dans le Levant, afin de fe guérir de fa paflion par
l’abfence, 6c d’oublier une perfonne qui paroiffoit
prendre plaifir à fes peines. Il lui adreffa un ouvrage
intitulé, las fuffr en jas d ’amour, 6c mourut à la guerre
en 13 54. ( L e Chevalier d e J a u c o u r t .')
P o é s ie s a t y r iq u e , voyeç Sa t y r e .
P o é s ie d u s t y l e , voye( St y l e , Poéjie du, { Poé-
> • ) "
POESIE.DU VERS, ( Poéjie.) voyeç VERS, Poéjie
du ; car la lettre P eft fi chargée, qu’il faut permettre
ces fortes de renvois, pourvû qu’on n’ait pas oublié
de les remplir. ( D . J. )
POET , f. m. ( Poids. ) gros poids dont on fe fert
en M ofcovie, particulièrement à Archangel ; il pefe
quarante livres du pays, qui reviennent à environ
trente-trois livres de Paris.
POETE, f. m. ( Belles-Lettres. ) écrivain qui com-
pofe des ouvrages en vers. Le mot grec trounȍ, lignifie
faifeur, inventeur, de Trotta, fa d o , fingo : c’eft
pourquoi l’on appelloit autrefois les poètes, fatifies ;
6c nos ancêtres les nommoient troubadours ou trou-
veurs, c’ eft-à-dire inventeurs, fans doute à caufe des
frétions qu’ils imaginent, 6c pour lefquelles Horace
leur accorde les mêmes privilèges qu’aux Peintres :
Picloribus atque Poetis
Tome X I I .
Quidlibet audendi femper fuit cequa pote fias.
Art poétique.
Les Romains les appelloient vates , c’eft-à-dire
prophètes, hommes infpirés : aufli Cicéron rapporte-
t-il comme un mot de Démocrite 6c de Platon, qu’on
ne fauroit être poète fine afflatu furoris, c’eft-à-dire
.fans-un grain de folie, 6c Horace attefte que Démocrite
banniffoit de l’Hélicon tous les gens fages :
Excludit fanos helicone Poetas
Democritus. Art poétique.
Malgré cette prévention, les Poètes ont été efti-
més 6c honorés dans tous les fiecles ; ils ont été les
premiers hiftoriens. Anciennement ils récitoient ou
chantoient leurs ouvrages ou fur les théâtres, ou
, dans les jardins 6c les jeux publics, ou dans les thermes
; 6c ils étoient en même tems a&eurs 6c mufi-
ciens. On a même regardé leurs noms comme fyno-
nymes à ceux de néocore 6c de panégyrijle des
dieux. Foye{ N é o c o r e . On regarde même les premiers
d’entre eux, tels qu’Homere, Héfiode, (te.
comme les théologiens du paganifme. Prefque tous
fe font propofé d’envelopper fous leurs frétions 6c
leurs allégories, des vérités ou de morale ou de phy-
fique ; les autres n’ont eu en vue que l’amufement. Il
y avoit à Delphes des poètes en titre d’office, dont
l’emploi étoit de mettre en vers les oracles que les
prêtres recueilloient de la bouche de la Pithie ; mais
ces vers n’étoient pas toujours dignes d’Apollon, le
dieu de la Poéfie.
M. Spanheim prétend que les auteurs arabes font
beaucoup plus poètes que ceux des autres peuples , 6c
qu’il y a plus de vers écrits dans leur langue feule ,
que dans celles de toutes les autres nations.
Là Grèce décernoit des ftatues 6c des couronnes
aux Poètes ; on n’en faifoit pas moins de cas à Rome ;
Horace 6c Virgile tenoient un rang diftingué à la
cour d’Augufte ; mais foit que les Poètes fe fuffent avilis
par la fuite, foit qu’on ne les regardât point comme
des gens fort utiles, on voit par une loi de l’empereur
Philippe, inférée dans le code, lib. X . tic.
1J2, que les Poètes font exclus des immunités accordées
aux autres profeffeurs des Sciences. Les modernes
femblent les avoir dédommagés de ce mépris,
en introduifant l’ufage de couronner avec pompé les
grands poètes. On nommoit poètes lauréats, ceux à
qui l’on accordoit cet honneur ; tels ont été Pétrarque,
Enéas Sylvius, Arias Montanus, Obrecht, le
chevalier Perfetti ; 6c en Angleterre Jean K a y , Jean
Gower, Bernard André , Jean Skelton , Dryden ,
Cyber. On peut voir fur cette matière une differta-
tion de M. l’abbé du Refnel, dans les mém. de l’académie
des Belles-Lettres , tome X .
On diftingué les Poètes, i°. par rapport au tems
où ils ont v é cu , en deux claffes jWes anciens 6c les
modernes ; 2®. par rapport aux climats qui les ont
produits, 6c où ils ont v écu , ou par rapport à la langue
dans laquelle ils ont écrit, en poètes grecs, latins
, italiens, efpagnols, françois, anglois, &c. 30.
par rapport aux objets qu’ils ont traités ; en poètes
épiques, tels qu’Homere 6c V irgile, le Taffe, 6c Milton,
(te. poètes tragiques, comme Sophocle, Eurypi-
d e, Shakefpear, Otwai, Corneille , 6c R acine, (te.
poètes comiques, Ariftophane, Ménandre, Plaute,
Térence, Fletcher, Jonhfon, Moliere , Renard;
poètes lyriques, commePindare, Horace, Anacréon,
Cowley, Malherbe, Rouffeau, &c. poètes fatyriques,
Juvenal, Perfe, Regnier, Boileau , Dryden , Old-
ham, &c.poètes élégiaques, &c. Voye^ E p i q u e , C o m
i q u e , L y r i q u e , &c.
POETE BUCOLIQUE, {Poéfie.) les poètes bucoliques
font ceux qui ont décrit en vers la vie champêtre, fes
amufemens 6c fes douceurs. L’effence de leurs ouvra-
O O 0 0 0