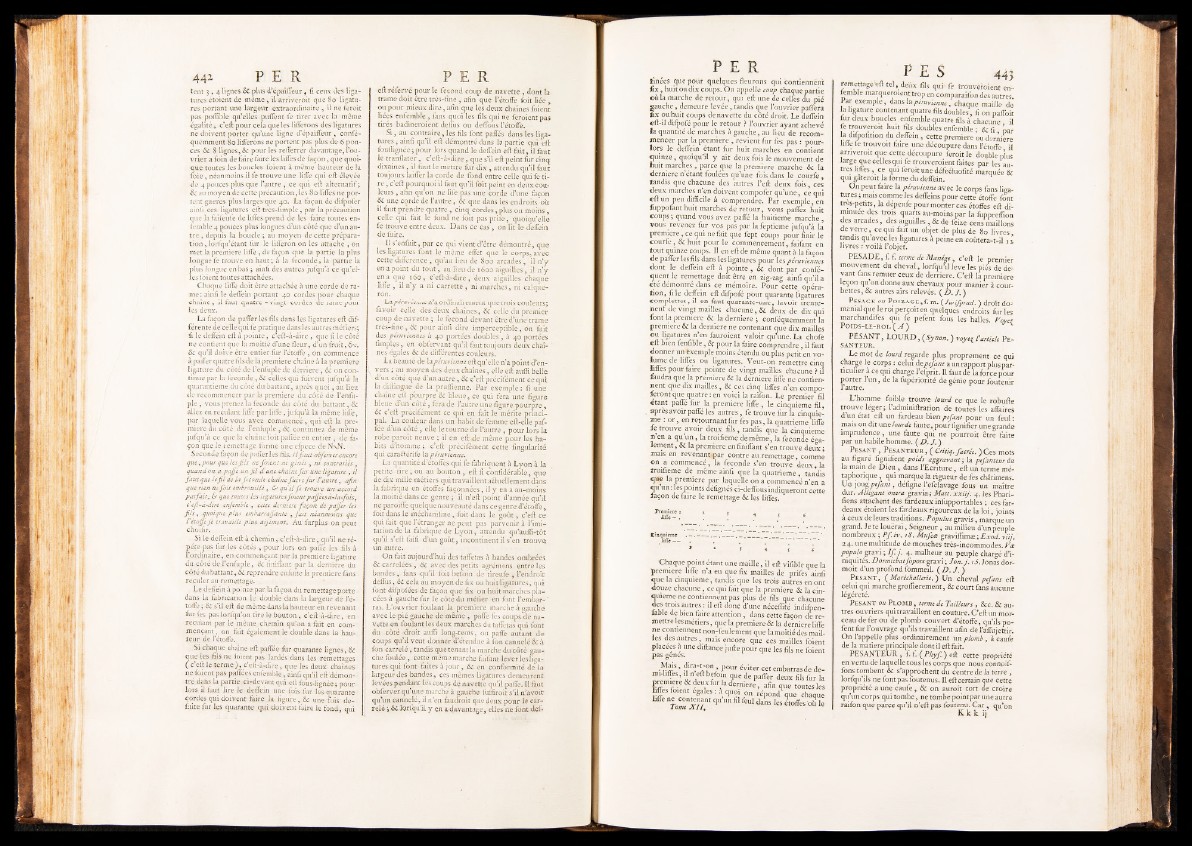
tent 3 ,4 lignes & plus d’épaiffeur, fi ceux des ligatures
étoient de meme, il arriveroit que 80 ligatures
portant une largeur extraordinaire , il ne leroit
pas poflible qu’elles puffent le tirer avec la même
égalité, c’eft pour cela que les lifferons des ligatures
ne doivent porter qu’une ligne d’épaiffeur , confé-
quemment 80 lifferons ne portent pas plus de 6 pouces
& 8 lignes, & pour les refferrer davantage, l’ouvrier.
a foin de faire faire les liffes de façon, que quoique
toutes les boucles foient à même hauteur de la
fo ie , néanmoinsil fe trouve une liffe qui eff élevée
de 4 pouces plus que l’autre , ce qui eff alternatif ;
&: au moyen de cette précaution, les 8o liffes ne portent
gueres plus larges que 40. La façon de difpofer
ainfi ces. ligatures eff très-fimple, par la précaution
que la faifeufe de liffes prend de les faire toutes en-
femble 4 pouces plus longues d’un côté que d’un autre
, depuis la boucle ; au moyen de cette préparation
, lorl'qu’étant fur . le lifferon on les attache , on
met la première liffe, de façon que la partie la plus
longue fe trouve en haut ; à la fécondé, la partie la
plus longue en bas ; ainfi des autres jufqu’à ce qu’elles
foient toutes attachées.
Chaque liffe doit être attachée à une corde de rame
: ainfi le deffein portant 40 cordes pour chaque
chaîne , il fout quatre - vingt cordes de rame pour
les deux.
La façon de paffer les fils dans les ligatures eff différente
dé célléqùi fe pratique dans les autres métiers;
fi le defléin eff à pointe, c’eft-à-dire , que fi le côté
ne contient que la moitié d’une fleur, d’un fruit, &c.
& qu’il doive être entier fur l’étoffe , on commence
à paffer quatre fils de la première chaîne à la première
ligature du côté de l’enfuple de derrière, & on continue
par la fécondé , & celles qui fuivent jufqu’à la
quarantième du côté du battant, après quoi, au lieu
de recommencer par la première du côté de l’enfup
le , vous prenez la fécondé du côté du battant, &
allez en reculant liffe par liffe, jufqu’à la même liffe,
par laquelle vous avez commencé , qui eff la première
du côté de l’enfuple , & continuez de meme
jufqu’à ce que la chaîne foit paffée en entier , de façon
que le remettage forme une efpece de N\N.
Seconde façon de paffer les fils, i l faut obferver encore
que, pour que les fils ne foient ni gênés , ni contrariés ,
quand on a paffé un fil d'une chaîne fur une ligature , il
faut que le fil de la féconde chaîne fuive fur l'autre, afin
que rien ne foit embrouillé , & quil fe trouve un accord
parfait, & que toutes les ligatures foient paffées à-la-fois,
c'cfl-à-dire enfemble , cette derniere façon de paffer les
fils , quoique plus embarraffante , fait néanmoins que
l'étoffe fe travaille plus aifèment. Au furplus on peut
choilîr.
Si le deffein eff à chemin, c’eft-à-dire, qu’il ne ré-
pqte-pas fur .les côtés , pour lors on paffe les fils à
l’ordinaire, en, commençant par la première ligature
du côté de.l’enfuple, & finiffant par la derniere du
côté du battant, & reprendre enfuite la première fans
reculer au remettage. . d
Le deffein à pointe par la façon du remettage porte
dans la fabrication le double dans la largeur de l’étoffe
; & s’il eff de même dans la hauteur en revenant
fur-fes pas lorfqu’on tire le bouton, c’eft •à-dire, en. i
reculant par le même chemin qu’on a fait en commençant
, on fait également le double dans la hauteur
de l’étoffe.
Si. chaque chaîne eff paffée fur quarante lignes., &
aue lesfils, ne foient pas lardés dans les remettages
Cc eft le terme ) , c’eft-à-dire, que les deux chaînes
ne foient pas paffées enfemble| ainfi qu’il eft démontre
dans la partie ci-devant qui eff fous-lignée ; pour
lots, il fout lire le deffein une fois fur les quarante
cordes qui doivent foire la figure, & une'fois de-
fiiife fur les quarante qui doivent faire le fond, qui
eft réfervé pour le fécond coup de navette , dont la
trame doit etre très-fine , afin que l’étoffe foit liée
ou pour mieux dire, afin que les deux chaînes foient
liées enfemble, fans quoi les fils qui ne feroient pas
tirés badineroient deffus ou deflous l’étoffe.
S i, au contraire, les fils font paffés dans les ligatures
, ainfi qu’il eft démontré dans la partie qui eft
fouflignée ; pour lors quand le deffein eft fait, il fout
le tranllater , c’eft-à-dire, que s’il eft peint fur cinq
dixaines , il faut le mettre fur dix , attendu qu’il fout
toujours Iaifler la corde de fond entre celle qui fe tire
, c’eft pourquoi il fout qu’il foit peint en deux couleurs
, afin qu’on ne life pas une corde d’une façon
& une corde de l’autre, ôc que dans les endroits oü
il fout prendre quatre , cinq cordes, plus ou moins,
celle qui fait le fond ne foit pas prife, quoiqu’elle
fe trouve entre deux. Dans ce cas, on lit le deffein
de fuite.
Il s’enfuit, par ce qui vient d’être démontré, que
les ligatures font le même effet que le corps, avec
cette différence , qu’au lieu de 800 arcades, il n’y
en a point du tout, au lieu de 1600 aiguilles, il n’y
en a que 160, c’eft-à-dire, deux aiguilles chaque
liffe , il n’y a ni carrette, ni marches, ni calque-
rôn.
La péruvienne n’a ordinairement que trois couleurs;
favoir celle des deux chaînes, & celle du premier
coup de navette ; le fécond devant être d’une trâme
très-fine , & pour ainfi dire imperceptible , ‘o'n fait
des péruviennes à 40 portées doubles, à 40 portées
fimples, en obfervant qu’il faut toujours deux chaînes
égales & de différentes couleurs.
La beauté de la péruvienne eft qu’elle n’a point d’en-
^ vers ; au moyen des deux chaînes, elle eft auflï belle
d un cote que d’un autre , & c’eft précifément ce qui
la diftingue de la pruflienne. Par exemple : fi une
chaîne eft pourpre & bleue, ce qui fera une figure
bleue d’un cote, fera de l’autre une figure pourpre ,
& c’eft precifement ce qui en fait le mérite principal.
La couleur dans un habit de femme eft-elle paf-
lee d’un côté , elle le tourne de l’autre , pour lors là
robe paroît neuve ; il en eft.de même pour les habits
d’homme ; c’eft précifément cette fingularité
qui caraftérife la péruvienne.
La quantité d’étoffes qui fe fabriquent à L y o n ! la
petite tire , ou au bouton , eft fi confidérable, que
de dix mille métiers qui travaillent a&uellement dans
la fabrique en étoffés façonnées, il y en a au-moins
la moitié dans ce genre ; il n’ëft point d’année qu’il
ne paroiffe quelque nouveauté dans ce genre d’étoffe ,
foit dans le méchanifme, foit dans le goût , c’eft ce
qui foit que l’étranger ne peut pas parvenir à l’imitation
de la fabrique de Ly on , attendu qu’aufli-tôt
qu’il s’eft faifi d’un goût, incontinent il s’en trouva
un autre.
On fait aujourd’hui des taffetas à bandes ombrées
& carrelées , & avec des petits agrémens entre les
bandés-, fans qu’il foit befOïn de tireufe , l’endroit
deffus, 6c cela au moyen de fix ou huit ligatures, qui
font difpofées de façon que fix ou huit-marches placées
à gauche fur le côté du métier en font l’embar--'
ras. L’ouvrier foulant la première marche à gauche
avec le pié gauche de même , paffe fes coups de navette
en foulant les deux marches du taffetas qui font
du côté -droit aufli long-tems, ou paffe autant de
coups qu’il veut donner d’étendue à fon cannelé & à
fon carrelé y tandis que tenant la marche du côté gauche,
foulée , cette même marche foifant lever les ligatures
qui font; faites à joiir, & en conformité de la
largeur des bandes, ces mêmes ligatures demeurent
levées pendant les coups de navette qu’il paffe. Il fout
obferver qu’une marche à' gauche futfiroit s’il n’avoit
qu’un cannelé, il n’en foudroit que deux pour le carrelé
; àc .lôrfqu’ii y en a davantage, elles ne font defo
linées que pour quelques fleurons qui contiennent
f ix , huit ou dix coups. On appelle coup chaque partie
cîila marche de retour, qui eft une de celles du pié
gauche, demeure levée, tandis que l’ouvrier paflera
fix ou huit coups de navette du côté droit. Le deffein
eft-il difpofé pour le retour ? l’ouvrier ayant achevé
la quantité de marches à gauche, au lieu de recommencer
par la première , revient fur fes pas : pour-
ïors le deffein étant fur huit marches en contient
quinze, quoiqu il y ait deux fois le mouvement de
huit marches , parce que la première marche & la
derniere n’étant foulées qu’une fois dans Je courfe,
tandis que chacune des autres l’eft deux fois, ces
deux marches n’en doivent compofer qu’une, ce qui
eft un peu difficile à comprendre. Par exemple, en
fiippofont huit marches de retour, vous paffez huit
coups ; quand vous avez paffé la huitième marche ,
vous revenez fur vos pas par lafeptieme jufqu’à la
première, ce qui ne fait que fept coups pour finir le
cou rfe, & huit pour le commencement, foifant en
tout quinze coups. Il en eft de même quant à la façon
de paffer lesfils dans les ligatures pour les péruviennes
dont le deffein eft à pointe , & dont par confèr
e n t le remettage doit être en zig-zag ainfi qu’il a
©te démontré dans ce mémoire. Pour cette opération,
file deffein eft difpofé pbur quarante ligatures
complettes, il en faut quarante-une, favoir trente-
neuf de vingt mailles chacune, & deux de dix qui
font la première & la derniere ; conféquemment la
première & la derniere ne contenant que dix mailles
ou ligatures n’en fauroient valoir qu’une. La chofe
eft bien fenfible, pour la foire comprendre, il faut
donner un Exemple moins étendu ou plus petit en volume
de liffes ou ligatures. Veut-on remettre cinq
liffes pour foire pointe de vingt mailles chacune ? il
faudra que la première & la derniere liffe ne contiennent
que dix mailles, & ces cinq liffes n’en composeront
que quatre : en voici la raifon. Le premier fil
étant paffé fur la première liffe , le cinquième fil,
. après avoir paffé les autres, fe trouve fur la cinquième
: o r , en retournant fur fes pas, la quatrième liffe
fe trouve avoir deux fils, tandis que la cinquième
n’en a qu’un , la troifieme de même, la fécondé également,
& la première en finiffant s’en trouve deux ;
mais en revenant*par contre au remettage, comme
on a commencé, la fécondé s’en trouve deux, la
troifieme de même ainfi que la quatrième, tandis
que la première par laquelle on a commencé n’en a
ou un ries points défignés ci-deffous indiqueront cette
laçon de faire le remettage & les liffes.
P rem ière i , ,
.'.'HjTe-,; . . ‘ ? ƒ . «
Cinquième ------------- . ------. _ "____1 _ ..................................
liffe— . . . * - ------------- -
• * ’ * / •
•Chaque joint étant une maille, il eft yifîble que la
îpremiere liffe n’a eu que fix mailles de prifes; ainfi
que la cinquième, tandis que les trois autres en ont
douze chacune, ce qui fait que la .première & la cinquième
ne contiennent pas plus de fils que chacune
D B tfois autres : il eft donc d’une néceflîté indifpen-
fable de bien faire attention, dans cette façon de remettre
les métiers, que la première & la derniere liffe
ne contiennent non-feulement que la moitié des mailles
des autres mais encore que ces mailles foient
placées à une diftanee jufte pour que les fils ne foient
pas genes.
Mais, dira-t-on, pour éviter cet embarras de de-
mi-hffes, il n eft befom que de paffer deux fils fur la
première &detrxfur la derniere, afin que toutes les
Mes foient égalés : à quoi on répond que chaque
M e ne conmnant qu un fil feul dans les étoffes J le
femettagèéft tel, deïïx fils qui-fe 'troüvèîoient en-
lemble marqueroienttrop en comparaifon des autres.
.Par exemple, dans la pimvhnn,,. chaque maille de
Ja ligature contenant quatre fils doubles, fi on paffoit
fer. deux b ig l e s enfemble quatre fils à chacune - il
fe trouveroit huit fils doubles enfemble ; & f i
la difeofition du deffein, cette première ou derniere
liffe fe trouvoit faire une découpure dans ftétoffe il
arriveroit qqe cette découpure ferait le doubie plus
large que celles qui fe trouveraient faites par les au.
très liffes , ce quiferoit une défeauofité marquée &
qui gâterait la forme du deffein.
On peut faire la péruvienne avec le corps fans ligatures
; mais comme les deffeins pour cette étoffe font -
tres-petits, la dépenfe pour monter ces étoffes eft diminuée
des trois quarts au-moins par la fuppreffion
des arcades , des aiguilles, & de feize cens maillons
deverreÿ.cequi fait un objet de plus de 80 livres .
tandis qu avec les ligatures, à peine en coûtera-t-il 11
livres : voilà l’objer.
P E SA D E ,f.f. terme de Manège , c’eft le premier
mouvement du cheval, lorftju’ille v e les pies dedei
vant fans remuer ceux de derrière. G’eft la première
Je#Si qu’on donne aux chevaux pour manier à courbettes
, & autres airs relevés. ( D. J. J
P e s a g e | | P c h z a g e , f. m. ( Jutifprui. ) droit doJ
maniai que le roi perçoit en quelques endroits fur les
marchandifes qui fe pefent fous les halles. Foyer
PO ID S -L E -R O I.(^ ) J V
PESANT, LOURD, (Synon. ) voyer C article PESANTEUR.
Le mot de lourd regarde plus proprement ce qui
charge le corps : celui deptfant a un rapport plus particulier
à ce qui charge l’efprit. Il faut de la force pour
porter l’un, de la fupériorité de génie pour foutenir
| l’autre.
L’homme foible trouve lourd ce que le robufte
trouve léger ; l’adminiftration de toutes les affaires
d un état eft un fardeau bien pefant pour un feul :
mais on dit une lourde faute, pour lignifier une grande
imprudence, une faute qui ne pourroit être faite
par un habile homme. ( D . J. )
P e s a n t , P e s a n t e u r , ( Gritiq. f actée. ) Ces mots
au figuré fignifient poids aggravant-, lu pefanteuràe
la main de Dieu , dans l’Ecriture, eft un terme métaphorique
, qui marque la rigueur de fes châtimens.
Un joug pefant, défigne l’efclavage fous un maître
dur. Alligant onera gravia; Matt. xxiij. 4. les Phari-
fiens attachent des fardeaux infupportables ; ces fardeaux
étoient les fardeaux rigoureux de la lo i, joints
à ceux de leurs traditions. Populus gravis, marque un
grand. Je te louerai, Seigneur, au milieu d’un peuple
nombreux ; P f iv. 18. Mufcce gravifiimæ ; Exod. viij. 24. une multitude de mouches très-incommodes. Va
populo gravi ; l f . j . 4. malheur au peuple chargé d’iniquités.
Dormiebat fopore gravi ; Jon.j. )5. Jonas dor-
moit d’un profond fommeil. ( D . J. )
P e s a n t , ( Maréchallerie. ) Un cheval pefant eft
celui qui marche groflierement, & court fans aucune
légéreté.
P e s a n t ou P l o m b , terme de Tailleurs , &c. & autres
ouvriers qui travaillent en couture. C’ eft un morceau
de fer ou.de plomb couvert d’étoffe, qu’ils po-
fent fur l’ouvrage qu’ils travaillent afin de l’affujettir.
On l’appelle plus ordinairement un plomb, à caufe
de la matière principale dont il eft fait.
PESANTEUR, f. f. ( Phyf ) eft cette propriété
en vertu de laquelle tous les corps que nous connoif-
fons tombent & s’approchent du centre de la terre ,
lorfqu’ils ne font pas foutenus. Il eft certain que cette
propriété a une caufe, & on auroit tort ae croire
qu’un corps qui tombe, ne tombe pointpar une autre
raifon que parce qu’il n’eft pas foutenu. C a r , qu’on
K k k ij