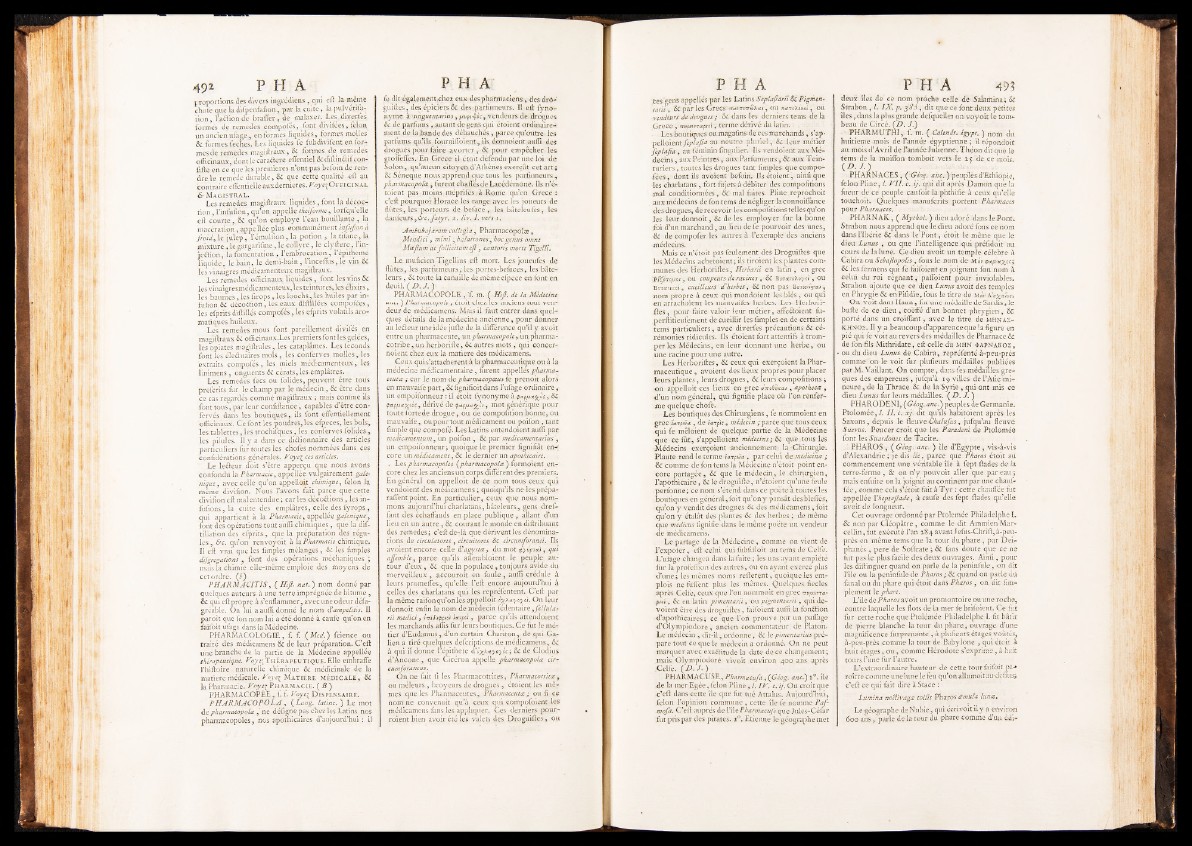
proportions des ; divers ingrédiens , qui eft la-meme -
choie que la difpenfafion, par la cuite, la pulyérifa- 1
tion, l’action de braffer, de malaxer» Les . diverses
formes de remedes compotes, font divifeeç, felo.n
un ancienufage, enfermes liquides, formes molles
&. formes feches. Les liquides fefubdivifent en for-t
mes de remedes magiftraux, 8c formes de remedes
officinaux, dont le caraûere effenriel &diftinûif.conf
i e en ce que les premières n’ont pas befoin de rendre
le remede durable, 8c que cette qualité-.eft au
contraire effentielleauxdernieres. Voy^OFFiciNAL
& M a g i s t r a l . v .
Les remedes magiftraux liquides , font la décpc-r
tion, l’infufiôn, qu’on appelle thdformc, lorfqu’elle
ed courte, & qu’on employé l’eau bouillante ,■ la
macération, appellée plus eommunément infujîpn à
froid, le julep, l’émuliion, la potion , la til'ane,la
mixture-, le garganfme, le collyre, le clydere, 1 m-
jeûion, la fomentation, l’embrocation, l’épitheme
liquide, le bain, le demi-bain , l’inceffiis, le vin 8c
les vinaigres médicamenteux magidraux.
Les remedes officinaux liauides , font les vins 8c
les vinaigresmédicamenteux,les teintures, les élixirs,
les baumes, les d rops, les loochs, les huiles par in-
fudon 8c déco&ion, les eaux didillées compofées,
les efprits didillés compofés, les efprits volatils aromatiques
duileux, ,
Les remedes mous font pareillement divifés en
magidr aux & officinaux.Les premiers font les gelées,
lesopiates magidrales, les cataplâmes. Les féconds
font les éleûuaires mois , les conferves molles, les
extraits compofés, les miels médicamenteux, les
linimens, onguents & cérats, les .emplâtres.
Les remedes fecs ou folides, peuvent être tous
prefcrits fur le champ par le médecin , 8c être dans
ce cas regardés commé magidraux ; mais comme ils
font tous, par leur conddance, capables d’être con-
fervés dans les boutiques, ils. font effentiellement
officinaux. Ce font les poudres, les efpeces, les bols,
les tablettes, les trochifques, les conferves.folides.,
les pilules. Il y a dans ce diftionnaire des articles
particuliers fur toutes les cliofes nommées dans, ces
conddérations générales. Foye[ ces articles.
Le lefteur doit s’être apperçu que nous avons
confondu la Pharmacie, appellée vulgairement gale-
nique, avec celle qu’on appelloit chimique, félon la
même divifion. Nous l’avons fait parce que cette
divifioneft mal entendue; car les décodions,, les in-
fiifions, la cuite des emplâtres, celle des fyrops ,
qui appartient à la Pharmacie, appellée galenique,
font des opérations tout auffi chimiques, que la dif-
tiliation des efprits, que la préparation des régules
, &c. qu’on renvoyoit à la Pharmacie chimique.
Il ed vrai que les fimples mélanges, 8c les fimples
difgregations , font des .opérations méchaniques ;
mais la chimie elle-même emploie des moyens de
cet ordre. (b)
PHARMAC1T IS , ( Hijl. nat.) nom donné par
quelques auteurs à une terre imprégnée de bitume ,
& qui ed propre à s’enflammer, avec une odeur défa-
gréable. On lui a auffi donné le nom à’ampelitis. Il
paroît que fon nom lui a été donné à caufe qu’on en
faifoit ufage dans la Médecine. .
PHARMACOLOGIE, f. f. (Med.) Icience ou
traité des médicamens 8c de leur préparation. C’ed
une branche de la partie de la Médecine appellée
thérapeutique, Wbye^ T h ér ap eu tique. Elle embrafle
l’hidoire naturelle chimique 8c médicinale de la
matière médicale. Foye{ M a t i è r e m é d i c a l e , 8c
la Pharmacie. Foye{ P h a r m a c i e . ( B )
PHARMACOPÉE, f. f . Foye^ D i s p e n s a ir e .
PHARMA COPOLA , ( Lang, latine. ) Le mot
de pharmacopola ,' ne défigne pas chez les Latins nos
pharmacopoles, nos apothicaires d’aujourd’hui : il
fe dit également,chez eux-desphâftnaciens, desdrO-*
guilles, des.épiciers 6c des .parfumeurs. Il ed fyno-
nyme k iunguentarius, pupi-^oç, vendeurs de. drogiies
8c de parfums ^autant de gens qui étoient ordinairement
de la .bande.des débauches, ^ parce qu’outre les
parfums qu’ils: fourniffoienf, ils, do nn oient auffi des
drogués pour faire avorter., & pour empêcher les
groflèffes.'En Grèce il (était défendu par une loi de
Solon,. qu’aucun citoyen d’Athènes exerçât cet art ;
8c Séneque npus apprend que tous les parfumeur ,
pharmacopola, dirent chaffesde Lacédémone. Ils n’ér
toient pas moins raéprifés ; à 'Rome qu’en Grece :
ç’,ed pourquoi Horace les. range avec les joueurs de
flûtes, les:.porteurs de befac expies bâteleufes, les
danfeurs, &c.fatyr. z. Uv. I. vers i.
Ambubajarum collcgia, Pharmacôpolæ,
Mendici , mimi j balatrones; hoc genus omne
Mceßum àc follicitùm e ß , cantons morte Tigelli.
Le muficien Tigellius ed mort. Les joueufes de
flûtes, les parflimeurs ; les portes-befàces, les bâte-
leurs, 8c toute la canaille de même efpece en font en
deuif. (D . J. )
PHARMACOPÖLE , ‘f. m. ( Hiß. de la Médecine
anc. ) Pharmacopole, étoit chez les anciens tout vendeur
de médicamens. Mais.il faut entrer dans quelques
détails de la médecine ancienne, pour donner
au le&eur une idée jude de la différence qu’il y avoit
entre un pharmaceute, un pharmacopole, un pharma-
cotribe, un herboride, 8c autres mots , qui concer-
noient chez eux la matière des médicamens.
Ceux qui s’attachèrent à la pharmaceutique ou à la
médecine médicamentaire, furent appelles pharma-
ceutce ■ ; car le nom de pharmacopoeus fe prenoit alors
en mauvaile part, 8c fgnifioit dans l’ufage ordinaire,
un empoifonneur : il étoit fynonyme à <papjAsL%cç, 8c
tfap/xetxioç, dérivé de tpap/j-a^v, mot générique pour
toute forte de drogue, ou de composition bonne, ou
mauvaife, ou pour tout médicament ou poifon:, tant
fimple que compofé. Les Latins entendoient auffi par
medicamentum, un poifon , &C par medicamentarius
un empoifonneur ; quoique le premier lignifiât en-;
core un médicament, &C le dernier un apothicaire,
j Les pharmacopoles (pharmacopola ) formoient encore
chez les anciens un corps différent des premiers.
En général on appelloit de ce nom tous ceux qui
vendoient des médicamens ; quoiqu’ils ne les préparaient
point. En particulier, ceux que nous nommons
aujourd’hui charlatans, bâteleurs, gens dref*
fant des. échaffauds en place publique, allant d’un
lieu en un autre , & courant le monde en diftribuant
des remedes; c’eftde-là que dérivent les dénominar
tions de circulatores, circuitores &C circumforanei. Ils
avoient encore celle d’agyrta, du mot àyéprai, qui
affemble, parce qu’ils affembioient le peuple aur
tour d’eux , 8c que la populace, toujours avide du
merveilleux, accouroit en foule, auffi crédule à
leurs promeffes, qu’elle l’eft encore aujourd’hui à
celles des charlatans qui les repréfentent. C ’eff par
la même raifon qu’on les appelloit èx^ayoyo). On leur
donnoit enfin le nom de médecin fédentaire ,fellula\
rii medici, eVfiP/ipp/oi ienpdi, parce qu’ils attendoient
les marchands,affis fur leurs boutiques. C e fut le mér
tier d’Eudamus, d’un certain Chariton, de qui Gallien
a tiré quelques defcriptions de médicamens, 8c
à qui il donne l’épithere d’o^xayoyoç ; 8c de Clodius
d’Ancone , que Cicéron appelle pharmacopola cir-
cumforaneus.
On ne fait fi les Pharmacotrites, Pharmacotrita,
ou méleurs., broyeurs de drogues , étoient les mêr
mes que les Pharmaceutes, Pharmaceuta ; ou fi ce
nom ne convenoit qu’à ceux qui compofoient les
médicamens fans les appliquer. Ces derniers pour-
roient bien avoir été les valets des Droguiftes, oh
tes ?ens appèllés par les Latins Seplafiani 8c Pigtren-
tarii, & par les Grecs tfctvTovréoXat , ou kcltox^ oI , ou
vendeurs de drogues ; 8c dans les derniers tems de la
Greee, wnfwwap»!:', terme dérivé du latin.- :
Les boutiques ou magafins- de ces marchands, s’ap ■
pelloient feplajia au. neutre pluriel, 8c rieur métier
feplafia , au féminin fingulier. Ils vendoient aux Médecins,
aux Peintresaux Parfumeurs':,’ & aux Tein*
turiers, toutes les drogues tant fimples que compo-
fées , dont ils avoient befoin. Ils etoient, ainfi que
les charlatans , fort fujets à débiter des eompofitions
mal conditionnées, & mal .faites. Pline reprochoit
.aux médecins de fon tems de négliger la connoiffance
des drogues, de recevoir les eompofitions telles.qu’on
les leur.donnoit, 8c de les. employer fur la bonne
foi d’un marchand, au lieu de fe pourvoir des fines,
8c de compofer les autres à l’exemple des anciens
-médecins.
Mais ce n’étoit pas feulement des Droguiftes qué
les Médecins achetoient;.ils tiroient les plantes communes
dés Hèrboriftes, Herbarïi en latin , en grec
'f’îfoToftw , ou coupeurs de racines , 8c Bo'ravoKoyoi, ou
B otui i/.o! , cueilleurs d'herbes, & non pas Botawç-ai,
nom propre à ceux qui mondoient les b lés, ou qui
en arrachoient les mauvaifes herbes. Les Herbori-
ftes , pour faire valoir leur métier, affe&oient fu-
perftitieufement de cueillir les fimples en de certains
tems particuliers, avec diverfes précautions & cérémonies
ridicules. Ils étoient fort attentifs à tromper
les Médecins, en leur donnant une herbe, ou
une racine pour une autre.
Les Herboriftes, 8c ceux qui exerçoient la Pharmaceutique
, avoient des lieux propres pour placer
leurs plantes, leurs drogues, 8c leurs eompofitions ;
on appelloit ces lieux en grec àpro^mett , apotheca ,
d’un nom général; qui fignifie place où l’on renferme
quelque chofe.
Les boutiques des Chirurgiens, fe nommoient en
grec iarpilk , de ïa.rp'n, médecin ; parce que tous ceux
qui fe mêloient de quelque partie de la Médecine
:que ce fut, s’appelloient médecins; 8c que tous les
Médecins exerçoient anciennement' la Chirurgie.
Plaute rend le terme îcnptia , par celui de nièdicina ;
8c comme de fon tems la Médecine n’étoit point encore
partagée, 8c que le médecin, l e .chiriirgien,
l’apothicairè, & le droguifte, n’étoient qu’une feule
perforine; ce nom s’étend dans ce poëte à toutes les
.boutiques en général, foit qu’on y pansât desbleffés,
qu’on y vendît des drogues 8c des médicamens, foit
qu’on y étalât des plantes 8c des herbes ; de même
que medicus fignifie dans le même poëte un vendeur
de médicamens.
Le partage de la Médecine , comme on vient dè
l ’expoler, eft celui qui fiibfiftoit au tems de Celfe.
L’ulàge changea dans la fuite ; les uns ayant empiété
fur la profeflion des autres, ou en ayant exercé plus
d’une ; les mêmes noms reftergnt, quoique les emplois
ne fufi'ent plus les mêmes. Quelques fiecles
après Celfe, ceux que l’on nommoit en grec
ptai, 8c en latin pimentarii, ou pigmentant, qui dévoient
être des droguiftes, faifoient aufii la fonftion
d’apothicaires ; ce que l’on prouve par un pafiage
d’Olympiôdore, ancien commentateur de Platon.
Le médecin , dit-il, ordonne, 8c le pimentarius prépare
tout ce que le médecin a ordonné. On ne peut
marquer avec exactitude la date de ce changement;
mais Olympiodoré vivoit environ 400 ans après
.Celfe. ( D . J . )
PHARMACUSE, Pharmacufa, (Géog. anc.)\°. île
de la mer Egée, félon P line, l. IF . c. ij. On croit que
c’eft dans cette île qué fut tué Attalus. Aujourd’hui,
félon l’opinion commune , cette île fe nomme Paf-
mofa. C’eft auprès de l’île Pharniacufe que Jules-Céfar
fut pris par des pirates. z°. Etienne le géographe met
deux îles de cë nom proche celle de Salamina; 8c
Strabon, l. IX .p .y 8 ô -dit que ce font deux petites
îles, dans la plus grande defquelles on voyoit le tombeau
de Circé. (D . J .)
PHARMUTHl, f. m. ( Calendr. égypt. ) notti du
huitième-mois de l’anné^e égyptienne ; il répondoit
au mois d’Avril de l’année Julienne. Théon dit que le
tèms de la moiffon tomboit vers le z< de ce mois.
( D. J. i); •••
PH ARN AGES, (-Géog. <zcc.)-peuplès d’Ethiopie,
félon Pline, /. FII. c. ij, qui dit après Damon que la
fueur de ce peuple caufoitJa:phthifie à ceux qu’elle
touchoit. Quelques manuferits portent Pharmaces
pour Pharnaces. . .
PH ARN A K , ( Mythol.') dieu adoré dans le Pont*
Strabon nous apprend que le dieu adoré fous ce nom
dansl’Ibérie 8c dans le Pont, étoit lé même que le
dieu Luniis , ou que l’intelligence , qui préfidoit au
cours de la lune, Ge dieu avoit un temple célébré à
Cabira ou Sebaflopolis, fous le nom de M«V oxpra-x0**
& les fermens qui fefàifoient en joignant fon nom à
celui du roi régnant, paffoient pouf inviolables.
Strabon ajoute que ce dieu Lunus avoit des temples
en Phrygie 8c enPifidie, fous le titre de M»V A
On voit dans Haun, fur une médaille de Sàrdis, le
bufte de ce dieu, coëffé d’un bonnet phrygien, 8c
porté dans un croiffant, avec le titre de m h n a e -
k h n o z . Il y a beaucoup d’apparence que la figure en
pié qui fe voit au revers des médailles de Pharnace 8c
de fon fils Mithridate, eft celle du m h n o>a p n a k o x ,
ou.du dieu Lunus de Cabira, repréfenté à-peu-près
comme" "on le voit fur plufieurs médailles publiées
par M, Vaillant. On compte , dans fes. médailles gre-
ques des empereurs , jufqu’à .19 villes de l’Afte mineure
, de la Thrace 8c de: la Syrie, qui ont mis ce
dieu Lunus fur leurs médailles. (D . J .)
PHARODENI, (Géog. anc.') peuples de Germanie.
Ptolomée, l. II. c. xj. dit qu’ils habitoient après les
Saxons, depuis . le ûeiwe Chalttfus, jufqu’au fleuve
Suevus. Peucer croit que les Paradent de Ptolomée
font les Suardones de Tacite..
PHAROS , (Géog: anc. ) île d’Egypte, vis-à-vis
d’Alexandrie ; je dis lie, parce que P haros étoit au
commencement une véritable île à fept ftades de la
terre-ferme , & on n’y pouvoit aller que par eau ;
mais enfuite onia joignit au continent par une chauffée
, comme cela s’étoit fait à T y r : cette chauffée fut
appellée Yheptajlade, à caufe des fept ftades qu’elle
avoit de longueur.
Cet ouvrage ordonné par Ptolemée Philadelphe I.
8c non par C léopâtre, comme le dit Ammien Marcellin
, fut exécuté l’an 2.84 avant Jefus-Chrift, à-peu-
près en même tems que la tour du phare , par Dei-
phanès , pere de Softrate ; 8c fans doute que ce ne
fut pas le plus facile des deux ouvrages. Ainfi, pour
les diftinguer quand on parle de la peninfule, on dit
l’île ou la peninfule de Pharos.; 8c quand on parle du
fanal ou du phare qui étoit dans Pharos, on dit Amplement
le phare.
L’île de Pharos avoit un promontoire ou une roche,
contre laquelle les flots de la mer fe brifoient. Ce fut
fur cette roche que Ptolémée Philadelphe I. fit bâtir
de pierre blanche la tour du phare., ouvrage d’une
magnificence furprenante , à plufieurs étages voûtés^
à-peu-près comme la tour de Babylone , qui étoiî à
huit étages, o u , comme Hérodote s’exprime, à huit
tours l’une fur l’autre.
L’extraordinaire hauteur de cette tour faifoit pa-*
roître comme une lune le feu qu’on allumoit au-deffus;
c’eft ce qui fait dire à Stacè :
Lütnina nociivaga tollit Pharos àmuta luna.
Le géographe de Nubie, qui écrivoitily a environ
600 ans, parle de la tour du phare comme d’un édi*