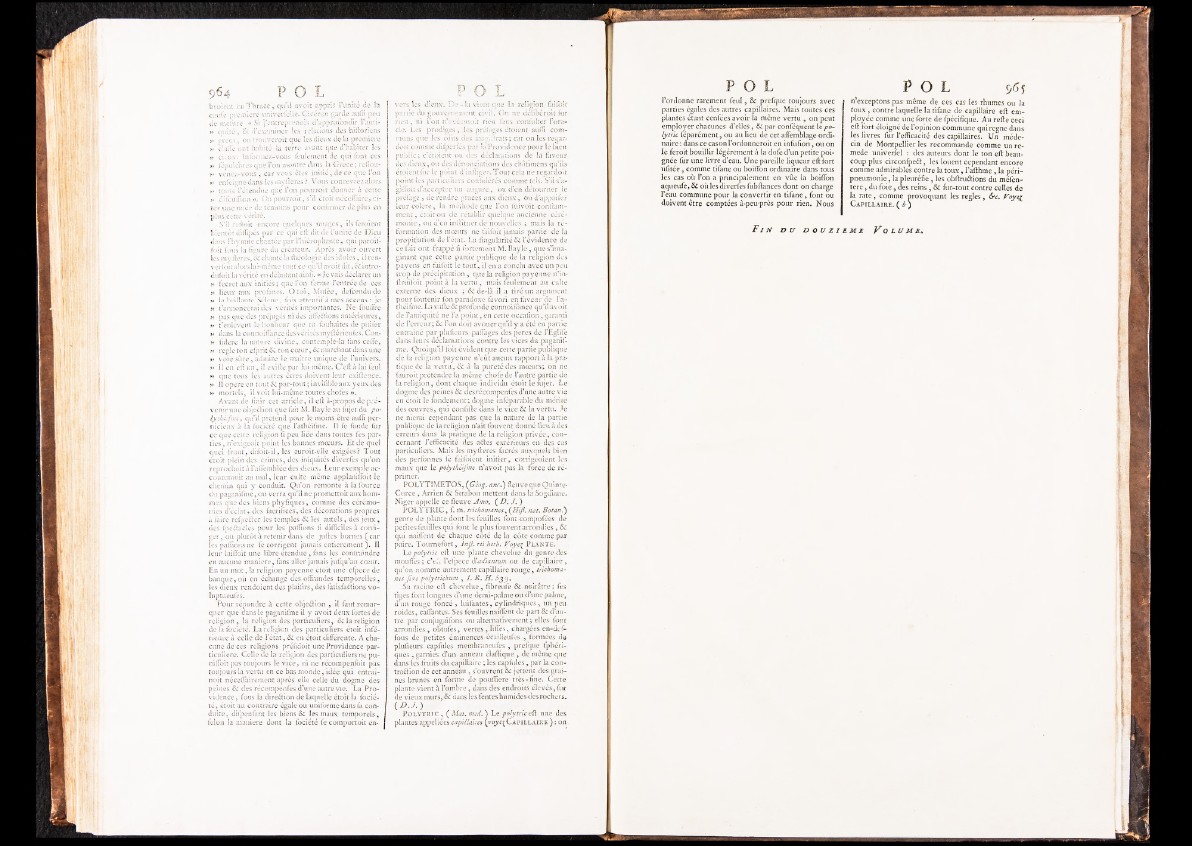
é
y 6 4 P 0 L
bi oient en Thrace, qu’il avoit: appris l’unité de là
caufe premiere univerielle. Ci<:éron garde aufii peu
de: mentre « Si j’entreprenois d’aoprofondir l’anti*
„ quité , & d’examiner les re iations des hiftoriens
» orées , on trouveroit que les; dieux de la première
» êlaffe ont habité la terre avant que d’habiter les
» peux . Informez-vous feule:ment de qui font ces
fépuh:hres que l’on montre dans la Grece ; reflouvene?>
vous , car vous êtes initié , de ce que l’on
» enfeij$ne dans les myfteres ? Vous concevrez alors
» toute l’étendue que l’on pouirroit donner à cette
difeu:ffion ». On pourroit, s’il étoit néceffaire, citer
une nuée de témoins pour confirmer de plus en
P1lus cetre vérité.
sftoït encore quelques; nuages , ils feroient
1 '.ientôt diflipés par ce qui eft dit de l’ulrite de Dieu
d;ms l’ivymne chantée par l’hiérophante, qui paroiffc>
it fouis la figure du créateur. Apres avoir ouvert
le s myft eres, 6c chante la theologie des idoles, il ren-
Vierfoit cdors lui-même tout ce qu’il avoit dit, 6c introdiiifoit
la1 vérité en débutant ainîi. « Je vais déclarer un
>> fecreit aux initiés ; que l’on :ferme l’entrée de ces
» lieux aux profanes. O to i, Mulée, defeendu de
» la brillante Sélene, fois attentif à mes accens : je
» t’annoncerai des vérités importantes. Ne foulfre
» pas que des préjugés ni des a {ferions antérieures,
» t’enlevent le bonheur que tu fouhaites de puil'er
» dans la connoifiance des vérités myftérieufes. Con-
» fidere la nature divine, contemple-la fans celle,
« réglé ton efprit 6c ton coeur, 6c marchant dans une
» voie sûre, admire le maître unique de Tunivers.
» 11 en eft un, il exifte par lui-même. C’eftà lui feul
» que tous les autres êtres doivent leur exiftence.
» Il opéré en tout 6c par-tout ; invifible aux yeux des
» mortels, il voit lui-même toutes chofes ».
Avant de finir cet article, il eft à-propos de prévenir
une objeôion que fait M. Bayle au fujet du po-
lythêîfma, qu’il prétend pour le moins être auffi pernicieux
à la fociété que l’athéifme. Il fe fonde fur
ce que cette religion fi peu liée dans toutes fes parties
, n’exigeoit point les bonnes moeurs. Et de quel
quel front, difoit-il, les auroit-elle exigées? Tout
étoit plein des crimes, des iniquités diverfes qu’on
reproehoit à l’alTemblée des dieux. Leur exemple ac-
coutumoit au mal, leur culte même applaniuoit le
chemin qui y conduit. Qu’on remonte à la fource
du paganifme, ou verra qu’il ne promettoit aux hom-
mes que des biens phyfiques, comme des cérémonies
d’éclat, des facrifices, des décorations propres
à taire refpefter les temples 6c les autels, des jeux,
des foe&acles pour les pallions fi difficiles à corriger,
ou plutôt à retenir dans de juftes bornes (car
les pallions ne fe corrigent jamais entièrement). Il
leur laiffoit une libre etendue, fans les contraindre
en aucune maniéré, fans aller jamais jufqu’au coeur.
En un mot, la religion payenne étoit une efpece de
banque, où en échange des offrandes temporelles,
les dieux rendoient des plaifirs, des fatisfaftions vo-
luptueufes.
Pour répondre à cette objection , il faut remarquer
que dans le paganifme il y avoit deux fortes de
religion, la religion des particuliers, & la religion
de la fociété. La religion des particuliers étoit inférieure
à celle de l’état, 6c en étoit différente. A chacune
de ces religions préfidoit une Providence particulière.
Celle de la religion des particuliers ne pu-
niffoit pas toujours le v ice, ni ne récompenfoit pas
toujours la vertu en ce bas monde, idée qui entraînent
néceffairement après elle celle du dogme des
peines 6c des récompenfes d’une autre vie. La Providence
, fous la dire&ion de laquelle étoit la fociété,
étoit au contraire égale ou uniforme dans fa conduite
, difpenfant les biens 6c les maux temporels,
félon la maniéré dont la fociété fe comportoit en-
P n ? v y jlj
vers les dieux. D e -1a vient que 1a religion faifoit
partie du gouvernenvc•nt civil. On ne délibéroit fur
rien, ni l’on n’exécu toit rien fans confulter l’oracle.
Les prodiges, 1<-s préfaces ét:oient auffi communs
que les edits deîs magiurats ;, car on les regar-*
doit comme dilperfés par la Provid cnce pour le bien
public ; c’etoient ou <les déclaratiians de la faveur
des dieux, ou des dentnidations des chatimens qu’ils
étoientfur le point d’infliger. Tout cela ne regardoit
point les particuliers confidérés comme tels. S’ils’a-
gifîbit d’accepter un augure, ou d’en détourner le
prélage, de rendre grâces aux dieux, ou d’appaifer
leur colere, la méthode que l’on fuivoit conftam-
ment, étoit ou de rétablir quelque ancienne cérémonie
, ou d’en inflituer de nouvelles ; mais la réformation
des moeurs ne faifoit jamais partie de la
propitiation de l’état. La fingularité 6c l’évidence de
ce fait ont frappé fi fortement M. Ba yle, que s’imaginant
que cette partie publique de la religion des
payens en faifoit le tout, il en a conclu avec un peu
trop de précipitation, que la religion payenne n’in-
ilruifoit point à la vertu, mais feulement au culte
externe des dieux ; 6c de-là il a tiré un argument
pour foutenir fon paradoxe favori en faveur de l’a-
théifme. La vafte 6c profonde connoifiance qu’il avoit
de l’antiquité ne l’a point, en cette occafion, garanti
de l’erreur; 6c l’on doit avouer qu’il y a été en partie
entraîné par plufieurs paffages des peres de l’Eglife
dans leurs déclamations contre les vices du paganifme.
Quoiqu’il foit évident que cette partie publique
de la religion payenne n’eut aucun rapport à la pratique
de la vertu, 6c à la pureté des moeurs; on ne
fauroit prétendre la même chofe de l’autre partie de
la religion., dont chaque individu étoit le fujet. Le
dogme des peines 6c des récompenfes d’une autre vie
en étoit le fondement; dogme inféparable du mérite
des oeuvres, qui confifte dans le vice 6c la vertu. le
ne nierai cependant pas que la nature de la partie
publique de la religion n’ait fouvent donné lieu à des
erreurs dans la pratique de la religion privée, concernant
l’efficacité des attes extérieurs en des cas
particuliers. Mais les myfteres facrés auxquels bien
des perfonnes fé faifoient initier, corrigeoient les
maux que le polythlifme n’avoit pas la force de réprimer.
POLYTIMETOS, ( Géog. anc.') fleuve que Quinte-
Curce , Arrien 6c Strabon mettent dans la Sogdiane.
Niger appelle ce fleuye Amo. ( D. J. )
POL YTRIC, f. m. trichomanes, (Hijl. nat. Botan.)
genre de plante dont les feuilles font compofées de
petites feuilles qui font le plus fouvent arrondies , 6c
qui naiffent de chaque côté de la côte comme par
paire. Tournefort, lnjl. rei h&rb. ffoye{ P l a n t e .
Le polytric eft une plante chevelue du genre des
moufles ; c’efi. l’efpece d’adiantum ou de capillaire ,
qu’on nomme autrement capillaire rouge, trichomanes
Jive polytrichum , I. R. H. .
Sa racine eft chevelue, fibreufe 6c noirâtre ; fes
tiges font longues d’une demi-palme ou d’une palme,
d’un rouge foncé , luifantes, cylindriques , un peu
roides, caftantes. Ses feuilles naiffent de part 6c d’autre
par conjugaifons ou alternativement ; elles font
arrondies, obtufes, vertes, liffes, chargées en-def-
fous de petites éminences écailleufes , formées do
plufieurs capfules membraneufes , prefque fphéri-
ques , garnies d’un anneau élaftique , de même que
dans les fruits du capillaire ; les capfules, par la con-
tra&ion de cet anneau, s’ouvrent 6c jettent des graines
brunes en forme de poufliere très-fine. Cette
plante vient à l’ombre, dans des endroits élevés, fur
de vieux murs, 6c dans les fentes humides des rochers.
I l p j
P o l y t r i c , (Mat. med. ) Le polytric eft une des
plantes appeliées capillaires (yoye^C a p il l a ir e ) : on
l’ordonne rarement feu l, 6c prefque toujours avec
parties égales des autres capillaires. Mais toutes ces
plantes étant cenfées avoir la même vertu , on peut
employer chacunes d’elles, 6c par conféquent le polytric
féparément, ou au lieu de cet affemblage ordinaire
: dans ce cason l’ordonneroit en infufion, ou on
le feroit bouillir légèrement à la dofe d’un petite poignée
fur une livre d’eau. Une pareille liqueur eft fort
ufitée, comme tifane ou boiffon ordinaire dans tous
les cas où l’on a principalement en vue la boiffon
aqueufe, 6c où les diverles fubftances dont on charge
l’eau commune pour la convertir en tifane, font ou
doivent être comptées à-peu-près pour rien. Nous
ft exceptons pas- même de ces cas les rhumes ou la
toux, contre laquelle la tifane de capillaire eft employée
comme une forte de fpécifique. Au refte ceci
eft fort éloigné de l’opinion commune qui régné dans
les livres fur l’efficacité des capillaires. Un médecin
de Montpellier les recommande comme unre-
mede univerfel : des auteurs dont le ton eft beaucoup
plus circonfpeft, les louent cependant encore
comme admirables contre la tou x, l’afthme, la péripneumonie
, la pleuréfie, les obftru&ions du méfen-
tere, du foie , des reins, 6c fur-tout contre celles de
la rate, comme provoquant les réglés, &c. Voyt^
C a p il l a ir e . ( b )
F i n d u D 0 U Z Z E M E V o l u m e *