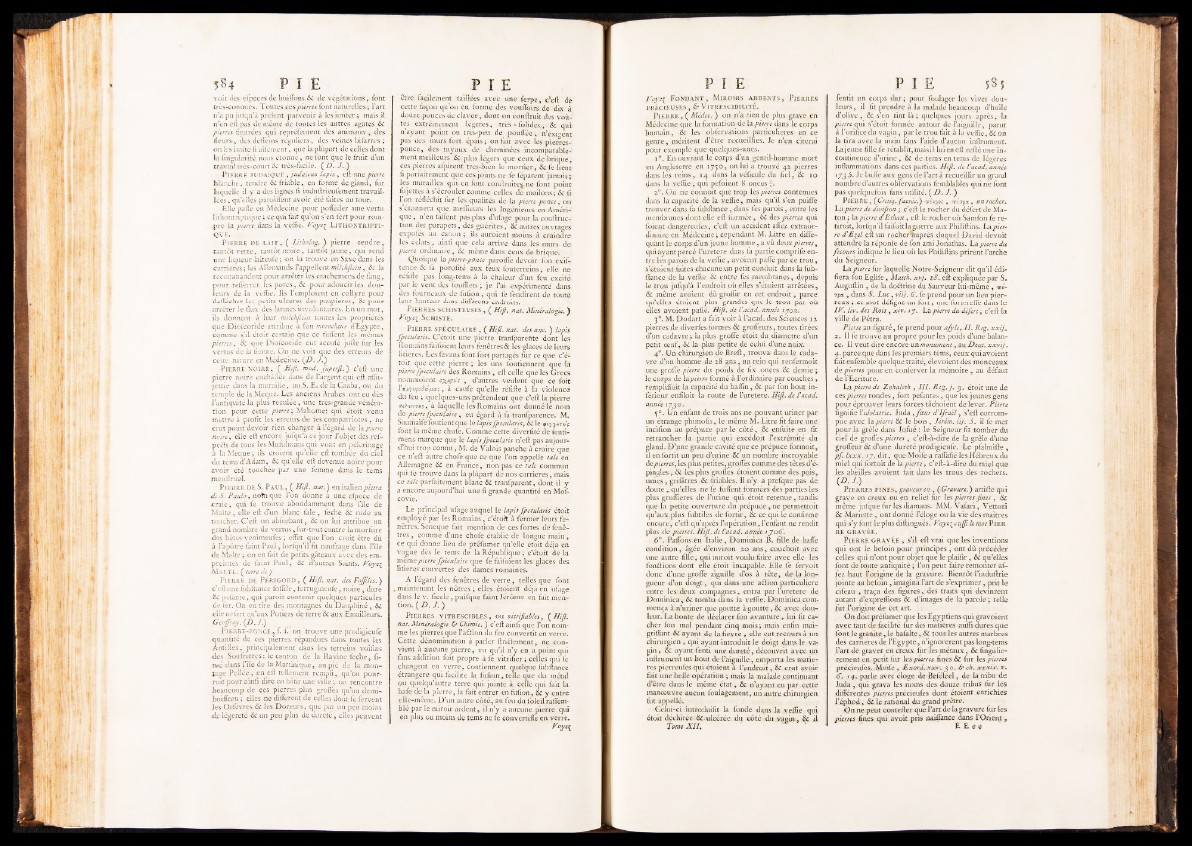
voit des -efpéces de buiffons & de végétations, fo'nt
très-connues. Toutes ces pierres font nature lies; l’art
ira pu juiqu’à préfent parvenir à les imiter ; mais il
n’en e11, pas de même de toutes les autres agates &
pierres figurées qui repréfentent des animaux, des
fleurs , des deffei-ns réguliers, des veines bicarrés ;
on les imite fi aifément, que la plupart de celles dont
la fingularité nous étonne, ne l’ont que le fruit d’un
travail très-court & très-facile. (D . J . )
P ie r r e j u d a ïq u e ,-judaicus lapis, -eft-unè pierre
blanche, tendre & friable, -en forme de gland, fur
laquelle il y a des lignes û induftrieiifement travaillées
, qu’elles paroiflent avoir été laites au tour»
Elle pâlie en Médecine pour pofféder une ver-tu
lithontriptique ; ce qui fait qu’on s’en fert pour rompre
la.pierre dans la v e f lïe . Voye^ L i t h o n t r i p t i -
QUE.
P ie r r e d e l a i t , ( Litholog. ) pierre tendre,
tantôt verte, tantôt noire , tantôt jaune, qui rend
une liqueur laiteufe ; on la trouve en Saxe dans les
carrières; les Allemands l’appellent milckfiein, & la
recommandent pour arrêter les crachemens de fang,
pour refierrer les pores, & pour adoucir les douleurs
de la veflïe. Ils l’emploient en collyre pour
deflecher les petits ulcérés des paupières, & pour
arrêter le flux des larmes involontaires. En un mot,
ils donnent à leur milckfiein toutes les propriétés
que Diofcoride attribue à fon morochtus d’Egypte,
comme s’il étoit certain que ce fufl’ent les mêmes
pierres, & que Diofcoride eut accufé jufte fur les
vertus de la fienne. On ne voit que des erreurs de
cette nature en Médecine. (D . /.)
P i e r r e n o i r e , ( Hift. mod. juperfi.') c’efl: une
pierre noire enchâffée dans de l’argent qui eft affu-
jettie dans la muraille, au S. E . de la Caaba, ou du
•temple de la Meque. Les anciens Arabes ont eu dès
l ’antiquité la plus reculée, une très-grande vénération
pour cette pierre ; Mahomet qui étoit venu
mettre à profit les erreurs de fes compatriotes, ne
crut point devoir rien changer à l’égard de la pierre
noire, elle eft encore jufqu’à ce jour l’objet des ref-
pefts de tous les Mufulmans qui vont en pèlerinage
à la Meque ; ils croient qu’elle eft tombée du ciel
du tems d’Adam, & qu’elle eft devenue noire pour
avoir été touchée par une femme dans le tems
menftruel.
P i e r r e d e S. Pa u l , ( Hiß. nat.") en italienpietra
di S. Paulo, nohî que l’on donne à une efpece de
craie, qui fe trouve abondamment dans Pile de
Malte , elle eft d’un blanc fale, feche & rude au
toucher. C’eft un abforbant, & on lui attribue un
grand nombre de vertus, fur-tout contre la mprfure
des bêtes venimeufes ; effet que l’on croit être dû
à l’apôtre faint Paul, lorfqu’il fit naufrage dans l’île
de Malte ; on en frit de petits gâteaux avec des empreintes
de faint Paul, & d’autres Saints. Voyt^
M a l t e . ( terre de )
P ie r r e d e P é r ig o r d , ( Hiß. not. des Foffles.)
c’ eft une fubftance fofîile, ferrugineufe, noire, dure
pelante, qui paroît contenir quelques particules
de fer.- On en tire des montagnes du Dauphiné , &
elle ne fert qu’aux Potiers de terre & aux Emailleurs.
Geoffroy. (D. 7.)
P ie r r e - p o n c e , f. f. on trouve une prodigieufe
quantité de ces pierres répandues dans toutes les
Antilles, principalement dans les terreins voifins
des Soufrières: le canton de la Ravine feche, fi-
twé dans l’île de la Martinique, au pié de la montage
Pellée, en eft tellement rempli, , qu’on pour-
xoit pour ainfi dire en bâtir une ville ; ou rencontre
beaucoup de ces pierres plus groffes qu’un demi-
boiffeau ; elles ne different de celles dont fe fervent
les Orfèvres & les Doreurs, que par un peu moins
de légèreté un peu plus de dureté, elles peuvent
être facilement taillées avec une ferpe, c’eft de
cette façon qu’on en forme des vouflbirs.de dix à
dottze pouces de clavée, dont on conftruit des voûtes
extrêmement légères, très - fôlidesj, -& qui
n’ayant point ou très-peu de pouflèe g n’exigent
pas des murs fort épais ; on fait avec les pierres-
ponce, des tuyaux de cheminées incomparable-1
ment meilleurs & plus;légers que ceux dé brique,
ces pierres afpirent très-bien le mortier, & fe lient
fi parfaitement que ces joints ne fe féparent jamais ;
les murailles qui en font conftruite^ ne font point
fujettes a s’écrouler comme celles de moilons; & fi
l’on réfléchit -fur les qualités de la pierre ponce, on
S. donnera que meilleurs les Ingénieurs en Amérique,
n’en faffent pas plus d’ufage pour la conftruc-
tion des parapets, des guérites, &c autres ouvrages
expofes au canon ; ils auroient moins à craindre
les éclats, ainfi que cela arrive dans les murs de
pierre ordinaire , 6c même dans ceux de brique.
Quoique h pierre-ponce paroiffe devoir-ion \exif-
tence & fia porofité aux feux fouterreins, elle ne
réfifte pas long-tems à la chaleur d’un feu excité
par le vent des foufflets ; je l’ai expérimenté dans
des fourneaux de fufion , qui fe fendirent de toute
leur hauteur dans diffère ns endroits.
P ie r r e s s c h i s t e u s e s , ( Hiß. nat. Minéralogie, )
Hoye{ S c h i s t e .
P i e r r e s p é c u l a i r e , ( Hiß. nat. des anc. ) lapis
fpecularis. C’étoit une pierre tranfpareftte dont les
Romains faifqient leurs fenêtres & les glaces de leurs
litières. Les favans font fort partagés fur ce que c’étoit
que cette pierre ; les uns foutiennent que là
pierre fpeculaire des Romains, eft celle que lés Grecs
nommoient a-yj^-oc , d’autres veulent que ce foit
ixpyupoS'ctpa.ç, à caufe qu’elle réfifte à la violence
du feu ; quelques-uns prétendent que c’eft la pierre
ffe*4WT»ç, à laquelle les Romains ont donné le nom
de pierre fpeculaire , eu égard à fa tranfparence. M.
Saumaifefoutientque le lapis fpecularis, & le çiyynnç
font la même chofe. Comme cette diverfité de fenti-
mens marque que le lapis fpecularis n’eft pas aujourd’hui
trop connu, M. de Valois panche à croire que
ce n’eft autre chofe que ce que l’on appelle talc en
Allemagne & en France, non pas ce talc commun
qui lé trouve dans la plûpart de nos carrières, mais
ce talc parfaitement blanc & tranfparent, dont il y
a encore aujourd’hui une fi grande quantité en Mof-
covie.
Le principal ufage auquel le lapis fpecularis étoit
employé par les Romains, c’éto à fermer leurs fenêtres.
Seneque fait mention de ces fortes dé fenêtres
, comme d’une chofe établie de longue main,
ce qui donne lieu de préfumer qu’elle étoit déjà en
vogue dès le tems de la République ; c’étoit de la
même pierre fpeculaire que fe faifoient les glaces des
litières couvertes des dames romaines!
A l’égard des fenêtres de verre, telles que font
maintenant les nôtres ; elles étoient déjà en ufage
dans le v. fiecle, puifque faint Jérôme en fait mention.
( D . J. )
P i e r r e s v i t r e s c i b l e s , ou vitrifiables, ( Hifi,
nat. Minéralogie & Chimie. ) c’eft ainfi que l’on nomme
les pierres que l’aftion du feu convertit en verre.
Cette dénomination à parler ftri&ement, ne conr
vient à aucune pierre, vu qu’il n’y en a point qui
fans addition foit propre à fe vitrifier ; celles qui fe
changent en verre, contiennent quelque fubftance
étrangère qui facilite la fufion, telle que du métal
ou quelqu’autre terre qui jointe à celle qui fait la
bafe de la pierre, la fait entrer en fufion, & y entre
elle-même. D’un autre côté, au feu du foleil raffem-
blé par le miroir ardent, il n’y a aucune pierre qui
en plus ou moins de tems ne le convertiffe en verre.
Voyez
H oy e i Fo n d a n t , Mir o ir s a r d e n t s , Pie r r e s
PRÉCIEUSES , & ViTRESCIBILITÉ.
P i e r r e , ( Médec. ) op n’a rien de plus grave en
Médecine que la formation de la pierre dans le corps
humain, & les .obfervatiops particulières en ce
genre, méritent d’être recueillies. Je n’en citerai
pour exemple que quelques-unes.
i° . En ouvrant le corps d’un gentil-homme mort
en Angleterre ,en 1750, on lui a trouyé 42 pierres
dans les reins, 14 dans la véficule du fiel, & 10
dans la veflïe, qui p.efoient 8 onces 7.
2.0. ,On ne connoît que trop les pierres contenues
dans la .capacité de la veflïe, mais qu’il s’en puiffe
trouver daps fa .fubftance , dans les parois, entre les
membranes dopt elfe eft formée, & des pierres qui
fojent dongereufes, c’eft un accident allez extraordinaire
en Médecine ; .cependant M. Litre en diffe-
quant le corps d’un j eune homme, a vû deux pierres,
qui ayant percé l’ureter.e dans fa partie.comprife entre
les parois de la veflïe , avoient paffé par ce trou,
s’ét oient faites .chacune un petit conduit dans la fub-
ftançe de la .veflïe & entre fes membranes, depuis
le tro.u jufqu’à l’endroit où elles s’étoient arrêtées,
même avoient dû groffir en cet endroit, parce
qu’elles étoient plus grandes que le trou par où
elles avaient .paffé. Hifi. de L'acad. année 1.702.
30. M. Dodart a fait voir à l’acad. des Sciences 12
pierres de div.erfes formes & grofieurs, toutes tirées
d’un cadavre ; la plus groffe étoit du diamètre d’un
petit oeuf, & la plus .petite de celui d’une noix.
40. Un .chirurgien de E reff, .trouva' dans le cadavre
d’un homme de 28 ans, un rein qui renfermoit
une groffe pierre du poids de lix onces & .demie ;
le corps de la pierre formé à l’ordinaire par couchers,
rempliffoit la capacité du bafîin, & par fon bout inférieur
.enfiloit la route de l’uretere. Hifi. de Çacad.
année iyx.o.
50. Un enfant de trois ans ne pouvant uriner par
un étrange phimoûs, le même M. Litre fit faire une
incifion au .prép.uce par le côté, & enfuite en fit
retrancher ;la jpartie qui excédoit l ’extrémité du
gland. D ’pne grande cavité que ce prépuce formoit,
il enfortit un peu d’urine .& un nombre incroyable
depierres, les plus petites, groffes comme des tête.s d’épingles,
les .plus groffes .étoient comme des pois,
unies, grifâtres .& friables. U n’y a prefque pas de
doute, qu’elles ne fe.fuffent .formées des parties les
plus groflieres de Furine qui étoit retenue, tandis
que.fa petite ouverture du prépuce , ne permettoit
qu’aux plus fubtiles de fortir, & c.e qui le confirme
encore, c’eft qu’après l’opération, l’enfant-ne rendit
plus .clé pierres. Hifi, de B acad. année 1J06.
.6°. Paffons en Italie, Dominica B. fille de baflè
condition, %ée d’environ 20 ans, couchoit avec
une autre fille, qui auroit voulu faire avec elle les
fonctions dont elle étoit incapable. Elle fe fervoit
donc d’une groffe aiguille d’os à tête, de la longueur
d’un doigt, qui dans une aélion particulière
entre les.deux compagnes, entra par Furetere de
Dominica, & tomba dans la veflie. Dominica,commença
à.n’uriner que goutte à goutte, & avec douleur.
La ihonte de déclarer fon ay.anture, lui fit cacher
fon mal pendant cinq mois ; mais enfin mai-
griffant & ayant de la fievte , elle eut recours à un
chirurgien, qui ayant introduit le doigt dans Je vagin
, de ayant fenti une dureté, découvrit ayec un
înftrumuent un bout deTaieuille , emporta les matières
pierraufes qui étoient à l’endroit, & crut aVpjr
fiiit une beflle opération ; mais la malade continuant
d’être dans le même état, & n’ayant eu par çette
manoeuvre aucun foulagement, un autre chirurgien
frit appellé.
Celui-ci introduifit la fonde d^ns la veflïe ,qyji
étoit déchirée ulcérée du côté du vagin, êc i l
Tome XII,
fentit un corps dur ; pour foulager les vives douleurs
, il fit prendre à la malade beaucoup d’huile
d’oliye , & s’en tint là ; quelques jours après, la
pierre qui s’étoit formée autour de l’aiguille, parut
à Fo,rifice du vagin, par le trou fait à la veflie, & on
la tira avec la main fans l’aide d’aucun infiniment.
La jeune fille fe rétablit, mais il lui en eft refté une incontinence
d’urine , & de tems en tems de légères
inflammations dans ces parties. Hifi. de l'acad. année
1 4 * Je lfrffe aux gens de Fart à recueillir un grand
nombre d’autres obfervafrons femblables qui ne font
pas quelquefois fans utilité. {D . J.')
Pie r r e , (Çritiq.facrée.) -arerpof , nrlrpa., un rocher*
La pierre de divifion ; c’eft le rocher du défert de Maton
j M pierre d'Ethan, eft le rocher où Samfon fe re-
tiroit, lorfqu’il faifoit la guerre aux Philiftins. La pierre
d'E^el eft un rocher%uprès duquel David devoit
attendre la réponfe de fon ami Jonathas. La pierre du
fecours indique le lieu où les Philiftins prirent l’arche
du Seigneur.
La pierre fur laquelle Notre-Seigneur dit qu’il édifiera
fon Eglife, Matth, xyj. 18. eft expliquée par S.
Auguftin , de la do&rine du Sauveur lui-même, <al-
Tpet, dans S. Luc, viij. C. fe prend pour un lieu pierreux
; ce mot défigne un fort, une fortereffe dans le
IF", liy. des Rois , xiv. i j . La pierre du défert, c’eft la
ville ,de Pétra.
Pierre au figuré, fe prend pour afyle, IL Reg. xxij.
2. Il fe trouvé au propre pour les poids d’une balance.
Il veut dire encore un monument, au Deut. xxyij.
4. parce que dans les premiers tems, ceux qui avoient
fait enfemble quelque.traité, élevoient des monceaux
de pierres pour en conferver la mémoire , au défaut
de l’Ecriture.
La pierre de Zohaleth, III. Reg. j . y . étoit une de
ces pierres rondes, fort pefantes, que les j eunes gens
pour éprouver leurs forces tâqhoient de lever. Pierre
fignifîe '^idolâtrie. Juda ^foeur d'Ifraël, s’eft corrompue
avec la pierre & le bois, Jérém. iij. 5. il fe met
pour la grêle dans Jofué : le Seigneur fit tomber du
ciel de groffes pierres , c’eft-à-dire de la grêle d’une
groffeur & d’une dureté prodigieufe. Le pfalmifte ,
p f Ixxx. .17. dit, que Moife a raffafié les Hébreux du
miel quifortoit de la pierre, c’eft-à-dire du miel que
les abeilles avoient fait dans les trous des rochers.
(« • • '• ) :
P i e r r e s F INES, graveur en , (Gravure.) arnfte qui
grave en creux ou en relief fiir les pierres fines , &
même jufque fur les diamans. MM. Vafari, Vettori
& Mariette , ont donné l’éloge ou la vie des maîtres
qui s’y font le plus diftingués. Voyeç eußi U mot P i e r ■
RE g r a v é e .
P i e r r e g r a v é e , s’il eft vrai que les inventions
qui ont le befoin pour principes , ont dû précéder
celles qui n’ont pour objet que le plaifir, & qu’elles
font de toute antiquité ; l’on peut faire remonter afi-
fez haut l’origine de la gravure. Bientôt l’induftrie
jointe au bçfoin, imagina l’art de s’exprimer , prit le
.cifeau , traça des figures, des traits qui devinrent
autant d’expreflions & d’images de la parole ; telle
fut l’origine de cet art.
On doit préfumer que les Egyptiens qui gravoient
avec tant de facilité fur des matières aufli dures que
font le granité,de bafalte, & tous les autres marbres
des carrières de l’Egypte, n’ignorerent pas long-tems
Fart dé graver en creux fur les métaux, &fingulie-
r,en>ent en. petit fui: les pierres .fines & fur les pierres
préçieufes. rMoïfe, Exard.xxv. g o . & ch. xxxix. v.
5 . 14. parle avec éloge ; de Beféléel, de la tribu de
Juda ,. qui grava les noms des douze tribus fur les
différentes pierres préçieufes dont étoient enrichies
Fjéphod, &i le rational du grand prêtre.
Qn p,e peut contefter que l ’art de la gravure fur les
pierres fines qui nvoit pris naiffance dans l’Qrient,
E E e e