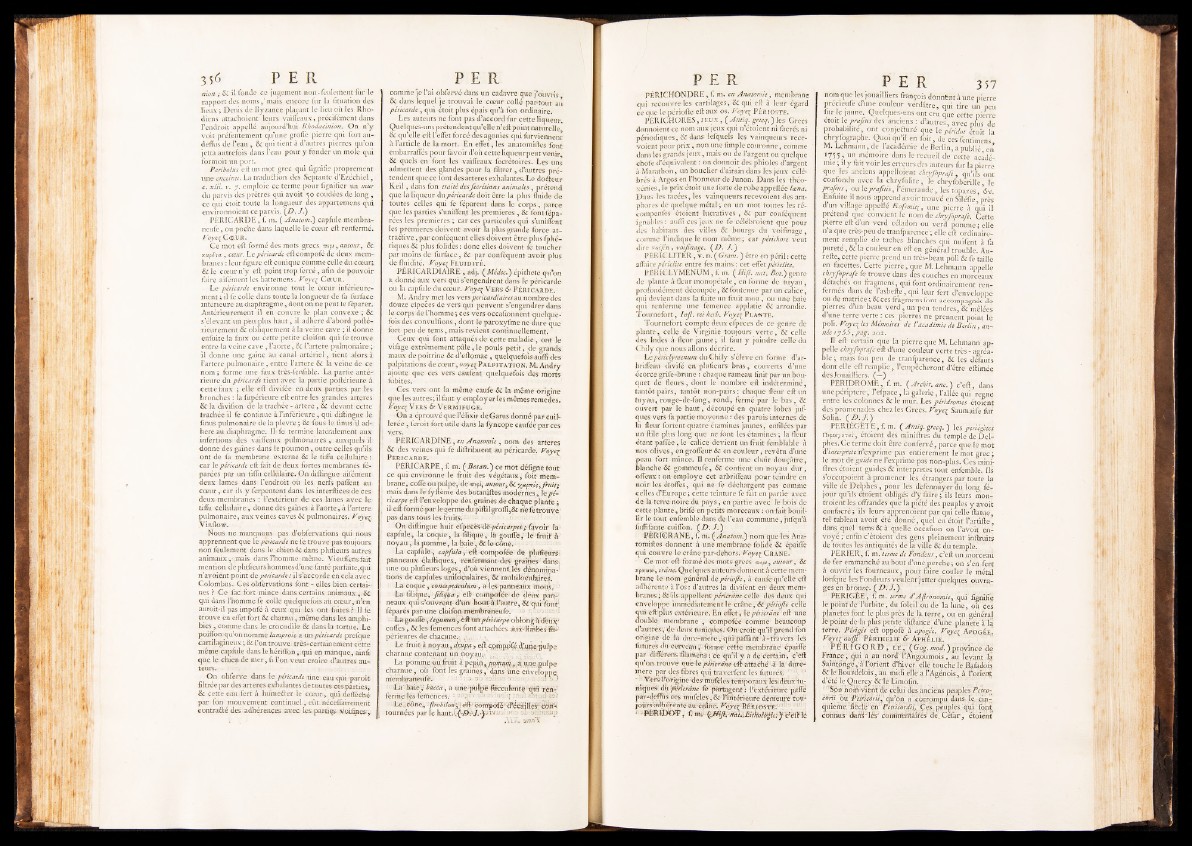
mon ; &£ il fonde ce jugement non-feulement fur le
rapport des noms,'mais encore fur la fituation des
lieux ; Denis de Byzance plaçant le lieu où les Rho-
diens attachoient leurs vaifleaux, précifément dans
l’endroit appelle aujourd’hui Rhodacinion. On n’y
voit préfentement qu’une groffe pierre qui fort au-
deffus de l’eau , & qui tient à d’autres pierres qu’on
jetta autrefois dans l’eau pour y fonder un mole qui
fprmoit un port.
Peribolus eft un mot grec qui fignifie proprement
une enceinte. La traduction des Septante d’Ezéchiel,
c. xlïi. v. y. emploie ce terme pour lignifier un mur
du parvis des prêtres qui avoit 50 coudées 4e long ,
ce qui étoit toute la longueur des appartemens qui
environnoient ce parvis, (D . J.')
PÉRICARDE, f. m. ( Anatomï) capfule membra-r
neufe, ou poche dans laquelle le coeur eft renfermé.
Foyt[Q<S.VR.
Ce mot eft formé des mots grecs mpi, autour, &c
y.apS'itt, coeur. Le péricarde eft compofé de deux membranes
: leur figure eft conique comme celle du coeur;
& le coeur n’y eft point trop ferré, afin de pouvoir
faire aifément les battemens. Foye^ Coeur.
Le péricarde environne tout le coeur inférieurement
; il fe colle dans toute la longueur de fa furface
inférieure au diaphragme, dont on ne peut le féparer.
Antérieurement il en couvre le plan convexe ; &
s’élevant un p'eu plus haut, il adhéré d’abord pofté-
rieurement & obliquement à la veine cave ; il donne
enfuite la faux ou cette petite cloifon qui fe trouve
entre la veine cave , l’aorte, & l’artere pulmonaire ;•
i l donne une gaine au canal artériel, tient alors à.
l’artere pulmonaire , entre Partere & la veine de ce
nom ; forme une faux très-fenfible. La partie antérieure
du péricarde tient avec la partie poftérieure à
cette faux ; elle eft divifée en deux parties par les
bronches : la fupérieure eft entre les grandes arteres
&: la divifion de la trachée - àrtere, & devant cette
trachée il fe continue à l’inférieure , qui diftingue le
finiis pulmonaire de la plevre ; & fous le finus ft adn
here au diaphragme. II? fe termine latéralement aux
infertions des vaifleaux pulmonaires, auxquels il
donne des gaines dans le poumon, outre celles qu’ils
ont de fa membrane externe &c le tiffu cellulaire :
car le péricarde eft fait de deux fortes membranes fé-
parées par un tiffu cellulaire. On diftingue aifément
deux lames dans l’endroit où les nerfs pàflênt au
coeur, car ils y ferpentent dans les interfticesrde ces
deux membranes : l’extérieur de ces lames avec le.
tiffu cellulaire, donne des gaines à l’aorte , à l’artere.
pulmonaire, aux veines caves & pulmonaires. Vôye^
.Vinftow.
Nous ne .manquons . pas d’obfervations qui nous-
apprennent que le péricarde ne lie trouve pas toujours
non feulement dans le chien & dans plufieurs autres
animauxmais dans l’homme même. Vieuffensfait
mention de plufieurs hommes d’une, fanté parfaite,qui
n’avoiént point de péricarde : il s’accorde en.cela avec
Colombus. Ces obfervations font - elles bien certaines
î Ce fac.fort mince'dans certains animaux
qui dans l’homme fe colle quelquefois aù coeur, n’en
auroit-il pas impofé à ceux qui..lés ont faites,?- Il fe
trouve en effet fort & charnu, même dans les amphibies
, comme dans le crocodile & dans la tortue. Le
poiffon qu’on nomme lamproie a un péricarde prefque
cartilagineux ; & l’on trouve, très-certainement cette
même capfule dans le hériffon, qui en manque , ainft
que le chien de mer, fi l’on veut croire d'autres au-i
teurs. .
On obferve dans ;le péricarde aine eauqùi paroît
filtrée par des arteres exhalantes de toutes <ees parties
& cette eau. fert à hume&er le coeur, qui de fléché
par fon mouvement continuel, eut.néceflairement
eontraélé des-adhérences avec les partiqs. voifines,,.
comme je l’ai obfervé dans un cadavre que j’ouyfis
& dans lequel je trouvai le coeur collé par-tout au
péricarde , qui étoit plus épais qu’à fon ordinaire.
Les auteurs ne font pas d’accord fur cette liqueur.
Quelques-uns prétendent qu’elle n’eft point naturelle
& qu’elle eft l’effet forcé des agonies qui furviennent
à l’article de la mort. En effet, les anatomiftes font
embarrafîes pour favoir d’où cette liqueurpeut venir
& quels en font les vaifleaux feorétoires. Les uns
admettent des glandes pour la filtrer, d’autres prétendent
que ce font des arteres exhalantes. Le dofreur
K e i l , dans fon traité des fecrèùons animales, prétend
que la liqueur àx\ péricarde doit être la plus fluide de
toutes celles qui fe Apparent dans le corps, parce
que les parties s’uniffent les premières , & font réparées
les premières ; car ces particules qui s’uniffent
les premières doivent avoir la plus grande force at-
traftive, par conféquent elles doivent être plus fphé-
riques & plus folides: donc elles doivent fé toucher
par moins de fiirfaee, & par conféquent avoir plus
de fluidité. Voye^ F l u i d i t é .
PÉRICARDIAIRE , adj. ( Médec.) épithete qu’on
a donné-aux vers qui s’engendrent dans le péricarde
où la capfule du coeur. Foye^ V e r s & P é r i c a r d e .
M. Andry met les vers pericardiairesau nombre des
douze efpeces de vers qui peuvent s’engendrer dans
le corps de l’homme ; ces vers oçcaftonnent quelquefois
des convulfions, dont le paroxyfme ne dure que
fort peu de tems, mais revient continuellement.
Ceux qui font attaqués de-cptte maladie, ont le
vifage extrêmement pâle, le pouls petit, de grands
maux de poitrine & d’eftomac , quelquefois aulfi: des
palpitations de coeur, voyez P a l p i t a t i o n . M. Andry
ajoute que ces vers caufent quelquefois des morts
lubites.
Ces vers ont la même caufe & la même origine
que les autres ; il faut y employer les mêmes remedes.
ff&yei V e r s & V e r m i f u g e .
On a éprouvé que l’élixir de Garns donné-par cuillerée
, feroit fort utile dans la fyncope eauféé par cès
yers.
PÉRICARDINE, en Anatomie , nom- des arteres
& des veines qui fe diftrihuent au péricarde. Foye^
P é r i c a r d e .
PÉRICARPE, f. m. ( Botan. ) ce mot défighe tout
ce qui environne le fruit des; végétaux, foit membrane,
coffe ou pulpe,-de nnp), autour, & x*p?ràç, fruit;
mais dans lé fyftème des botanjftês modernes, lè péricarpe
eft l’enveloppe des, graines de chaque plante ;
il eft formépar le germe du piftilgroffi-,& néfe trouve/
pas dans tous les fruits.11
On diftingue huit efipè ê eS: dépéri carpes^ fàvoir la-
capfule, -là coque, lafiliqué, là gouflë,' le- frùit à
noyau, la pomme-, la-baie, & leeônè; -
La capftilé--, capfüla , eft cotnpoféë de plufieurs.'
panneaux élaftiqùes, réhfèimànt-des graifresi! dans,
une ou plufieurs loges, d’où viennent lés déno ruina-^
tioris' de Caplitlès ùnifddidàires, & mùlt-ilbdifairéï.
La coque t conckptddütüm-, aifeSpanneaux -iftçrtis.- -
lia-filitjue-, ßätjfa-, eft1 compOfée^de deux parri1
neaùx qui s’oiivrént- d?üft boift^Pautre, & quiTont*
féparés paraine cloifon méiftbranéufë;
La gonfle ^dégumen-^PÇéiiripééiédrpe oh\6^-ii^éuT&
coffes, & le s femences font attachées aiixdlmbes fir-
périeures de djacupe.; • \
Le fruit à nqya\\xdrßpk-> ^ q q f ii^ ç .^ à^ -g iilp e
charnue ç.ontenant un ftpyau^O u ;, r
La poi^_q-ô4/ndt à
charnue, ou fönt les graines, dans imë enveloppe
frfefrtb^an'eufé. : ' ;:d 0 > ^.oiî• -? snjs rp s r.r;I cO
■ Là baie ^ bàeca , a uhejpùipë fitccuferitç; qffî fénV
ferme lès fënlétiêéSV : - ‘'igtv '-.3
-Léc^Ônéi, -ߥobilitP<\ éfj?^êofùpôfé'^éëâjHéfî'étih^
tournées par le h a u t . j . -}-1y j ! 1 k'0 ol; aîiîtmup
.WA. amoT
PÉRICHONDRE, f. m. en Anatomie, membrane
qui recouvre les cartilages, & qui eft à leur égard
ce que le périofte eft aux os. Foye^ Périoste.
PÉRICHORES, je u x , ( Antiq. greeq.) les Grecs
donnoient ce nom aux jeux qui n’étoient ni facrés ni
périodiques., & dans lefquels les vainqueurs rece-
voient pour prix, non une fimple couronne, comme
dans les grands jeux, mais ou de l’argent ou quelque
choie d’équivalent : on donnoit des phioles d'argent
à Marathon, un bouclier d’airain dans lès jeux célébrés
à Argos en l’honneur de Junon. Dans les théo-
xéifies, le prix étoit une forte de robe appellée Icena.
Dans les taeées, les vainqueurs recevoient- des amphores
dé quelque métal ; en un mot toutes les ré-
eompenfés étoient lucratives, & par conféquent
ignobles : aufli ces jeux ne fe célébroient- que pour
c!çs habitans des villes 6c bourgs du voifinage,
comme l’indique le nom même ; car périchore veut
dire v01 f in , voifinage. (D . J. )
PÉRICLITER, v . n. ( Gram. ) être en péril: cette
affaire périclite entre fes mains : cet effet périclite.
PÉRICLYMENUM, f. m. (Hiß. nat. Bot.)genre
de plante à fleur monopétale, en forme de tuyau ,
profondément découpée , & foutenue par un calice,
qui devient dans la fuite un fruit mou, ou une baie
qui renferme une femence applat-ie & arrondie.
Tournefort, Infi, rei herb. Voye{ Plante.
Tournefort compte deux efpeces de ce genre de
plante, celle de Virginie toujours v e r te , & celle
des Indes à fleur jaune ; il faut y joindre celle du
Chily que nous allons décrire.
Lepériclymenum du-Chily s’élève en forme d?ar-
briffeau divifé en plufieurs bras , couverts d’une
écorce grife-brune : chaque, rameau finit par un bouquet
de fleurs , dont le nombre eft indéterminé,
tantôt pairs, tantôt non-pairs: chaque fleur eft un
tuyau, rouge-de-fang, rond, fermé par le bas, &
ouvert par le haut, découpé en quatre lobes juf-
ques vers fa partie moyenne : des parois internes de
la fleur fortent quatre étamines jaunes, enfilées par
un ftile plus long que ne font- les étamines ; la fleur
étant paffée, le calice -devient un fruit femblahle à
nos olives , en großem» & en couleur, revêtu d'une
peau fort mince. Il renferme une chair douçâtre,
blanche & gommeufe, & contient un noyau dur,
offeux : ori e-mploye cet arbriffeau pour teindre en
noir-les étoffes, qui ne-fe déchargent pas comme
celles d’Europe ; cette teinture fe fait en partie avec
de la-terre noire du pa ys, en partie a-veç ' le bois' de
cet^e plante-, brifé en petits morceaux : on fait bouillir
le tout enfemble dans de l’eau commune, jufqu’à
fuffifanje cuiflbn. ( D: J. )
^©RliERANE, f. tUi (Ânatôm.) n om que les Anatomiftes
donnent à une membrane folidè-ôi epaiffe
qui couvre le crâne par-dehors; Foyer C râne.
- Ce^mot eft formé des mots grecs <s«p/, autour, &
xpamv-y crâne. Quelques auteurs donnent à-eette mem-
branç le nom-général depéripfte , à caufe qu’elle eft
adhérente à l’os: d’autres la divifent en-' dëux membranes
; & ‘ils-appellent' péricrânt\ celle dés deux qui
enveloppe immédiatement le- crâne y de pérïofië èçllë
qui1 eft'plus extérieure. En effet; le pérïcrâm eft une
double membrane , compoféë comme beaucoup
d^aiïtrés V dé deux furiiqiies.1 0 n c ro it qu’il prend f'ori
origine de la dure^mere ,;qôi' pâflîifit à-thàvëfs le^
futures du oetyeàu fötme-cette membrânë épaiffë
par differen’s 'fllàifiëhS,c 'cë -qvfiîÿ a de’certain-, ç’éft
qu’on-: trouve que le pètitrdne eft"attaché':,>à, la durè^
inere par des fibres qui traverfent les futures'. ! \ '
Vèfè-Êô'ri'gine <desr if ii^ e s itéiR'poraiix/îësi dëux’tiv-
niquesi du p'éri'crâne fe partagent : Bextériëùre paffé
pài'^deffiüs cès mufçles ; & l’întérioure dëihéure top*
joffrs^dhërêntëdu-'cr^hëi ^çÿeç-BÉkiosTÉ*.'- v
; PÉJRIDOT, fi m-.J ' ( ^ f i . Jrth}aEkkolb$eïŸ<?ttt1Lt
nom eue -es jouailliers françois donnent A une pierre
preeieufe d’une couleur verdâtre, qui tire un peu
iur le jaune1. Quelques-uns ont cru que cette pierre
etoit le pmjius des anciens : d’autres, avec plus de
probabilité j orit conjeaurd que le pèridoc etoit la
chryfograppe. Quoi qu’il en foit, de ces fentimens
M. Lehmann, de l’araddmie de Berlin, à publie en
1755, un mémoire dans le recueil de cette académie
; il y ftit voir les erreurs, dés auteurs fur la pierre
que les anciens appelaient chrÿftprdft qu'ils ont
confondu a v e c . la chfyfôlité ;; le chryfoberilie, le
pmfitp ,'•# lepmfiùs,-l’émettnde-, tes topazes, &c.
Enfuïte il nous apprend avoir trouvé en Siléfie, près
u’tm village appelle Kofimiq, une pierre i qui il
prétend q;ue-convient te nom de chryfipràfe. Cette
pierre eft d’iin verd céladon ou verd potnifie ; elle
11’a que très-peu détranfparence’i: elle eft ordinairement
remplie de taches 'Manches qui nuifent à fa
pureté, & la- couleur en èft en général trouble. Au-
refte, cette piçrre prend un très-beau pffli & fe taillé
en facéttes. Cette pierre, que. M.Lehmann appelle
chryfîpràft fe trouve dans dés couches en mprceaux
détachés pu fragmen> , qui font ordinairement renfermés
dhns.de l’asbefte, qui leur fert d’enveloppe
où de matrice; & ces frâgmens font accompagnëside
pierres- d'un beau verd, un- peu tendres,. &'mêlées
d’une terre Verte : ccs pierres ne prennent point le
poli, /« Mémoires de l'académie de Berlin, an-
Tiêe i wm:,'pagi ^oH.
Il eft e e fiin que la pierre que M. Lehmann ap-
p A k cknyfipéife<elt d’une- conleiif verte très - agréab
le ; mais fon p.eu de tranfparence, & les, défauts
dênt elle eft'remplie i.l’émpIcliEroritd’ê tk eftimée
dés Jouailliers. (—)
PÉRIDRQME, f. m. ( Ardue, anc. ) c’eft, dans
une périptere, l’efpace, la galerie, l’allée qui régné
entre les colonnes & le mur. Les péridromes étoient
des promenades chez les Grecs. Foyer Saumaife fur
Solin. ( B . J . )
PERIÉGÈTE, f. m. (Antiq. grecq.) les periéghes
Thpinymai, étoient des miniftres du temple de D elphes.
C e terme doit être confervé, parce que le mot
^interprètem'exprime pas entièrement le mot grec;
le motdè guide ne l’exprime pas non-plus. Ces miniftres
étoient guides & interprètes tout enfemble. Ils
s’oeçupoient à promener les . étrangers par toute la
ville de Delphes , pour lès dëfennuyer du long fér
jour qu’ils étoient obligés d’y faire ; ils leurs mon-
troient les offrandes que la pieté des peuples y avoit
confacré; ils leurs apprenôient par qui telle ftatue,
tel tableau avoit été donné, quel en étoit l’artifte
dans quel tems & à quelle ôccafiori on l’aVoit envoyé
;■ enfin c etoient des geiis pleinement inftruits
de toiites les antiquités de la ville & du temple.
PER1ER , f. m. terme de Fondeur, c’eft un morceau
de fer emmanché au bout d’une.perche; on s’en fert
à ouvrir les fourneaux, pour faire couler le métal
lorftjùe les Fondeurs veulent'jetter quelques çu-vra-
ges en brôrizé-,( D. J. )
PERIGÉE, fi m. terme d’Afironomie, qui fignifie
le point de'fl^bite, du folèil^oü de la lune, ou ces
planètes font, le plus près dé la terre., ou en général
ië'p'oint dè;la plus petite diftance d’une planète à la
terre. Périgée eft oppofë^ j i apogée. F’oye^ K.pogÉe!
Foÿeçauffi PÉRIHÉLIE & APHÉLIE.
P É R I G O R D , ÉÉ', ( Gog. mod. ) proyincè de
France ; qui à au nord^ l’Ang'oumois, aù ïeyant la
Sajntôhg,e,;â l’ôrient d’hiver, elle toüche le Bafadois
& le BouMèlbis , Su midi elîe.a l’Agénois, à l’onenfi
d’été le Quercy &'lë Limofin.
8 Spn hbmVient 4e celui des anciens peuplés Petr.o-
coni oit Pétélmriij qiù’ô'n à'jÇQjrampü dans-,le, cip-
quieihë:JflëcflP'én Petricordii. Çes, peuples, qui lopt
dbhtiuS* (faÙ^'léV com'mëntâirés' de_ Céfâr, étoient