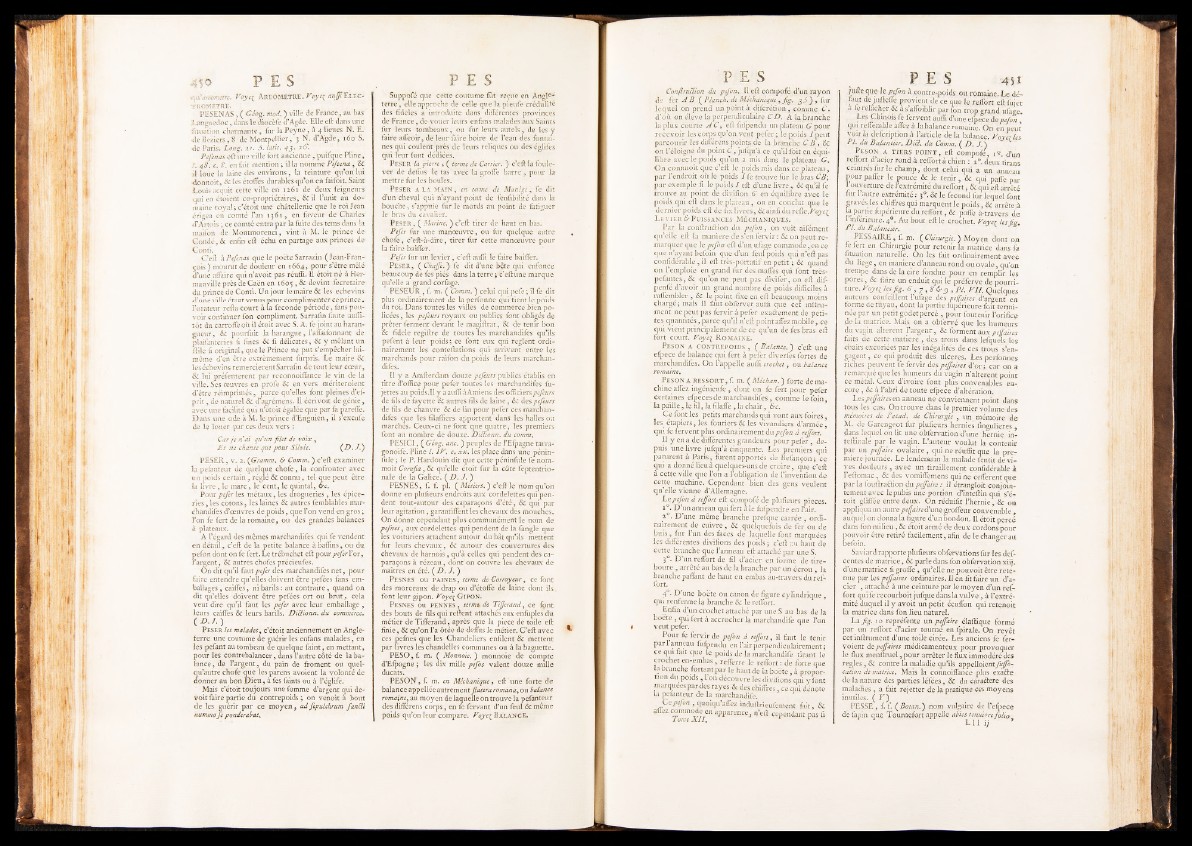
*m’aréomètre. Voyez AREOMETRE. Voyez auffi El e o
TROMETRE,
PESENAS , ( Géog. mod. ) ville de France, au bas
Languedoc, dans le diocèfe d’Agde. Elle eft dans une
fituation charmante, fur la Peyne, à 4 lieues N. E.
«le Beziers, 8 de Montpellier, 3 N. d’A'gde, 160 S.
«le Paris. Long. 21. 3. latit. 43- 2 G.
Pefenas eft une ville fort ancienne, puifque Pline.,
L 48. c. 8. en fait mention ; ilia nomme Pifcence, &
il loue la laine des environs, là teinture qu’on lui
•donnoit, & les étoffes durables qu’on en faifoit. Saint
Louis acquit cette ville en 1161 de deux feigneurs
qui en étoient co-propriétaires, & il l’unit au domaine
royal ; c’étoit une châtellenie que le roi Jean
érigea en comté l’an 1361, en faveur de Charles
d’Artois ; ce comté entra par la fuite des tems dans la
maifon de Montmorenci, vint à M. le prince de
Çondé, & enfin eft échu en partage aux princes de
Conti.
C’eft à Pefenas que le poète Sarrazin ( Jean-François
) mourut de douleur en 1664, pour s’être mêlé
d’une affaire qui n’avoit pas réufli. Il étoit né à Her-
manville près de Caën en 1605 , & devint fecretaire
du prince de Conti. Un jour le maire & les echevins
d’une ville étant venus pour complimenter ce prince,
l’orateur refta court à la fécondé période, fans pouvoir
continuer fon compliment. Sarrafin faute aufli-
îô t du carroffe oîi il étoit avec S. A. fe joint au harangueur
, 8c pourfuit la harangue, l’affaifonnant de
plaifanteries fi fines 8c fi délicates, & y mêlant un
ftile fi original, que le Prince ne put s’empêcher lui-
même d’en être extrêmement furpris. Le maire 8c
leséchevins remercièrent Sarrafin de tout leur coeur,
& lui préfenterent par reconnoiffance le vin de la
ville. Ses oeuvres en profe 8c en vers mériteroient
d’être réimprimés, parce qu’elles font pleines d’ef-
p r it , de naturel 8c d’agrémens. Il écrivoit de génie,
avec une facilité qui n’étoit égalée que par fa pareffe.
Dans une ode à M. le prince d’Enguien, il s’exeufe
de le louer par ces deux vers :
Car je 7? ai qu'un jilet de voix,
E t ne chante que pour Sdvic. (/?. J.')
PESER, v. a. (Gramm, & Comm. ) c’eft examiner
la pelanteur de quelque chofe, la confronter avec
un poids certain, réglé & connu, tel que peut être
la livre, le marc, le cent, le quintal, &c.
Pour pefer les métaux, les drogueries , les épiceries
, les cotons, les laines 8c autres femblables mar-
chandifes d’oeuvres de poids, que l’on vend en gros ;
l’on fe fert de la romaine, ou des grandes balances
à' plateaux!
A l’égard des mêmes marchandifes qui fe vendent
en détail, c’eft de la petite balance à bafîins, ou du
pefon dont on fe fert. Le trébuchet eft pour pefer l’or,
l’argent, 8c autres chofes précieufes.
On dit qu’il foui pefer des marchandifes net, pour
faire entendre qu’elles doivent être pefées fans emballages
, cailles, ni barils : au- contraire, quand on
dit qu’elles doivent être pefées ort ou brut, cela
veut dire qu’il faut les pefer avec leur emballage ,
leurs caifles 8c leurs barils. Diclionn. du commerce.
( - » • ' • ) ■ .
Peser les malades, c’étoit anciennement en Angleterre
une coutume de guérir les enfans malades, en
les pefant au tombeau de quelque faint, en mettant,
pour les contrebalancer, dans l’autre côté de la balance
, de l’argent, du pain de froment ou quel-
qu’autre chofe que les parens avoient la volonté de
donner au bon D ieu , à fes faints ou à l’églife.
Mais c’étoit toujours une fomme d’argent qui de-
voit faire partie du contrepoids ; on venoit a bout
de les guérir par ce moyen , ad fepulchrum fancli
numrno fe ponderabat.
Suppofé que cette coutume fut reçue en Angleterre
, elle approche de celle que la pieufe crédulité
des fideles a introduite dans différentes provinces
de France, de vouer leurs enfans malades aux Saints
fur leurs tombeaux, ou fur leurs autels, de les y
faire affeoir, de leur faire boire de l’eau des fontaines
qui coulent près de leurs reliques ou des églifes
qui leur font dédiées.
Peser la pierre , ( terme de Carrier. ) c’eft la foule-
ver de deflus le tas avec la groffe barre , pour la
mettre fur les boules.
Peser A LA main , en terme de Manège, fe dit
d’un cheval qui n’ayant point de fenfibilité dans la
bouche, s’appuie fur le mords au point de fatiguer
le bras du cavalier.
Peser , ( Marine. ) c’eft tirer de haut en bas.
Pefer fur une manoeuvre, ou fur quelque autre
chofe, c’eft-à-dire, tirer fur cette manoeuvre pour
la faire baifler.
Pefer fur un levier, c’eft aufli le faire baifler.
Peser, ( Ciiajfe. ) fe dit d’une bête qui enfonce
beaucoup de fes piés dans la terre ; c’eftune marque
qu’elle a grand corfage.
PESEU R , f. m. ( Comm. ) celui qui pefe ; il fe dit
plus ordinairement de la perfonne qui tient le poids
du roi. Dans toutes les villes de commerce bien policées
, les pefeurs royaux ovi publics font obligés de
prêter ferment devant le magiftrat, & de tenir bon
8c fidele regiftre de toutes les marchandifes qu’ils
pefent à leur poids ; ce font eux qui règlent ordinairement
les conteftations qui arrivent entre les
marchands pour raifon du poids de leurs marchandifes.
Il y a Amfterdam douze pefeurs publics établis en
titre d’office pour pefer toutes les marchandifes fu-
jettes au poids.il y a aufli àAmiens des officiers pefeurs
de fils de fayette 8c autres fils de laine, 8c des pefeurs
de fils de chanvre 8c de lin pour pefer ces marchandifes
que les filafliers apportent dans les halles oit
marches. Ceux-ci ne font que quatre, les premiers
font au nombre de douze. Diclionn. du comm.
PESICI, ( Géog. anc. ) peuples de l’Efpagne tarra-
gonoife. Pline l. IV. c. x x . les place dans une pénin-
ïiile ; le P. Hardouin dit que cette péninfule fe nom-
moit Corufia, 8c qu’elle etoit fur la côte feptentrio-
nale de la Galice. ( D . J. )
PESNES, f. f. pl. ( Métiers. ) c’eft le nom qu’on
donne en plufieurs endroits aux cordelettes qui pendent
tout-autour des caparaçons d’été, 8c qui par
leur agitation, garantiffent les chevaux des mouches.
On donne cependant plus communément le nom de
pefnes, aux cordelettes qui pendent de la fangle que
les voituriers attachent autour du bât qu’ils mettent
fur leurs chevaux, 8c autour des couvertures des
chevaux de harnois, qu’à celles qui pendent des caparaçons
à rézeau, dont on couvre les chevaux de
maîtres en été. (D . J . )
Pesnes ou P aines , terme de Corroyeur, ce font
des morceaux de drap ou d’étoffe de laine dont ils „
font leur gipon. Voyez Gipon.
Pesnes ou pennes, terme, de Tiferand, ce fpnt
des bouts de fils qui relient attachés aux enfuples du
métier de Tifferand, après que la piece de toile eft
finie, & qu’on l’a ôtée de deflus le métier. C ’eft avec
ces pefnes que les Chandeliers enfilent 8c mettent
par livres les chandelles communes ou à la baguette.
PESO, f. m. ( Monnaie. ) monnoie de compte
d’Efpagne ; les dix mille pefos valent douze mille
ducats.
PESON, f. m. en Méchanique, eft une forte de
balance appellée autrement datera romana, ou balance
romaine, au moyen de laquelle on trouve la pefanteur
des différens corps, en fe fervant d’un feul 8c même
poids qu’on leur compare. Voyez Balance.
P E S
Conflruclion du pefon. Il eft compofé d’un rayon
de fer A B ( PLanch. de Méchanique, fg . 3 3 ) , fur
lequel on prend un point à diferétion., comme C.
d’oii on éleve la perpendiculaire C D. A la branche
la plus courte A C , eft fufpendu un plateau G pour
recevoir les corps qu’on veut pefer ; lep^oids 1 peut
parcourir les différens point^ de la branche C B , 8c
on l’éloigne du point C , jufqu’à ce qu’il foit en équilibre
avec le poids qu’on a mis dans le plateau G.
On connnoît que c’eft le poids mis dans ce plateau,
par l’endroit oii le poids / fe trouve fur le bras CB-,
par exemple fi le poids 1 eft d’une livre, & qu’il fe
trouve au point de divifion G en équilibre avec le
poids qui eft dans le plateau ., on en conclut que le
dernier poids eft de fix livres , 8c ainfi du refte. Voyez
L e v i e r & P u i s s a n c e s M é c h a n i q u e s .
Par la conftruélion du pefon, on voit aifément
qu’elle eft la maniéré de s’en fervir : 8c on peut remarquer
que le pefon eft d’un ufage commode, en ce
que n’ayant befoin que d’un feul poids qui n’eft pas
confidérable, il eft très-portatif en petit ; 8c quand
on l’emploie en grand fur des maffes qui font très-
pefantes, & qu’on ne peut pas divifer, on eft dif-
penfé d’avoir un grand nombre de poids difficiles à
raffembler , & le point fixe en eft beaucoup moins
chargé; mais il fautobferver aufli que cet infiniment
ne peut pas fervir à pefer exactement de petites
quantités, parce qu’il n’eft point affezmobile, ce
qui vient principalement de ce qu’un de fes bras eft
fort court. Voyez R o m a i n e .
P e s o n a c o n t r e p o i d s ,. ( Balance. ) c’eft une
efpece de balance qui fert à pefer diverfes fortes de
marchandifes. On l’appelle aufli crochet, ou balance
romaine.
P e s o n a r e s s o r t , f. m. ( Méchan. ) forte de machine
affez ingénieufe , dont on fe fert pour pefer
certaines efpeces de marchandifes, comme le foin,
la paille, le fil, la filaffe,, la chair, &c.
Ce font les petits marchands qui yont aux foires,
les étapiers, les fouriers 8c les vivandiers d’armée,
qui fe fervent plus ordinairement du pefon à reffort.
Il y en a de différentes grandeurs pour pefer, depuis
une livre jufqu’à cinquante. Les premiers qui
parurent à Paris , furent apportés de Befançon ; ce
qui a donné lieu à quelques-uns de croire, que c’eft
à cette ville que l’on a l’obligation de l’invention de
cette machine. Cependant bien des gens veulent
qu’elle vienne d’Allemagne.
Le pefon à refort eft compofé de plufieurs pièces.
i° . D ’un anneau qui fert à le fufpendre en l’air.
20. D ’une même branche prefque carrée , ordinairement
de cuivre, 8c quelquefois de fer ou de
buis , fur l’un des faces de laquelle font marquées
les différentes divifions des poids ; c’eft p.u haut de
cette branche que l’anneau eft attaché par une S.
30. D ’un reffort de fil d’acier en forme de tire-
boure , arrêté au bas de la branche par un écrou, la
branche paffant de haut en embas au-travers du reffort.
4°. D ’une boëte ou canon de figure cylindrique ,
qui renferme la branche & le reffort.
Enfin d’un crochet attaché par une S au bas de la
boëte , qui fert à accrocher la marchandife que l’on
# veut pefer.
Pour fe fervir de pefon à refort, il faut le tenir
pari anneau fufpendu en l’air perpendiculairement;
ce qui fait que le poids de la marchandife tirant le
crochet en-embas , refferre le reffort : de forte que
la branche fortant par le haut de la boëte, à proportion
du poids , l’on découvre lés divifions qui y font
marquées par des rayes & des chiffres, ce qui dénote
la pefanteur de la marchandife.
Ce pefon , quoiqu’affez induftrieufement fait, &
affez commode en apparence, n’eft cependant pas fi 2 orne X I I , 1
F E S 451
jijfte que le pefon à contre-poids ou romaine. L e défaut
depifteffe provient de ce que le reffort eft fujet
a fe relâcher 8c às’affoiblir par ion trop grand ufage.
Les Chinois fe fervent aufli d’une efpece àepefon
qui reffemble affez à la balance romaine. On en peut
voir la defeription à l’article delà balance. Voye? les
PL du Balancier. Dicl. du Çorpm.f D . J.')
P eson a tiers p o in t , eft compofé, 1Q. d’un
reffort d’acier rond à.^reffort à chien : 20. deux tirans
ceintrés fur le champ, dont celui qui a un anneau
pour paffer le pouce & le tenir, 8c qui paffe par
1 ouverture de l’extrémité du reffort, 8c qui eft arrêté
fur l’autre extrémité : 3°. & le fécond fur lequel font
gravés les chiffres qui marquent le poids, 8c arrête à
la partie fupérieure du reffort, 8c paffe à-travers de
l’inférieure. 40. Au bout eft le crochet. Voyez les fis.
Pl. du Balancier.
. PESSAIRE , f. m. ( Chirurgie. ) Moyen dont on
fefert en Chirurgie pour retenir la matrice dans fa
fituation naturelle. On les fait ordinairement avec
du liege, en maniéré d’anneau rond ou ovale, qu’on
trempe dans de la cire fondue pour en remplir les
pores, 8c faire un enduit qui le préferve de pourriture.
Voyez Ush - <?,7 > 8 , PL VII. Quelques
auteurs confeillent l’ufage des pejfaires d’argent en
forme de tuyau, dont la partie fupérieure foit terminée
par un petit godet percé , pour foutenir l’orifice
de la matrice. Mais on a obfervé que les humeurs
du vagin altèrent l’argent, & forment aux pejfaires
faits de cette matière, des trous dans lefquels les
chairs excoriées par les inégalités de ces trous s’engagent
, ce qui produit des ulcérés. Les perfonnes
riches peuvent fe fervir des pejfaires d’or ; car on a
remarqué que les humeurs du vagin n’âlterent point
ce métal. Ceux d’ivoire font plus convenables encore
, 8c à l’abri de toute efpece d’altération.
Les pejfaires en anneau ne conviennent point dans
tous les cas. On trouve dans le premier volume des
mémoires de l'acad. de Chirurgie , un mémoire de
M. de Garengeot fur plufieurs hernies fingulieres ,
dans lequel on lit une obfervation d’une hernie in-
t eft in ale par le vagin. L’auteur voulut la contenir
par un pejfapre ovalaire , qui ne réuflit que la première
journée. Le lendemain la malade fentit de vives
douleurs , avec un tiraillement confidérable à
l’eftomac, 8c des vomiffemens qui ne cefferent que
par la fouftraûion du peffaire : il étrangloit conjointement
avec le pubis une portion d’inteftin qui s’é-
toit gliffée entre deux. On réduifit l’hernie, 8c on
appliqua un autre peffaire d’une groffeur convenable ,
auquel on donna la figure d’unbondon. Il étoit percé
dans fon milieu, & étoit armé de deux cordons pour
pouvoir être retiré facilement, afin de le changer ail
befoin.
Saviard rapporte plufieurs obfervationsfur les def-
centes de matrice, 8c parle dans fon obfervation xiij.
d’une matrice fi groffe , qu’elle ne pouvoit être retenue
par les pejfaires ordinaires. II en fit faire un d’acier
, attache à une ceinture par le moyen d’un reffort
quife recourboit jufquedansla v u lv e , à l’extrémité
duquel il y avoit un petit écuffon qui retenoit
la matrice dans fon lieu naturel.
La fg . 10 repréfente un peffaire élaftique formé
par un reffort d’acier tourne en fpirale. On revêt
cet infiniment d’une toile cirée. Les anciens fe fer-
voient de pejfaires médicamenteux pour provoquer
le flux menftruel, pour arrêter le flux immodéré des
réglés, 8c contre la maladie qu’ils appelaient fujfo-
cation de matrice. Mais la connoiffance plus exaâe
de la nature des parties léfées, ,8c du caraftere des
maladies , a fait rejetter de la pratique ces moyens
inutiles. ( Y')
PESSE , f. f. ( Botan. ) nom vulgaire de l’efpece
defapin que Tournefort appelle abies tenuiore folio
L 11