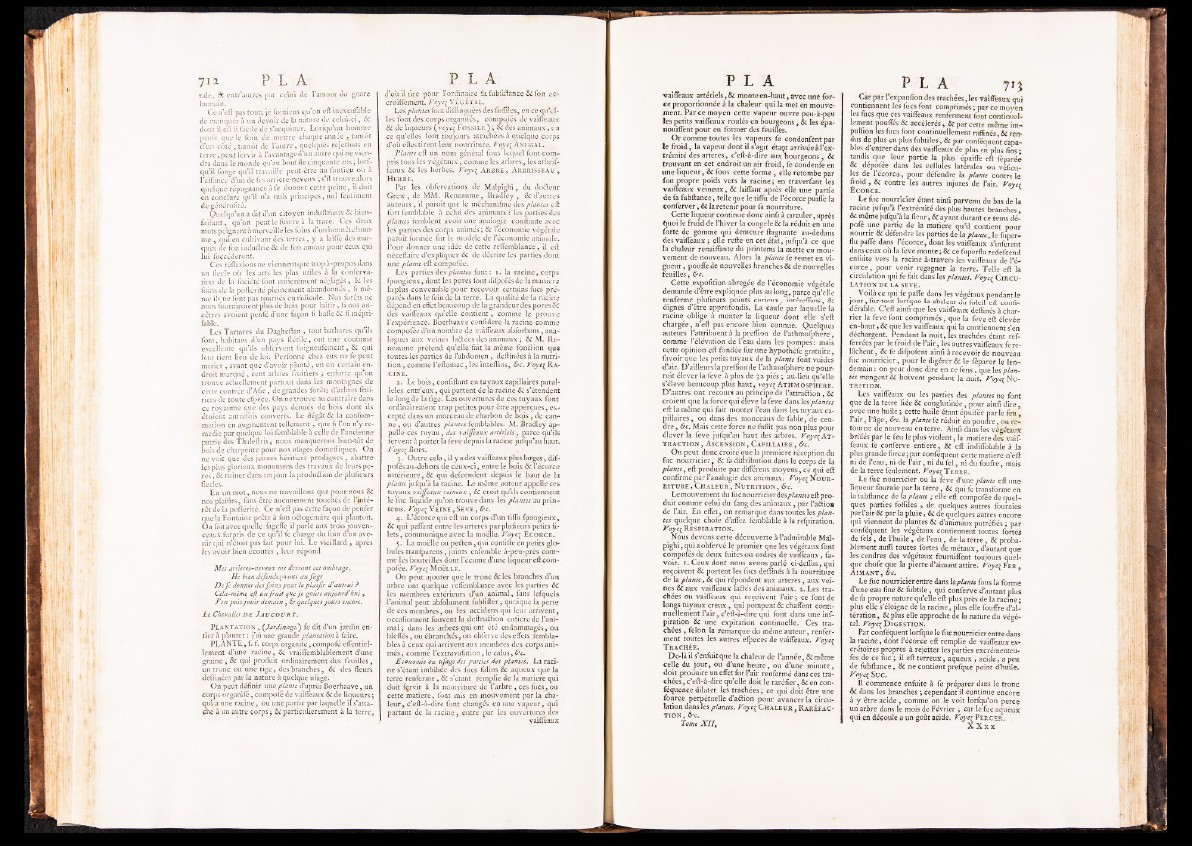
raie, 8c entr’autres par celui de l’amour du genre
humain.
Ce n’eft pas tout; je foutiens qu’on eft inexcufablc
de manquer à un devoir de la nature de celui-ci, 8c
dont il eft ft facile de s’acquitter. Lorsqu’un homme
penl'e que le foin de mettre chaque annee , tantôt
d’un côté , tantôt de l’autre, quelques rejcttons en
terre ,peut fervir à l’avantage d’un autre qui ne viendra
dans le monde qu’au bout de cinquante ans ; lorf-
qu’il fonge qu’il travaille peut-être au foutiea où à
l’aifance d’un de fes an iere-neveux ; s’ il trouve alors :
quelque répugnance àfe donner cette peine; il doit
en conclure qu’il n’a nuis principes, nul fentiment
de gcnérôfité.
Quelqu’un a dit d’un citoyen induftricux 8c bienfaisant,
qu’on peut le fuivre à la trace. Ces deux
mots peignent à merveille les foins d’un honnete homme
, qui en cultivant des terres , y a laiffe des marquas
de fon indüftrie 8c de fon amour pour ceux qui
lui fuccéderont.
Ces réflexions ne viennent que trop à-propos dans
un fiecle oîi les arts les plus utiles à la cônferya-
tion de la fociété font entièrement négligés , & les
foins de la poftérité pleinement abandonnés , fi même
ils ne font pas tournés en ridicule. Nos forêts ne
nous fourniroientplus de bois pour bâtir, fl nos ancêtres
avoient penfé d’une façon fl balte & fl mépri-
fable.
Les Tartares du Dagheftan , tout barbares qu’ils
font, habitans d’un pays ftérile, ont une coutume
excellente qu’ils obfervent foigneufement, 8c qui
leur tient lieu de loi. Perfonne chez eux ne fe peut
marier, avant que d’avoir planté, en un certain endroit
marqué , cent arbres fruitiers ; enforte qu’on
trouve aéluellement partout dans les montagnes de
cette contrée d’Afie, de grandes forêts d’arbres fruitiers
de toute efpece. On ne trouve au contraire dans
ce royaume que des pays dénués de bois dont ils
étoient autrefois couverts. Le dégât & la confom-
mation en augmentent tellement, que fl l’on n’y remédie
par quelque loi femblable à celle de l’ancienne
patrie des Thaleftris, nous manquerons bien-tôt de
bois de charpente pour nos ufages domeftiques. On
ne voit que des jeunes héritiers prodigues , abattre
les plus glorieux monumëns des travaux de leurs pe-
res, 8c ruiner dans un jour la produûion de plufieurs
fiecles.
En un mot, nous ne travaillons que pour nous 8c
nos plaifirs, fans être aucunement touchés de l’intérêt
de la poftérité. Ce n’eft pas cette façon de penfer
que la Fontaine prête à fon oûogénaire qui plantoit.
On fait avec quelle fageffe il parle aux trois jouvenceaux
furpris de ce qu’il fe charge du foin d’un avenir
qui n’étoit pas fait pour lui. Le vieillard , après
les avoir bien écoutés , leur répond
Mes arrieres-neveux me devront cet ombrage.
He bien défendez-vous au fage
De fe donner des foins pour le plaïjir cl autrui ?
Cela-même efl un fruit que je goûte aujourd'hui ,
T en puis jouir demain, & quelques jours encore.
Le Chevalier DE J AU COURT.
Plantation , ( Jardinage.) fe dit d’un .jardin entier
à planter : j’ai une grande plantation à faire.
PLANTE, f. f. corps organifé ,compofé effentiel-
lement d’une racine, 8c vraisemblablement d’une
graine, 8c qui produit ordinairement des feuilles,,
un tronc ou une tige, des branches, 8c des fleurs
deftinées par la nature à quelque ufage.
On peut définir une plante d’après Boerhaave, un
corps organifé, compofé de vaiffeaux 8c de liqueurs ;
qui a une racine, ou une partie par laquelle il s’attache
à un autre corps; & particulièrement à la terre,
d’où il tire pour l’ordinaire fa fubfiftance 8c fon ac*
croiffement. Voyez V égé tal.
Les plantes font diftinguées des foffiles, en ce qu’elles
font des corps organifés, compqfés de vaiffeaux
8c de liqueurs ( voyez Fossile ) ; & des animaux, en
ce qu’ elles font toujours attachées à quelque corps
d’où elles tirent leur nourriture. Voyez Animal.
Plante eft un nom général fous lequel font compris
tous les végétaux, comme les arbres, les arbrif-
î'eaux 8c les herbes. Voyez A r b r e , A rbrisseau ,
Herbe.
Par les obfervations de Malpighi, du do&euf
Grew, de MM. Reneaume, Bradley , & d’autres
auteurs , il paroît que le méchanifine des plantes eft
fort femblable à celui des animaux : les parties des
plantes femblent avoir une analogie confiante aveç
les parties des corps animés ; 8c l’économie végétale
paroît formée fur le modèle de l’économie animale..
Pour donner une idée de cette reffemblance, il eft
nécefl’aire d’expliquer 8c de décrire les parties dont
une plante eft compofée.
Les parties des plantes font : i . la racine, corps
fpongieux, dont les pores font difpofésde la maniera
la plus convenable pour recevoir certains fucs préparés
dans le fein de la terre. La qualité de la racine
dépend en effet beaucoup de la grandeur des pores ôç
des vaiffeaux qu’elle contient, comme le prouve
l’expérience. Boerhaave confidere la racine comme
compofée d’un nombre de vaiffeaux abforbans, analogues
aux veines laûées des animaux ; 8c M. Reneaume
prétend qu’elle fait la même fon&ion que
toutes les-parties de l’abdomen , deftinées à la nutrition
, comme l’eftomac, les inteftins, &c. Voyez R acine.
z. Le bois, confiftant en tuyaux capillaires parallèles
entr’eux, qui partent de la racine 8c s’étendent
le long dé la tige. Les ouvertures de ces tuyaux font
ordinairement trop, petites pour être apperçues, excepté
dans un morceau de charbon de bois, de canne
, ou d’autres plantes femblables. M. Bradley appelle
ces tuyau, des vaijfeaux artériels, parce qu’ils
fervent à porter la feve depuis la racine julqu’au haut.
. Voyez Bois. .
3. Outre cela, il y a des vaiffeaux plus larges, difi*
pofés an-dehors de ceux-ci, entre le bois & l’écorce
intérieure, 8c qui defeendent depuis le haut de la
plante jufqu’à la racine. Le même auteur appelle ces
tuyaux vaiffeaux veineux, 8c croit qu’ils contiennent
le fuc liquide qu’on trouve dans les plantes au prin-
tems. Voyez V ein e, Se v e , &c.
4. L’écorce qui eft un corps d’un tiffu fpongieux,
8c qui paffant entre les arteres par plufieurs petits filets,
communique avec la moelle. Voyez Ecorce.
5. La moelle ou peften, qui confifte en petits glo^
bules tranfparens, joints enfemble à-peu-près comme
les bouteilles dont l’écume d’une liqueur eft çom-
pofée. Voyez MoëLLE.
On peut ajouter que le tronc & le s branches d’un
arbre ont quelque reffemblance avec les parties 8c
les membres extérieurs d’un animal, fans lefquels
l’animal peut abfolument fubfifter, quoique la perte
de ces membres, ou les accidens qui leur arrivent,
occafionnent fouvent la deftru&ion entière de l’animal
; dans les arbres qui ont été endommagés, ou
bleffés ,.ou ébranchés, on obferve des effets lembla-
bles à ceux qui arrivent aux membres des corps animés
, comme l’extravafation, le calus, &ç.
Economie ou ufage des parties des plantes. La racine
s’étant imbibée des fucs falins 8c aqueux que la
terre renferme, 8c s’étant remplie de la matière qui
doit fervir à la nourriture de l’arbre , ces fucs, ou
cette matière, font mis en mouvement par la chaleur,
ç’eft-à-dire font changés en une vapeur, qui
partant de la racine, entre par les ouvertures des
vaifleaux
vaiffeaux artériels, & monte en-haut, avec une forc
e proportionnée à la chaleur qui la met en mouvement.
Par ce moyen cette vapeur ouvre peu-à-peu
les petits vaiffeaux roulés en bourgeons, 8c les epa-
nouiffent pour en former des feuilles.
O r comme toutes les vapeurs fe condenfent par
le froid , la vapeur dont il s’agit étant arrivée à l’extrémité
des arteres, c’eft-à-dire aux bourgeons , &
trouvant en cet endroit un air froid, fe condenfe en
une liqueur, & fous cette forme, elle retombe par
Ton propre poids vers la racine ; en traverfant les
vaiffeaux veineux, & laiffant après elle une partie
de fa fubftance, telle que le tiffu de l’écorce puiffe la
conferver, 8c la retenir pour fa nourriture.
Cette liqueur continue donc ainfi à circuler, après
quoi le froid de l’hiver la congele 8c la réduit en une
forte de gomme qui demeure ftagnante au-dedans
des vaiffeaux ; elle refte en cet état, jufqu’à ce que
la chaleur renaiffante du printems la mette en mouvement
de nouveau. Alors la plante fe remet en vigueur
, pouffe de nouvelles branches 8c de nouvelles
feuilles, &c.
Cette expofition abrégée de l’économie végétale
demande d’être expliquée plus au long, parce qu’elle
Tenferme plufieurs points curieux, intéreflàns, 8c
dignes d’être approfondis. La caufe par laquelle la
racine oblige à monter la liqueur dont elle s’ eft
chargée, n’eft pas encore bien connue. Quelques
auteurs [’attribuent à la preflion de l’athmofphere,
comme l’élévation de l’eau dans les pompes : mais
cette opinion eft fondée fur une hypothèfe gratuite,
favoir que les petits tuyaux de la plante font vuides
d’air. D ’ailleurs la preifionde l’athmofphere ne pourvoit
élever la lèye à plus de 32 pies ; au-lieu qu’elle
s’élève beaucoup plus haut, voyez A t h m o s p h e r e .
D ’autres ont recours au principe de l’attra&ion, 8c
croient que la force qui éleve la fe ve dans les plantes
eft la même qui fait monter l’eau dans les tuyaux capillaires,
ou dans des monceaux de fable, de cendre
, &c. Mais cette force ne fufiit pas non plus pour
élever la feve jufqu’au haut des arbres. Voyez A t t
r a c t io n , A s c e n s io n , C a p il l a ir e , &c.
On peut donc croire que la première réception du
fuc nourricier, 8c fa diftribution dans le corps de la
plante, eft produite par différens moyens, ce' qui eft
confirmé par l’analogie des animaux. Voyez N o u r r
i t u r e , C h a l e u r , N u t r i t io n , & c.
Le mouvement du fiuc nourricier Ats plantes eft produit
comme celui du fang des animaux, par l’aaioa
de l’air. En effet, on remarque dans toutes les plantes
quelque chofe d’affez femblable à la refpiration.
Voyez R e s p ir a t io n .
_ Nôus devons cette découverte à l’admirable Malpighi
, qui a obfervé le premier que les végétaux font
compolés de deux fuites ou ordrès de vaiffeaux, favoir.
1. Ceux dont nous avons parlé ci-deffus, qui
reçoivent 8c portent les fucs deftinés à la nourriture
de la plante , & qui répondent aux arteres, aux veines
& aux vaiffeaux laétcs des animaux. 2. Les trachées
ou vaiffeaux qui reçoivent l’air ; ce font de
longs tuyaux creux, qui pompent 8c chaffent continuellement
l’air , c’eft-à-aire qui font dans uneinf-
pirâtion 8c une expiration continuelle. Ces trachées
, félon la remarque du même auteur, renferment
toutes les aiitres efpeces de vaiffeaux. Voyez
T r a c h é e .
De-là il s’ enfuit que la chaleur de l’année, & même
celle du jour, ou d’une heure, ou d’une minute,
doit produire un effet fur l’air renfermé dans ces trachées,
c’eft-à-dire qu’elle doit le raréfier, 8c en con-
féquence dilater les trachées; ce qui doit être une
fource perpétuelle d’aûion pour avancer la circulation
dans les plantes. Voyez C h a l e u r , R a r é f a c t
io n , &c.
Tome X I I%
Car par l’expanfion des trachées,les vaiffeaux qui
contiennent les flics font comprimés ; par ce moyen
les fucs que ces vaiffeaux renferment font continuellement
pouffés 8c accélérés, & par cétte même im~
pulfion les fucs font continuellement raffinés 8c rendus
de plus en plus fubtiles, & par çonféquent capables
d’entrer dans des vaiffeaux de plus en plus fins ;
tandis que leur partie la plus épaiffe eft féparée
8c dépofée dans les cellules latérales ou véficu-
les de l’écorce, pour défendre la plante contre le
froid, 8c contre les autres injures de l’air. Voyez
Ecorce. v
Le fuc nourricier étant ainfi parvenu du bas de la
racine jufqu’à l’extrémité des plus hautes branches,
8c même jufqu’a la fleur, 8c ayant durant ce tems dé*
pofe une partie de la matière qu’il contient pour
nourrir 8c défendre les parties de la plante, le fuper-
flu paffe dans l’écorce, dont les vaiffeaux s’inferent
dans ceux où la feve monte ; 8c ce fuperflu redefeend
enfuite vers la racine à-travers les vaiffeaux de l’écorce
, pour venir regagner la terre. Telle eft la
circulation qui fe fait dans les plantes. Voyez C ir c u l
a t io n d e l a SEVE.
Voilà ce qui fe paffe dans les végétaux pendant le
jou r, fur-tout lorlqùe la chaleur du foleil eft confi-
dérabie. C ’eft ainfi que les vaiffeaux deftinés à charrier
la feve font çomprimés, que la feve eft élevée
en-haut, 8c que les vaiffeaux qui la contiennent s’en
déchargent. Pendant la nuit, les trachées étant ref-
ferrées par le froid de l’air, les autres vaiffeaux fe relâchent
, & fe difpofent ainfi à recevoir de nouveau
flic nourricier, pour le digérer 8c le féparer le lendemain
: on peut donc dire en ce fens , que les plantes
mangent boivent pendant la nuit. Voyez Nut
r i t io n .
Les vaiffeaux ou les parties des plantes ne font
que de la terre liée & conglutinée, pour ainfi dire,
avec une huile ; cette huile étant épuifée parle feu ,
l’air, l’âge, &c. la plante fe réduit en poudre, ou retourne
de nouveau en terre. Ainfi dans les végétaux
brûlés par le feu le plus violent, la matière des vaiffeaux
le conferve entière, 8c eft indiffoluble à la
plus grande force ; par co.nféquent cette matière n’eft:
ni de l’eau, ni de l’air, ni du fe l, ni du foufre, mais
de la terre feulement. Voyez T erre.
Le fuc nourricier ou la feve d’une plante eft une
liqueur fournie par la terre, & qui fe transforme en
la fubftance de la plante ; elle eft compofée de quelques
parties foffiles , de quelques autres fournies
par l’air 8c par la pluie, 8c de quelques autres encore
qui viennent de plantes & d’animaux putréfiés ; par
çonféquent les végétaux contiennent toutes fortes
de fels, de l’huile , de l’eau, de la terre, & probablement
auffi toutes fortes de métaux, d’autant que
les cendres des végétaux fourniffent toujours quelque
chofe que la pierre d’aimant attire. Voyez Fer ,
A im a n t , & c.
Le fuc nourricier entre dans h plante fous la forme
d’une eau fine & fubtile, qui conferve d’autant plus
de fa propre nature qu’elle eft plus près de la racine ;
plus elle s’éloigne de la racine, plus elle fouffre d’altération
, & plus elle approche de la nature du végétal.
Voyez D igestion.
Par çonféquent lorfque le fuc nourricier entre dans
la racine, dont l’écorce eft remplie de vaiffeaux excrétoires
propres à rejetter les parties excrémenteu-
fes de ce fuc ; il eft terreux, aqueux , acide, a peu
de fubftance, & ne contient prefque point d’huile.
Voyez Svc.
Il commence enfuite à fe préparer dans le tronc
8c dans les branches ; cependant il continue encore
à y être acide , comme on le voit lorfqu’on perce
un arbre dans le mois de Février ; car ie fuc aqueux
qui en découle a un goût acide. V oy ez Percer. .
X X x x