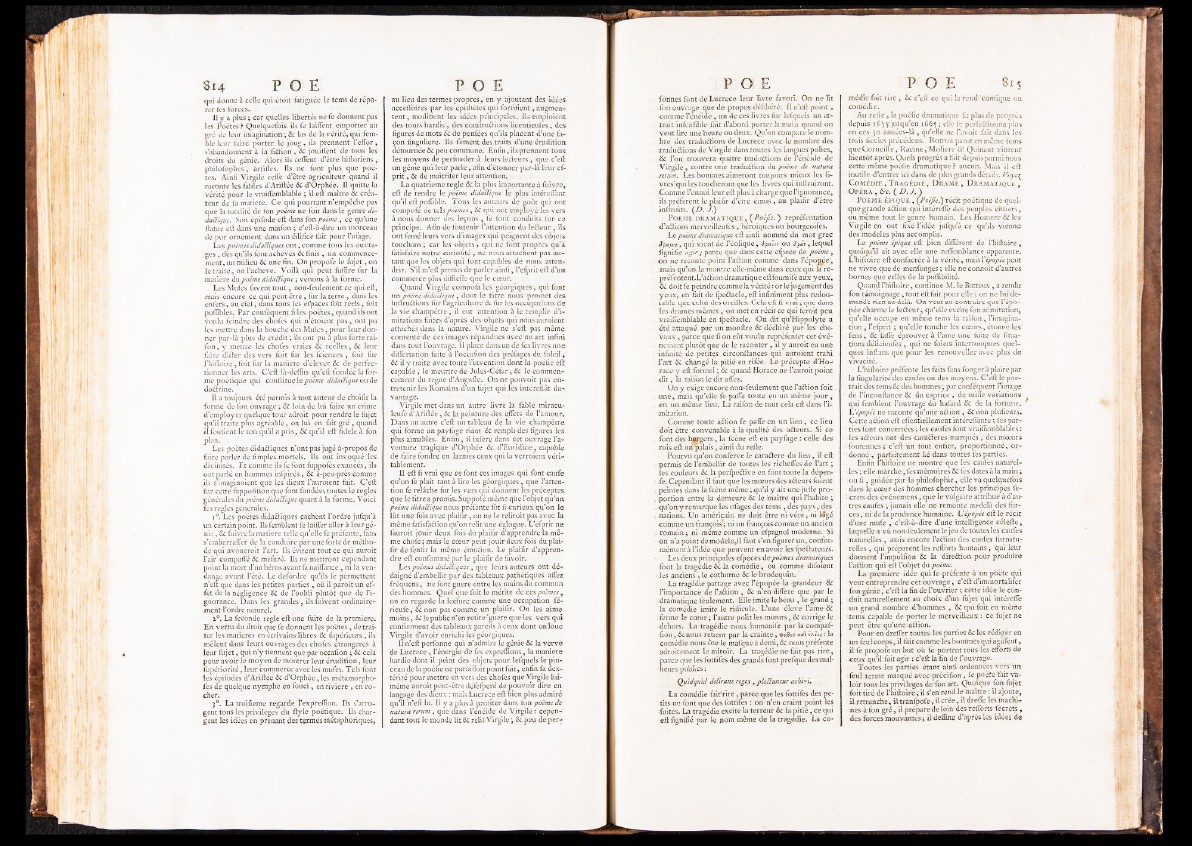
•qui donne à celle qui étoit fatiguée le tems de répare
r les forces.
il y a plus ; car quelles libertés ne fe donnent pas
les Poètes ? Quelquefois ils fe laiflènt emporter au
gré de leur imagination ; 6c las de la vérité, qui fem-
ble leur faire porter lé jou g, ils prennent l’effor ,
s’abandonnent à la fiâion , & jouiflent de tous les'
droits du génie. Alors ils ceffent d’être hiftoriens ,
pliilofophes, artiftes. Ils ne font plus que poètes.
Ainli Virgile celle d’être agriculteur quand il
raconte les fables d’Ariftée 6c d’Orphée'. Il quitte la
vérité pour le vraiflemblable ; -il eft maître 6c créateur
de fa matière. Ce qui pourtant n’empêche pas
que la totalité de fon poème ne foit dans le genre didactique.
Son épifode ell dans fon poème , ce qu’une
ftatue eft dans une maifon ; c’ eft-à-dire un morceau
de pur ornement dans Un édifice fait pour l’ufage.
Les poèmes didactiques ont, comme tous les ouvrages
, dès qu’ils font achevés & finis , un commencement,
un milieu 6c une fin. On propofe le fujet, on
le traite, on l’acheve. Voilà qui peut fuffire fur la'
matière du poème didactique ; venons à la forme.
Les Mufes favent tou t , non-feulement ce qui eft,
mais encore ce qui petit être, fur la terre, dans les
enfers, au ciel, dans toùs les efpaces foit réels, foit
poflibles. Par conféquent fi les poètes, quand ils ont
Ÿoulu feindre des chofes qui n’étoient pas , ont pu
les mettre dans la bouche des Mufes, pour leur donner
par-là plus de crédit ; ils ont pu à plus forte rai-
fon , y mettre les chofes vraies 6c réelles, 6c leur
faire diefer des vers foit fur les fciençes , foit fur
l’hiftoire, foit fur la maniéré d’élever 6c de perfectionner
les arts. C’eft là-deffus qu’eft fondée la forme
poétique qui conftitue le poème didactique ou de
doârine. .
Il a toujours été permis à tout auteur de choifir la
forme de fon ouvrage ; 6c loin de lui faire un crime
d’employer quelque tour adroit pour rendre le fujet
qu’il traite plus agréable, on lui en fait gré , quand
il foutient le ton qu’il a pris , 6c qu’il eft fidele à fon
plan.
Les poètes didactiques n’ont pas jugé à-propos de
faire parler de fimples mortels. Ils ont invoqué les
divinités. Et comme ils fe font fuppofés exaucés, ils
ont parlé en hommes infpirés, 6c à-peu-près comme
ils s’imaginoient que les dieux l’auroient fait. C ’eft
fur cette fuppofition que font fondées toutes le réglés
générales du poème didactique quant à la forme. Voici
les réglés générales.
i°. Les poètes didaétiques cachent l’ordre jufqu’à
un certain point. Ils femblent fe lâiffer aller à leur génie
, 6c fuivrela matière telle qu’elle fe préfente, fans-
s’embarraffer de la conduire par une forte de méthode
qui avoûëroit l’art. Ils évitent tout ce qui auroit
l’air compaffé & mefuré. Ils ne mettront cependant
point la mort d’un héros avant fa naiffance, ni la vendange
avant l’été. Le defordrê qu’ils fe permettent
n’ eft que dans les petites parties , où il paroît un ef- ■
fet de la négligence 6c de l’oubli plutôt que de l’ignorance.
Dans les grandes, ils fuivent ordinairement
l’ordre naturel.
2°. La fécondé réglé eft une fuite de la première.
En vertu du droit que fe donnent les poètes, de traiter
les matières en écrivains libres 6c fupérieurs , ils
mêlent dans leurs ouvrages des chofes étrangères à
leur fujet, qui n’y tiennent que par occafion ; 6c cela
pour avoir le moyen de montrer leur érudition, leur
îiipériorité, leur commerce avec les mufës. Tels font
les épifodes d’Ariftée 6c d’Orphée, les métamorpho-
fes de quelque nymphe en fouci, en riviere , en rocher.
3°. La troifieme regarde l’expreflion. Ils s’arrogent
tous les privilèges du ftyle poétique. Ils chargent
les idées en prenant dés termes métaphoriques,
au lieu des termes propres, en y: ajoutant dès idées'
accefloires par les épithètes qui fortifient ; augmentent
, modifient les.idées.principales. Ils emploient
des tours hardis , des conftructipns licentieufes, des
figures de mots 6c de penfées qu’ils, placent d’une façonfinguliere.
Ils fement des traits d’une érudition
détournée 6c peu commune. Enfin ,ils prennent tous
les moyens de perfuader à-leurs leâeurs , que c’eft
un génie qui leur parle, afin d’étonner par-là'leur ef-
p rit, & de maîtrilèr leur attention. 3
La quatrième réglé 6c la plus importante à fuivre,'
eft de rendre le poème didactique le plus int ère fiant
qu’il eft poflible. Tous les auteurs de goût qui ont
compofé de tels poèmes, 6c qui ont employé les vers
à nous donner des leçons , fe font*'conduits fur ce
principe. Afin de foutenir l’attention du leâeur , ils
ont femé leurs vers d’images qui peignent des objets
touchans ; car les objets , qui ne font propres qu’à
fatisfaire notre curiofité, ne nous attachent pas autant
que les objets-qui font capables‘de nous attendrir.
S’il m’eft permis de parler ainfi, l’efprit eft d’un-
commerce plus difficile que le coeur.
■ Quand Virgile compofales géorgiques, qui font
un poème didactique, dont le titre nous promet des
inftru&ions fur l’agriculture 6c fur les occupations de
la vie champêtre , il eut attention à le remplir d’imitations
faites d’après des objets qui nous auroient
attachés dans la nature. Virgile ne s’eft pas même
contenté de ces images répandues avec un art infini
dans tout l’ouvrage. Il place dans un de fes livres une
diflertation faite à l’occafion des préfages du foleil,
6c il y traite avec toute l’invention dont la poéfie eft
capable, le meurtre de Jules-Céfar, & le.commencement
du régné d’Augufte. On ne pouvoir pas entretenir
les Romains d’un fujet qui les intéreftât davantage.
Virgile met dans un autre livre la fable miracu-
leufe d’Ariftée, 6c la peinture des effets de l’amour.
Dans un autre c’eft un tableau de la vie champêtre
qui forme un payfage riant 6c rempli des figures les
plus aimables. Enfin, il inféré dans cet ouvrage l’aventure
tragique d’Orphée 6c d’Euridice, capable
de faire fondre en larmes ceux qui la verroient véritablement.
Il eft fi vrai que ce font ces images qui font caufe
qu’on fe plaît tant à lire les géorgiques, que l’atten-
' tion fe relâche fur les vers qui donnent les préceptes
que le titre a promis. Suppofé même que l’objet qu’un
poème didactique nous prefente fut fi curieux qu’on le
lût une fois avec plaifir, on ne le reliroit pas avec la
même fatisfaétion qu’on relit une églogue. L’efprit ne
fauroit jouir deux fois du plaifir d’apprendre la même
chofe ; mais le coeur peut jouir deux fois du plaifir
de fentir la même émotion. Le plaifir d’apprendre
eft confommé par le plaifir de lavoir.
Les poèmes didactiques , que leurs auteurs ont dédaigné
d’embellir par des tableaux pathétiques affez
fréquens, ne font guere entre les mains du commun
des hommes. Quel que foit le mérite de ces poèmes ,
on en regarde la leâure comme une occupation fé-
rieufe, & non pas comme un plaifir. On les aime
moins, 6c le public n’en retire 'guere que les vers qui
contiennent des tableaux pareils à ceux dont on loue
Virgile d’avoir enrichi les géorgiquess ' ■ .
Il n’eft perfonne qui n’admire le génie 6c la verve
de Lucrèce , l’énergie de fes expremons, la maniéré
hardie dont il peint des objets pour lefquels le pinceau
de la poéfie ne paroifloit point fait, enfin fa dextérité
pour mettre en vers des chofes que Virgile lui-
même auroit peut-être défefperé de pouvoir dire en
langage des dieux : mais Lucrèce eft bien plus admiré
qu’il n’eft lu. Il y a plus à profiter dans fon poème de
natura rerum , que dans l’enéide de Virgile : cependant
tout le monde lit 6c relit Virgile ; 6c peu de performes,
font de Lucrèce leur, livre favori: On ne lit
l'on ouvrage que de propos délibéré. Il n’eft point,
comme l’énéid'e , un de ces livres fur lefquels un attrait
infenfible fait d’abord porter la main quand on
veut lire une heure ou.deux. Qu’on compare le nombre
des traductions de Lucrèce avec le nombre des
iraduétions de. Virgile dans toutes les langues polies,
&C l’on. trouvera quatre traductions de l’énéide de
Virgile , contre une traduction du poème de natura
rerum„ Les hommes aimeront toujours mieux les li-
vresjjqui les toucheront que les livres qui inftruiront.
Comme l’ennui leur eft plus à charge quel’ignorance,
ils préfèrent le plaifir d’être i émus , au plaifir d’être
inftruits. (Z>. /.)
Po em e d r a m a t iq u e , ( Poéjie.) repréfentation
d’aCtions merveilleufes, héroïques ou bourgeoifes.
Le poème dramatique eft ainfi nommé du mot grec
S'pctfj.ct, qui vient de l’éolique, S'pdiiv ou -<fy«V, lequel
lignifie agir ; parce que dans cette efpece de poème,
on ne raconte point l’aCtion comme dans l’épopée,
mais qu’on, la montre elle-même dans ceux qui la re-
préfentent.L’aCtion dramatique eftfoumife aux yeux,
&c doitfe peindre comme la vérité : or le jugement des
y eux, en fait de fpeCtacle, eft infiniment plus redoutable
que. celui des oreilles. Cela eft fi v rai, que dans
les drames mêmes, on met en récit ce qui feroit peu
vraiffemblable en fpeCtacle. On dit qu’Hippolyte a
été attaqué par un.monftre& déchiré paroles chevaux
, parce que fton eût voulu repréfenter cet événement
plutôt que de le raconter, il y auroit eu une
infinité de petites circonftances qui auroient trahi
l’art 6c changé la pitié en rifée. Le précepte d’Horace
y eft formel ; 6c quand Horace ne l’auroit point
d i t , la raifon le dit affez.
On y exige encore non-feulement que l’aCtion f o i t .
une, mais, qu’elle fe paffe toute en un même jou r,
en un.même lieu: La raifon de tout cela eft dans l’imitation.
Comme toute aCtion fe paffe en un lien , ce lieu
doit être convenable à .la qualité des aCteursJ Si ce
font des l é g e r s , la foène eft en payfage : celle des
rois eft unpalais, ainfi du refte.
Pourvu qu’on conferve le caraCtere du lieu , il eft
. permis de l’embellir de toutes les richeffes de l’art ;
les couleurs 6c la perfpeCtive en font toute la dépen-
; fe. Cependant il faut que les moeurs des aCteurs foient
, peintes dans la fcène même ; qu’il y ait une jufte proportion
entre la demeure 6c le maître qui l’habite ;
. qu’on'yremarque les ufages des-tems , des p ays,1 des
. nations.- Un américain, ne doit être ni vêtu, ni logé
. comme un françois ; ni un françois comme un ancien
. romain ; ni. même comme un-efpagnol moderne. -Si
- on n’a point demodele,il faut s’en figurer un, conformément
à l’idée que peuvent en avoir les fpeôateurs.
. Les; deux principales efpeces de poèmes dramatiques
. font-la. tragédie'& la comédie, ou comme difoient
i les anciens , le cothurne 6c le brodequin.
La tragédie partage avec l’épopée^ la -grandeur !&
l’importance de l’aftio'n ,. &: n’en différé que par le
dramatique feulement. Elle imite le beau , le grand;
la comédie imite le-ridicule, iL’une-éleve l’amc &
j ferme le coeur ; l’autre polit les moeurs, & corrige le
dehors. La tragédie nous • humanife par la' compaf-
-fion nous retient par la crainte, *<£i ixioç lia
-comédie-nous ôte le mafque à demi, & nouspréfente
adroitement le miroir. La tragédie-ne’fait pas rire,
parce que les fottifes des grands font prefque des-raal-
-heurs publics:
Quidqpid délirant reges., plecluntur achi yi. ■
-La comédie faifrire , -parce que les fottifes des petits
ne font que des -fottifes : on m’en craint point les
•fuites.La tragédie excite la terreur & la p itié, ce qui
eft fignifié par le nom même de la tragédie. La comédîe
fait rire , 6c c’eft ce qui la rend'Comique ou
comédie.
Au refte, la poéfie dramatique fit plus de progrès
depuis 1635 julqu’en 1665 ; elle 1e perfectionna plus
en ces 30 années-là, qu’elle ne l’avoit fait dans les
trois fiecles précédens. R otrou parut en même tems
que Corneille, Racine, Molière 6t. Quinaut vinrent
bientôt après. Quels progrès a fait depuis parmi nous
cette même poéfie dramatique ? aucun. Mais' il eft
inutile d’entrer ici dans de plus grands détails. Voyeq_
C o m é d ie , T r a g é d ie , D r a m e , D r a m a t iq u e ,
O p é r a , &c. ( D . J. )
Po em e é p iq u e , ( Poéjîeè) récit poétique de quelque
grande action quiintéreffe des peuples entiers,
ou même tout le genre humain. Les Homere 6C les
Virgile en ont fixé l’idée jufqu’à ce qu’ils vienne
des modèles plus accomplis.
Le poème épique eft bien différent de l’hiftoire ,
quoiqu’il ait avec elle une reffemblance apparente.
L’hiftoire eft confacrée à la vérité, mais ¥ épopée peut
ne vivre que de menfonges ; elle ne conmoît d’autres
bornes que celles de la pofliDilité.
Quand l’hiftoire, continue M. le Bafféux, a rendu
fon témoignage , tout eft fait pour elle ;"on nelitide-
mand e rien au-delà. On veut au contraire que* l’épopée
charme le leûeur, qu’elle excite fon admiration,
qu’elle occupe en même tems la raifon , l’imagination
, l’efp rit ; qu’elle touche les coeurs, étonne les
fens j & ■ fiiffe ■ éprouver à l’ame une fuite de filiations
délicieufes , qui ne foient interrompues quelques
inftans que pour les renouveller avec plus de
•vivacité.
- L’hiftoire préfente les faits fans fonger à plaire par
la fingularité des caufes ou des moyens. C’eft le por- .
trait des tems 6c dés hommes-; par conféquent l’image
de l’inconftancé & du caprice , de milFè variations
qui femblent l’ouvrage du hafard & de la fortune.
L,’épopée ne raconte qu’une' àftion , 6c non pluiieilrs.
Cette aftion eft effentiellement intéreffante ; fes parties
font concertées ; les caufes font vraiffëmblâbles:
-les aéleurs ont des çara&eres marqués ,'!des moeurs
foutenues ; c’eft un tout entier, proportionné, ordonné
, • parfaitement-lié dans toutes fes parties.
Enfin l’hiftoire ne montre1 que les' caufes naturelles
; elle marche, fes mémoires 6c fes dates à'ia main ;
oit fi , guidée par la philofopHie, elle va quelquefois
dans le coeur des hommes chércher lès principes fe-
crets des événemens, -que lé viilgaire attribue' à d’au-
tres caufes ; jamais elle nè remonte âitdelà des fbr-
•ces, ni de la prudence humaine. L'épopée ëft le récit
d’une mufe , c’ëft-à-dire d’üne intélligence célèfte,
laquelle a vû-non-feulémentle jeu de toutes les caitfes
■ naturelles, mais encore EaêtiOn dès' caufes fürnatu-
relles , qui préparent lès rèfforts humains, ! qui leur
donnent l’impulfion & la 'difëâion-pOùr produire
l’aétion qui eft l’objet du poème.
- La:première idée qui :fe^préfente,â'''iin poète qui
veut entreprendre cet ouvrage, c’èft d’immortalifer
•fon- génie, c’éft la fin de l’ouvrier; cette idée’le conduit
naturellement au choix d’tin fujet qui intérèffe
un grand nombre 'd’homîiies , & qiü foit en'rnême
:tems capable de porter le: merveillëüx : Ce fujet ne
peut être qu’une aftion.
•Pour endreffer toutes les parties 6c les rédiger en
un-feu! corps, il feit commélëshom'mès qufa'gifféht,
i l fe, propofe-un; but où fe ;portent tôûs les efforts de
:.ceux'qu?ibfait agir- : *c’eft la fitn de l’oitvragè.
Toutes les:parties étant ainfi ordorinées vers un
:feul terme marqué avec:p'récifion-, le poète-fait valoir
tous les privilèges de'fbn att. Quoique fon fujet
foit-tiré de rhiftoîre , i l s’eti rend le'mâîfre : il ajoute,
iLretranche, i l îr anfpofe, if crée, il' dréffe les machines
à fon gré, il prépare de loin "des réffOfts fécrëts ,
des forces mouvantes-; ildëflîne d’après lësideës de