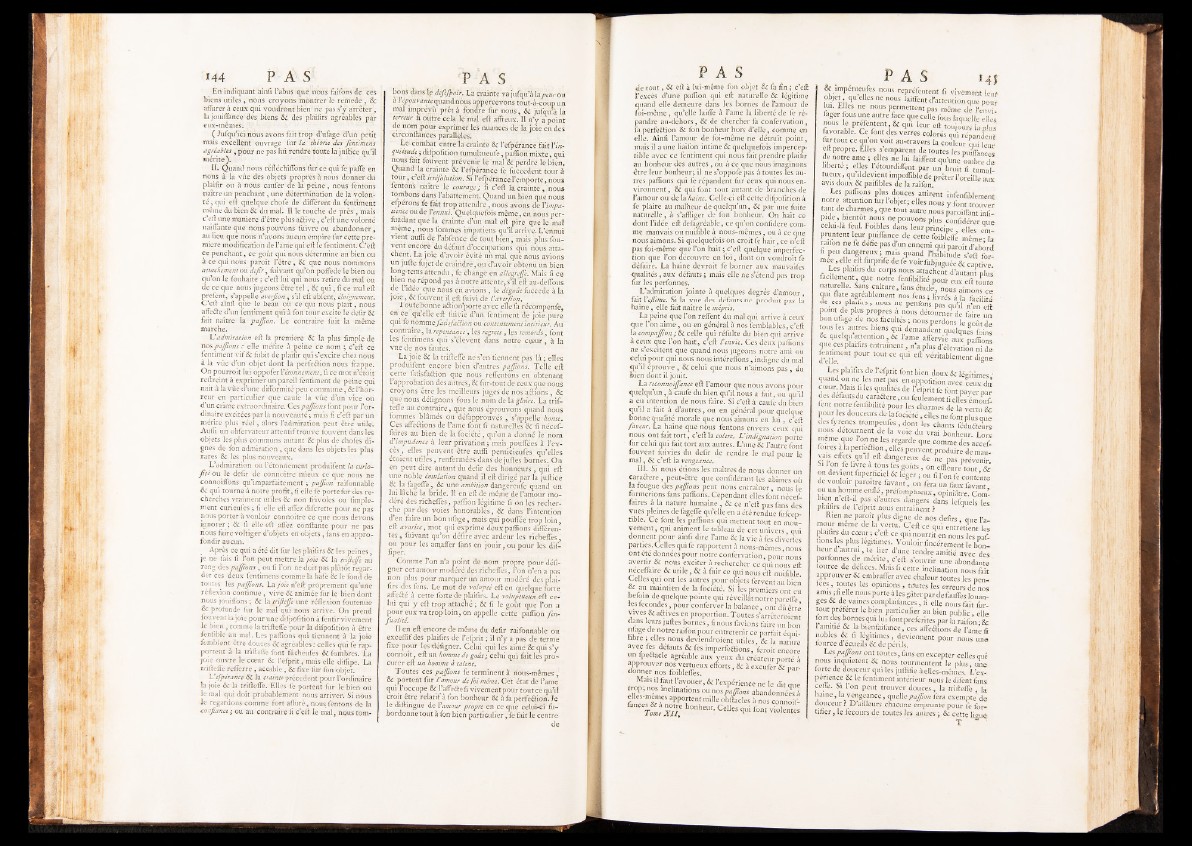
En indiquant ‘ainfi l’abus que nous faifons de ces
biens utiles , noùs croyons montrer le remede , &
affurer à ceux qui voudront bien-ne pas s’y arrêter ,
la jouiffance' des. biens 6c des plailirs agréables par
eux-mêmes;
( Jufqu’ici nous avons fait trop d’ufage d’un petit
mais excellent ouvrage fur la théorie des fentimens
agréables pour ne pas lui rendre foute lajuftice qu’il
mérite).
II. Quand nous réfléchiffons fiir ce quffe paffe en
nous à là vue des objets propresû nous donner du
plaifir ou à nous caufer dé la peine, nous fentons
naître un penchant, une détermination de la volonté
, qui eft quelque chofe de différent du fentiment
même du bien 6c du mal. Il le touche de près , mais
c’eft une maniéré d’être plus a&ive , c’ eft une volonté
naiffante que nous pouvons fuivre ou abandonner ,
au lieu que nous n’avons aucun empire fur cette première
modification de l’ame qui eft le fentiment. C’eft
ce penchant, ce goût qui nous détermine au bien ou
a ce qui nous paroît l’êtré , 6c que nous nommons
attachement où defir, fuivant qu’on poffede le bien ou
qu’on le fouhaite ; c’eft lui qui nous retire du mal ou
de ce que nous jugeons être t e l , 6c q ui, fi ce mal eft
prefent, s’appelle averjion, s’il eft ablent, éloignement.
C ’eft ainfi que le beau où ce qui nous plaît, nous
affefte d: 'un fentiment qui à fon tour excite le defir 6c
fait naître la pajjîon. Le contraire fuit la même
marche.
L’admiration eft la première Sc la plus fimple de
nos paffîons : elle mérite à peine ce nom ; c’eft ce
fentiment v if & fubit de plaifir qui s’excite chez nous
à la vue d’un objet dont la perfeftion nous frappe.
On pourroit lui oppofer V étonnement, fi ce mot n’étoit
reftreint à exprimer un pareil fentiment de peine qui
nait à la vue d’une difformité peu commune, & l’horreur
en particulier que caufe la vue d’un vice ou
d’un crime extraordinaire. Ces paffions font pour l’ordinaire
excitées par la nouveauté ; mais fi c’éft par un
mérite plus ré e l, alors l’admiration peut être utile.
Auffi un obfervateur attentif trouve fouvent dans les
objets les plus communs autant & plus de chofes dignes
de fon admiration , que dans les objets les plus
rares 6c les plus nouveaux.
L’admiration ou l’étonnement produifent la curio-
Jité ou lè defir de connoître mieux ce que nous ne
connoiffons qu’imparfaitement ; paffion raifonnable
& qui tourne à notre profit, fi elle fe porte fur des recherches
vraiment utiles & non frivoles ou Amplement
curieufes ; fi elle eft affez difcrette pour ne pas
nous porter à vouloir connoitre ce que nous devons
ignorer ; 6c fi elle eft affez confiante pour ne pas
nous faire voltiger d’objets en objets, fans en approfondir
aucun. - -
Après ce qui a été dit fur les plaifirs & les peines,
je ne fais fi l’on peut mettre là joie 6c la trifiejfe au
rang des pajjîons , ou fi l’on ne doit pas plutôt regarder
ces deux fentimens comme la bafe 6c le fond de
toutes les pajjîons. La joie n’eft proprement qu’ une
réflexion continue , vive 6c animée fur le bien dont
nous jouiflons ; 6c la trifieffe une réflexion foutenue
6c profonde fur le mal qui nous arrive. On prend
fouvent la joie pour une difpofition à fentir vivement
le bien, comme la trifteffe pour la difpofition à être
fenfible au mal. Les pallions qui tiennent à la joie
femblent être douces 6c agréables : celles qui fe rapportent
à la trifteffe font fâcheufes & fombres. La
joie ouvre le coeur 6c l’êfprit, mais elle diflipe. La
trifteffe relferre , accable , 6c fixe fur fon objet.
Vefpérance 6c la crainte précèdent pour l’ordinaire
la joie & la trifteffe. Elles fe portent fur le bien ou
le mal qui doit probablement noùs arriver. Si nous
le regardons comme fort aflùré, nous fentons de la
confiance; ou au contraire fi c’eftde mal, noustombons
dans 1g defefpoir.'La. crainte va jufqu’àla/w/rou
a Vepouvantequand nous appercevons tout-à-coup un
mal imprévu prêt à fondre fur nous, 6c jufqu’à la
terreur li Ôtftrè cela le mal eft affreux. Il n’y a point
dë nom .pour exprimér les nuancés de la joie en des
circo'nftàrïcès parallèles:
Le- combat entfèià crainte 6c refpérancë fait Vin-
quiétude ; difpofition tumultueufe, paffion mixte,, qui
nous fait foxtvent prévenir le mal & perdre le bien.
QuàndAa crainte 6c l’êfpérance fe fuccedent tour à
tour, c’eftirréfolutioniSi l’ëfpérancel’emporte,nous
*ent? ns na*tre le courage ; li c’eft la crainte , ! nous
tombons dans l’abattement. Quand un bien que nous
elperons fe fait trop attendre, nous avons de Vimpa-
tience. ou de Vennui. Quelquefois même, en nous per-
fuadant que la crainte d’un mal eft pirè que le mal
meme, nousfommes impatiens qu’il arrive, L’ennui
vient auffi de l’abfèçce de fout bien, mais plus fouvent
encore du défaut d’occupations qui nous attachent.
La joie d’avoir évité un mal que nous avions
un jufte fujet de craindre, ou d’avoir obtenu un bien
long-tems attendu, fe change en allegreffe. Mais fi ce
j*en;.n® r^Pond pas à notre attente, s’il eft au-deffous
de l’idée que nous en avions, le dégoût fuccede à la
jo ie , ,6c fouvent il eft fiiiyi de" V averjion.
Toutebonne attion’porte avec elle fa récompenfe,
en ce qù’elle eft fuivie d’un fentiment de joie pure
quiffe nommeJatisj,action oivcontentement intérieur. Au
contraire, la repentance, les regrets , lçs remords, font
les fentimens qui s’élèvent dans notre coeur, à la
vue de nos fautes.
La joie & la trifteffe ne s’en tiennent pas 'là ; elles
produifent encore bien d’autres paffions. Telle eft
cette fatisfaciion que nous reffentons en obtenant
> f approbation des autres, & fiir-tout de ceux que nous
croyons être les meilleurs juges de nos affions , 6c
que nous défignons fous le nom de la gloire. La trif-
teffe au contraire, que nous éprouvons quand nous
fommes blâmés ou défapprouvés , s’appelle honte.
Ces affeftions de l’àme font fi naturelles 6c fi nécefi-
faires au bien de la fociété, qu’on a donné le nom
6Vimpudence à leur privation ; mais pouflees à l’excès,
elles peuvent être auffi perniçieufes. qu’elles
étoient utiles, renfermées dans de juftes bornes. On
en peut dire autant du defir des honneurs , qui eft
une noble émulation quand il eft dirigé par la juftice
6c la fageffe, 6c une ambition dangereùfe quand on
lui lâche la bride. Il en eft de même de l’amour modéré
des richeffes, paffion légitime fi on les recherche
par des voies honorables, & dans l’intention
d’en faire un bon ufage, mais qui pouflee trop loin,
eft avarice, mot qui exprime deux paffions différent
te s , fuivant qu’on défire avec ardeur les richeffes,
ou pour les an^affer fans en jouir, ou pour les dif-
fiper.
Comme l’on n’a point de nom propre pour défi-
gner cet amour modéré des richeffes, l’on n’eh a pas
non plus pour marquer un amour modéré despîai-
firs des fens. Le mot de volupté eft en quelque lorte
affeéle à cette forte de plaifirs. Le voluptueux eft ce»
i lui qui y eft trop attaché ; & fi le goût que l’on a
pour eux v a trop loin, on appelle çette paffion fen-
fualité.
Il en eft encore de même du defir raifonnable ou
exceffif des plaifirs de l’efprit ; il n’y a pas de terme
fixe pour les défigner. Celui qui les aime & qui s’y
connoît, eft un homme de goût; celui qui fait lès procurer
eft un homme à talent.
Toutes ces pajjîons fe terminent à nous-mêmes,
6c portent fiir l amour de foi même. Cèt état dê l’ame
qui l’occupe & l’affefte fi vivement pour tout ce qu’il
croit être relatif à fon bonheur 6c à fa përfeûion. Jè
le diftingue de Vamour propre en ce que celui-ci fu-
bordônne tout à fon bien particulier, fe fait le centre
de
de tout, & eft à lui-même fon objet 6c fa fin ; c’eft
l’excès d’une paffion qui eft naturelle 6c légitime
quand elle demeure dans les bornes de l’amour de
loi-même, qu’elle laiffe à l’ame la liberté dé fe répandre
au-dehors, & de chercher fa confefvation,
la perfeélion 6c fon bonheur hors d’elle, comme en
elle. Ainfi l’amour de foi-même ne détruit point,
mais il a une liaifon intime 6c quelquefois imperceptible
avec ce fentiment qui nous fait prendre plaifir
au bonheur des autres , ou à Ce que nous imaginons
etre leur bonheur; il ne s’oppofé pas à toutes les autres
paffions qui fe répandent fur ceux qui nous environnent
, 6c qui font tout autant de branches de
l ’amour ou de la haine. Celle-ci eft cette difpofition à
fe plaire au malheur de quelqu’un, 6c par une fuite
naturelle ., à s’affliger de fon bonheur. On hait ce
dont l’idée eft defagréable, ce qu’on confidere com-'
me mauvais ou nuifible à nous-mêmes, ou à ce que
nous aimons. Si quelquefois oij croit fe haïr, ce n’eft
pas foi-même que l’on hait ; c’eft quelque imperfection
que l’on découvre en fo i, dont on voudroit fe
défaire. La haine devroit fe borner aux mauvaifes
qualités, aux défauts ; mais elle ne s’étend pas trop
fur les perfonnes.
L’admiration jointe à quelques degrés d’amour,
fait Veflime. Si la vue des défauts ne produit pas la
haine, elle fait naître le mépris.
La peine que l’on reffent du mal qui arrive à ceux
que l’on aime, ou en général à nos femblables, c’eft
la contpajjîon; 6c celle qui réfulte du bien qui arrive
à ceux que l’on hait, c’eft Ü envie. Ces dèux paffions
ne s’excitent que quand nous jugeons notre ami ou
celui pour qui nous nous intéreflons, indigne du mal
qu’il éprouve , 6c celui que nous n’aimons pas, du \
bien dont il jouit.
La reconnoijfance eft l’amour que nous avons pour
quelqu’un , f f caufe du bien qu’il nous a fait,.ou qu’il
a eu intention de nous faire. Si c’eft à caufe du bien
qu’il a fait à d’autres, ou en général pour quelque
bonne qualité morale que nous aimons en lu i , c’eft
faveur. La haine que nous fentons envers ceux qui
nous ont fait tort, c’eft la colere. L'indignation porte
fur celui qui fait tort aux autres. L’une 6c l’autre font
fouvent fuivies du defir de rendre le mal pour le
mal, & c’eft la vengeance.
III. Si nous étions les maîtres de nous donner un
cara&ere , peut-être que confidérant les abîmes où
la fougue des pajjîons peut nous entraîner, nous le
formerions fans paffions. Cependant elles font nécef-
fàires à la nature humaine , 6c ce n’eft pas fans des
vues pleines de fageffe qu’elle en a été rendue fufeep-
fable. Ce font les paffions qui mettent tout en mouvement,
qui animent le tableau de cet univers, qui
donnent pour ainfi dire l’ame & la vie àfes diverlès
parties. Celles qui fe rapportent à nous-mêmes, nous
ont ete données pour notre confervation, pour nous
avertir & nous exciter à rechercher ce qui nous eft
neceflaire 6c utile, 6c à fuir ce qui nous eft nuifible.
Celles qui ont les autres pour objets fervent au bien
& au maintien de la fociété. Si les premiers ont eu
beioin de quelque pointe qui réveillât notre pareffe
les fécondés, pour conferver la balance, ont dû être
vives 6c aftives en proportion. Toutes s’arrêteroient
dans leurs juftes bornes, fi nous favions faire un bon
ulage de notre raifon pour entretenir ce parfait équilibre
; elles nous deviendroient utiles, 6c la nature
avec fes defauts g g fes imperfeftions, feroit encore
un fpeftacle agréable aux yeux du créateur porté à
approuver nos vertueux efforts, 6c à exeufer & pardonner
nos foibleffes. ^
troDwu« ^lllp1’av.ouel‘ ’ & l’expérience ne le dit due
è ï S mê™ " C matl0ns W M M abandonnées à
élles-memes apportent mille obftacles à nos connoiffen'
Tm) XlT b0nheurlCelles H font violentes
& împetueufes nous repréfentent fi vivement ieiif
m m m ■ ne n«™ ■ d’attention, que pou,
lui. E f c n e nous permettent pas même d l l’en™
% e r fous une autre face que celle fous laquelle elles
nous le prefentent & qui leur eft toujours la plus
favorable. Ce. font des verres éplorés qui répandent
fur tout ce qu on voit au-travers la codeur qui leur
eftgsppre. Elles s emparent de toutes les puiffances
de notre ame ; elles ne lui laiffent qu’une ombre de
liberté elles l etourdiffent par un bruit fi tumula
tueux, quil devieiit împoflible de prêter l’oreillé aux
avis doux 6c paifibles de la raifon.
Les paffions; plvB d o t® attirent ïhfenfibiemenÊ
H B a“ “ tion fur 1 abjet; elles nous y font trouver
que tout autre, nous paroiffant infi-
pide; hentôt nous
celui-là feul. Foibles dans leur principe elles em
pruntent leur jniiffançe de cette foibleffé même • i l
raifon ne fe defie pas d’un ennemi qui paroît d’abord
fi peu dangereux; mais quand l’hàbitude s-eft for,
mee, elle eft furpnfe de H H H | captive
Les plaifirs du. corps nous attachent d’autanï plus'
facile,nem que notre fenfibilité pour eux eft toute
naturelle. S g sp u ltu re , fans, Aude, nous aimons ce
qui flateÆgoeablement n§s«fens ; livrés, à la fàcilité
m n a® ,n e penfqnsjpàs qu’il n’en eft
.pomt dç p l p p r o ç e s i nous détourner de .foire lm
M a f w daws/acultes ;;if.s>us.per®ins Î S C t
tous les autres biens qu, depiàndent quelqu£,.foi„ | I
& quelqu attention, l’arne affervié aux paffions
«me ces plaifirs entraînent, n’a plusd’élevation ni d e
d™!™“ 1 P°Ur tOUt “ qi“ eft ^Wnblement digne.
Les plaifirs de l’efprit font bien doux & légitimes >
quand on ne fos met pas-? „;oppofition ayec f e
coeur. Mais i les qimlnes de l’elprit fe ion: payer par
. [ Ides defoutsdttcaraftere ,ou feulement fi ellesdmouf
; fent notre fenfibilité pour les charmes de la y m ï t
• H Ü Ies£°ne«,rs de la foc-.c’é , elles font phu que
des iyrencs trompeu e s , dont les chants Æ a e u r s
nous detoument|| la voie .du vrai bonheur. Lora
meme que l’on ne les regarde que. comme des acceft
foires àla perfeftion elle? peuvent produire de mau. H H B H da; :8I:rcu'v H ne pas prévenir.
Si I on fe livre à fous fes goûts , qn effleure tout & .
on devient fuperfiûel & foger ; m fi fo conte’
de voidôtr paroitre favant.^on fera un f i„ x favant
, ou un homme enfle, prefomptueux, opiniâtre. Co«£
dangers dans lefquels les
plailirs de 1 eipnt nous entraînent ?
Rien ne parGit plus digne de nos-defirs clue l’a.
mour même de lavertu. C’.eft cé qui M les
plaifirs du coeur ; c eft ce qui nourrit en nous les paft
fions les plus légitimés Vouloir fincérement le bonheur
d autrui, le lier dune tendre amitié avec des
perfonnes de mente, c’efl. slouvrir une abondante '
lource de deliq*. Mais fi cette inclination nous ftit
, approuver & embrafler avec chaleur routes les pen-
lees, toutes les opinions , toutes les erreurs de nos
amis ;fi elle nous porte à les gâter par de fouffes louai,,
ges & de vame;s.|omplaifances., fi elle nous foit fur.
tout preferer le bien particulier au bien public elle
fort des bornes qui lui font preferites par la raifon • &
1 amitié & la bienfaifaiice, ces àffeaions de l’amê fi
nobles & ft’ légitimes, deviennent pour nous une
lource d ecueils 6c de périls.
l-es/wffîongÿni toutes, faits en excepter celles qui
nous inquiètent Sc nous tourmentent le plus une
forte de douceur qui les juftifie à elles-mêmes. L ’ex.
; penence & le fentiment intérieur nous le difent fans
- ceffe. Si l’on p?ut; trouver .d o u c e s la trifteffe ,,là
' hahic, la vengeance ; quelle paflion fera exempte de
douceur ? D’ailleurs chacune emprunte pour fe fortifier
, le feçours de toutes les autres ; & cette lieu«