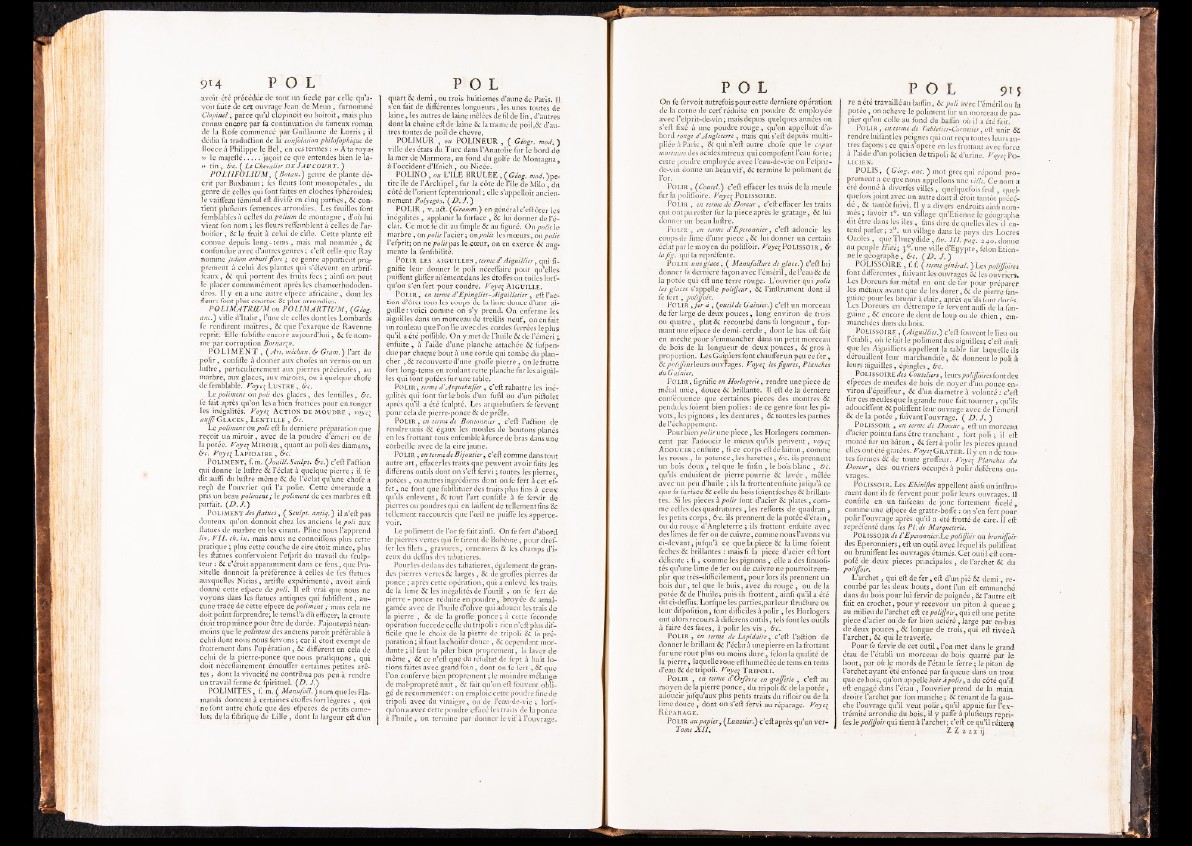
avoit été précédée de tout un fiecle par celle qu’ a-
voit faite de cet ouvrage Jean de Meun, furnommé
Clopiiul , parce qu’il clopinoit ou boitoit, mais plus
connu encore par fa continuation du fameux roman
de la Rofe commencé par Guillaume de Lorris ; il
dédia fa tradu&ion de la confolation philofophique de
Boëce à Philippe le Bel, en ces termes : » A ta roya*
» le majefté........ jaçoit ce que entendes bien le la-
» tin, &<, ( Le Chevalier DE J a u COU RT.}
POLIIFOL IUM , ( Botan.} genre déplanté décrit
par Buxbaum ; fes fleurs font monopétales , du
genre de celles qui font faites en cloches fphéroïdes;
le vaiffeau féminal eft divifé en cinq parties, 6c contient
plufieurs femences arrondies. Les feuilles font
femblables à celles du polium de montagne, d’où lui
vient fon nom ; les fleurs reffemblent à celles de l’ar-
boifier, & le fruit à celui de cifte. Cette plante eft
connue depuis long - tems, mais mal nommée , 6c
confondue avec d’autres genres ; c’eft celle que Ray
nonrme Jedum arbuti flore ; ce genre appartient prq,-
prément à celui des plantes qui s’élèvent en arbrif-
fealtx, 6c qui portent des fruits fecs ; ainfi on peut
le placer communément après les chamoerhododen-
dros. Il y en a une autre efpece africaine, dont les
fleurs font plus courtes 6c plus arrondies.
PQL1MATRIUM ou POLIMARTIUM, (Géog.
anc.j ville d’Italie, l’une de celles dont les Lombards
fe fendirent maîtres , 6c que l’exarque de Ravenne
reprit; Elle fubfifte encore aujourd’hui, 6c fe nomme
par corruption Bornarjo.
P O L IM E N T , (Are. mlchan. & Gram.} l’art de
polir, confifte à donner aux chofes un vernis ou un
luftre, particulièrement aux pierres précieufes, au
marbre, aux glaces, aux miroirs, ou à quelque chofe
de femblable. Voyt{ L u s tr e ,. &c.
Le poliment ou poli des glaces, des lentilles, &c.
fe fait après qu’on les a bien frottées pour en ronger
les inégalités. Voye{ A c t io n d e m o u d r e , voye?
auflî GLA.cEs, L e n t il l e , &c.
Le poliment ou poli eft la derniere préparation que
reçoit un m iroir, avec de la poudre d’émeri ou de
la potée. Voye^ Mir o ir , quant au poli des diamans,
&c. Voye{ L a p id a ir e , &c.
P o l im e n t , f.m. (Joaill.Sculpt. &c.} c’eft l’a&ion
qui donne le luftre 6c l’éclat à quelque pierre ; il fe
ait aüffi du luftre même 6c de l’éclat qu’une chofe a
reçu de l’ouvrier qui l’a polie. Cette émeraude a
pris un beau poliment ; le poliment de ces marbres eft
parfait. (D. J .)
Po l im e n t des flatues, ( Sculpt. antiq.} iln ’eftpas
douteux qu’on donnoit chez les anciens le poli aux
ftatues de marbre en les cirant. Pline nous l’apprend
liv. VII. ch. ix. mais nous ne connoiflons plus cette
pratique ; plus cette couche de cire étoit mince, plus
les ftatues confervoient l’efprit du travail du fculp-
teur : & c’étoit apparammerit dans ce fens, que Pfa-
xitelle donnoit la préférence à celles de fes ftatues
auxquelles Nicias, artifte expérimenté, avoit ainfi
donné cette efpece de poli. Il eft vrai que nous ne
voyons dans les ftatues antiques qui fubfiftent, aucune
trace de cette efpece de poliment ; mais cela ne
doit point furprendre; le tems l’a du effacer; la croûte
étoit trop mince pour être de durée. J’ajouterai néanmoins
que le poliment des anciens paroît préférable à
celui dont nous nous fervons ; car il étoit exempt de
frottement dans l’opération, 6c différent en cela de
celui de la pierre-ponce que nous pratiquons , qui
doit néceffairement émouffer certaines petites arêtes
, dont la vivacité ne contribue pas peu à rendre
un travail ferme & fpirituel. (D . J.}
POLIMITES, f. m. ( Manufacl. ) nom que les Flamands
donnent à certaines étoffes fort légères , qui
ne font autre chofe que des efpecès de petits camelots
delà fabrique de L ille, dont la largeur eft d’un
quart 6c demi, ou trois huitièmes d’aune de Paris. Il
s en fait de différentes longueurs, les unes toutes de
laine, les autres de laine mêlées de fil de lin, d’autres
dont la chaîne eft de laine 6c la trame de poil,& d’autres
toutes de poil de chevre.
POLIMUR , ou POLINEUR , ( Géogr. mod. )
ville des états du Turc dans l’Anatolie fur le bord de
la mer de Marmora, au foncl du golfe de Montagna,
à l’occident d’Ifnich, ou Nicée.
POLINO, ou L’ILE BRÛLÉE, (Géog. mod.petite
île de l’Archipel, fur la côte de n ie de Milo, du
côté de l’orient feptentrional ; elle s’appelloit anciennement
Polyegos. (D .J .}
POLIR , v . aft. (Gramm.} en général c’eft ôter les
inégalités , applanir la furface , 6c lui donner de l’éclat.
Ce mot fe dit au fimple 6c au figuré. On polit le
marbre , on polit l’acier ; on polit les moeurs, on polit
l’efprit; on ne polit pas le coeur, on en exerce 6c augmente
la fenfibilite.
Po l ir le s a ig u il l e s , terme d’Aiguillier, qui lignifie
leur donner le poli néceffaire pour qu’elles
puiffent gliffer aifémentdans les étoffes ou toiles lorf-
qu’on s’en fert pqur coudre. Voye{ A ig u il l e .
P o l i r , en terme dEpinglier- Aiguilletier , eft l’action
d’ôter tous les coups de la lime douce d’une aiguille:
voici comme on s’y prend. On enferme les
aiguilles dans un morceau de treillis neuf, ôn en fait
un rouleau que l’on lie avec des cordes ferrées le plus
qu’il a été poflible. On y met de l’huile 6c de l’éinéri ^
enfuite , à l’aide d’une planche attachée 6c fufpen-
due par chaque bout à une corde qui tombe du plancher
, & recouverte d’une groffe pierre, on le frotte
fort long-tems en roulant cette planche fur les aiguilles
qui font pofées fur une table.
Po l ir , terme d'Arquebufier , c’eft rabattre les inégalités
qui font fur le bois d’un fufil ou d’un piftolet
après qu’il a été fculpté. Les arquebufiers fe fervent
pour cela de pierre-ponce 6c de prêle.
Po l ir , en terme de Boutonnier , c’eft l’aftion de
rendre unis 6c égaux les moules de boutons planés
en les frottant tous enfembleàforce de bras dans une
corbeille avec de la cire jaune.
Po l ir , en terme de Bijoutier y c’eft comme dans tout
autre art, effacer les traits que peuvent avoir faits les
différens outils dont on s’eft fervi ; toutes les pierres,
potées , ou autres ingrédiens dont onfe fert à cet effet
, ne font que fubftituer des traits plus fins à ceux
qu’ils enlevent, & tou t l’art confifte à fe fervir de
pierres ou poudres qui en laiffent de tellement fins 6c
tellement raccourcis que l’oeil ne puiffe les apperce-
voir.
Le poliment de l’or fe fait ainfi. On fe fert d’abord
de pierres vertes qui fe tirent de Bohème, pour dref-
fer les filets, gravures, ornemens & les champs d’i-
ceux du deffus des tabatières.
Pour les dedans des tabatières, également de grandes
pierres vertes 6c larges, 6c de groflès pierres de
ponce ; après cette opération, qui a enlevé les traits
de la lime 6c les inégalités de l’outil , on fe fert de
pierre - ponce réduite en poudre, broyée 6c amalgamée
avec de l’huile d’olive qui adoucit les trais de
la pierre , & de la groffe ponce ; à cette fécondé
opération fuccede celle du tripoli : rien n’eft plus difficile
que le choix de la pierre de tripoli 6c fa préparation
; il faut la choifir douce, 6c cependant mordante
; il faut la piler bien proprement, la laver de
même , & ce n’eft que du réfultat de fept à huit lotions
faites avec grand foin, dont on fe fert , 6c que
l’on conferve bien proprement ; le moindre mélange
de mal-propreté nuit, 6c fait qu’on eft fouvent obligé
de recommencer : on emploie cette poudre fine de
tripoli avec du vinaigre, ou de l’eau-de-vie ; lorsqu'on
a avec cette poudre effacé les traits de la ponce
à l’huile, on termine par donner le v if à l’ouvrage.
On fe fervoit autrefois pour cette derniere opération
de la corne de cerf réduite en poudre & employée
avec l’efprit-de-vin; mais depuis quelques années on
s’eft fixe à une poudre rouge , qu’on appelloit d’abord
rouge d'Angleterre , mais qui s’eft depuis multipliée
à Paris , 6c qui n’eft autre chofe que le cap ut
mortuum des acides nitreux qui compofent l’eau forte;
cette poudre employée avec l’eau-de-vie ou l ’efprit-
de-vin donne un beau v if , 6c termine le poliment de
l’or.
Po l ir , (Coutel.} c’eft effacer les trais de la meule
fur la poliffoire. Voyeç Po l is so ir e .
Po l ir , en terme de Doreur, c’eft effacer les traits
qui ont pu refter fur la piece après le gratage, & lui
donner un beau luftre.
Po l ir , en terme d.'Eperonnier, c’eft adoucir les
coups de lime d’une piece , 6c lui donner un certain
éclat par le moyen du polifloir. Voyeç Po l is s o ir , &
la fig. qui la repréfente.
Po l ir une glace y ( Manufacture de glace.} c’eft lui
donner fa derniere façon avec l’éméril, de l’eau & de
la potée qui eft une terre rouge. L’ouvrier qui polit
les glaces s’appelle polijjeur, 6c l’inftrument dont il
fe f e r t , polijfoir.
Po l ir y fer à , (outilde Gainier.} c’eft un morceau
de fer large de deux pouces, long environ de trois
ou quatre , plat & recourbé dans fa longueur , formant
une efpece de demi-cercle , dont le bas eft fait
en meche pour s’emmancher dans un petit morceau
de bois de la longueur de deux pouces, 6c gros à
proportion. Les Gaîniers font chauffer un peu ce fe r ,
6c poliflentleurs ouvrages. Voye^ les figures, Planches
du Gainier.
Po l ir , fignifie en Horlogerie, rendre une piece de
métal unie, douce & brillante. Il eft de la derniere
conféquence que certaines pièces des montres &
pendules foient bien polies : de ce genre font les pivots
, les pignons, les dentures, 6c toutes les parties
de l’échappement.
Pour bien polir une p iece, les Horlogers commencent
par l’adoucir le mieux qu’ils peuvent, voye£
A d o u c ir ; enfuite, fi ce corps eft de laiton, comme
les roues , la potence, les barettes, &c. ils prennent
un bois doux, tel que le fiifin , le bois blanc , &c.
qu’ils enduifent de pierre pourrie 6c lavée , mêlée
avec un peu d’huile ; ils la frottent enfuite jufqu’à ce
que fa furface & celle du bois foient feches 6c brillantes.
Si les pièces à polir font d’acier 6c plates, comme
celles des quadratures , les refforts de quadran ,
les petits corps, &c. ils prennent de la potée d’étain,
ou du rouge d’Angleterre ; ils frottent enfuite avec
des limes de fer ou de cuivre, comme nous l’avons vu
ci-devant, jufqu’à ce que la piece 6c la lime foient
feches 6c brillantes : mais fi la piece d’acier eft fort
délicate ; fi , comme les pignons , elle a des finuofi-
tés qu’une lime de fer ou de cuivre ne pourroitremplir
que très-difficilement, pour lors ils prennent un
bois dur, tel que le buis, avec du rouge , ou de la
potée 6c de l’huile; puis ils frottent, ainfi qu’il a été
dit ci-deffus. Lorfque les parties,par leur ftrufture ou
leur difpofition, font difficiles à polir , les Horlogers
ont alors recours à différens outils, tels font les outils
à faire des faces, à polir les vis , &c.
POLIR , en terme de Lapidaire, c ’eft l’afrion de
donner le brillant & l’éclat à une pierre en la frottant
fur une roue plus ou moins d u r e , félon la qualité de
la pier re , laquelle roue efthumeftéede tems en tems
d’eau & de tripoli. Voyeç T r ipo l i .
Po l ir , en terme d Orfèvre en grojferie , c’eft au
moyen de la pierre ponce, du tripoli & de la potée,
adoucir jufqu’aux plus petits traits du rifloir ou de la
lime douce, dont on s’eft fervi au réparage. Voye{
R é p a r a g e .
P o l ir au papier, (Lunetier.} c’eft après qu ’un v e r -
Tome X I I ,
re a été travaillé au baffin, & poli avec l’émériiou là
potée, on achevé le poliment fur un morceau de papier
qu’on colle au fond du baffin oîi il a été fait.
POLIR , en terme de Tabletier-Cornetier, eft unir &
rendre luifant les peignes qui ont reçu toutes leurs au-*
très façons ; ce qui s’opère en les frottant avec force
à l’aide d’un policien de tripoli & d’urine. Voye.r Po-
l i c ie n .
POLIS, (Géog. anc. } mot grec qui répond proprement
a ce qqenous appelions une ville. Ce nom a
ete donné à diverfes villes , quelquefois feu l, quelquefois
joint avec un autre dont il étoit tantôt précé-
de , & tantôt fuivi. Il y a divers endroits ainfi nommes^;
favoir i° . un village qu’Etienne le géographe
’ dit être dans les îles , fans dire de quelles îles il entend
parler ; . un village dans le pays des Locres
Ozoles, que Thucydide , liv. III. pag. 240. donne
au peuple Hioei; 3 une ville d’Egypte, félon Etienne
le géographe, &c. (D . J .}
POLISSOIRE , f. f. ( terme général. ) Les poli [foires
font différentes, fuivant les ouvrages & les ouvriers.
Les Doreurs fur métal en ont de fer pour préparer
les métaux avant que de les dorer, & de pierre fan-
guine pour les brunir à clair, après qu’ils font dorés.
Les Doreurs en détrempe fe fervent aufïï de la fan-
guine , & encore de dent de loup ou de chien emmanchées
dans du bois.
,, P°^issOir e , (Aiguillier.} c ’eft fouvent le lieu ou
1 établi , où fefait le poliment des aiguilles; c’eft ainfi
que les Aiguilliers appellent la table fur laquelle ils
défouillent leur marchandife, 6c donnent le poli à
leurs aiguilles , épingles , &c.
Po l is s o ir e des Couteliers, leurs polifloires font des
efpeces de meules de bôis de noyer d’un pouce environ
d’épaiffeur, 6c d’un diametfe à volonté : c’eft:
fur ces meules que la grande roue fait tourner , qu’ils
adouciffent 6c poliffent leur ouvrage avec de l’émeril
6c de la potée , fuivant l’ouvrage. ( D . J. }
Po l is so ir , en terme de Doreur, eft un morceau
d’acier pointu fans être tranchant , fo rt poli ; il eft
monté fur Un b â to n , 6c fert à polir les pièces quand
elles ont été gratées. Voye[ G r a t e r . Il y en a de toutes
formes 6c de toute groffeur. Voye^ Planches du
Doreur, des ouvriers occupés à polir différens ouvrages.
.
Po l is s o ir . Les Ebéniftes appellent ainfi un infiniment
dont ils fe fervent pour polir leurs ouvrages. Il
confifte en un faifceau de jonc fortement ficelé,
comme une efpece de gratte-boffe : on s’en fert pour
polir l’ouvrage après qu’il a été frotté de cire. Il eft
repréfenté dans les PI. de Marqueterie.
Po l is s o ir de VEperonnier.Le polifloir ou brunifloir
des Eperonniers, eft un outil avec lequel ils poliffent
ou bruniffent les ouvrages étamés. Cet outil eft com-
pofé de deux pièces principales , de l’archet 6c du
polifloir.
L’archet, qui eft de fe r , eft d’un pié 6c demi, recourbé
par les deux bouts, dont l’un eft emmanché
dans du bois pour lui fervir de poignée, 6c l’autre eft
fait en crochet, pour y recevoir un piton à queue ;
au milieu de l’archet eft ce polifloir, qui eft une petite
piece d’acier oifde fer bien aciéré , large par en-bas
de deux pouces, 6c longue de trois, qui eft rivée à
l’archet, 6c qui le traverfe.
Pour fe fervir de cet outil, l’on met dans le grand
étau de l’établi un morceau de bois quarré par le
bout, par où le mords de l’étau le ferre ; le piton de
l’archet ayant été enfoncé par fa queue dans un trou'
que ce bois, qu’on appelle bois àpolir, a du côté qu’il
eft engagé dans l’étau , l’ouvrier prend de la main
droite l’archet par fon manche ; & tenant de la gauche
l’ouvrage qu’il veut polir, qu’il appuie fur l’extrémité
arrondie du bois, il y paffe à plufieurs repri-
fes 1 e.polifloir qui tient à l’archet; c’eft ce qu’il réitéré
n i ___::