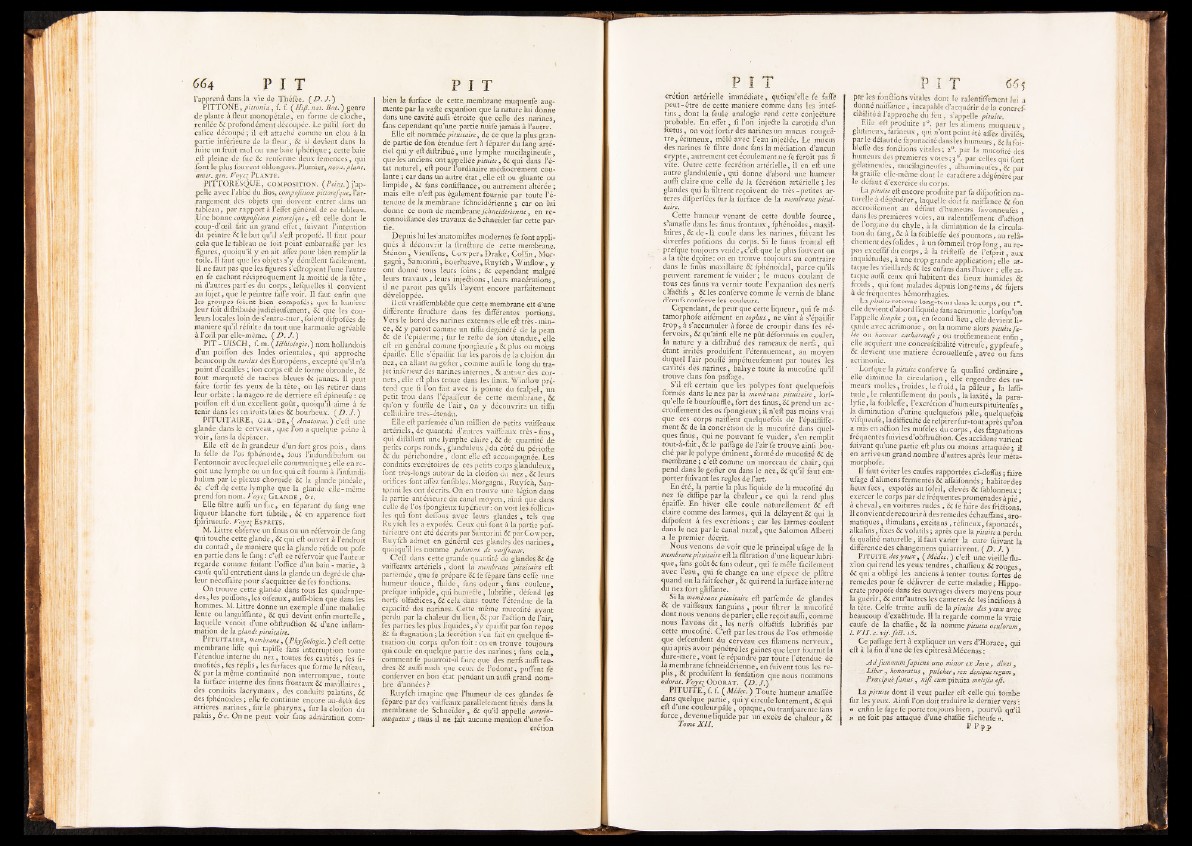
l’apprend dans la vie de Tl)éfée. ( D. J. )
PITTONE, p i t to n ia , f. f. ( H if l.n a t . B o t . ) genre
déplanté à fleur monop étale, en forme de cloche,
renflée & profondément dépoupée. Le piflil fort du
calice découpé ; il eft attaché comme un clou à la
partie inférieure de la fleur, il devient dans la
fuite un fruit mol ou une baie fphérique ; cette baie
eft pleine de fuc & renferme deux femences, qui
font le plus fouvent oblongues. Plumier, n o v a .p la n t,
amer. gen. Voy e£ PLANTE.
PITTORESQUE, composit ion. (Peint.') j ap-
pelle avec l’abbé du Bos* compojition pittorefque, l’arrangement
des objets qui doivent entrer dans un
tableau, par rapport à l’effet général de ce tableau.
,Une bonne compojition pittorefque, eft celle dont le
.coup-d’oeil fait un grand effet, fuivant l’intention
du peintre & le but qu’il s’eft propofé. Il faut pour
cela que le tableau ne foit point embarraffé par les
figures, quoiqu’il y en ait affez pour bien remplir la
toile. Il faut que les objets s’y démêlent facilement.
Il ne faut pas que les figures s’eftropient l’une l’autre
en fe cachant réciproquement la moitié de la tête,
ni d’autres parties du corps, lefquelles il convient
aufujet, que le peintre faflevoir. J1 faut enfin que
les groupes foicnt bien compofés; que la lumière
leur foit diftribuée judicieufement, & que les couleurs
locales loin de s’entre-tuer, foient difpofées de
maniéré qu’il réfuî,te du tout une harmonie agréable
à l’oeil par elle-même. ( D . J. )
PIT - UÎSCH, f. m. ( Icïhiologie. ) nom bollandois
d’un poiffon des Indes orientales , qui approche
beaucoup du turdus des Européens, excepté qu’il n’a
point d’ecailles ; fon corps eft de forme obronde, &
tout marqueté de taches bleues & jaunes. Il peut
faire fprtir fes yeux de la tête, ou les retirer dans
leur orbite ; la nageoire de derrière eft épineufe : ce
poiflon eft d'un excellent goût, quoiqu’il aime à fe
tenir dans les endroits fales & bourbeux. ( D. J. )
PITUITAIRE, GLAMDE, ( Anatomie. ) ç’eft unë
glande dans le cerveau , que l’on a quelque peine à
vo ir , fans la déplacer.
Elle eft de la grandeur d’un fort gros pois, dans
la felle de l’os fphénoïdè, fous l’infiindibulum ou
l’entonnoir avec lequel elle communique ; elle en reçoit
une lymphe ou un fuc qui eft fourni à l’infundi-
bulum par le plexus choroïde & la glande pinéale,
'& c’eft de cette lymphe que la glande elle-même
prend fon nom. Voye\ Glande , 6-c.
Elle filtre aufiï un fuc, en féparant du fang une
liqueur blanche fort fubtile, & en apparence fort
fpiritueufe. Voye{ Esprits.
M. Littré obferve un finus ou un réferyoir de fang
qui touche cette glande, & qui eft ouvert à l’endroit
du contatt, de maniéré que la glande réfuie ou pofe
en partie dans le fang : c’eft ce réfervoir que l’auteur
regarde comme faifant l’office d’un bain - marie, à
caufe qu’il entretient dans la giande un degré de chaleur
neceffaire pour s’acquitter de fes fondions.
On trouve cette glande dans tous les quadrupèdes
, les poiffons, les oifeaux, aufîi-bien que dans les
hommes. M. Littré donne un exemple d’une maladie
lente ou languiffante, & qui devint enfin mortelle,
laquelle venoit d’une obftru&ion & d’une inflammation
de la glande pituitaire.
Pituitaire, membrane, (Phyjiologie. ) c’eft cette
membrane rifle qui tapiffe fans interruption toute
l’etendue interne du nez, toutes fes cavités, fes fi-
nuofi tes, fes replis, les fur faces que forme le réfeau,
& par la meme continuité non interrompue, toute
la furface interne des finus frontaux & maxillaires
des conduits lacrymaux, des conduits palatins &
des fphénoïdes ; elle fe continue encore au-delà des
arriérés narines, fur le pharynx, fur la cloifon du
palais , &c. On ne pept voir fans admiration combien
la furface de cette, membrane muqueufe augmente
par la vafte expanfion que la nature lui donne
dans une cavité auffi étroite que celle des narines,
fans cependant qu’une partie nuife jamais à l’autre.
Elle eft nommée pituitaire, de ce que la plus grande
partie de fon étendue fert à féparer du fang artériel
qui y eft diftribué, une lymphe mucilagineufe,
que les anciens ont appellée pituite, & qui dans l’état
naturel, eft pour l’ordinaire médiocrement coulante
; car dans un autre état, elle eft ou gluante ou
limpide, & fans confiftance, ou autrement altérée;
mais elle n’eft pas également fournie par toute l’étendue
de la membrane fchneidérienne ; car on lui
donne ce nom de membrane Jchneidèrienne, en re-
connoiffance des travaux de Schneïder fiu: cette partie.
Depuis lui les anatomiftes modernes fe font appliqués
à découvrir la ftnitture de cette membrane.
Stéiion, VieufTens, Cowper, Drake, C ollin, Mqr-
gagni, Santorini, Boerhaave, R uyfch, Winflow, y
ont donne tous leurs foins ; & cependant malgré
leurs travaux, leurs injettions, leurs macérations,
il ne paroit pas qu’ils Payent encore parfaitement
développée.
Il eft vraiffemblable que cette membrane eft-d’une
différente ftrutture dans fes différentes portions.
Vers le bord des narines externes elle eft très - minc
e , &: y paroit comme un tifîii dégénéré de la peàïi
& de l’epiderme ; fur le refte de fon étendue, elle
eft en général comme fpongieufe, & plus ou moins
epaiffe. Elle s’épailîit fur les parois de la cloifon du
nez, en allant au gofier, comme auffi le long du trajet
inférieur des narines internes , & autour des cornets
, elle eft plus tenue dans les finus. ‘Winflow prétend
que fi l’on fait avec la pointe du fcalpel, un
petit trou dans l’épaifleiir de cette membrane, &
qu’on y fouftle de Pair, on y découvrira un tiffu
cellulaire très-étendu.
Elle eft parfemée d’un million de petits vaiffeaiye
artériels, de quantité d’autres vaiffeaux très - fins ,
qui diftillent une lymphe claire, & de quantité de
petits corps ronds, glanduleux ,‘du côté du périofte
& du périchondre, dont elle eft accompagnée. Les
conduits excrétoires de ces petits corps glanduleux,
font très-longs autour de la cloifon du nez, & leurs
orifices font affez fenfibies. Morgagni, Ruyfch, San-
tprini les ont décrits. On en trouve une légion dans
la partie antérieure du canal moyen, ainfi que dans
celle de l’os fpongieux fupérieur: on voit lesffollicu-
les qui font deffous avec leurs glandes , tels que
Ruyfch les a expofés. Ceux qui font à la p,artie pof-
terieure ont été décrits par Santorini & parCowper.
Ruyfch admet en général ces glandes des narines,
quoiqu’il les nomme pelotons de vaiffeaux.
C ’eft dans cette grande quantité de glandes & de
vaiffeaux artériels, dont la membrane pituitaire eft
pariemée, que fe prépare & fe fépare fans ceffe une
humeur douce, fluide, fans odeur, fans couleur,
prefque infipide, qui humette, lubrifie, défend les
nerfs olfattices, & cela dans toute l’étendue de la
capacité des narines. Cette même mucofité ayant
perdu par la chaleur du lieu, & par l’attion de Pair,
les parties les plus liquides, s’y épaiffit par fon repos
& là ftagnation ; la lecrétion s’en fait en quelque fi-
tuation du corps qu’on foit : on en trouve toujours
qui coule en quelque partie des narines ; fans cela.,
comment fe pourroit-il faire que des nerfs auffi tendres
& auffi nuds que ceux de l’odorat, puflent fé
conferver en bon état pendant un auffi grand nombre
d’années?
Ruyfch imagine que l’humeur de ces glandes fe
fepare par des vaiffeaux parallèlement fitués dans la
membrane de Schneider, & qu’il appelle arterio-
muqueux ; mais il ne fait aucune mention d’une fe-
crétion
crétiori artérielle immédiate, qiiôiqu’elle le faffe
peut-être de cette maniéré comme dans les intef-
rins, dont la feule analogie rend cette conjetture
probable! En effet, fi l’on injefte la carotide d’un
foetus, on voit fortir des narines un mucus rougeâtre
, écumeux, mêlé avec l’eau injettée. Le mucus
des narines fe filtre donc fans la médiation d’aucun
crypte, autrement cet écoulement ne fe feroit pas fi
vite. Outre cette fecrétion artérielle * il en eft une
autre glanduleufe, qui donne d’abord une humeur
auffi claire que celle de la fécrétion artérielle ; les
glandes qui la filtrent reçoivent de très-petites artères
difperfées fur la furface de la membrane pituitaire.
Cette humeur venant de cette double fource,
s’amaffe dans les finus frontaux, fphénoïdes, maxillaires
, & de - là coule dans les narines, fuivant les
diverfes polirions du corps. Si le finus frontal eft
prefque toujours vuide, c’eft que le plus fouvent on
a la tête droite : on en trouve toujours au contraire
dans le finus maxillaire & fphénoïdal, parce qu’ils
peuvent rarement fe vuider ; le mucus coulant de
tous ces finus va vernir toute l’expanfion des nerfs
clfattifs t & les conferve comme le vernis de blanc
d’oeufs conferve les couleurs»
Cependant, de peur que cette liqueur, qui fe mé-
tamorphofe aifément ën tophus, ne vînt à s’épàiffir
trop, à s’accumuler à force de croupir dans fes ré-
fervoirs, & qu’ainfi elle ne pût déformais en couler,
la nature y a diftribué des rameaux de nerfs, qui
étant irrités produifent l’éternuement, au moyen
duquel l’air pouffé impétueufement par toutes les
cavités des narines, balaye toute la mucofité qu’il
trouve dans fon paffage.
S’il eft certain que les polypes font quelquefois
formés dans le nez par la membrane pituitaire, lorf-
qu’elle fe bourfouffle, fort des finus, & prend un ac-
croiffement des os fpongieux ; il n’eft pas moins vrai
que ces corps naiffent quelquefois de l’épaiffiffe-
ment & de la concrétion de la mucofité dans quelll
ques finus, qui ne pouvant fe vuider, s’ en remplit
tout-à-fait, & le paffage de l’air fe trouve ainfi bouche
par le polype éminent, formé de mucofité & de
membrane ; c ’eft comme un morceau de chair, qui
pend dans le gofier ou dans le nez, & qu’il faut emporter
fuivant leS réglés de l’art.
En été, la partie la plus liquide de la mucofité du
nez fe diffipe par la chaleur, ce qui la rend plus
épaiffe. En hiver elle coule naturellement & eft
claire comme des larmes, qui la délayent & qui la
difpofent à fes excrétions ; car les larmes • coulent
dans le nez par le canal nazal, que Salomon Alberti
a le premier décrit.
Nous venons de voir que le principal ufagè de la
membrane pituitaire eft la filtration d’une liqueur lubrique,
fans goût & fans odeur, qui fe mêle facilement
avec l’eaü, qui fe change en une efpece de plâtre
quand on la fait fecher, & qui rend la furface interne
du nez fort griffante.
Si la membrane pituitaire eft parfemée de glandes
& de vaiffeaux fanguins , pour filtrer la mucofité
dont nous venons de parler; elle reçoit auffi, comme
nous l’avons d it , les nerfs olfaftifs lubrifiés par
cette mucofité. C’eft par les trous de l’os ethmôïde
que descendent du cerveau ces filamens nerveux,
qui après avoir pénétré les gaines que leur fournit la
dure-mere, vont fe répandre par toute l’étendue de
la membrane fchneidérienne , en fuivent tous les repris
, & produifent la fenfation que nous nommons
odorat. Voye^ ODORAT. (Z). /.)
PITUITE, f. f. ( Médec. ) Toute humeur amafféé
dans quelque partie, qui y circule lentement , & qui
eft d’une couleur pâle, opaque , ou tranfparente fans
force, devenue liquide par un excès de chaleur, &
Tome X I I .
P ï T rt/t*
A 1 I O O 5
par les fondions vitales dont le ralenriffemènt lui à
°.?l?f?e,n>a^ ance > incapable d’acquérir de la concrefi
cibilite a l’approche du feu , s’appelle pituite.
Elle eft produite i° . par les alimens muqueux,
glutineux, farineux, qui n’ont point été affez divifés)
par le défaut de faponacité dans les humeurs, & la foi-
bleffe des fonctions vitales; 20. par la mucofité des
humeurs des premières vo ie s;3°. par celles qui font
gelatineuf es, mucilagineufes , albumineufes, & par
la graiffe elle-même dont le caraftere a dégénéré par
le défaut d’exercice du corps.
La pituite eft encore produite par fa difpofition naturelle
à dégénérer, laquelle doit fa naiffance & fon
accroilfement au défaut d’humeurs favonneufes
dans les premières voies, au ralentiffement d’aériort
de l’organe du chyle, à la diminution de la circulation
du fang, & à lafoibleffe des poumons, au relâ*
chement des folides, à un fômmeil trop long, au repos
exceffif du corps, à la triftefle de l’efprit, aux
inquiétudes, à une trop grande application ; elle attaque
les vieillards & les enfans dans l’hiver ; elle attaque
auffi ceux qui habitent des lieux humides &
froids , qui font malades depuis long-tems, & fiijets
à de fréquentes hémorrhagies.
La pituite retenue long-tems dans le corps, où i° .
elle devient d’abord liquide fans acrimonie, lorfqu’on
l’appelle Limphe ; ou, en fécond lieu , elle devient liquide
avec acrimonie, on la nomme alors pituite faite
ou humeur catharreufe ; ou troifiemement enfin
elle acquiert une concrefcibilité vitreufe, gypfeufe’
& devient une matière écrouelleufe, avec ou fans
acrimonie.
Lorfque la pituite conferve fa qualité ordinaire ,
elle diminue la circulation, elle engendre des tu*'
meurs molles, froides, le froid, la pâleur, la laffi-
tude, le ralentiffement du pouls, la laxité* la para-
lyfie,Ia foibleffe, l’excrétion d’humeurspituiteufes
la diminution d’urine quelquefois pâle, quelquefois
vifqueufe, la difficulté de refpirer fur-tout après qu’on
a mis en aûion les mufcles du corps, des ffa^nations
frequentes fiiivies d obftrucfion. Ces accidens varient
fuivant qu’une partie eft plus ou moins attaquée; ii
en arrive un grand nombre d’autres après leur méte-
morphofe.
Il faut éviter les caufes rapportées ci-deffus ; faire
iifage d’alimens fermentés &affaifonnés; habiter des
lieux fecs, expofés au foleil, élevés & fablonneux -
exercer le corps par de fréquentes promenades à pié ^
à cheval, en voitures rudes, & fe faire des friâions*
Il convient de recourir à desremedes échauffàns, aromatiques
, ftimulans, excitans , réfineux, faponacés
alkarins , fixes & volatils ; après que la pituite a perdu
fa qualité naturelle, il faut varier la cure fuivant la
différence des changemens qui arrivent. ( D. J. )
Vitxjite des yeux, (Médec. ) c’eft une vieille fluxion
qui rend les yeux tendres, chaffieux & rouges,
& qui a obligé les anciens à tenter toutes fortes de
remedes pour fe délivrer de cette maladie ; Hippocrate
propofe dans fes ouvrages divers moyens pour
la guérir, & entr’autres les cautères & les incifions à
la tete. Celle traite auffi de la pituite des yeux avec
beaucoup d’exattitude. Il la regarde comme la vraie
caufe de la chaffie, &c la nomme pituita oculorum
l. VII. c. vij.fect. i5.
Ce paffage fert à expliquer un vers d’Horace, qui
eft à la fin d’une de fes épitresàMécenas :
A d fummum fapiens uno minor etc Jove > dives ,
.Liber 9 konoratus , pulcher, rex déni que regum t
Pratcipue fatius, niji cum. pituita molejla ejl.
La pituite dont il veut parler eft celle qui tombe
fur les yeux. Ainfi l’on doit traduire le dernier vers':
« enfin le fage fe porte toujours bien, pourvû qu’il
» ne foit pas attaqué d’une -chaffie fàcheufe ».
P P pp