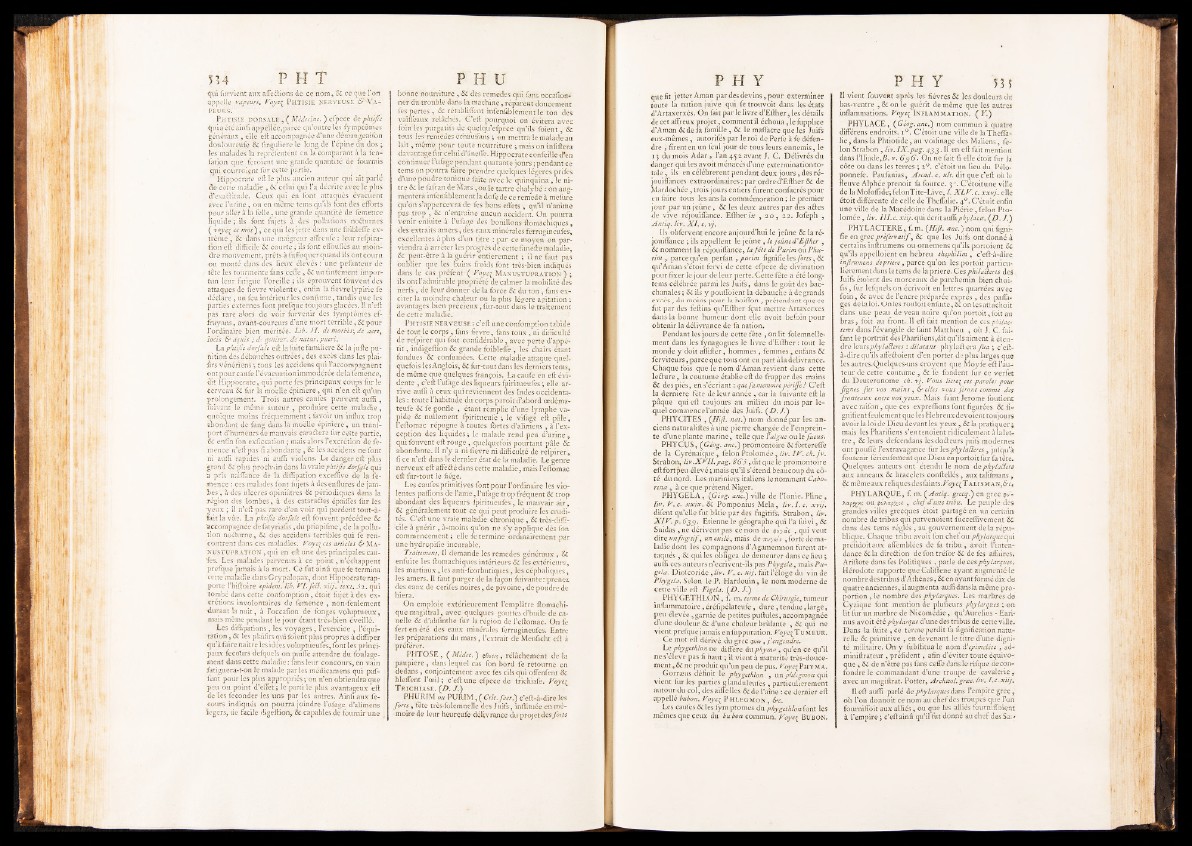
534 P H T
djfii f u m e n t aux affe ctio ns de ce nom, 8c ce que l’ on
-appelle vapeurs. Voyeç P h t i s i e n e r v e u s e 6*nV a -
REURA.'
P h t i s i e d o r s a l e , ( Médecine. ) efpece deplulfîe
qui a été ainfi appellëe,parce qu’outre les fymptômes
généraux , elle eft àcèompagnée d’une démangeaifon
doulôureufe 8c finguiiere le long de l’épine du dos ;
l’es malades la reprélëntent en la comparant à la fen-
fation que. feroient une grande quantité de fourmis
qui courroiçnt fur cette partie.
' Hibpôcrate eft le plus ancien auteur qui ait parlé
de cette maladie , 8c celui qui l’a décrite avec le plus
d’exactitude. Ceux qui en font attaqués évacuent
avec l’urine, ou en meme tems qu’ils font des efforts
pouf aller à là Celle, une grande quantité de' femence
liquide ;. ils font fujets à des pollutions no Sûmes
( voye^ ce mot'), ce qui les jette dans une fbibleffe extrême
,. & dans une maigreur affreufe : leur refpira-
tion eft difficile & courte ; ils font eflouflës au moindre
mouvement, prêts à fuffoquer quand ils ont couru
ou monté dans des lieux élevés : une pefanteur de
tète les toûrmente fans ceffe , 8c un tintement importun
leur fatigue l’oreille ; ils éprouvent fouvent des
attaques de fièvre violente, enfin la fievrelypirie fe
déclare , un feu intérieur les confume, tandis que les
parties externes font prefque toujours glacées. Iln’eft
pas rare alors de voir furvenir dès iÿmptômes ef-
frayans, avant-coureurs d’une mort terrible, & pour
l’ordinaire bien méritée. Lib. II. de morbis-, de acre,
locis & dquis ; de genitur. de natur. pueri.
La phtifit dorfale eft la fuite familière & la jufte punition
des débauchés outrées, des excès dans les plai-
firs vénérien^ •, tous les accidens qui l’accompagnent
ont pour caufe l’évacuation immodérée de la femence,
dit Hippocrate, qui porte fes principaux coups fur le
Cerveau 8c fur la moelle épiniere, qui n’en eft qu’un
prolongement. Trois autres caufes peuvent auffi ,
fuivant le même auteur , produire cette maladie,
quoique moins fréquemment ; favoir un influx trop
abondant de farig dans la moelle épinière , un transport
d’humeurs de mauvais caraftere fur cette partie,
€c enfin fon exficcation ; mais alors l’excrétion de femence
n’eft pas fi abondante , 8c les accidens ne font
ni auffi rapides ni auffi violons. Le danger eft plus
grand & plus prochain dans la vraie plitijie dorfait qui
â pris naiffânce de la diffipation exceffive de la femence
: ces malades font fujets à des enflures de jambes
, à des ulcérés opiniâtres 8c périodiques dans la
région des lombes, à des cataraéles épaiffes fur les
yeux ; il n’eft pas rare d’en voir qui perdent tout-à-
faitla vue. La phtijît dorfale eft fouvent précédée 8c
’accompagnée de fatyriafis , du priapifme, de la pollution
no&urne, &c des accidens terribles qui fe rencontrent
dans ces maladies. Voye^ ces articles 6* Man
u s t u p r a t i o n , qui en eft une des principales caû-
’fes. Les malades parvenus à ce point, n’echapperit
prefque jamais à la mort. Ce fut ainfi que fe termina
cette maladie dans Grypalopax, dont Hippocrate rapporte
l’hiftoire epidem. lib. Vl.fecl. viij. text, 5z. qui
tombé dans cette confomption, étoit fujet à des excrétions
involontaires de femence , non-feulement
durant la nuit, à l’occafion de fonges voluptueux,
mais même pendant le jour étant très-bien éveillé.
Les diffipatîons , les voyages, l’exercice , l’équitation
, & les plaifirs qui foient plus propres à difliper
qu’à faire naître les idées voluptueufes, font les principaux
fecoiirs defquels on puiffe attendre du foulage-
ment dans cette maladie : fans leur concours, en vain
fatiguera-t-on le malade par les médicamens qui paf-
fent pour les plus appropriés ; on n’en obtiendra que
peu ou point d’effet ; le parti le plus avantageux eft
de les féconder -les uns par les autres. Ainfi aux fe-
cours indiqués on pourra joindre l’ufage d’alimens
légers, de facile digeftion, 8c capables de fournir tme
P H U
bonne nourriture , & des remedes qui. fans occafiort*
ner du trouble dans la machine, réparent doucement
fes pertes , 8c rétablirent infenfiblement le ton des
vaiffeaux relâchés. G’eft pourquoi on évitera avec
foin les purgatifs de quelqu’efpece qu’ils foient, 8c
tous les remèdes échauffons ; on mettra le malade au
la it , même, pour toute nourriture ; mais on infiftera
davantage fur celui d’âneffe. Hippocrate confeille d*en
continuer l’ufage pendant quarante jours ; pendant ce
tems on pourra faire prendre quelques légères prifes
j d’une poudre tonique faite avec le quinquina, le ni-
trç 8c le aàfran de Mars, ou le tartre chalybé : on augmentera
infenfiblement la dofede ce remede à mefure
qu’cin s’appercevra de les bons effets , qu’il n’anime
pas trop , 8c n’entraîne aucun accident. On pourra
venir enfuite à l’ufage des bouillons ftomachiques ,
des extraits amers, des eaux minérales ferrugineufes,
excellentes à plus d’un titre : par ce moyen on parviendra
à arrêter les progrès de cette fiinefte maladie,
8c peut-être à la guérir entièrement ; il ne faut pas
oublier que les. bains froids font très-bien indiqués
dans le cas préfent ( Voyeç M a n u s t u p r a t i o n ) ;
ils ont l’admirable propriété de calmer la mobilité des
nerfs , de leur donner de la force &■ du ton , fans exciter
la moindre chaleur ou la plus légère agitation ;
avantages bien précieux, fur-tout dans le traitement
de cette maladie.
P h t i s i e n e r v e u s e ; c’eft une confomption tabide
de tout le corps , fans fievre, fans toux, ni difficulté
derefpirer qui foit confidérable, avec perte d’appétit
, indigeftion 8c grande foibleffe’, les-chairs étant
fondues & confirmées. Cette maladie attaque quefi
quefois lesAnglois, 8c fur-tout dans les derniers tems,
de même que quelques françois. La caufe en eft évidente
, c’ eft l’ufage des liqueurs fpiritueufes ; elle arrive
auffi à ceux qui reviennent des Indes occidentales
: toute l’habitude du corps paroît d’abord oedéma-
teufe 8c fe gonfle , étant remplie d’une lymphe va-
pide & nullement fpiritueufe ; le vifage eft pâle ,
l’eftomac répugne à toutes fortes d’alimens , à l’exception
des liquides ; le malade rend peu d’u rine,
qui fouvent eft rouge , quelquefois pourtant pâle 8c
abondante. Il n’y a ni fievre ni difficulté de refpirer,
fi ce n’eft dans le dernier état de la- maladie. Le genre
nerveux eft affeftédans cette maladie, mais l’eftomac
eft fur-tout le fiége.
Les caufes primitives font pour l’ordinaire les violentes
paffions de l’ame, l’ufage trop fréquent 8c trop
abondant des liqueurs fpiritueufes, le mauvair air,
& généralement tout ce qui peut produire les crudités.
C’eft une vraie maladie chronique , 8c très-difficile
à guérir , à-moins qu’on ne s’y applique dès fon
commencement ; elle le termine ordinairement par
une hydropifie incurable.
Traitement. Il demande les remedes généraux , 8c
enfuite les ftomachiques intérieurs 8c les extérieurs,
les martiaux, les anti-feorbutiques, les céphaliques,
les amers. Il faut purger de la façon fuivante:-prenez
des eaux de cerifes noires, de pivoine, de poudre de
hiera.
On emploie extérieurement l’emplâtre ftomachi-
que magiftral, avec quelques gouttes d’huile de ca-
nelle 8c d’abfinthe fur la région de l’eftomac. On fe
fert en été des eaux minérales ferrugineufes. Entre
les préparations du mars, l’extrait de Menficht eft à
préférer.
PHTOSE , ( Médec. ) çflof/ç, rélâchement d e là
paupière , dans lequel cas fon bord fe retourne en
dedans, conjointement avec fes cils qui offenfent 8c
bleffent l’oeil ; c’eft une efpece de trichiafe. Voye^
T r i c h i a s e . (D. J.)
PHURIM ou PURIM, ( Crit.facr.) c’eft-à-dire les
forts, fête très-folemnelle des Juifs, inftituée en mémoire
de leur heureufe délivrance du projet des forts
P H Y que fit jetter Aman par des devins, pouf exterminer
toute la nation juive qui fe trouvoit dans les états
d’Artaxerxès. On fait par le livre d’Efther, les détails
de cet affreux p rojet, comment il échoua, le fupplice
d’Aman & de la famille, 8c lè maffacre que les Juifs
eux-mêmes, autorifés par le roi de Perfe à fe défendre
, firent en un feul jour de tous leurs ennemis, le
ï 3 du mois Adar, l’an 45 z avant J. C. Délivrés du
danger qui les avoit ménacés d’une extermination totale
, ils en célébrèrent pen dant deux jours, des ré-
iouiffances extraordinaires : par ordre d’Efther 8c de
Mardochée , trois jours entiers furent confacrés pour
eu faire tous les ans la commémoration ; le premier
jour par un jeûne, 8c les deux autres par des a êtes
de vive réjouiffance. Eftherix , 2 0 , 22. Jofeph ,
Antiq. liv. X I . c.yj.
Ils obfervent encore aujourd’hui le jeune 8c la réjouiffance
j ils appellent le jeûne , le jeûne d'Eßher ,
8c nomment la rejouiffance, la fête de Purim ou Phu-
ritn , parce qu’en perfan , purim lignifie les forts, &
qu’Aman s’étoit fervi de cette efpece de divination
pour fixer le jour de leur perte. Cette fête a été long-
tems célébrée parmi les Juifs, dans le goût des bacchanales
; 8c ils y pouffoient la débauche à de grands
excès, du moins pour la boiffon, prétendant que ce
fut par des feftins qu’Efther fçut mettre Arta'xerxes
dans la bonne humeur dont elle avoit befoin pour
.obtenir la délivrance de fa nation.
Pendant les jours de cette fête , on lit folemnelle-
ment dans les lÿnagogues le livre d’Efther : tout le
monde y doit affilier, hommes , femmes, enfans 8c
ferviteurs, parce que tousont eu part à la délivrance.
Chaque fois que le nom d’Aman revient dans cette
lefture, la coutume établie eft de frapper des mains
& des piés, en s’écriant : que fa memoire périffe ! C’eft
la derniere fête de leur année , car la fuivante eft la
pâque qui eft toujours au’ milieu du mois par lequel
commence l’année des Juifs. (D . J.)
PHYCITES , (Hiß. nat.) nom donne par les anciens
naturaliftes à une pierre chargée de l’empreinte
d’une plante marine, telle que l'algue ou le fucus*
PHYCUS, (Géog. anc.) promontoire & fo r te r e f lè
de la Cyrénaïque, félon Ptolomée , liv. IV. ch.jv.
Strabon, liv.XVII. pag. 865 ,dit que le promontoire
eftfortpeu élevé ; mais qu’il s’étend beaucoup du côté
du nord. Les mariniers italiens le nomment Cabo-
rena , à ce que prétend Niger.
PHYGELA, (Géog. anc.) ville de l’Ionie. Pline,
liv. V. c. xxix . 8c Pomponius Mêla, liv. I. c. xvij.
difent qu’elle fut bâtie par des fugitifs. Strabon, liv.
X IV . p. 63 g . Etienne le géographe qui l’a fuivi, 8c
Suidas , ne dérivent pas ce nom de tpuydç , qui veut
dire un fugitif j un exilé, mais de a\ , forte de maladie
dont les compagnons d’Agamemnon furent attaqués
, 8c qui les obligea de demeurer dans ce lieu ;
auffi ces auteurs n’ecrivent-ils pas Phygela, mais Page
la. Diofcoride , liv. V. c. xij. fait l’éloge du vin de
Phygela. Selon le P. Hardouin, le nom moderne de
cette ville eft Figcla. (D . J.)
PHYGETHLON, f. m. terme de Chirurgie, tumeur
inflammatoire, éréfipélateufe, dure , tendue, large,
peu elevée, garnie de petites pullules, accompagnée
d une douleur 8c d’une chaleur brûlante , 8c qui ne
vient prefque jamais enfuppuration. Voyc{T u m e u r .
Ce mot eft dérivé du grec <pva , j'engendre.
Le phygethlon ne différé duphyma , qu’en ce qu’il
ne s’élève pas fi haut ; il vient à maturité très-doucement
,8c ne produit qu’un peu de pus. Voye^ P h y m a .
_ Gorræus definit le phygethlon , un phlegmon qui
vient fur les parties g landuleufes , particulièrement
autour du col, des aiffelles & d e Faîne : ce dernier eft
appellé bubon. Voye^ P h l e g m o n , &c.
Les caufes &les fym ptomes du phygethlon font les
mêmes que ceux du bu bon commun. Voyc^ Bubon.
P H Y 5 3 5
îi vient fouvent après les fièvres & les douleurs du
bas-ventre , 8c on le guérit de même que les autres
inflammations. Voye^ In f l a m m a t i o n . ( T".)
PHYLACE, (Géog.anc.) nom commun à quatre
différens endroits. i ° . C’étoit une ville de laTheffa-
lie , dans la Phtiotide, au voifinage des Maliens, félon
Strabon , liv. IX.pag. 433. Il en eft fait mention
dans l’Iliade,B. v. 6<) 6 . On ne fait fi elle étoit fur la
côte ou dans les terres ; z°. c’étoit un lieu du Pélo-
ponnefe. Paufanias, Arcad. c. ult. dit que c’eft ôûle
fleuve Alphée prenoit fa fource. 30. C’étoitune ville
de la Moloffide; felonTite-Live, l. X LV. c. xxvj. elle
étoit différente de celle de Theffalie. 40. C ’étoit enfin
Une ville de la Macédoine dans la Piérie, félon Ptolomée
, liv. III. c. xiij. qui écrit auffiphylacce. (D. J .)
PHYLACTERE, f.m. (Hift. anc.) nom qui figni*
fie en grec préfervatif, 8c que. les Juifs ont donné à
certains inftrumens ou ornemens qu’ils portoient 8c
qu’ils appelloient en hebreu thephilim , c’eft-à-dire
in f rumens depriere, parce qu’on les portoit particulièrement
dans le tems de la priere. Ces philatteres des
Juifs étoient des morceaux de parchemin bien choi-
fis, fur lefquels on écrivoit en lettres quarrées avec
foin, 8c avec de l’encre préparée exprès , des paffa-
ges de la loi. On les rouloit enfuite, &: on les attachoit
dans une peau de yeau noire qu’on portoit, foit au
bras, foit au front..Il eft fait mention de ces philac-
teres dans l’évangile de faint Matthieu , où J. C. fai-
fant le portrait des Pharifiens,dit qu’ils aiment à étendre
leurs phylactères : dilatant phylari era fua ; c’efl-
à-dire qu’ils affe&oient d’en porter de plus larges que
les autres.Quelques-uns croyent que Moyfe eft Fauteur
de cette coutume , 8c fe fondent fur ce verfet
du Deuteronome ch. vj. Vous lierez ces paroles pout
jignes fur vos mains , 6* elles vous feront comme des
fronteaux entre vos yeux. Mais faint Jerome foutient
avec raifon, que ces expreffions font figurées 8c lignifient
feulement que les Hebreux dévoient toujours
avoir la loi de Dieu devant les y e u x , 8c la pratiquer ;
mais les Pharifiens s’entenoient ridiculement à la lettre
, 8c leurs defeendans les doèleurs juifs modernes
ont pouffé l’extravagance fur les phylactères, jufqu’à
foutenir férieufement que Dieu en portoit fur fa tête.
Quelques auteurs ont étendu le nom de phylactère
aux anneaux 8c bracelets conftellés ,.aux talifinans,
& même aux reliques des faints.^oye^ T alisman,^ «
PHYLARQUE, f. m. (Antiq. grecq.) en grec <pu-
Actp^HÇ ou (pvXcLpxoç , chef d'une tribu. Le peuple des
grandes villes grecques étoit partagé en un certain
nombre de tribus qui parvenoient fucceffivement 8c
dans des tems réglés , au gouvernement de la république.
Chaque tribu avoit fon chef ou phylarque qui
préfidoitaux affemblées de fa tribu, avoit l’inten-*
dance 8c la direction de fon tréfor 8c de fes affaires*
Ariftote dans fes Politiques , parle de ces phylarques*
Hérodote rapporte que Califtene ayant augmenté le
nombre des tribus d’Athènes, 8c en ayant formé dix de
quatre anciennes, ilaugmênta auffidansla même proportion
, le nombre des phylarques. Les marbres de
Cyzique font mention de plufieurs phylarques ; on
lit fur un marbre de Nicomédie, qu’Aurelius - Eari-
nus avoit été phylarque d’une des tribus de cette ville.
Dans la fuite , ce terme perdit fa lignification naturelle
8c primitive , en devenant, le titre d’une dignité
militaire. On y fubftitua le nom.d’êpimelite , ad-
miniftrateur , préfident, afin d’éviter toute équivoque
, 8c de n’être pas fans ceffe dans le rifque de confondre
le commandant d’une troupe de cavalerie ,
avec un magiftrat. Potter, Archceol. greec. liv. l.c .xiij.
Il eft auffi parlé de phylarques dans l’empire grec,
où Fon donnoit ce nom au chef des troupes que Fon
fourniffoit'aux alliés, ou que les alliés fourniffoient
à l’empire ; c’eft ainfi qu’il fut donné au chef desSar?
L