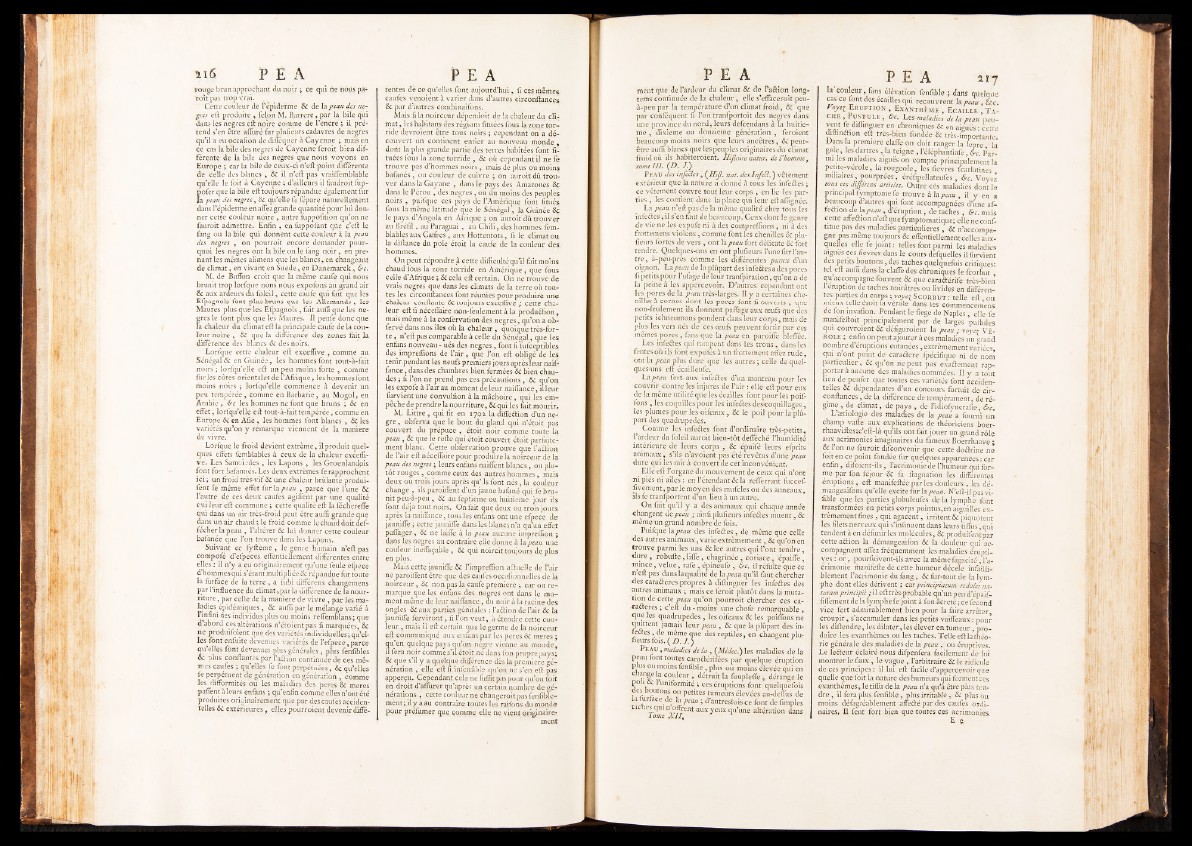
« 6 P E A
rouge brun.approchant du noir ; ce qui ne riôüs pà-
'roît pas trop vrai.
Cette couleur dé l’epiderme & de la peau des negres
eft produite , félon M. Barrere, par la bile qui
dans les negres eft noire comme de l’encre ; il prétend
s’ en être alluré fur plufieurs cadavres de negres
qu’il a eu occafion de diüéquer a Cayenne ; mais en
ce cas la bile des negres de Cayenne feroit bien différente
de la bile des negres que nous voyons en
Europe ; car la bile de ceüx-ci ri’eft point différente -
de celle des blancs , & il n’eft pas vraiflèmblable
qu’elle le foit à Cayenne ; d’ailleurs il faudroit fiip-
pofer que la bile e11 toujours répandue également fur
fa peau des negres, & qu’elle fe fépare naturelleinent
dans l’épiderme en alfez grande quantité pour lui donner
cette couleur noire , autre liippofition qu’on ne
fauroit admettre. Enfin , en fuppofant qüe c’eft le
fang ou la bile qui donnent cette couleur à la peau
des negres , on pourroit encore demander pourquoi
les negres ont la bile ou le fang noir, en pre*-
hant les mêmes alimens que les blancs, en changeant
de climat, en vivant en Suede, en Danemarck, &c.
M. de BufFon croit que la même caufe qui nous
brunit trop lorfque nons nous expofons àu grand air
& aux ardeurs du foleil, cette caufe qui fait que les
Efpagnols font plus bruns que les Allemands , les
Maures plus que les Efpagnols , fait aufii que les negres
le font plus que les Maures. Il penfe donc que
la chaleur du climat eft la principale caufe de la cou*
leur noire , & que la différence des zones fait la
différence des blancs & des noirs.
Lorfque cette chaleur eft exceflive , comme au
Sénégal & en Guinée, les hommes font tout-à-fait
noirs ; lorfqu’elle eft un peu moins forte , comme
furies côtes orientales de l’Afrique, les hommes font
moins noirs ; lorfqu’elle commence à devenir un
peu tempérée , comme en Barbarie, au Mogol, en
Arabie , &c les hommes ne font que bruns ; & en
effet, lorfqu’elle eft tout-à-fait tèmpérée, comme en
Europe & en A fie , les hommes font blancs , & les
variétés qu’on y rémarque viennent de la maniéré
de vivre.
Lorfque le froid devient extrême, il produit quelques
effets femblables à ceux de la chaleur exceflive.
Les Samoïides , les Lapons , les Groenlandpis
font fort bafannés. Les deux extrêmes fe rapprochent
ici ; un froid très-vif & une chaleur brûlante produi-
fent le même effet fur la peau , parce que l’une &
l’autre de ces deux caufes agiflènt par une qualité
qui leur eft commune ; cette qualité eft la féchereffe
qui dans un air très-froid peut être aufli grande que
dans un air chaud ; le froid comme le chaud doit aef-
fécher la peau , l’altérer & lui donner cette couleur
bafanée que l’on trouve dans les Lapons.
Suivant ce fyftème , le genre humain n’eft pas
compofé d’efpeces effentiellement différentes entre
elles : il n’y a eu originairement qu’une feule efpece
d’hommes qui s’étant multipliée & répandue fur toute
la furface de la terre , a fiibi différens changemens
par l’influence du climat, par la différence de la nourriture
, par celle de la maniéré de vivre , par les maladies
épidémiques , & aufli par le mélange varié à
l’infini des individus plus ou moins reffemblans; que
d’abord ces altérations n’étoientpas fi marquées, &
ne produifoient que des variétés individuelles ; qu’elles
font enfuite devenues variétés de l’efpeçe, parce
qu’elles font devenues plus générales, plus fenfibles
& plus confiantes par l’aftion continuée de ces mêmes
caufes ; qu’elles fe font perpétuées, & qu’elles
fe perpétuent de génération en génération , comme
les difformités ou les maladies des peres & meres
paffent à leurs enfans ; qu’enfin comme elles n’ont été
produites originairement que par des.caufes accidentelles
& extérieures, elles pourroienr devenir diffé-
P E A
fentes dè ce qu’elles .font aujourd’h u i, fi ces mêmes
caufes venoient à varier dans d’autres cireonftançes
& par d’autres combinaiforis.
Mais fi la noirceur dépendoit de la chaleur du cli-i
mat, les habitans des régions fituées fous la zoqe torride
devraient être tous noirs ; cependant on a découvert
un continent entier au nouveau monde ,
dont la plus grande partie des terres habitées font fituées
fous la zone torride , & oh cependant il ne fe
trouve pas d’hommes noirs , mais de plus ou moins
bafanés , ou couleur de cuivre ; on auroit dû trouver
dans la Gayane , dans le pays des Amazones &
dans le Pérou , dés negres , ou du moins des peuples
noirs , puifque ces pays de l’Amérique font fitués
fous la même latitude que le Sénégal, la Guinée &c
le pays d’Angola en Afrique ; on auroit dû trouver
au Bréfil, au Paraguai , au Chili, des hommes femblables
aux Catfres , aux Hottentots, fi le climat ou
la diftance du pôle étoit la caufe de la couleur des/
hommes.
On peut répondre à cette difficulté qu’il fait moins
chaud fous la zone torride en Amérique , que fous
celle d’Afrique ; & cela eft certain. On ne trouve de
vrais negres que dans les climats de la terre où toutes
les circonftances font réunies pour produire une
chaleur confiante & toujours exceflive ; cette chaleur
eft fi néceffaire non-feulement à la produClion ,
mais meme à la confervation des negres, qu’on a ob-
fervé dans nos îles oh la chaleur , quoique très-forte
, n’eft pas comparable à celle du Sénégal, que les
enfans nouveau - nés des negres, font fi fufceptibles
des impreffions de l’a ir , que l’on eft obligé de les
tenir pendant les neufs premiers jours après leur naifj
fance, dans des chambres bien fermées & bien chaudes
; fi l’on ne prend pas ces précautions, & qu’on
les expofe à l’air au moment de leur naiffançe, il leur
furvient une convulfion à la mâchoire, qui les empêche
de prendre la nourriture, & qui les fait mourir.
M. Littré , qui fit en 1701 la aiffeélion d’un ne--
g re , obferva que le bout du gland qui n’étoit pas
couvert du prépuce , étoit noir comme toute la
peau , & que le relie qui étoit couvert étoit parfaitement
blanc. Cette obfervation prouve que l’adion
de l’air eft néceffaire pour produire la noirceur de la
peau des negres ; leurs enfans naiffent blancs, ou plutôt
rouges , comme ceux des autres hommes , mais
deux ou trois jours après qu’.ls font nés, la couleur
change , ils paroiffent d’un jaune bafané qui fe brunit
peu-à-peu , & au feptieme ou huitième jour ils
font déjà tout noirs. On fait que deux ou trois jours
apres la naiffançe, tous les enfans ont une efpece de
jauniffe ; cette jauniffe dans les blancs n’a qu’un effet
paffager, & ne laiffe à la peau aucune impreffion ;
dans les negres au contraire elle donne à la peau une
couleur ineffaçable , & qui noircit toujours de plus
en plus.
Mais cette jauniffe & l’impreffion aCluelle de Pair
ne paroiffent être que des caufes occasionnelles de la
noirceur, & non pas la caufe première .; car on remarque
que les enfans des negres ont dans le moment
même de leur naiffançe,, du noir à la racine des
ongles & aux parties génitales : l’a&ion de Pair & la
jauniffe ferviront, fi l’on veut, à étendre cette couleur
, mais il eft certain que le germe de la noirceur
eft communiqué aux enfans par les peres & meres ;
qu’en quelque pays qu’un nègre vienne au monde,
il fera noir comme s’il étoit ne dans fon propre pays;
& que s’il y a quelque différence dès la première génération
, elle eft fi infenfible qu’on ne s’en eft pas
apperçu. Cependant cela ne fuffit pas pour qu’on foit
en droit d’aflurer qu’après un certain nombre de générations
, cette couleur ne changeroitpas fenfible-
mentj ily a au contraire toutes les raifons du monde
pour prefumer que comme elle ne vient originairement
P E A
ment que de l’ardeur du climat & de PaéKon long-
tems continuée de la chaleur, elle s’effaceroit peu-
à-peu par la température d’un climat froid, & que
par conféquent fi l’on tranfportoit des negres dans
une, province du nord, leurs defeendans à la huitième
, dixième ou douzième génération , feraient
beaucoup moins noirs que leurs ancêtres, & peut-
être aufli blancs que les peuples originaires du climat
froid oh ils habiteroient. Hiïloire natur. de L'homme,
’tome III. (D- /•)
Peau des infefles, ( . nat.des Infecl. ) vêtement
extérieur que la nature a donné à. tous les infeCles ;
ce vêtement couvre tout leur corps , en lie les parties
, les contient dans la place qui leur eft afîïgnée.
La peau n’eft pas de la même qualité chez tous les
infeCles, il s’en faut de beaucoup. Ceux dont le genre
de vie ne les expofe ni à des comprenions , ni à des
frotteinens viôlens, comme font les chenilles & plufieurs
fortes de vers , ont la peau fort délicate & fort
tendre. Quelques-uns en ont plufieurs l’une fur l’autre
, à-peu-près comme les différentes peaux d’un
oignon. La peau de la plûpart des infeâes a des pores
fi petits pour l’ufage de leur tranfpiration, qu’on a de
la peine à les appércevoir. D ’autres cependant ont
les pores de la peau très-larges. Il y a certaines chenilles
à cornes dont les pores font fi ouverts , que
non-feulement ils donnent paflage aux oeufs que des
petits ichneumons pondent dans leur corps, mais de
plus les vers nés de ces oeufs peuvent fortir par ces
mêmes pores , fans que la peau en paroiffe bleffée.
Les infeCles qui rampent dans les trous , dans les ;
fentes oh ils font expofes à un frottement affez rude,
ont la peau plus dure que les autres ; celle de quelques
uns eft écailleüfe.
La. peau fert-aux infeCles d’un manteau pour les
couvrir contre les injures de l’air : elle eft pour eux
de la même utilité que les écailles font pour les poif-
fons , les Coquilles pour les infeCles des*coquillages,
les plumes pour les oifeaux, & le poil pour la plûpart
des quadrupèdes.
Comme les infeCles font d’ordinairé très-petits,
l’ardeur du foleil auroit bien-tôt defféché l’humidité
intérieure de leurs corps , & épuifé leurs efprits
animaux, s’ils n’avoient pasetérevêtus d’une peau
dure qui les mît à Couvert de cet inconvénient.
Elle eft l’organé du mouvement de ceux qui n’ont
ni pies ni ailes : en l’etendant & la reflerrant fiiccef-
fivement, par le moyen des mufcles ou des anneaux,
ils fe tranfportent d’un lieu à Un autre.
On fait qii’il y a des animaux qui chaque année
changent de peau ; ainfi plufieurs infeéles muent, &
même un grand nombre de fois.
Puifque la peau des infeéles , de même que celle
des autres animaux, varie extrêmement, & qu’on en
trouve parmi les uns & lee autres qui l’ont tendre,
dure , robufte, liffe, chagrinée, coriace, épaiffe ,
mince, velue, rafe, épineufe , &c. il réfulte que ce
n eft pas dans la qualité de la peau qu’il faut chercher
des caraôeres propres à diftinguer les infeéles des
autres animaux ; mais ce feroit plutôt dans la mutation
de cette peau qu’on pourroit chercher ces caractères
; c’eft du - moins une chofe remarquable,
que les quadrupèdes , les oifeaux & les poiffons ne
quittent jamais leur peau , & que la plûpart des infectes
, de même que des reptiles, en changent plufieurs
fois. (Z), ƒ .)
Peau , maladies de la , (Médec.) les maladies de la
peau font toutes caraCtérifées par quelque éruption
plus ou moins fenfible, plus ou moins élevée qui en
c !ange la couleur , détruit la foupleffe , dérange le
po 10L 1 uniformité ; ces éruptions font quelquefois
des boutons ou petites tumeurs élevées au-deffus de
• “ irtace.de la peau ; d’autresfois ce font de fimples
taches qui n offrent aux yeux qu’une altération dans
i orne X I I ,
P E A 217
la couletir, fans élévation fenfible ; dans ôitelcfue
cas ee font des écaillés qui refioüvrent la peau , tic.
ro je i Eruption , Exanthème , Ecaille , T a -
c h k , Pu s t u l e , &c. I.es maUdus de la peau peu.
vent le diftinguer en chroniques & en aiguës • cette
diflinaion eft-très-bien fondée & très-importante
Dans la premiefe, claffe Ori i doit ranger la lepre - la
■ gâte,fies dârttes . la teigne , l’éléphantiafe, &c. Parmi
les maladies aiguës on compte principalement la
pente-vérole , lairongscrte, les Sériés fcarlatines
miliaires, pourprées, éréfipellateufes-j Voyez
tous ces différens articles. Outre cés maladies dont lé
pnncipalïfymptonie.fe trouvé i h peau, il y en a
beaucoup d’autres qui font accompagnées d’une af-
feélion de la,peau, d’éruption, de taches , &c. mais
cette affection n’eft que fymptomatique; elle ne conf-
titue pas des maladies particulières, & n’accompa-
gné pas même toujours & effentiellement celles auxquelles
elle f e joint : telles font parmi les maladies
aigues ces fievres-dans le cours defquelles il furvient
des petits boutons, des taches quelquefois critiques:
tel eft aufli dans la claffe des chroniques le feorbut ,
qu’accompagne fouvent & que caraélérife très-bien
1 éruption de taches noirâtres ou livides en différentes
parties du corps ; voye^ Sco rbu t : telle eft ou
mieux telle étoit la vérole dans les commencemens
de fon invafion. Pendant le fiege de Naples elle fe
manifeftoit principalement par de larges pullules
qui couvroient & défiguroient la peau ; voyer VÉROLE
; enfin on peut ajouter à ces maladies un grand
nombre d’éruptions cutanées, extrêmement variées
qui n’ont point de caraftere fpécifique ni de nOm
particulier, & qu’on rie peut pas' exactement rapporter
à aucune des maladies nommées. Il y a tout
lieu de penfer que toutes ces variétés font accidentelles
& dépendantes d’un concours fortuit de cir-
conftances , de la différence dé tempérament, de régime
, de climat, de pays , de l’idiofyncrafie, &c.
L’ætiologie des maladies de la peau a fourni un
champ vafte aux explications de théoriciens boer-
rhaaviftes;c’eft-là qu’ils ont fait jouer un grand rôle
aux acrimonies imaginaires du fameux Boerrhaavë ;
& l’on ne fauroit difconvenir que cette doClrine ne
foit en ce point fondée fur quelques apparences : car
enfin, difoient-ils, l’acrimonie de rhumeur qui forme
par fon féjour & fa ftagnation le s1 differentes
éruptions , eft manifeftée parles douleurs , les dé-
mangeaifons qu’elle excite fur la peau. N’eft-il pas vi-
fible que les parties globuleufes de la lymphe font
transformées en petits corps pointus,en aiguilles extrêmement
fines , qui agacent, irritent & piquotent
les filets nerveux qui s’infinuentdans leurs tiffus, qui
tendent à en défunir les molécules, & produifent par
cette a&ion la démangeaifon & la douleur qui accompagnent
affez fréquemment les maladies éruptives
: o r , pourfuivent-ikavec la même fagacité, l’acrimonie
îhanifefte de cette humeur décele infailliblement
l’acriihonie du fang, & fur-tout de la lymphe
dont elles dérivent ; car principiatum redolet natur
arn principii ; il eft très-probable qu’un peu d’épaif-
.fiffement de la lymphe fe joint à fon âcreté ; ce fecorid
vice fert admirablement bien pour la faire arrêter
•croupir, s’accumuler dans les petits vaiffeaux: pour
les diftendre, les dilater, les élever en .tumeur, produire
les exanthèmes ou les taches. T elle eft la théorie
générale des maladies de la peau, ou éruptives.
Le leCleur éclairé nous difpenfera facilement de lui
montrer le faux, le vague , l’arbitraire & le ridicule
de ces principes : il lui eft facile d’appercevoir que
quelle que foit la nature des humeurs qui forment ces
exanthèmes, letiffu de la peau n’a qu’a être plus tendre
, il fera plus fenfible, plus irritable, & plus ou
moins défagréablement affeClé par des caufes ordinaires,
Il fent fort bien que-toutes ces acrimonies
E e.