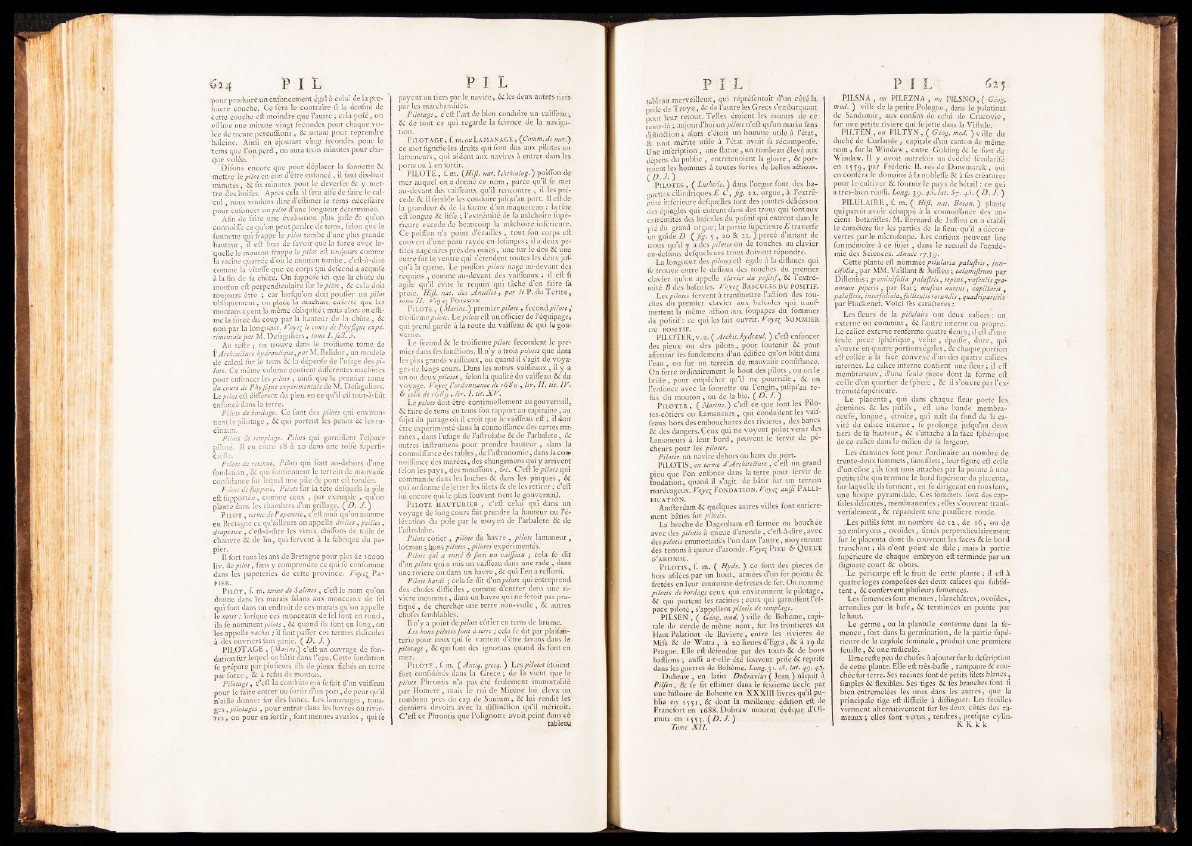
||# P I L
pour produire lift enfoncement égal à celui de la çTre-
iniere couche. Ce fera le contraire il la denfite de
cette couche eft moindre que l’autre ; cela pofé, on
eftime une minute vingt fécondés pour chaque vo-
ïé e dp trente percuflions, & autant pour reprendre
'haleine. Ainfi en ajoutant vingt fécondés pour le
teins que -t’onperd , on aura trois minutes pour chaque
volée»
Difons encore que pour déplacer la fonnette &
mettre le pilot en-état d’ètre enfoncé, il faut dix-huit
minutes, & fix minutes pour le deverfer & y mettre
des boites. Après cela il fera aifé de faire le cal-
‘cul nous voulons dire,d’eftimer le tems néceffaire
■ pour enfoncer un pilot d’une longueur déterminée.
Afin de faire une évaluation plus jufte & qu’on
çonnoiffe ce qu’on peut perdre de tems, félon que la
fonnette qui frappe le pilot tombe d’une plus grande
hauteur il eft bon de favoir que la force avec laquelle
le mouton frappe le pilot eft toujours comme
la racine qùarrée d’où le mouton tombe, c’eft-à-dire
comme la vîteffe que ce corps qui defcend a acquife
à la fin de fa chute. On fuppofe ici que la chute du
mouton eft perpendiculaire fur le pilot, & cela doit
toujours être ; car lorfqü’on doit pouffer un pilot
-obliquement ., on place'la machine, enfqrte que les
montans âyent la même obliquité ; mais alors on efti-
•me la force du coup par la hauteur de la chute, &
non par la longueur. Foyei le cours de Phyjique expérimentale
par M. Defaguliers, tome l.fecl. 5.
Au refte * on trouve dans le troifieme tome de
VArchitecture hydraulique ypar M. Belidor, un modèle
de calcul fur le tems & la dépenfe de l’ufage des pilots.
Ce même volume contient différentes machines
pour enfoncer les pilots , ainfi que le premier tome
du cours de Phyjique expérimentale de M. Defaguliers.
Le pilot eù. different du pieu en ce qu’il efttout-à-fait
'enfoncé dans la terre.
Pilots de bordage. Ce font des pilots qui environnent
le pilotage , & qui portent les patins & les ra-
cinaux.
Pilots de remplage. Pilots qui garniffent l’efpace
piloté. Il en entre 18 à 20 dans une toife fuperfi-
Ïielle. _ , - , L
Pilots de retenue. Pilots qui font au-dehors d’une
'fondation, 6C qui foutiennent le terrein de mauvaife
confiftance fur lequel une pile de pont eft fondée.
Pilots de fupport. Pilots fur la tete defquels la pile
eftfupportée, comme ceux , par exemple , qu’on
plante dans les chambres d’un grillage. ( D . J. )
PiLOT, terme de Papeterie, c’eft ainfi qu’on nomme
en Bretagne ce qu’ailleurs on appelle drilles , peilles,
•drapeaux, c’eft-à-dire les vieux chiffons de toile de
chanvre & de lin, qui fervent à la fabrique du papier.
Il fort tous les ans de Bretagne pouf plus de iqooo
ü v. àepilot ,*fans y comprendre ce qui fe confomme
dans les papeteries de cette province. Foye^ Papier.
Pilot , f. m. terme de Salines , c’ eft le nom qu’on
donne dans les marais falans aux monceaux de fel
qui font dans un endroit de ces marais qu’on appelle
le mort : lorfque ces monceaux de fel font en rond,
ils fe nomment pilots , & quand ils font en long, on
les appelle vaches ; il faut paffer ces termes ridicules
à des ouvriers fans génie. ( D. J. )
PILOTAGE, {Marine.') c’eft un ouvrage de fondation
fur lequel onbâtit dans l’eau. Cette fondation
fe prépare par plufieurs fils de pieux fichés en terre
par force, & à refus de mouton.
Pilotage, c’eft la conduite qui fe fait d’un vaiffeau
pour le faire entrer ou fortir d’un port, de peur qu’il
n’aille donner fur des bancs. Les lamanages, tona-
ges, pilotages , pour entrer dans les havres ou rivie-
' Tes, ou pour en fortir, font menues avaries , qui fe
P I L
payeritun tiers par le navire, & les deux autres tiers
par les màrchandifes.
Pilotage .y c’eft .l’art de bien conduire un vaiffeau -,
& de tout -ce qui regarde la fcience de, la navigation.
P i l o t a g e , f .m.ouL a m a n a g e , (Comm.demer.)
ce mot fignifie-les droits qui font dus aux .pilotes ou
lamaneurs, qui aident aux navires à entrer dans les
ports ou à en fortir. v;
PILOTE, f. m. (H i j l . nat. Ichthiolog.) poiffon dé
mer auquel on a donne ce nom, parce qu’il fe met
àu-dévant des vaiffeaux qu’il rencontre , il les précédé
& il femble les Conduire jufqu’au port. Il eft de
la grandeur & de la forme d’un maquereau : la tête
eft longue & lifté ; l’extrémité de la mâchoire fupé-
rieure excede de beaucoup la mâchoire inférieure.
Ce poiffon n’a point d’écailles , tout fon corps eft
couvert d’une peau rayée ën loiànges ;. il a deux petites
nagèoires près des ouïes, une fur le dos & unè
autre fur le. ventrè qui s’étendent toutes les deux jufi
qu’à la queue. Le poiffon p ilo te nage au-devant des
requins , comme au-devant des vaiflèaux ; il eft fi
agile qu’il évite le requin qui tâche d’en faire fa
proie. H j jî. n a t. des A n t il le s , p a r le P. du Tertre,
tome Ï I . F o y é { POISSON.
Pi l o t e , (Marine.) premier pilote, fécond pilote ,
troifieme pilote. Le pilote eû un officier de l’équipage*
qui prend garde à la route du vaifléau & qui le gouverne.
Le fécond & le troifieme pilote Xeconfient le pre*
mier dans fes fondions. Il n’y a trois pilotes que dans
les plus grands vaiffeaux, ou quand il s’agit de voyages
de longs cours. Dans les autres vaiffeaux, il y a
un ou deux pilotes, félon la qualité du vaiffeau & du
voyage. Foye£ Vordonnance de 1680 , liv. TI. lit. I F >
& et lie de 1689 , liv. I. tït. X F .
Le pilote doit être continuellement aù gouvernail,
& faire de tems en tems fon rapport au capitaine, au
fujet du parage où il croit que le vaiffeau eft ; il doit
être expérimenté dans la connoiffance des cartes marines
, dans l’ufage de l’aftrolâbe & de l’arbalete, &
autres inftrumens pour prendre hauteur , dans la
connoiffance des tables, de l’aftronomie, dans la coït«
noiffance des marées, des changemens qui y arrivent
félon les pa ys, des mouflons, &c. C ’eft le pilote qui
commande dans les bûches & dans les pinques , &
qui ordonne de jeiter les filets & de/les retirer ; c’eft
lui encore qui le plus fouvent tient le gouvernail.
P il o t e h a u t u r ie r , c’eft celui qui dans un
voyage de long cours fait prendre la hauteur ou l’élévation
du pôle par le moyen de l’arbalete & de
l’aftrolabe.
Pilote côtier , pilote de havre , pilote lamaneur ,
locman ; bons pilotes, pilotes expérimentés.
Pilote qui a entré & forti un vaiffeau ; cela fe dit
d’un pilote qui a mis un vaiffeau dans une rade , dans
une riviere ou dans un havre, & qui l’en a refforti.
Pilote hardi ; celafe dit d’un pilote qui entreprend
des chofes difficiles, comme d’entrer dans une riviere
inconnue, dans un havre qui ne feroit pas pra-*.
tiqué , de chercher une terre non-vufte , & autres
chofes femblahles.
Il n’y a point de pilote côtier en tems de brume.
Les bons pilotes font à terre ; cela fe dit par plaifan-
terie pour ceux qui fe vantent d’être favans dans le
pilotage , & qui font des ignorans quand ils font en
mer.
P i l o t e , f. m. ( Antiq. gr'ècq. ) Les pilotes étoient
fort confidérés dans la Grece ; de là vient que le
pilote Phrontis n’a pas été feulement immortalifé
par Homere, mais le roi de Micène lui éleva un
tombeau près du cap de Sunium, & lui rendit leS
derniers devoirs avec la diftinûion qu’il méritoit.
C ’eft ce Phrontis que Polignotte avoit peint dans cè
tableau,
P I L
tableau merveilleux, qui répréfentoit d’un côté-la
prife de T ro y e , & de l’autre les Grecs s’embarquant
pour leur retour. Telles, étoient les moeurs de ce
tems-là ; aujourd’hui un pilote n’eft qu’un marin fans
diftinétion; alors c’étoit un homme utile à l’état,
èt tout mérite Utile à l’état avoit fa récompense,
Une; infçription, une ftatue , un tombeau élevé aux
dépens du public , entrétenoient la gloire , & por-
toient les hommes à toutes fortes de belles a étions.
( D . J . )
Pilotes., ( Lutherie. ) dans l’orgue font des baguettes
ciîindriques E C , fig. 22. orgue, à l’extrémité
inférieure defquelles font des jointes déliées ou
des. épingles qui entrent dans des trous qui font aux
extrémités, des bafcules du pofitifqm entrent dans le
pié du grand orgue ; la partie Supérieure E traverfe
un guide D ( fig, y , 20 & 22, ) percé d’autant de
trous qu’i l y a des pilote? ou de touches, auclayier.
au-deffous. defquels ces trous dqiv.ent répondre.
La. longueur des pilotes.efi égale à la diftance qui
fe trouve entre le deffpus des touches du premier
clavier qu’on appelle clavier du pofitij', & l’extrémité
B des bafcules. Foye^ Basçules du positif.
Les pilotes fervent, à tranûnettre l’aclion des touches
du premier clavier aux bafcules qui transmettent
la même aftion aux foupapes du fommier
du pofitif : ce qui les fait ouvrir- Koye{ Sommier
du positie.
PILOTER, v. a, ( Arckit.hydrqul. ) ç’eft enfoncer
des pieux ou des pilots^,, pour foutenir & ppur
affermir les fondemens d’un édifice qu’on bâtit dans
l’eau , ou fur. un terrein de: mauvaife confiftance.
On ferre.ordinairement le bout des pilots,, ou on le
brûle, pour empêcher qu’il ne. pçurriffe,, &; on
l’enfonce avec la fonnette ou l’engin, jufqu’au re-
fus du mouton , ou de là hie. ( D . J. )
Pilo t e r , ( Marine.) c’eft ce que font les P1I0-
tes-côtiers ou. Lamaneurs, qui conduifent les vau-
feaux hors des embouchures des rivières , des bançs
&; des dangers. Ceux qui ne VQyent. point venir des
Lamaneurs à leur bord, peuvent fe feryir, de pécheurs
pour les piloter.
Piloter un navire dehors qit hors du port.
PILOTIS, en terme, d'Architecture , ç’eft un grand
pieu que l’on enfonce dans la terre pour fërvir de
fondation, quand il s_’agit de bâtir fur un terrein
marécageux. Foye{ FONDATION, Foye%_ aufji Pa lli-
ELCATION.
Amfterdam & quelques autres villes font entièrement
bâties, fur pilotis, ( ,
La breche de Dagenham eft fermée ou, bouchée
avec des pilotis.h queue d’afonde, ç’eft-à-dire,avec
des pilotis emmortaifés l’un dans l’autre, moyennant
des tenons à queue d’aronde. Foye^ Pieu 6* Q ueue
d’arondé. . t
Pilotis , f. m. ( Hydr, ), ce font des pièces de
bois afilées par un bout, armées d’un fer pointu &
frétées en leur couronne de frétés de fer. On nomme
pilotis de bordage ceux qui environnent le pilotage,
& qui portent les racines ; ceux qui garniffent l’efi
pace piloté, s’appellent pilotis de remplage.
PILSEN , ( Géog. moi, ) ville de Bohème, capitale
du cercle de même nom, fur les frontières du
Haut-Palatinat de Bavière, entre les rivières de
Mifa & de Watt a , à 20 lieues d’Egra, à *9 de
Prague. Elle eft défendue par des tours & de bons
battions ; aufli a-t-elle été fouvent prife & reprife
dans les guerres de Bohème. Long.ji. 18. Ipt. 49. 4,3,.
Dubraw , en latin Duhravius ( Jean ), naquit à
Pilfen, & fe fit çftimer dans le fçiri.eme fie cl e paç
une hiftoire de Boheme en XXXIII livrés qu’il publia
en 1551, & dont la meilleure éditfon efi dq
Francfort en 1688. Dubrav mourut évé^ue d’Ql-
tnutz en 15 53. f D . J. )
Tome X I I ,
p i l m
PILSNA , ou PILEZNA .»/ou PILSNO, ( Géog.
mod. ) ville de la petite Pologne , dans le palatinat
de Sand,omir, aux confins de celui de Cracovie,
fur unç petite riviere qui fe jette dans la Viftule.
PILT.EN , ou PILTYN, ( Géog. mod. ) v ille du
duché de Curlande, capitale d’un canton de même ’
nom, fur la Windaw , entre Qolding & le fort de
Windaw. Il y avoit autrefois un évêché fécularifé
en 15,59, par Frédéric -II.; rp,i de. Danemarck , qui:
en contera le domaine à la nobleffe & à fes créatures ;
pour le cultiver 6c fournir le .pays, de bétail : ce qui'
atrès-bien réufti. Long. 3 cj. 4J. lut. 5y. q5. ( D . J . )
PILULAIRE, f. m. ( Hift. nat. Botan.) plante
quiparoît avoir échappé à la connoiffance des an-'
ciens botaniftes. M. Bernard de Juflieu en a établi
le cara&erè fur les parties de la fleur qu’il a découvertes
par le microfcope. Les curieux peuvent lire
fon mémoire à ce fujet, dans le recueil de l’académie
des Sciences. Année i j 3S)-
Cette plante eft nommée piliilaria palufiris, jun-
cifolia, par MM. Vaillant & Juflieu ; calamifirum par
Dillenius ; graminifolia palufiris y repens, vafculis gra•
noriim piperis , par Rai ; mufeus aur/eus, capillans ,
palufiris, interfoliolay folliculis rotundis , quadripartitis:
par Pluckenet. Voici fes carafteres :
Les fleurs de la pilulaire ont deux calices : un
externe ou commun , & l’autre interne ou propre.
Le calice externe renferme quatre fleurs;il eft d’une
feule pièce' fphérique, velue , épaiffe, dure, qui
s’ouvre en. quatre portions égales, & chaque portion
eft collée à la face convexe d’un des quatre calices
internes. L e calice interne contient une fleur; il eft
membraneux, d’une feule piece dont la forme eft
celle d’un, quartier de fphere , & il s’ouvre par l’extrémité
fuperieure.
Le: placenta, qui dans chaque fleur porte les,
étamines & les piftils, eft une bande membra-
rieufe, longue, étroite, qui naît du fond de laça-,
vité du. calice interne, fe prolonge jufqu’au deux
tiers de fa hauteur, & s’attache à la face'fphérique.
de ce calice dans le milieu de fa largeur.
Les étamines font pour l’ordinaire au nombre de
trente-deux fommets, fans filets(; leur figure eft celle
d’un cône ; ils font tous attachés par la pointe à une
petite tête qui termine le bord fupérieur du placenta,
fur laquelle ils forment, en fe dirigeant en tous fens,
une houpe pyramidale. Ces fommets font des cap-
fules délicates, membraneufes, ; elles s’ouvrent tranf-
verfalement, & répandent une poufliere ronde.
Les piftils font au nombre de 12 , de 16 , ou de
20 embryons , ovoïdes, fitués perpendiculairement
fur le placenta dont ils couvrent les faces & le bord
: tranchant ; ils n’ont point de ftile ; mais la partie
fupérieure de chaque embryon eft terminée par un
! ftigmate court & obtus.
Le péricarpe eft le fruit de cette plante ; il. eft à
! quatre ioges compofées des deux calices qui fubfif-
tent, & confervent plufieurs femences.
Les femences font menues, blanchâtres, ovoïdes,
; arrondies par la bafe, & terminées en pointe par
le haut.
Le germe, ou la plantule contenue dans la fe-
mence , fort dans la germination, de la partie fupérieure
de la capfule femi’nale, produit une première
feuille, & une radicule.
lime refte peu cle chofes à ajouter fur la defeription
de cette plante. Elle eft très-baffe , rampante & couchée
fur terre. Ses racines font de petits filets blancs,
Amples & ftexibles. Ses tiges & les branches font fi
tien entremêlées les unes dans les autres, que la
principale tige eft difficile à diftinguer. Les feuilles
Viennent alternativement fur les deux, côtés des rameaux
; elles font vertes , tendres, prefque cylin-
K K k k