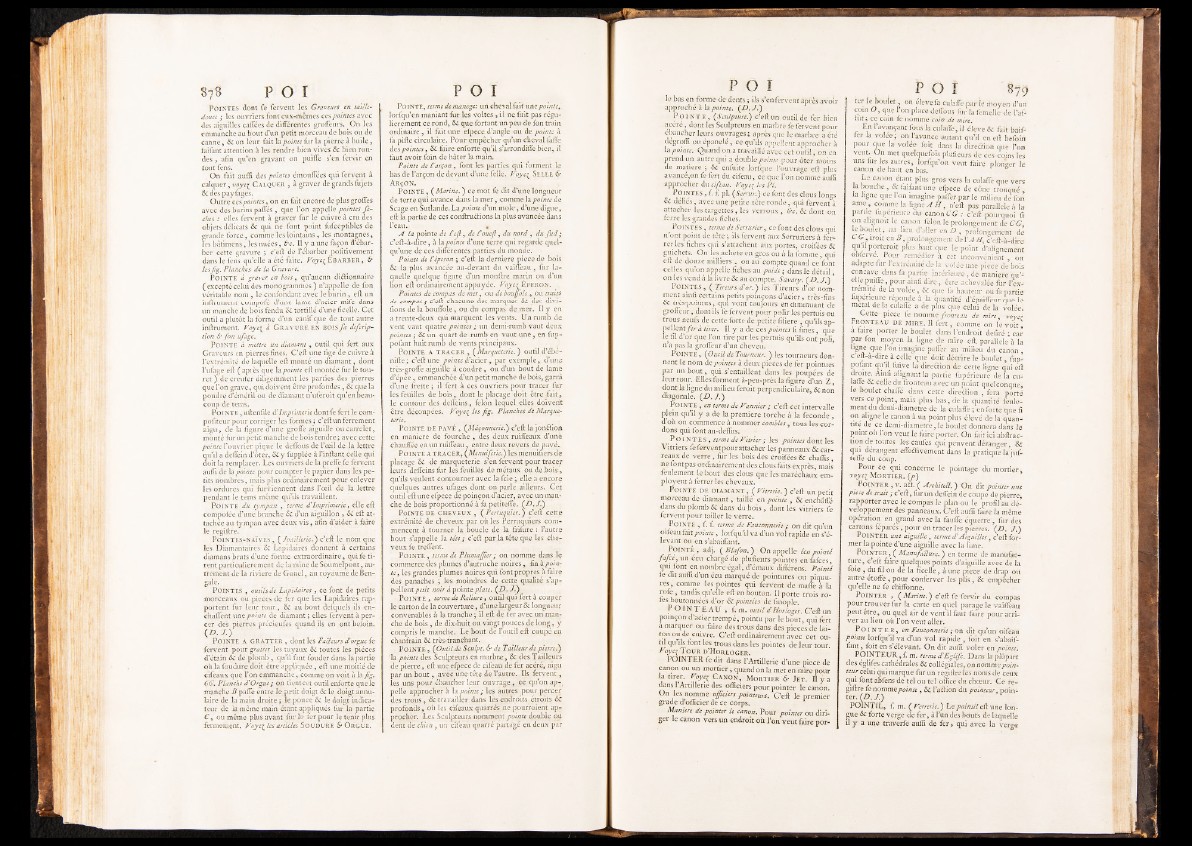
P o in t e s dont fe fervent les Graveurs en taille-
douce ; les ouvriers font eux-mêmes ces pointes avec
des aiguilles caffées de differentes groffeurs. On les
emmanche au bout d’un petit morceau de bois ou de
canne, 8c on leur fait la pointe fur la pierre à huile,
faifant attention à les rendre bien vives 8c bien rondes
, afin qu’en gravant on puiffe s’en fervir en
tout fens.
On fait auffi des pointes émouffees qui fervent à
calquer, voye^ C a l q u e r , à graver de grands fujets
8c des payfages.
O u t r e ce s pointes, o n en fa it e n c o r e de p lu s g r o f fe s
a v e c des burins p â lie s , q u e l’ o n a p p e lle pointes fe-
ches : e lle s fe r v e n t à g r a v e r fu r l e c u iv r e à c ru des
o b je ts d é lica ts 8c q u i n e fo n t p o in t fu fc e p tib le s de
g ran d e f o r c e , com m e le s lo in ta in s , le s m o n ta g n e s ,
le s b â t im e n s , le s nu é e s , &c. I l y a u n e fa ç o n d’ éba r-
b e r c e t te g r a v u re ; c ’ e ft de l’ e b a r b e r p o fit iv em e n t
d an s le fens q u ’e l le a é té fa ite . Voye^ É B A R B E R , &
les fig. Planches de la Gravure.
P o i n t e à graver en bois, qu’aucun diélionnaire
( excepté celui des monogrammes ) n’appelle de fon
véritable nom , lë confondant avec le burin , efl un
infiniment coinpofé d’une lame d’acier mife dans
un manche de bois fendu 8c tortillé d’une ficelle. Cet
outil a plutôt la forme d’un canif que de tout autre
infiniment. Voye{ à G r a v u r e EN BOIS fa deferip-
tion & fon ufiage.
POIN TE à mettre un diamant , o u t il q u i fe r t a u x
G r a v e u r s en p ie r re s fin es . C ’e ft u n e t ig e d e c u iv r e à
l ’ e x t r ém ité de la q u e lle e f l m o n té u n d iam a n t , d o n t
l ’u fa g e e f i ( ap rès q u e la pointe e f l m o n té e fu r le t o u -
r e t ) d e c r e u fe r d ilig em m en t le s p a r tie s d es p ie r re s
q u e l ’o n g r a v e , q u i d o iv e n t ê t r e p ro fo n d e s , 8c q u e la
p o u d r e d’ ém é r il o u d e d iaman t n 'u fe r o i t q u ’ en b e a u c
o u p de térhs.
P o i n t e ,u f ie n f i le d 'Imprimerie d o n t f e f e r t le com-
p o f it e u r p o u r c o r r ig e r le s fo rm e s ; c ’ e ft u n fe rr em en t
a i g u , d e la fig u r e d’u n e g r o ffe a ig u ille o u c a r r e le t ,
m o n té fu r u n p e t it m a n ch e d e b o is t en d r e ; a v e c c e t te
pointe l’o u v r ie r p iq u e le d e ffo u s d e l’oe i l de la le t t r e
q u ’il a d e ffe in d ’ô t e r , & y fu p p ié e à l’ in ftan t c e lle q u i
d o i t la r em p la c e r . Les o u v r ie r s d e la p re ffe fe fe r v e n t
au ffi de la pointe p o u r c om p te r le p a p ie r dans le s p e t
its n om b r e s , ma is p lu s o rd in a ir em e n t p o u r e n le v e r
le s o rd u r e s q u i fu r v ie n n e n t dans l ’oe i l d e la le t t r e
p en d an t le tem s m êm e q u ’ils t ra v a ille n t .
POIN TE du tympan , terme d'imprimerie, elle efi
compofée d’une branche 8c d’un aiguillon , & efl attachée
au tympan avec deux v is , afin d’aider à faire
le regillre.
P o i n t e s - n a ï v e s , ( Joaillerie.') c’ eft le nom que
les Diamantâirès 8c Lapidaires donnent à- certains
diamans bruts d’une forme extraordinaire, qui fe tirent
particulièrement de la mine de Soumelpont, autrement
de la riviere de Gonel, au royaume deBen-
galë.
P o in t e s , outils de Lapidaires, ce font de petits
morceaux ou pièces de fer que les Lapidaires rapportent
fur leur tour, 8c au bout defquels ils en-
chaffent une pointe de diamant ; elles fervent à percer
des pierres précieufes quand ils en ont befoin.„
P o i n t e a GRATTER , d o n t le s Facteurs £ orgue fe
f e r v e n t p o u r gratter [es tu y a u x 8c to u te s le s p iè c e s
d ’ é ta in 8c de p lom b , qu ’ il faut fo u d e r dans la p a r tie
o ù la fo u d u r e d o i t ê t r e a p p liq u é e , e f l u n e m o it ié de
c i f e à u x q u e l ’o n em m a n c h e , com m e o n v o i t à la fig.
66. Planche d? Orgue; o n t ie n t c e t o u t il e n fo r te q u e le
m a n ch e B p a ffe e n t re l e p e t it d o ig t 8c le d o ig t an nula
ire d e la main d r o ite ; l e p o u c e 8c le d o ig t in d ic a t
e u r de la m êm e m a in é tan t ap p liq u é s fu r la p a r tie
C , o u m êm e plus a v a n t fu r le r e r p o jir le t en ir plus
fe rm em en t . Voye£ les articles S o u d u r e & O r g u e .
P o i n t e , terme de manege: un che^ al-fait une pointe,
lorfqu’en maniant fur les voltes, il ne fuit pas régulièrement
ce rond, 8c que fortant un peu de fon train
ordinaire, il fait une efpece d’angle ou de pointe à
fa pille circulaire. Pour empêcher qù’un cheval fafie
des pointes, & faire enforte qu’il s’arrondiffe bien, il
faut avoir foin de hâter la main.
Pointe de l'arçon, fo n t le s p a r tie s q u i'fo rm e n t le
b a s de l ’a r ç o n d e d e v a n t d ’u n e fe lle . Voye^ S e l l e &
A r ç o n .
P o i n t e , ( Marine. ) ce mot fe dit d’une longueur
de terre qui avance dans la m er, comme la pointe de
Scage en Sutlande.Lapointe d’un mole, d’une digue,
efl la partie de ces conflrudtions la plus avancée dans
l’eau.j . ,
A la p o in te de P efi, de l ’ouefi, du nord, du fud ;
c ’e f l - à - d i r e , à la pointe d’u n e t e r r e q u i r e g a rd e q u e lq
u ’u n e d e c e s d iffé ren te s p a r t ie s d u m o n d e .
Pointe de l'éperon ; c ’ e ft la d e rn ie r e p ie c e de b o is
8c la p lu s a v a n c é e a u -d e v an t du v a i f f e a u , fu r la q
u e lle q u e lq u e fig u re d’u n m o n ft r e m a r in o u d ’un
lio n e f l o rd in a ir em e n t a p p u y é e . Voyeç É p e r o n .
Pointes de compas de mer, ou de boufiole,, ou traits
de compas ; c’efl chacune des marques & des divi-
fions de la bouffole, ou du compas de mer. Il y en
a trente-deux qui marquent les vents. Un rumb de
vent vaut quatre pointes ; un demi-rumb vaut deux
pointes ; 8c un quart de rumb en vaut une, en fup-
pofant huit rumb de vents principaux.
POIN TE A t r a c e r , ( Marqueterie. ) outil d’ébé-
nifle ; c’efl une pointe d’acier, par exemple, d’une
très-groffe aiguille à coudre, ou d’un bout de lame
d’épee, emmanchée d’un petit manche de bois, garni
d’une frette ; il fert à ces ouvriers pour tracer fur
les feuilles de bois, dont le placage doit être fait,
le contour des deffeins, félon lequel elles doivent
être découpées. Voyeç les fig. Planches de Marqueterie.
P o in t e d e p a v é , (Maçonnerie.) c’efl la jonélion
en maniéré de fourche , des deux ruiffeaux d’unè
chauffée en un ruiffeau, entre deux revers de pavé..
P o i n t e a t r a c e r , ( Menuiferie.') les menuifiers de
placage 8c de marqueterie s’en fervent pour tracer
leurs deffeins fur les feuilles de métaux ou de bois ,
qu’ils veulent contourner àvec la feie ; elle a encore
quelques autres ufages dont on parle ailleurs. Cet
outil efl une efpece de poinçon d’acier, avec un manche
de bois proportionné à fa petiteffe. {D. /.)
P o in t e d e c h e v e u x , ( Perruquier. ) c’efl cette
extrémité de cheveux par où les Perruquiers commencent
à tourner la boucle de la friiure : l’autre
bout s’appelle la tête ; c’ efl par la tête que les cheveux
fe treffent.
P o in t e , terme de Plumafjier; on nomme dans le
commerce des plumes d’autruche noires, fin à poin:
te, les grandes plumes noires qui font propres à faire
des panaches ; les moindres de cette qualité s’apr
pellent petit noir à pointe plate. {D . J.)
P o i n t e , terme de Reliure, outil qui fert à couper
le carton de la couverture, d’unelargeur 8c longueur
convenables à la tranche ; il efl de fer avec un manche
de bois , de dix-huit ou vingt pouces de long, y
compris le manche. Le bout de l’outil efl coupé en
chanfrain 8c très-tranchant.
P O IN T E , {Outil de Sculpt. & de Tailleur de pierre J)
la pointe des Sculpteurs en marbre, & des Tailleurs
de pierre, efl une efpece de cifeaü de fer acéré, aigu
par un b ou t, avec une tête de l’autre. Ils fervent L
les uns pour ébaucher leur Ouvrage, ce qu’on ap7(
pelle approcher à la pointe ; le? autres pour percer
des trous , & travailler .dans les endroits étroits &
profonds, où les cifeaux quarrés ne pourroient approcher.
Les Sculpteurs nomment pointe double ou
dent de chien , un cifeau quârre partage en deux par
le bas en forme de dents ; ils s’en fervent aptes avoir
approché à la pointe. {D. J.)
P o i n t e , (Sculpture.) c’efl un outil de fer bien
acéré, dont les Sculpteurs en marbre fe fervent pour
ébaucher leurs ouvrages ; après que le marbre a été
dégrofli ou épanelé, ce qu’ils appellent approcher à
la pointe. Quand on a travaillé aVëc cét outil, .on en
prend un autre qui a double pointe pour ôter moins
de matière ; & enfuite lorfque l’ouvrage efl plus
avancé,on fe fert du cifeau, ce que l’on nomme aufîi
approcher du cifeau. Voye£ les Pi.
P o in t e s , f. f. ph (' Sentir.) ce font des clous longs
& déliés, avec une petite tête ronde, qui fervent à
attacher les targettes, les verroux, &c. 8c dont on
-ferre les grandes fiches.
^ Po in t e s , terme de Serrurier, ce font des clous qui
n’ont point de tête ; ils fervent aux Serruriers à ferrer
les fiches qui s’attachent aux portes, croifées 8c
guichets. On les acheté en gros ou à la fomme, qui
efl de douze milliers , ou au compte quand ce font
celles qu’on appelle fiches au poids ; dans le détail,
on les vend à la livre & au compte. Savary. ( D. ƒ.)
Po in t e s , { Tireurs d 'or.) les Tireurs d’or nomment
ainfi certains petits poinçons d’acier, très-fins
& tres-pointus, qui vont toujours en diminuant de
groffeur, dont ils fe fervent pour polir les pertuis ou
trous neufs de cette forte de petite filiere , qu’ils appellent
fer à tirer. Il y a de ces pointes fi fines, que
le fil d’or que l’on tire par les pertuis qu’ils ont poli,
n’a pas la groffeur d’un cheveu.
Po in t e , (Outil de Tourneur. ) les tourneurs donnent
le nom de pointes à deux pièces de fer pointues
par un-Bout, qui.s’entaillent, dans les poupées de
leur tour. Elles forment à-peu-près la figure d’un Z ,
dont la ligne du milieu feroit perpendiculaire, & non
diagonale. (D .J .)
P o in t e , en terme de Vannier ; c’efl cet intervalle
plein qu’il y a de la première torche à la fécondé ,
d’où on commence à nommer combles, tous les- cordons
qui font au-deffùs. • ,
P O IN t e S , ternie de Vitrier ; les pointes dont les
Vitriers fe fervent pour attacher les panneaux & carreaux
de verre , fur les bois des croifées & chaflis ,
ne font pas ordinairement des clous faits exprès, mais
feulement le bout des clous que les maréchaux em-
ployent à ferrer les chevaux.
Po in t e d e diamant , ( Vitrerie. ) c’efl un petit
morceau de diamant, taillé en pointe , & enchâffé
dans du plomb & dans du bois , dont les vitriers fe
fervent pour tailler le verre.
P o in t e , f. f. terme de Fauconnerie ; on dit qu’un
oifeau fait pointe, lorfqu’il va d’un vol rapide en s’élevant
Ou en s’abaiffant.
Po in t é , adj. ( Blofon. ) On appelle écu pointé
fofcê, vin écu chargé de plufieurs pointes en fafees,
qui font en nombre égal, d’émaux différens. Pointé :
fe dit auffi d’un écu marqué de pointures ou piquu-
res, comme les pointes qui fervent de maffe à la
ro fe, tandis qu’elle efl en bouton. Il porte trois ro-
•fes boutonnées d’or 8c pointées de finople.
P O I N T E A U , f. m. outil d.'Horloger. G’efl un
poinçon d’acier trempé, pointu par le bout, qui fert
à marquer ou faire des trous dans des pièces de lai-
ton ou de cuivre. C ’efl ordinairement avec cet outil
qu’ils font les trous dans les pointes de leur tour.
Voye^ T o u r d ’Ho r l o g e r .
POINTER fe dit dans l’Artillerie d’une piece de
canon ou un mortier, quand on la met en mire pour
la tirer. Voye^ C a n o n , Mo r t ie r & Je t . Il y a
dans 1 Artillerie des officiers pour pointer le canon.
On les nomme officiers pointeurs. C’efl le premier
grade d’officier de ce corps. ,
Maniéré de pointer le canon. Pour pointer ou diriger
le canon vers un endroit où l’on veut faire porter
le boulet, oh elevefa culaffe par lé moyen d’un
coin O , que l’on place deffous fur la femelle de l’af-
fut ; ce coin fe nomme coin de mire.
En l’avançant fous la culaffe, il éieve & fait baif-
fer la volee; on l’avance autant qu’il en efl befoin
pour, que la volée foit dans la direélion que l’on
veut. On met quelquefois plufieurs de ces coins les
uns furies autres, lorfqu’on veut faire plonger le
carton de haut en bas.
Le canon étant plus gros vers la culaffe que vers
la bouche, 8c faifant une efpece de cône tronqué
la ligne que l ’on imagine pafTer par le milieu de fon
ame.’ comme la ligne A H , n’efl pas parallèle à la
partie fupeneure du canon C G : c’efl pourquoi fi
on ahgnoit le canon félon le prolongement de CG ,
le boulet, ait lieu d’aller en D , prolongement de
C G , iroit en B , prolongement de VA II, c’efl-â-dire
qu’il porterait plus haut que le point d’alignement
obferve. Pour remédier à cet inconvénient , ori
adapte fur 1 extrémité de la volée une piece de bois
concave dans fa partie intérieure, de maniéré qu’elle
puiffe, pour ainfi dire, être achevalée fur l ’ex->
tremité de fa volé e, 8c que fa hauteur ou fa partie
ultérieure reponde à la quantité d’épaiffeur que le
métal de la culaffe a de plus que celui de la volée*
Cette- piece fe nomme fronteau dé mire, 'voyei
Fr o n t e a u d e M iR lfilî'fer t, comtjre on le v o i t ,
à faire porter le boulet dans l’endroit defiré ; car
par 1011 moyen la ligne de mire elt parallèle à la
ligne que l’on imagine paffer au milieu du canon ,
c eft-a-dire à celle que doit décrire le boulet, fup-
pofant qu’il fuive la direélion de cette ligne qui efl
l l l l l Ainli alignant la partie fupérieure de la cutané
8c celle du fronteau avec un point quelconque^
le boulet chaffe dans cette direélion , fera porté
vers ce point, mais plus bas, de la quantité feulement
du demi-diametre de 1a culaffe ; en forte vqUe fi
on aligné le canon à un point plus élevé de ta quantité
de ce demi-diametre, le boulet donnera dans le
point où l’on veut le faire porter. On fait ici abflrac-
tion de toutes les caufes qui peuvent déranger, 8c
qui dérangent effectivement dans la pratique 1a iiif-
teffe du coup.
Pour ce qui concerne le pointage du mortier;
voye^ Mo r t ie r . (/>)
Po in t e r , v. aci. ( Arclùtecl. ) On dit poi/îter une
piece de trait ; c’efl, fur un deffein de coupe de pierre;
rapporter avec le compas le plan ou le profil au dé-
veloppemenr des panneaux. C’efl auffi faire 1a même
opération en grand avec la fauffe équerre , fur des
cartons feparés, pour en tracer les pierres. (.D . J.)
Po in t e r une aiguille , terme d'Aiguiller, c’efl former
1a pointe d’une aiguille avec 1a lime.
Po in t e r , ( Manufacture. ) en terme de manufacture,
c’efl faire quelques points d’aiguille avec de la
foie , au fil ou de ta ficelle, à une piecë de drap oii
autre étoffe , pour conferver les plis, 8c empêcher
qu’elle ne fe chiffonne.
Po in t e r , {Marine.) c’efl fe fervir du compas
pour trouver fur ta carte en quel parage le vaiffeau
peut être, ou quel air de vent il faut faire pour arriver
au lieti où l’on veut aller.
P O IN T E R , en Fauconnerie y On dit qu’un oifeau
pointe lorfqu’i l v a d’un v o l rapide , foit en s’abaiffant
, foit en s’élevant. O n dit auffi v o le r en pointe.
POINTEUR, f. m. terme d'Eglife. Dans 1a plfipart
des eglîfes cathédrales & collégiales* on nomme pointeur
celui qui marque fur un regiftre les noms de Ceux
qui font abfens de tel Ou tel office du choétir. Ge regiftre
fe nomme pointe , 8c l’aélion du pointeur, pointer.
{D. J.) ,
POINTIL, f. m. ( Verrerie. ) Le pointil efl tille longue
8c forte verge dé fer* à l’ündès bouts de laquelle
il y a une traverfé auffi de fer > qui avec la ver^e