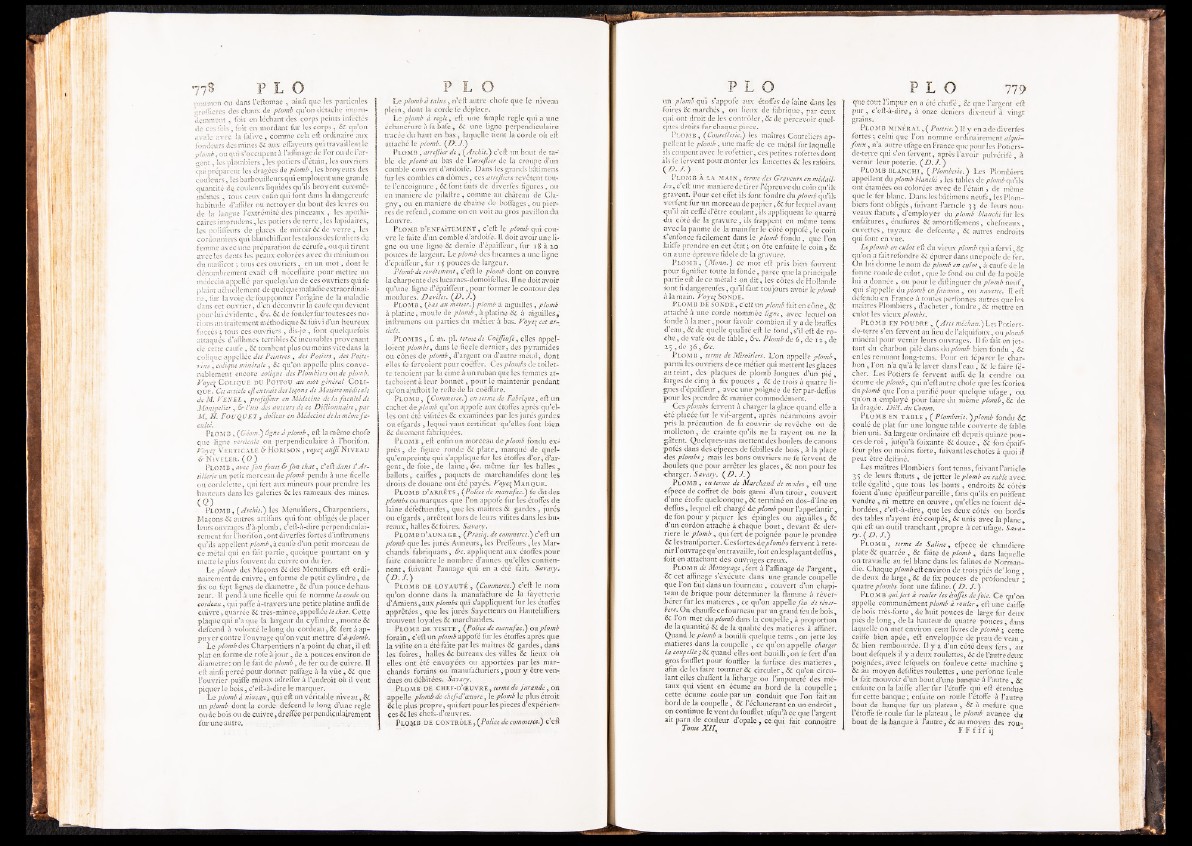
poumon ou clans l’eftomac , ainfi que les particules
crolfieres des chaux de plomb qu’on détache imprudemment
, foit en léchant des corps peints infeftés
de ces fcls , (bit en mordant fur les corps , & qu’on
avale avec la falive , comme cela eft ordinaire aux
fondeurs des mines Ôc aux effayeurs qui travaillent le
plomb, ou qui s’occupent à l’affinage de l’or ou de l’argent
, les plombiers , les potiers d’étain, les ouvriers
qui préparent les dragées de plomb, les broyeurs des
couleurs, les barbouilleurs qui emploient une grande
quantité dç couleurs liquides qu’ils broyent eux-mê-
•mêmes tous ceux enfin qui font dans la dangereufe
habitude d’affiler ou nettoyer du bout des levres ou
de la langue l’extrémité des pinceaux , les apothicaires
imprudens, les potiers de terre, les lapidaires,
.les pondeurs de glaces de miroir ôc de verre , les
cordonniers qui blanchiflent les talons desfoüliers de
femme avec une préparation de cérufe, ou qui tirent
avec les dents les peaux colorées avec du minium ou
du mafficot ; tous ces ouvriers, en un mot, dont le
dénombrement exa£l eft néceffaire pour mettre un
médecin appellé par quelqu’un de ces ouvriers qui fe
plaint aéluellement de quelque maladie extraordinair
e , fur la voie defoupçonner l’origine de la maladie
dans cet ouvrier, d’en découvrir la caufe qui devient
pour lui évidente, 6*c. 8c de fonder fur toutes ces notions
un traitement méthodique 8c fuivi d’un heureux
fuccès ; tous ces ouvriers , dis-je , font quelquefois
attaqués d’afthmes terribles 5c incurables provenant
de cette caufe, & tombent plus ou moins vite dans la
colique appellée des Peintres , des Potiers, des Poitevins
, colique minérale , 8c qu’on appelle plus convenablement
encore colique des Plombiers ou de plomb.
Foye{ C olique du Poitou au mot général C oliq
ue. Cet article efl extrait des leçons de Matière médicale
de M. VEN EL , profeffeur en Médecine de la facilité de
Montpelicr, & l'un des auteurs de ce Dictionnaire, par
M. H. F o u QU ET, docteur en Médecine de la même fa culté.
_
PLOMB , (Géom.) ligne à plomb, eft la même chofe
que ligne verticale ou perpendiculaire à l’horifon.
Voyt{ V ert icale & Horison , voye^ aujji Nive au
& Niveler. (O )
PLOMB , avec fon fouet & fon chat, c’eft dans l'Artillerie
un petit morceau de plomb pendu à une ficelle
ou cordelette, qui fert aux mineurs pour prendre les
hauteurs dans les galeries 8c les rameaux des mines.
(<2) ■ ■
Plomb , (Archit.) les Menumers, Charpentiers,
Maçons 8c autres artifans qui font obligés de placer
leurs ouvrages d’à-plomb, c’ eft-à-dire perpendiculairement
furl’horifon,ontdiverfes fortes d’inftrumens
qu’ils appellent plomb,kcaufe d’un petit morceau de
ce métal qui en fait partie, quoique pourtant on y
mette le plus fouvent du cuivre ou du fer.
Le plomb des Maçons 8c des Menuiiiers eft ordinairement
de cuivre, en forme de petit cylindre, de
fix ou fept lignes de diamètre, 8c d’un pouce de hauteur.
Il pend à une ficelle qui fe nomme la corde ou
cordeau, qui paffe à-travers une petite platine auffide
cuivre, quarrée 8c très-mince, appellee le chat. Cette
plaque qui n’a que la largeur du cylindre, monte 8c
defeend à volonté le long du cordeau, 8c fert à appuyer
contre l’ouyrage qu’on veut mettre d'à-plomb.
Le plomb dés Charpentiers n’a point dé chat, il eft
plat en forme de rofe à jour, de 2 pouces environ de
diamètre : on le fait de plomb, de fer ou de cuivre. Il
eft ainfi percé pour donner paffage à la v u e , 8c que
l’ouvrier puiffe mieux adreffer à l’endroit où il veut
piquer le bois, c’eft-à-dire le marquer.
Le plomb à niveau,qui eft un véritable niveau, 8c
un plomb dont la corde defeend le long d’une réglé
ou de bois ou de cuivre, dreffée perpendiculairement
fur une autre.
L g plomb à talus, n’eft autre chofe que le niveau
plein, dont la corde fe déplace.
Le plomb à réglé, eft une fimple réglé qui a une
échancrure à fa bafe, 8c une ligne perpendiculaire
tracée du haut en bas, laquelle tient la corde où eft
attaché le plomb. (D . J.)
Plomb , arreflier de, ( Archit.) c’eft un bout de table
de plomb au bas de \'arreflier de la croupe d’un
comble couvert d’ardoife. Dans les grands bâtimens
fur les combles en dômes, ces arrefliers revêtent toute
l’encoignure, 8c font faits de diverfes figures, ou
en maniéré de pilaftre, comme au château de Cla-
gny, ou en maniéré de chaîne de boffages, ou pierres
de refend, comme on1 en voit au gros pavillon du
Louvre.
Plomb d’enfaîtement , c’eft le plomb qui couvre
le faîte d’un comble d’ardoife. Il doit avoir une ligne
ou une ligne & demie d’épaiffeur, fur 18 à 20
pouces de largeur. Le plomb des lucarnes a une ligne
d’épaiffeur, fur 15 pouces de largeur.
Plomb de revêtement, c’eft le plomb dont on couvre
la charpente des lucarnes-demoifelles. Il ne doit avoir
qu’une ligne d’épaiffeur, pour former le contour des
moulures. Daviler. (D . J.)
PLOMB, (bas au métier.') plomb à aiguilles, plomb
à platine, moule de plomb, à platine 8c à aiguilles,1
inftrumens ou parties du métier à bas. Voye^ cet article.
Plo m b s , f. m. pl. terme de Coeffeufe, elles appel-
loient plombs, dans le fiecle dernier, des pyramides
ou cônes de plomb, d’argent ou d’autre métal, dont
elles fe fervoient pour coëffer. Ces plombs de toilette
tenoient par la cime à un ruban que les femmes at-
tachoient à leur bonnet, pour le maintenir pendant
qu’on ajuftoit le relie de la coëffure.
PLOMB, f Commerce.) en terme de Fabrique, eft un
cachet de plomb qu’on appofe aux étoffes après qu’elles
ont été vifitées 8c examinées par les jurés gardes
ou efgards , lequel vaut certificat qu’elles font bien
8c duement fabriquées.
Plomb , eft enfin un morceau de plomb fondu exprès
, de figure ronde 8c plate, marqué de quel-
qu’empreinte qui s’applique fur les étoffes d’o r, d’argent
, de foie, de laine, &c. même fur les balles ,
ballots, caiffes, paquets de marchandifes dont les
droits de douane ont été payés. Voye^ Marque.
PLOMB d’arrêts , (Police de manufac.') fe dit des
plombs ou marques que l’on appofe fur les étoffes de
laine défeftueufes, que les maîtres & gardes , jurés
ou efgards , arrêtent lors de leurs vifites dans les bu-,
reaux, halles & foires. Savary.
PLOMB D’AUNAGE, (Pratiq. de commerce.) c’eft un
plomb que les jurés Auneurs, les Preffeurs , les Marchands
fabriquans, &c. appliquent aux étoffes pour
faire connoître le nombre d’aunes qu’elles contiennent
, fuivant l’aunage qui en a été fait. Savary ;
(D . j . y
Plomb de lo ya u t é , (’Commerce.,) c’eft le nom
qu’on donne dans la manufa&ure de la fayetterie
d’Amiens, aux plombs qui s’appliquent fur les étoffes
apprêtées, que les jures Sayetteurs ou Hautelifliers
trouvent loyales 8c marchandes.
Plomb de visite , ( Police de manufac.') ou plomb
forain, c’eft un plomb appofé furies étoffes après que
la vifite en a été faite par les maîtres 8c gardes, dans
les foires, halles 8c bureaux des villes 8c lieux oii
elles ont été envoyées ou apportées par les marchands
forains ou manufaéturiers, pour y être vendues
ou débitées. Savary
Plomb de chef-d’oeuvre, terme de jurande, on
•appelle plomb de chef-d'oeuvre, le plomb le plus étroit
& le plus propre, qui fert pour les pièces d’expériences
8c les chefs-d’oeuvres.
Plomb de contrôle, (P o lic e de commerce-) ç’eft
tin plomb qui s’appofe aiîx étoffes de laine dans les
foires 8c marchés , ou lieux de fabrique, par ceux
qui ont droit de les contrôler, 8c de percevoir quelques
droits fur chaque pièce.
Plomb , ( Coutellerie.) les maîtres Couteliers appellent
le plomb, une maffe de ce métal fur laquelle
ils coupent avec le rofettier, ces petites rofettesdont
ils fe fervent pour monter les lancettes & les rafoirs.
( D . J . )
PLOMB A 'LA m a in , terme des Graveurs en médailles
, c’eft une maniéré de tirer l’épreuve du coin qu’ils
gravent. Pour cet effet ils font fondre du plomb qu’ils
verfent fur -un morceau de papier, 8c fur lequel avant
qu’il ait ceffé d’être coulant, ils appliquent le quarré
du côté de la gravure , ils frappent en même tems
avec la paume de la main fur le côté oppofé, le coin
s’enfonce facilement dans le plomb fondu, que l’on
laiffe prendre en cet état; on ôte enfuite le coin, 8c
on a une épreuve fidele de la gravure.
Plo m b , (Monn.) ce mot eft pris bien fouvent
pour fignifier toute la fonde, parce que la principale
partie eft de ce métal : on d it, les côtes de Hollande
lont fi dangereufes, qu’il faut toujours avoir le plomb
à la main. Vyyeç S ONDE.
Plomb de sonde , c ’eft un plomb fait en cône, 8c
attaché à une corde nommée ligne, avec lequel on
fonde à la mer, pour favoir combien il y a de brades
d’eau, 8c de quelle qualité eft le fond,s’il eft de roche
, de vafe ou de fable, &c. Plomb de 6, de 12 de
2.5 , de 36, &c.
Plomb , terme de Miroitiers. L’on appelle plomb,
parmi les ouvriers de ce métier qui mettent les glaces
au teint, des plaques de plomb longues d’un p ié ,
larges de cinq à fix pouces , 8c de trois à quatre lignes
d’épaiffeur, avec une poignée de fer par-deffus
pour les prendre 8c manier commodément.
Ces plombs fervent à charger la glace quand elle a
été placée fur le vif-argent , après néanmoins avoir
pris la précaution de la couvrir de revêche ou de
molleton, de crainte qu’ils ne la rayent ou ne la
gâtent. Quelques-uns mettent des boulets de canons
pofés dans des efpeces de fébilles de bois, à la place
des plombs ; mais les bons ouvriers ne fe fervent de
houlets que pour arrêter les glaces, 8c non pour les
charger. Savary. ( D . J .)
Plomb , en terme de Marchand de modes, eft une
efpece de coffret de bois garni d’un tiroir, couvert
d’une étoffe quelconque, 8c terminé en dos-d’âne en
deffus, lequel eft chargé de plomb pour l’appefantir,
de fon pour y piquer les épingles ou aiguilles, 8c
d’un cordon attaché à chaque bout, devant 8c derrière
le plomb , qui fert de poignée pour le prendre
8c lestranfporter. Ces fortes de plombs fervent à retenir
l’ouvrage qu’on travaille, foit enlesplaçant deffus,
foit en attachant des ouvrages creux.
Plomb de Monoyage ,fert à l’affinage de l’argent,
ôc cet affinage s’exécute dans une grande coupelle
que l ’on fait dans un fourneau, couvert d’un chapiteau
de brique pour déterminer la flamme à réverbérer
fur les matières , ce qu’on appelle feù de réverbère.
On chauffe ce fourneau par un grand feu de bois,
& l’on met du plomb dans la coupelle, à proportion
de la quantité 8c de la qualité des matières à affiner.
Quand le plomb a bouilli quelque tems, on jette les
matières dans la coupelle , ce qu’on appelle charger
la coupelle ; 8c quand elles ont bouilli, on fe fert d’un
gros foufflet pour fouffler la furfaee des matières ,
afin de les faire tourner 8c circuler, & qu’en circulant
elles chaffent la litharge ou l’impureté des métaux
qui vient en écume au bord de la coupelle ;
cette écume coule par un conduit que l’on fait au
bord de la coupelle, 8c l’echancrant en un endroit,
on continue le vent du foufflet ,’ufqu’à ce que l’argent
ait paru de couleur d’opale, ce qui fait connoître
Tome X I I , -
qtiô tout l’impur en a été chaffé, 8c que l’argent eft
p u r , c’eft-à-dire, à onze deniers dix-neuf à vingt
grains.
Plomb Minéral , ( Poterie.) Il y en a de diverfes
•fortes ; celui que l’on nomme ordinairement alqui-
fa u x , n’a autre ufage en France que pour les Potiers-
de-terre qui s’en fervent, après l ’avoir pulvérifé , à
vernir leur poterie. (D .J . )
Plomb b l an ch i, ( Plomberie. ) Les Plombiers
appellent du plomb blanchi, les tables de plomb qu’ils
ont étamées ou colorées avec de l’étain , de même
que le fer blanc. Dans lés bâtimens neufs, les Plombiers
font obligés, fuivant l’article 3 3 de leurs nouveaux
ftatuts , d’employer du plomb blanchi fur les
enfaitures, enufures & amortiffemens, chefheaux ,
cuvettes, tuyaux de defeente, & autres endroits
qui font en vue»
Le plomb enculot eft du vieux plomb qui a fervi, &
qu’on a fait refondre & épurer dans une poêle de fer.
On lui donne le nom de plomb en culot, à caufe de la
fO! *me ronde de culot, que le fond ou cul de la poêle
lui a donnée , ou pour le diftinguer du plomb n euf,
qui s’appelle du plomb en faumon, ou navette. Il eft
défendu en France à toutes perfonnes autres que les
maîtres Plombiers, d’acheter, fondre, & mettre en
culot les vieux plombs.
Plomb en po u d r e , (Arts médian.) Les Potiers-
de-terre s’en fervent au lieu de l’alquifoux, ou plomb
minéral pour vernir leurs ouvrages. Il fe fait en jet-
tant du charbon pilé dans du plomb bien fondu , ôc
en les remuant long-tems. Pour en féparer le charbon
, l’on n’a qu’à le laver dans l’eau, & le faire fé-
cher. Les Potiers fe fervent àuffi de la cendre ou
écume de plomb, qui n’eft autre chofe que les feories
du plomb que l’on a purifié pour quelque ufage , ou-
qu’on a employé pour faire du même plomb, & de
la dragée. Dicl. du Comnu
Plomb en t a b l e , (Plomberie.')plomb fondu &
coulé de plat fur une longue table couverte de fable
bien uni. Sa largeur ordinaire eft depuis quinze pouces
de r o i , jufqu’à foixante & douze, & fon épaif-
feur plus ou moins forte , fuivant les chofes à quoi il
peut être deftiné.
Les maîtres Plombiers font tenus, fuivant l’article
'35 de leurs ftatuts , de jetter 1 e plomb en table avec
telle égalité , que tous les bouts , endroits & côtés:
foientd’une épaifléurpareille,fans qu’ils enpuiflènt
vendre , ni mettre en oeuvre, qu’elles ne foient débordées,
c’eft-à-dire , que les deux côtés ou bords
des tables n’ayent été coupés, & unis avec la plane,
qui eft un outil tranchant, propre à cet ufage. Savary.
f D .J . )
Pl o m b , terme de Saline, efpece de chaudière
plate &: quarrée , & faite de plomb , dans laquelle
on travaille au fel blanc dans les falines de Normandie.
Chaque plomb eft environ de trois piés de’lon»
de deux de large , & de fix pouces de profondeur ;
quatre plombs font une falinë. ( D . J . )
PLOMB qui Jert à rouler les étoffes de foie. Qe qu’on
appelle communément plomb à rouler, eft une caiffe
de bois très-forte, de huit pouces de large fur deux
piés de long, de la hauteur de quatre ponces ; dans
laquelle on met environ cent livres de plomb ; cette
caiffe bien apée, eft enveloppée de peau de veau ,
& bien rembourrée. Il y a d’un côté deux fers, au
bout defquels il y a deux roulettes, & d e l’autre deux
poignées, avec lefquels On fouléve cette machine ;
& au moyen defdites roulettes , une perfonne feule
la fait mouvoir d’un bout d’une banque à l’autre , &
enfuite on la laiffe aller fur l’étoffe qui eft étendue
fur cette banque; enfuite on roule l’étoffe à l’autre
bóut de banque fur un plateau , & à mefiire que
l’étoffe fe roule fur le plateau, le plomb avance du
bout de la banque à l’autre, ôc au moyen des rou->
f e J