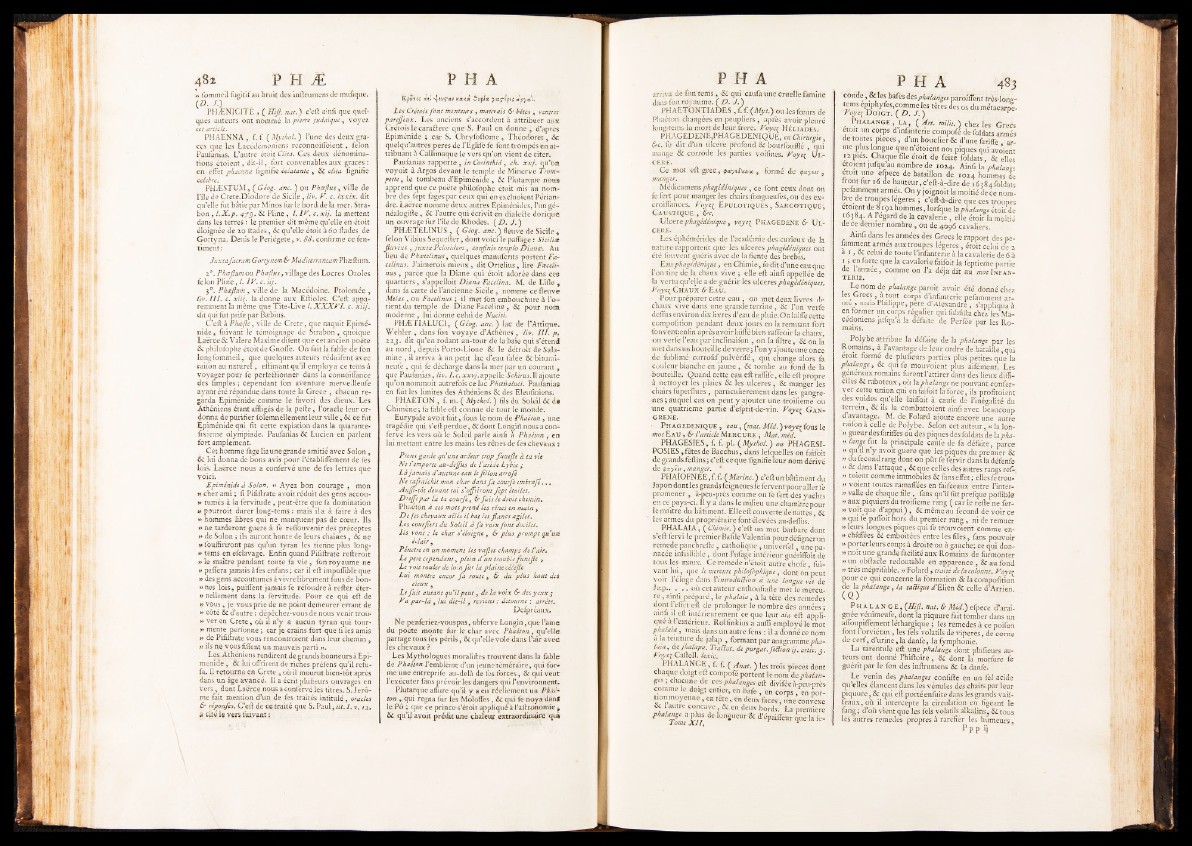
» fpmmeil fugitif au bruit des inftrumens .de mufique.
( À / . ) . . , ,
PHÆNICITE , ( Hiß. hat. ) c’eft ainfi que quelques
auteurs ont nommé la pierre judaïque , voyez
cet article.
PHAENNA , f. f. ( Mythol. ) l’une des deux grâces
que les Lacédémoniens reçonnoiffoient, félon
Paufanias. L’autre étoit Clita. Ces deux dénominations
étoient, dit-il, fort convenables aux grâces :
en effet phaenna lignifie éclatante , & clita lignine
célébré 4
PHÆSTUM, ( Géog. anc. ) ou Phceftus, ville de
î’île de Crete.Diodore de Sicile , liv. V. c. Ixxix. dit
qu’elle fut bâtie par Minos fur le bord de la mer. Stra-
bon , l.X .p . 47$. & Pline , /. IP . c. xij. la mettent
dans les terres : le premier dit même qu’elle en étoit
éloignée de 20 Itades, & qu’elle étoit à 60 ftades de
Gortyna. Denis le Periégete, v. 8è>. confirme ce fen-
timent:
Juxtafacram Gortynem & Madittrraneam Phæftum.
20. Phceßum ou Pfusßus, village des Locres Ozoles
félon Pline, l. IV. c. iij.
30. Phaflum, ville de la Macédoine. Ptolomée ,
liv. III. c. xiij. la donne aux Eftioles. C ’eft apparemment
la même que T ite-Live /. X X X V I . c. xiij.
dit qui fiit prife par Bæbius.
C ’efi; à Phaße, ville de Crete, que naquit Epimé-
nide, fuivant le témoignage de Strabon, quoique
Laërce & Valere Maxime difent que cet ancien poète
Sc philofophe étoit de Gnoffe. On lait la fable de fon
longfoiïime il, que quelques auteurs réduifent avec
raifon au naturel, efiimant qu’il employa ce tems à
voyager pour fe perteftionner dans la connoiffance
des fimples ; cependant fon aventure merveilleufe
ayant été répandue dans toute la Grece , chacun regarda
Epiménide comme le favori des dieux.‘ Les
Athéniens étant affligés de la pefte, l’oracle leur ordonna
de purifier folemnellementleur ville , & ce fi.it
Epiménide qui fit cette expiation dans la quarante-
fixieme olympiade. Paufanias & Lucien en parlent
fort amplement.
Cet homme fage lia une grande amitié avec Solon,
& lui donna de bons avis pour l’établiffement de fes
lois. Laërce nous a confervé une de fes lettres que
YÇÛci.
Epiménide à Solon. « Ayez bon courage , mon
*» cher ami ; fi Pififtrate avoit réduit des gens accou-
» tumés à la fervitude , peut-être que fa domination
p pourroit durer long-tems : mais il a à faire à des
» hommes libres qui ne manquent pas de coeur. Ils
» ne tarderont guere à fe reffouvenir des préceptes
» de Solon ; ils auront honte de leurs chaînes, & ne
f» fouffiriront pas qu’un tyran les tienne plus long-
» tems en efclavage. Enfin quand Pififtrate refteroit
>; le maître pendant toute fa v ie , fon royaume ne
» paffera jamais à fes enfans ; car il eft impoffible que
» des gens accoutumés à vivre librement fous de bon-
»nes lois, puiffent jamais fe réfoudre à refier éter-
p nellement dans la fervitude. Pour ce qui eft de
>> vous, je vous prie de ne point demeurer errant de
» cote & d’autre : dépêchez-vous de nous venir trou-
» ver en Crete, où il n’y a aucun tyran qui tour-
» mente perfonne ; car je crains fort que fi les. amis
» de Pififtrate vous rencontroient dans leur chemin,
» ils ne vous fiffent un mauvais parti ».
Les Athéniens rendirent de grands honneurs à Epi-
menide, & lui offrirent de riches préfens qu’il refii-
fa. Il retourna en Crete , où il mourut bien-tôt après
dans un âge avance. Il a écrit piufieurs ouvrages en
v er s , dont Laërce nous a confervé les titres. S. Jerome
fait mention d’un de fes traités intitulé, oracles
& réponfes. Ç’eft de ce traité que S. Paul, tit. I. v, 12,
a cité le vers fuivant :
KpHTts octl Kctuà ô’iipi* yetçïpîc apyeù. '
Les Cretois font menteurs , mauvais & bêtes , ventres
parejjeux. Les anciens s’accordent à attribuer aux
Crétois le caraftere que S. Paul en donne , d’après
Epiménide ; car S. Chryfpftome, Théodbret, &
quelqu’autres peres de l’Eglife fe font trompés en attribuant
à Caliimaque le vers qu’on vient de citer.
Paufanias rapporte, in Corinthiâ, ch. x x j. qii’ort
voyoit à Argos devant le temple de Minerve Trom-
pette, le tombeau d’Epiménide , & Plutarque nous
apprend que ce poète philofophe étoit mis au nombre
des fept fagespar ceux qui en excluoient Périan-
dre. Laërce nomme deux autres Epiménides, l’un gé-
néalogifte , & l’autre qui écrivit en dialette dorique
un ouvrage fur l’île de Rhodes. ( D . J. )
PHÆTELINUS , ( Géog. anc. ) fleuve de Sicile $
félon Vibius Sequefter, dont voici le paffage : S ici lia
fiuvius , juxta Peloridem, confinis templo Diana* Au
lieu de Phoetelinus, quelques manufcrits portent Fa-
celinus. J’aimerois mieux, dit Ortelius, lire Faceli-
nus , parce que la Diane qui étoit adorée dans ces
quartiers, s’appelloit Diana Facelina. M. de Lifîe *
dans fa carte de l’ancienne Sicile , nomme ce fleuve
Mêlas , ou Facelinus ; il met fon embouchure à l’orient
du temple de Diane Faceline , & pour nom
moderne , lui donne celui de Nuciti.
PHÆTIALUCL, (Géog. anc. ) lac de l’Attique.
V eh ler , dans fon voyaye d’Athènes , liv. III. p*
2 2 j. dit qu’en rodant au-tour de la baie qui s’étend
au nord, depuis Porto-Lione Sç le détroit de Sala-
mine , il arriva à un petit lac d’eau falée & bitumi-
neufe , qui fe décharge dans la mer par un courant ,
que Paufanias, liv. I. c. xxvj. appelle Sckirus. Il ajoute
qu’on nommoit autrefois ce lac Phoeiialuci. Paufanias
en fait les limites des Athéniens & des Eleufiniens*
PHAÉTON , f. m. ( Mythol. j fils dii Soleil & d*
Chimène ; fa fable eft connue de tout le monde.
Eurypide avoit fait, fous le nom de Phaéton , une
tragédie qui s’eft perdue, & dont Longin nous a con*
fervé les vers où le Soleil parle ainfi à Phaéton , en
lui mettant entre les mains les rênes de fes chevaux 3
P rens garde qui une ardeur trop furiejle à ta vie
Ne C emporte au-dejfus de l'aride Lybie ;
Là jamais d'aucune eau le filo n arrofè
Ne rafraîchit mon char dans fa courfe tmbrafé. . .
Aufji-tôt devant toi s'offriront fept étoiles.
Dreffe par là ta courfe, & fuis le droit chemin.
Phaéton à ces mots prend les rênes en main ,
De {es chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les courfîers du Soleil à fa voix font dociles.
Ils vont : le char s'éloigne , & plus prompt qu'un
éclair,
Pénétré en un moment les vafles champs de Pair*
Le pere cependant, plein d'un trouble funefle ,
Le voit rouler de loin fur la plaine célejle
Lui montre encor fa route , & du plus haut des
deux ,
Le fuit autant qu'il peut, de la voix & des yeux •
V 1 par-là , lui d it-il. reviens ; détourne : arrête.
Defpréaux.
Ne penferiez-vouspas, obferve Longin, que l’âme
du poète monte fur le char avec Phaéton. qu’elle
partage tous fes périls, & qu’elle vole dans l’air avec
les chevaux ?
Les Mythologues moraliftes trouvent dans la fable
de Phaéton l’emblème d’un jeune téméraire, qui forme
une entreprife au-delà de fes forces, & qui veut
l’exécuter fans prévoir les dangers qui l’environnent.
Plutarque aflure qu’il y a eu réellement un Phaê-
ton qui régna fur les Moloffes, & qui fe noya dan*
le Pô ; que ce prince s’étoit appliqué à l’aftronomie ,
& qu’il avoit prédit une chaleur extraordinaire qui
arriva de-fon tems , & qui caufa une cruelle famine
dans fon royaume. ( D. J.')
PHAETONTIADES , f. f. (Myt.j ou les foeurs de
Phaéton changées en peupliers, après avoir pleuré
long-tems la mort de leur frere. Voye? Héliadesj
PHAGEDENË,PHAGEDENIQUE, en Chirurgie ^
&c. fe dit d’un Ulcéré profond & bourfoufflé , qui
maiïge & corrode les parties voifines. Voye^ Ul-
GERE.
. Ge mot eft grec , 9*^J W .> formé de <p*ytiv,
manger.
Médicamens phagédéniquès , ce font ceux dont on
fe fert pour manger les chairs fongueufes, ou des ex-
croiffances. Voye1 E p u l o t i q u e s , S a r c ô t i q u e ',
C a u s t i q u e , &c.
Ulcéré phagédénique, voye( P h a g e d e n e & ULCERE.
Les éphémérides de l’académie des curieux de la
nature rapportent que les ulcérés phagédéniquès ont
été fouvent guéris avec de la fiente des brebis*
Eau phagédénique, en Chimie, fe dit d’une eau que
l’on'tire de la chaux vive ; elle eft ainfi appellée de
la vertu qu’elle a de guérir les ulcérés phagédéniquès.
■ Voyc{ C h a u x & E a u .
Pour préparer cette eau , on met deux livres de
chaux vive dans une grande terrine, & l’on verfe
deffus environ dix livres d’eau de pluie. On laiffe cette
compofition pendant deux jours en la remuant fort
fouvent:enfin après avoir laiffé bien raffeoir la chaux,
on verfe l’eau par inclinaifon , on la filtre, & on la
met dans un bouteille de verre ; l’on y ajoute une once
de fublimé corrofif pulvérifé, qui change alors fa
couleur bianche en jaune , & tombe au fond de la
•bouteille. Quand cette eau eft rafïife, elle eft propre
à nettoyer Tes plaies & les ulcérés , & manger les
chairs fuperflues , particulièrement dans les gangrenés
; auquel cas on peut y ajouter une troifieme ou
tme quatrième partie d’efprit-de-vin. Voyei Gangs
RENE.
PH AG ED EN IQ U E , eau, (mat. Méd. j voye£ fo u s le
mot E a u , & l'article M e r c u r e , Mat. méd.
PHAGESIES, f. f. pl. ( Mythol. j ou PHAGESI-
POSIES, fêtes de Bacchus , dans lefquélles on faifort
de grands feftins ; c’eft ce que lignifie leur nom dérivé
de ipayliv , manger. *
• PHAlOFNÉE, f. f. ( Marine. ) c’eft un bâtiment du
Japon dont les grands feigneurs le ferventpour aller fe
promener , à-peu-près comme on fè fert des yachts
en ce pays-ci. Il y a dans le milieu une chambre pour
•le maître du bâtiment. Elle eft couverte de nattes &
les armes du propriétaire font élevées au-deffus. *
5 PHALAïA , (Chimie.') c’eft un mot barbare dont
s’eft fervi le premier Bafile Valentin pourdéfigner un
remede panchrefte , catholique , univèrfel, une panacée
infaillible, dont l’ufage intérieur guériffoit de
tous les maux. Ce remede n’étoit autre chofe fuivant
lui, que Le mercure philofophique , dont on peut
Voit l’éloge dans Ÿintroduclion à une longue vie de
Jæp.. . . . où cet auteur enthoufiafte met le mercure
, ainfi préparé, le phalaia, à la tete des remedes
dont l’effet eft de prolonger le nombre des années;
ainu îl^eft intérieurement ce que leur aia eft applique
a 1 extérieur. Rolfinkius a auffi employé le mot
phalaia, mais dans un autre fens : il a donné ce nom
a la teinture de jalap , formant par anagramme phalaia,
aQ j lia lapa. Traclat. de purgat.feclion ij. arîic. 3 .
Voye\ Caftell. lexic.
PHALANGE, f. f. ( Anat. ) les trois pièces dont
chaque doigt eft compofé portent le nom de phalan-
■ ges ; chacune de c es phalanges eû divifée à-peu-près
•comme le doigt entier, en bafe , en cofps , en por-
tionmoyenne, en tête, en deux faces, une convexe
6 1 autre concave & en deux bords. La première
^ ‘a aTomeXII de ion£ueur & d’épaiffeur que la feconde,
& le s bafes dès phalanges paroifient très-Iong-
tems epiphyfes,comme les têtes des os du métacarpe.
Voye{ D o i g t . ( D . J . ) v
t P h a l a n g e , l a , ( An. milit. ) chez fes Grecs
etoit un corps d infanterie compofé de foldats armés
déboutés pièces, d’un bouclier & d’une fariffe arme
plus longue que n’étqient nos piques qui avoient
ïzpies* Chaque file étoit de feize foldats, & elles
etoientjufqu’au nombre de 1024. Ainfi la phalange
étoit une efpece de bataillon de 1024 hommes de
front fur 16 de hauteur, c’eft-à-dire de 16384foldats
pefamment armés. On y joignoit la moitié de ce nombre
de troupes légères ; c’eft-à-dire que ces troupes
etoient de 8192 hommes, lorfque la phalange étoit de
16384. A 1 egard de la cavalerie, elle étoit la moitié
de ce dernier nombre, ou de 4096 cavaliers.
Ainfi dans les armées des Grecs le rapport des pefamment
armés aux troupes legeres, étoit celui de 2
à 1 , & celui de toute l’infanterie à la cavalerie de 6 à
j ’ ?,n <îue cavalerie faifoit la feptieme partie
de l’armee, comme on l’a déjà dit au ' mot In f a n t
e r i e .
Le nom d.e phalange paroît avoir été donné chez
6 re c? 5 " f °ut corps d’infanterie pefamment ar-
m e ; mais Philippe, pere d’Alexandre , s’appliqua!
en former un corps régulier qui fubfifta chez les Macédoniens
jiifqu’a la défaite de Perfée par les Romains.
Polybe attribue la défaite de la phalange par les
Romains, à l’avantage de leur ordre de bataille, qui
étoit formé de piufieurs parties plus petites que la
phalange, & qui fe mouvoient plus aifément* Les
généraux romains furent l’attirer dans des lieux difficiles
& raboteux, où la phalange ne pouvant confer-
ver cette union qui en faifoit la force, ils profitoient
des vuides qu’elle laiffoit à caufe de l’inégalité du
fcri'ein , & ils la combattoient ainfi avec beaucoup
d’avantage* M. de Folard ajoute encore Une autre
raifon à celle de Polybe* Selon cet auteur, « la lon-
' » gueur des fariffes ou dés piques des foldats de hpka-
» lange fut la principale caufe de fa défaite, parce
» qu’il n’y avoit guere que les piques du premier &
» du fécond rang dont on put fe fervir dans la défenfe
» & dans l’attaque, & que celles des autres rangs refi*
» toient comme immobiles &: fans effet; elles fe trou-
» voient toutes ramaffées ën faifeeaux entre l’inter-
» valle de chaque file , fans qu’il fut prefque poffible
» aux piquiers du troifieme rang ( car le refte ne fer-
» voit que d’appui), & même au fécond de voir ce
» qui fe paffoit hors du premier rang , ni de remuer
» leurs longues piques qui fe trouvoient comme en-
» châffées & enlboîtées enü-e les files, fans pouvoir
» porter leurs coups à droite ou à gauche; ce qui don-
» noit une grande facilité aux Romains de furmonter
» un obftacle redoutable en apparence , & au fond
» très méprifable. » Folàrd , traité de la colonne. Voye^
pour ce qui concerne la formation & la compofition
de la phalange, la tactique af’EIien & celle d’Arrien
(Q)
P h a l a n g e , (Hiß. nat. & Méd.) efpece d’araignée
vénimeufe, dont la piquure fait tomber dans un
affoupiffement léthargique ; les remedes à ce poifon
font l’orviétan, les fels volatils de viperes, de corne
de cerf, d’urine, la danfe, la fymphonie.
La tarentule eft une phalange dont piufieurs auteurs
ont donné l’hiftoire, & dont la morfure fe
guérît par le fon des inftrumens & la danfe.
Le venin des phalanges confifte en un fel acide
qu’elles élancént dans les vénules des chairs par leur
piquure, & qui eft porté enfuite dans les grands vaif-
feauXjOÙ il intercepte la circulation en figeant le
fang; d’où vient que les fels volatils alkalins, &tous
les autres remedes propres à raréfier les humeurs,