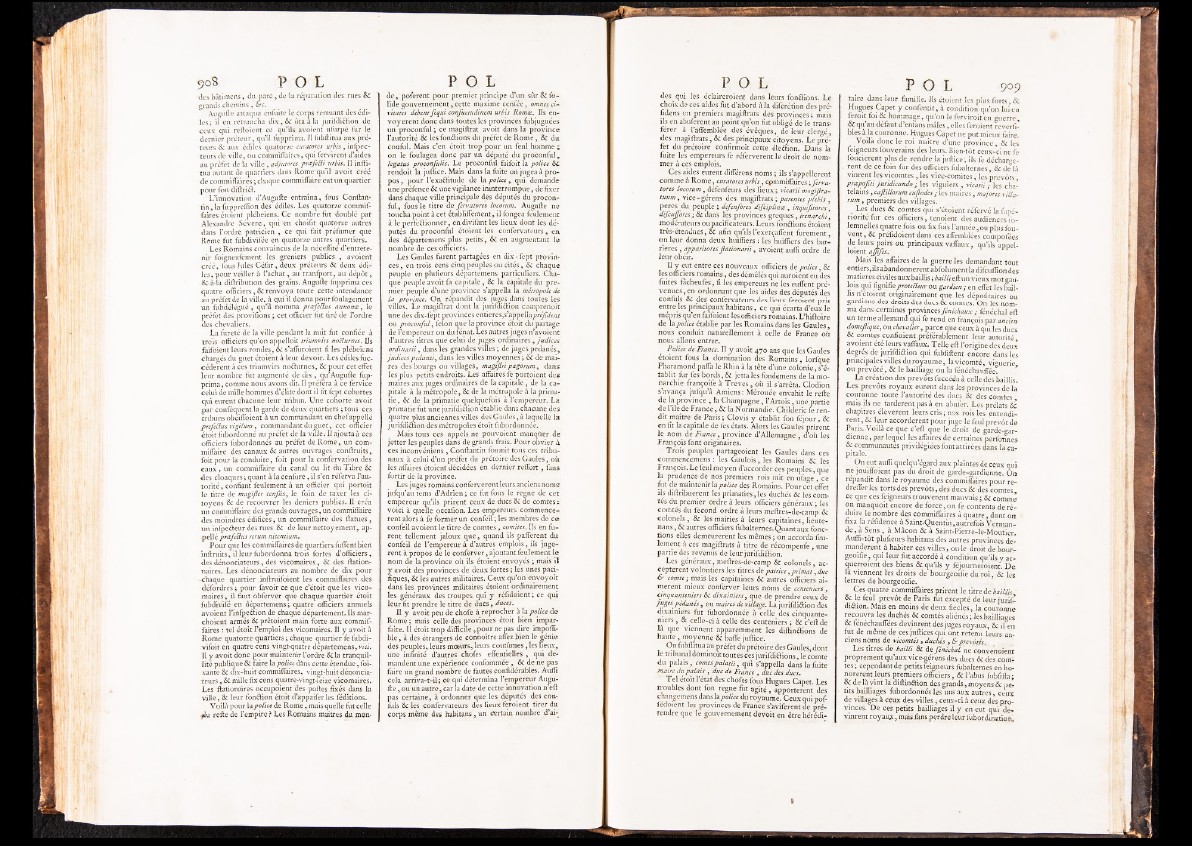
'des bûtimens, du pare, de la réparation des rues &
grands ch em in s&c.
Augufte attaqua enfuite le corps remuant des édiles
; il 'en retrancha dix, Sc ôta à la . jurifdi&ion de
ceux qui relloient ce qu*ils avoiènt ufurpé fur le
dernier préteur, qu’il fupprima. Il fubftituaaux préteurs
8c aux édiles quatorze curâmes urbis, infpec-
teurs de ville, Ou commifïàiîes, qui fervirent d’aides
au préfet de la v ille , adjutores prafecti urbis. Il infti-
tüa autant de quartiers clans Rome qu’il avoit créé
de commiffaires ; chaque commiffaire eut un quartier
pour fon 'diffriél.
' L’innovation d’Augufte entraîna, fous Gonftam
tin, la fuppreffion des édiles. Les quatorze commif-
faires ètoient plébéiens. ’Ce nombre fut doublé pat
Alexandre Sévere-, qui en choifit quatorze autres
dans l ’ordre patricien , ce -qui fait préfumer que
Rome fut fubdivifée en quatorze autres quartiers.
Les Romains convaincus de la nécelfité d’entretenir
foigneufement les greniers publics , avoient
créé, fous Jules Céfar-, deux préteurs 8c deux édiles,
pour veiller à l’achat, au tranfport, au dépôt,
Sc-à-la diftribution des grains. Augufte fupprima ces
quatre officiers, 8c renvoya toute cette intendance
au préfet de la ville, à qui il donna pour foulagement
un fubdélégué, qu’il nomma prafeclus annonce, le
préfet des provifions ; cet officier fut tiré de l’ordre
.des chevaliers.
La fureté de la ville pendant la nuit fut confiée à
trois officiers qu’on appelloit triumvirs nocturnes. Ils
faifoient leurs rondes, ôc s’affiiroient li les plébeïens
chargés du guet étoient à leur devoir. Les édiles fuc-
céderent à ces triumvirs no&urnes, 8c pour cet effet
leur nombre fut augmenté de d ix, qu’Augufte fupprima
, comme nous avons dit. Il préféra à ,ce fervice
celui de mille hommes d’élite dont il fit fept cohortes
qui eurent chacune leur tribun. Une cohor,te avoit
par conféquent la garde de deux quartiers ; tous ces
. tribuns obeiffoient à un commandant en chef appellé
.prefeclus vigilum, commandant du guet, cet officier
étoit fubordonné au préfet de la ville. Il ajouta à ces
officiers fubordonnés au préfet de Rome, un com-
miffaire des canaux & autres ouvrages conftruits,
foit pour la conduite, foit pour la confervation des
eaux, un commiffaire du canal ou lit du Tibre 8c
des cloaques ; quant à la cenfure, il s’en réferva l’autorité
, confiant feulement à un officier qui portoit
le titre de magifter cenfus, le foin de taxer les citoyens
8c de recouvrer les deniers publics. Il créa
un commiffaire des grands ouvrages, un cQmmiffaire
des moindres édifices, un commiffaire des ftatues,
un infpefteur des rues 8c de leur nettoyement, appellé
prafeclus rtrum nitentium.
Pour que les commiflaires de quartiers fuffentbien
inftruits, il leur fubordonna trois fortes d’officiers,
des dénonciateurs, des vicomaires, ôc des ftation-
naires. Les dénonciateurs au nombre de dix pour
•chaque quartier inffruifoient les commiffaires des
défordres ; pour fàvoir ce que c’étoit que les vico-
maire^, il faut obfervër que chaque quartier étoit
fubdivlfé en départemens ; quatre officiers annuels
avoient l’infpeftion de chaque département. Ils mar-
choient armés 8c prêt oient main forte aux commiffaires
: tel .étoit l’emploi des vicomaires. Il y avoit à
Rome quatorze quartiers,; chaque quartier fe fubdi-
vifoit en quatre cens vingt-quatre departemens, vici.
Il y avoit donc pour maintenir l’ordre ôc la tranquillité
publique & faire la police dâns cette étendue, foi-
xante & dix-huit commiffaires, vingt-huit dénonciateurs
, ôc mille fix cens quatre-vingt-feize vicomaires.
Les ftationaires occupoient des poftes fixés dans la
ville, & leur fonction étoit d’appaifer les féditions.
Voilà pour la police de Rome, mais quelle fut celle
jdu refte de l’empire ? Les Romains maîtres du monde
, poferent pour premier principe d’un sur ÔCfo-
lide gouvernement, cette maxime cenfée, omnes ci-
vitates debent fequi confuetudinem urbis Romce. Ils envoyèrent
donc dans toutes les provinces fubjuguées
un proconful ; ce magiftrat avoit dans la province
l’autorité ôc les fondions du préfet de Rome, 8c du
conful. Mais c’en étoit trop pour un feul homme ;
on le foulagëa donc par un député du profconful,
legatus proconfulis. Le proconful faifoit la police ÔC
rendoit la juftice. Mais dans la fuite on jugea à propos
, pour l’exa&itude de la police, qui demande
une préfence 8c une vigilance ininterrompue, de fixer
dans chaque ville principale des députés du proconful
, fous le titre de fervatores locoruin. Augufte ne
toucha point à cet établiffement, il fongea feulement
à le perfectionner, en divifarit les lieux dont les députés
du proconful étoient les confervateurs, en
des départemens plus petits, 8c en augmentant le
nombre de ces officiers.
Les Gaules furent partagées en dix - fept provinces
, en trois cens cinq peuples ou cités, ôc chaque
peuple en plulieurs départemens particuliers. Chaque
peuple avoit fa capitale, 8c la capitale du premier
peuple d’une province s’appella la métropole de
la province. On répandit des juges dans toutes les
villes. Le magiftrat dont la jurifdiCtion comprenoit
une des dix-fept provinces entières,s’appellaprèjident
ou proconful, félon que la province étoit du partage
de l’empereur ou dulénat.Les autres juges n’avoient
d’autres titres que celui de juges ordinaires, judices
ordinarii, dans les grandes villes ; de juges pedanés,
judices pedanei, dans les villes moyennes ; ôc de maires
des bourgs ou villages, magiftri pagorum, dans
les plus petits endroits. Les affaires fe portaient des
maires aux juges ordinaires de la capitale, de la capitale
à la métropole, 8c de la métropole à la prima-
tie, & de la primatie quelquefois à l’empereur. La
primatie fut une jurildiâion établie dans chacune des
quatre plus anciennes villes des Gaules, à laquelle la
jurifdiClion des métropoles étoit fubordonnée.
Mais tous ces appels ne pouvoient manquer de
jetter les peuples dans de grands frais. Pour obvier à.
ces inconvéniens , Conftantin fournit tous ces tribunaux
à celui d’un préfet du prétoire des Gaules, oit
les affaires étoient décidées en dernier reffort, fans
fortir de la province.
Les juges romains conferverent leurs anciens noms
jufqu’au tems d’Adrien ; ce fut fous le régné de cet
empereur qu’ils prirent ceux de ducs & de comtes r
voici à quelle occafion. Les empereurs commence-;
rent alors à fe former un confeil ; les membres de ce
confeil avoient le titre de comtes, comités. Ils en furent
tellement jaloux que, quand ils pafferent du
confeil de l’empereur à d’autres emplois, ils jugèrent
à propos de le conferver, ajoutant feulement le .
nom de la province oit ils étoient envoyés ; mais il
y avoit des provinces de deux fortes ; les unes pacifiques,
ÔC les autres militaires. Ceux qu’on envoyoit
dans les provinces militaires étoient ordinairement
les généraux des troupes qui y réfidoient; ce qui
leur fit prendre le titre de ducs, duces.
Il y avoit peu de chofe à reprocher à la police de
Rome; mais celle des provinces étoit bien imparfaite.
Il étoit trop difficile, pour ne pas dire impoffi-
ble, à des étrangers de connoître affez bien le génie
des peuples, leurs moeurs, leurs coutumes, les lieux,
une infinité d’autres chofes effentielles , qui demandent
une expérience confommée , & de ne pas
faire un grand nombre de fautes confidérables. Auffi
cela arriva-t-il; ce qui détermina l’empereur Augufte
, ou un autre, car la date de cette innovation n’eft
pas certaine, à ordonner que les députés des con-
fuls 8c les confervateurs des lieux feroient tirer du
corps même des habitans, un certain nombre d’aides
qui les éclaireraient dans leurs fondions. Le
choix de ces aides fut d’abord à la diferétion des pré-
fidens ou premiers magiftrats des provinces ; mais
ils en abuferent au point qu’on fiit obligé de le transférer
à l’affemblee des évêques, de leur clergé,
des magiftrats, 8c des principaux citoyens. Le préfet
du prétoire confirmoit cette élection. Dans la
fuite les empereurs fe réferverent le droit de nommer
à ces emplois.
Ces aides eurent différens noms ; ils s’appellerent
comme à Rome, curatores urbis, cpmmiffaires fervatores
locorum, défenfeurs des lieux ; vicarii magiflra-
tuum, vice-gérens des magiftrats ; parentes plebis ,
peres du peuple ; defenfores difciplince , inquiftores,
difcujfores; 8c dans les provinces greques, irenarchi,
modérateurs ou pacificateurs. Leurs fondions étoient
très-étendues, & afin qu’ils l’exerçaffent furement,
on leur donna deux huiffiers : les huiffiers des barrières
, apparitores Jlationarii, avoient auffi ordre de
leur obéir.
Il y eut entre ces nouveaux officiers de police, 8c
les officiers romains, des démêlés qui auraient eu des
fuites fâcheufes, fi les empereurs ne les euffent prévenues
, en ordonnant que les aides des députés des
confuls 8c des confervateurs des lieux feroient pris
entre les principaux habitans, ce qui écarta d’eux le
mépris qu’en faifoient les officiers romains. L’hiftoire
de la police établie par les Romains dans les Gaules,
nous conduit naturellement à celle de France oii
nous allons entrer.
Police de France. Il y avoit 470 ans que les Gaules •
etoient fous la domination des Romains, lorfque
Pharamond paffa le Rhin à la tête d’une colonie, s’établit
fur fes bords, & jetta les fondemens de la monarchie
françoife à Treves, oii il s’arrêta. Clodion
s’avança jufqu’à Amiens : Mérouée envahit le refte
de la province ,. la Champagne, l’Artois, une partie
de l’île de France, & la Normandie. Childeric fe rendit
maître de Paris ; Clovis y établit fon féjour, 8c
en fit la capitale de fes états. Alors les Gaules prirent
le nom de France, province d’Allemagne , d’où les
François font originaires.
Trois peuples partageoient les Gaules dans ces
commencemens : les Gaulois, les Romains 8c les
François. Le feul moyen d’accorder ces peuples, que'
la prudence de nos premiers rois mit en ufage , ce
fiit de maintenir la police des Romains. Pour cet effet
ils diftribuerent les primaties,les duchés 8c les comtés
du premier ordre à leurs officiers généraux; les
comtés du fécond ordre à leurs meftres-de-camp 8c
colonels , 8c les mairies à leurs capitaines, lieute-
nans, & autres officiers fubalternes. Quant aux fonctions
elles demeurèrent les mêmes ; on accorda feulement
à ces magiftrats à titre de récompenfe , une
partie des revenus de leur jurifdiétion.
Les généraux,meftres-de-camp & colonels, acceptèrent
volontiers les titres de patrice, primat, duc
& cojnte ; mais les capitaines & autres officiers aimèrent
mieux conferver leurs noms de centeniers,
cinquanttniers & dixainiers, que de prendre ceux de
juges pèdanés, ou maires de village. La jurifdiâion des
dixainiers fiit fubordonnee à Celle des cinquante-
niers, & celle-ci à celle des centeniers ; & c’eft de
là que viennent apparemment les diftinttions de
haute, moyenne & baffe juftice.
On fubftitua au préfet du prétoire des Gaules, dont
le tribunal dominoit toutes Ces jurifdiftions, lé comte
du palais , cornes palatü, qiii s’appella dans la flûte
maire du palais , duc de France , duc des ducs.
Tel etoit 1 état des chofes fous Hugues Capet. Les
troubles dont fon régné fiit agité, apportèrent des
changemens dans la police du royaume. Ceux quipof-
fedoient les provinces de France s’aviferent de prétendre
que le gouvernement devoit en être héréditaire
dans leur famille. Ils étoient les plus forts, Sc
Hugues Capet y confentit, à condition qu’on lui en
ferait foi & hommage, qu’on le ferviroit en guerre,
& qu’au défaut d’enfàns mâles, elles feraient reverfi-
blesàla couronne. Hugues Capet ne put mieux faire.
Voilà donc le roi maître d’une province, & les
feigneurs fouverains des leurs. Bien-tôt ceux-ci ne fe
foucierent plus de rendre la juftice ; ils fe déchafge-
. rent de ce loin fur des officiers fubalternes, & de là
vinrent les vicomtes , les vice-comites , les prévôts,
proepojiti juridicundo ; les viguiers , vicarii ; les châtelains
, cafiillorum eufiodes ; les maires, majores villa-
rum, premiers des villages.
Les ducs & comtes qui s’étoient réfervé la fupé-
norité fur ces officiers, tenoient des audiences for
lemnelles quatre fois ou fix fois: l’année, ou plus fou-
vent , & préfidoient dans ces affemblées compofées
de leurs pairs ou principaux vaffâux, qu’ils appel-
loient ajjifes.
Mais les affaires de la guerre les demandant tout
entiers,ils abandonnèrent abfolumentla difeuffion des
matières civiles aux baillis ; bailli eft un vieux mot gaulois
qui fignifîe prottcicur ou gardien ; en effet les baillis
netoient originairement que les dépofitaires ou
gardiens des droits des ducs & comtes. On les nomma
dans certaines provinces fénéchaux ; fénéchal eft
un terme allemand qui fe rend en françois par ancien
domejlique, ou chevalier, parce que ceux à qui les ducs
& comtes confident préférablement leur autorité
avoient été leurs vaffaux. Telle eft l’origine des deux
degrés de jurifdi&ion qui fubfiftent encore dans les
principales villes du royaume, la vicomté, vimerie
ou p révôté, & le bailliage ou la féné chauffée? ’
La création des prévôts fuccéda à celle des baillis.
Les prévôts royaux eurent dans les provinces de la
couronne toute l’autorité des ducs & des comtes
mais ils ne tardèrent pas à en abufer. Les prélats 8c
chapitres, éleverent leurs cris ; nos rois-les entendirent
, 8c leur accordèrent pour juge le feul prévôt de
Paris. Voilà ce que c’eft que le droit de garde-gardienne,
par lequel les affaires de certaines perfonnes
8c communautés privilégiées font attirées dans la capitale.,
On eut auffi quelqu’égard aux plaintes de, ceux qui
ne jouiffoient pas du droit de garde-gardienne. O'n
répandit dans le royaume des commiffaires pour rer
dreffer les torts des prévôts, des ducs 8c des comtes
ce que ces feigneurs trouvèrent mauvais ; 8c comme
on manquoit encore de force, on fe-contenta de réduire
le nombre des commiflaires à quatre, dont on
fixa la réfidence à Saint-Quentin, autrefois Verman-
d e , à Sens , à Mâcon 8c à Saint-Pierre-le-Moutier,
Auffi-tôt plufieurs habitans des autres provinces demandèrent
à habiter ces villes, ou le droit de bourr
geoifie , qui leur fut accordé à condition qu’ils y aç^
querroient des biens 8c qu’ils y féjourneroient. De
là viennent les droits de bourgeoifie du roi, Scies
lettres de bourgeoifie.
Ces quatre cpmmiffaires prirent le titre de baillis '
8c le feul prévôt de Paris fut excepté de leur j\irif?
di&ion. Mais en moins de deux fiecles, la couroiïne
recouvra les duchés 8c comtés aliéné;.les.bailliages
8c fénéchauffées devinrent des juges royaux, 8c il°en
fiit de même de ces juftices qui ont retenu leurs anciens
noms de vicomtés , duchés y & prévôtés.
Les titres de • bailli Ôc de fénéchal ne convenoient
proprement qu’aux vicérgérens des ducs 8c des comr
tes ; cependant de petits feigneurs fubalternes en honorèrent
leurs premiers officiers, 8c l ’abus fubfiftà ;
8c de là vint la diftin&ion des grands, moyens 8c per
' tits bailliages fubordonnés les uns aux autres, ceux
de villages à ceux des villes ,■ ceux-ci à ceux des provinces.
De ces petits bailliages il y en eut qui devinrent
royaux, mais fans perdre leur fubordination»