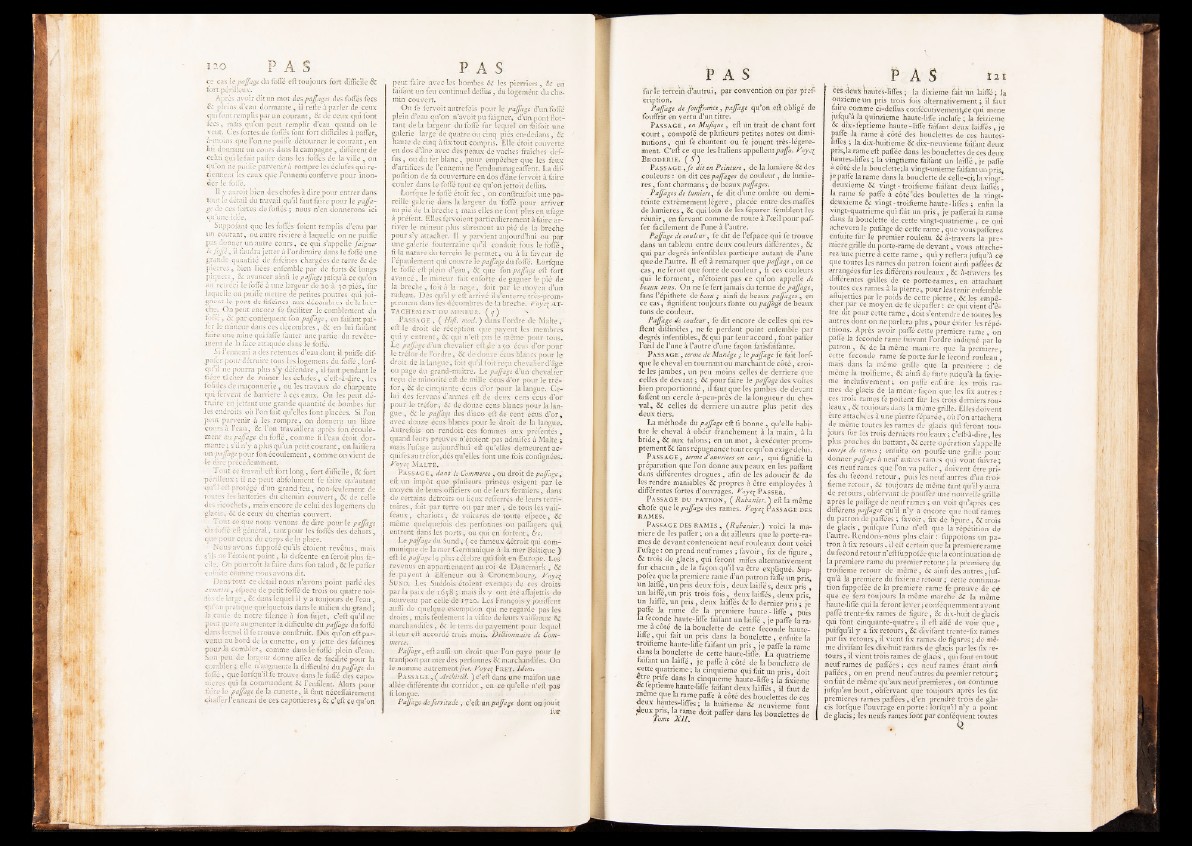
ce cas le pajfage du foffé eft toujours fort difficile 8c
fort périlleux.
Après avoir dit un mot des pajfages des foffiés fecs
& pleins d’ eau dormante, il relie à parler de ceux
gui font remplis par un courant, de de ceux qui font
lecs, mais qu’on peut remplir d’eau quand on le
veut. Ces fortes de foffés font fort difficiles à paffer,
à-moins que l’on ne puilfe détourner le courant, en
lui donnant un cours dans la campagne, différent de
celui qui le fait paffer dans les foffés de la ville , ou
qu’on ne puiffe parvenir à rompre leséclufes qui retiennent
les eaux que l’ennemi conferve pour inonder
le foffé.
Il y auroit bien des chofes à dire pour entrer dans
tout le détail du travail qu’il faut faire pour le pajfa-
_ge de ces fortes de foffés ; nous n’en donnerons ici
qu’une idée. ..
Suppofant que les foffés' foient remplis d’eau par
un courant, ou autre riviere à laquelle on ne puiffe
pas donner un autre cours, ce qui s’appelle faigner
Afojfé-, il faudra jetter à l’ordinaire dans le foffé une
grande quantité de fafcines chargées de terre 8c de
pierres, bien liées enfemble par de forts & longs
piquets, & avancer ainfi le pajfage jufqu’à ce qu’on
ait rétréci le foffé à une largeur de 20 à 3 0 piés, fur
laquelle on puiffe mettre de petites poutres qui joignent
le pont de fafcines aux décombres de la brèche.
On peut encore fe faciliter le comblement du
foffé, 8c par conféquent fon pajfage, en failant paf-
ler le mineur dans ces décombres, 8c en lui faifant
faire une mine qui faffe fauter une partie du revêtement
de la face attaquée dans le foffé.
Si l’ennemi a des retenues d’eau dont il puiffe dif-
.pofer pour détruire tous les logemens du foffé, lorfqu’il
ne pourra plus s’y défendre , il faut pendant le
liège tâcher de ruiner les éelufes, c’eft-à-dire, les
fohdes de maçonnerie, ou les travaux de charpente
qui fervent de barrière à ces eaux. On les peut détruire
en jettant une grande quantité de bombes fur
les endroits oii l’on fait qu’ elles font placées. Si l’on
peut parvenir à les rompre, on donnera un libre
cours à l’eau, 8cTon travaillera après fon écoulement
su pajfage du foffé, comme fi Peau étoit dormante;
s’il n’y a plus qu’un petitcourant, on laiffera
un pajfage pour fon écoulement, comme on vient de
le dire précédemment.
Tout ce travail eft fort long , fort difficile, 8c fort
périlleux ; il ne peut abfolument fe faire qu’autant
qu’il eft protégé d’un grand feu, non-feulement de
toutes les batteries du chemin couvert, 8c de celle
des ricochets, mais encore de celui des logemens du
glacis, & de ceux du chemin couvert.
Tout ce que noiis venons de dire pour le pajfage
du fofle eft général, tant pour les fofles des dehors,
que pour ceux du corps de la place.
Nous avons fuppofë qu’ils étoient revêtus, mais
s’ils ne l’étoient point, la defcente enferoitplus facile.
On pburroît la faire dans fon talud, & le paffer
•enfuite comme nous avons dit. . :
Dans tout ce détail nous n’avons point parlé des
èurteues, efpece de petit foffé de trois ou quatre toi-
des de large , 8c dans lequel il y a toujours de l’eau,
•qu’on pratique quelquefois' dans le milieu du grand ;
la cauie de notre filence à fon fujet, c’eft qu’il ne
peut guere augmenter là difficulté du pajfage du foffé
dans lequel il fe trouve conftruit. Dès qu’on eft parvenu
au bord de la cunette, on y jette des fafcines
pour la combler, comme dans le foffé plein d’eam
Son peu' de largeur donne affez de facilité pour la
combler; elle n’augmente la difficulté du pajfage du
foffé, que lorfqu’il fe trouve dans le foffé des capo-
nieres qui la commandent 8c l’enfilent. Alors pour
faire le pajfage de la cunette, il faut néceffairement
chaffer l’ennemi de ces caponieres ; 8c c’eft ce qu’on
peut faire avec les bombes 8c les pierriers, 8c en
faifant un feu continuel deffus , du iogemënt du chemin
couvert.
On fe fervoit autrefois pour le pajfage d’un foffé
plein d’eau qu’on n’avoit pu faigner, d’un pont flottant
de la largeur du folié fur lequel on faifoit une
galerie large de quatre ou cinq piés en-dedans, 8c
haute de cinq à fix tout compris. Elle étoit couverte
en dos d’âne avec des peaux de vaches fraîches deffus
, ou du fer blanc, pour empêcher que les feux
d’artifices de l’ennemi ne l’endommageaffent. La dif-
pofition de fa couverture en dos d’âne fervoit à faire
couler dans le foffé tout ce qu’on jettoit defliis.
Lorfque le foffé étoit fée , on conftruifoit une pareille
galerie dans la largeur du ‘foffé pour arriver
au pie de la breche ; mais elles ne font plus en ufage
à préfent. Elles fervoient particulièrement à faire arriver
le mineur plus sûrement au pié de la breche
pour s’y attacher. Il y parvient aujourd’hui ou par
une galerie fouterraine qu’il conduit fous le foffé,
fi la nature du terrein le permet, ou à la faveur de
l’épaulement qui couvre le pajfage du foffé. Lorfque
lé foffé eft plein d’eau, 8c que fon pajfage eft fort
avancé, le mineur fait enforte de gagner le pié de
la breche , foit à la nage, foit par le moyen d’un
radeau. Dès qu’il y eft arrivé il s’enterre très-promptement
dans les décombres de la breche. Voyez At ta
ch em en t DU MINEUR. ( ç ) N
Passage , ( Hiß. niod. ) dans l’ordre de Malte,’
eft le droit de réception que payent les membres
qui y entrent, 8c qui n’eft pas le même pour tous.
Le pajfage .d’un chevalier eft .de 25b écus d’or pour
le trélor de l’ordre, 8c de douze écus blancs pour le
droit de la langue, foit qu’il foit reçu chevalier d’âge
ou page du grand-maître. Le pajfage d’un chevalier
reçu de minorité eft de mille écus d’or pour le tré-
fo r , 8c de cinquante écus d’or pour la langue. Celui
des fervans d’armes eft de deux cens ecus d’or
pour le tréfor, 8c de douze cens blancs pour la langue
, 8c le pajfage des diaco eft de cent écus d?o r ,
avec douze écus blancs pour le-droit de la langue..
Autrefois on rendoit ces fommes aux préfentés ,
quand leurs preuves n’étoient pas àdmifes à Malte ;
mais l’ufage aujourd’hui eft qu’elles demeurent ac-‘
quifes au tréfor, dès qu’elles font une fois confignéésè-
Voyei Malte. •
Pa s sa g e , dans h Commerce , ou droit de pajfage ,
eft un impôt que pliifieurs princes exigent par le
moyen de; leurs officiers' ou de leurs fermiers, dans
de certains détroits ou lieux refferrés d è leurs terri-;
toires, foit par terre ou par mèr , dé tous lés Vaif-
feaux, chariots , 8c voitures de toiité efpece, 8c
même quelquefois des perfonries ou paffagers qui
entrent dans les ports, ou qui en fbrtent, &ç.
Le pajfage du Sund, ( ce fameux détroit qui communique
de la mer Germanique à: la mer Baltique Y
eft lé pajfage lo. plus célébré qui foit en Europe. Les
revenus en appartiennent au roi -de Danemark , 8c
fe payent à Elfeneur ou à Cronembourg. Voyè^
Sund. Les Suédois étoient exempts de ces'droits1
par la paix de 1658 ; mais ils y ont été affujettis de
nouveau par celle de 1720. Les François y jouiffent
auffi de quelque exemption qui ne regarde pas les
droits, mais feulement la vifite de leurs vaiffeaux 8c
marchandifes, 8c le terns du payement pour lequel
il leur eft accordé trois mois. Dictionnaire de Commerce.
Pajfage, eft auffi un droit que l’on paye pour le
tranfport par mer des perfonnes 8c marchandifes. On
le nomme autrement fret. Voye[ Fret. Idem.
Pass â g e , jArchitect. ) c’eft dans une maifonune
allée différente du corridor , en ce qu’elle n’eft pas
fi longue.
Pajfage defervitpde , c’eft Unpajjage dont OU jouit
fur
’jfurlé te’freiÀ d’autrui, par convention ou par pref-
Cription,
Pajfage de fouffrahee, pajfage qu’on eft obligé de
fouffrir en vertu d’un titre;
Passage , en Mujique, eft Un trait de chant fort
dourt, compofé de plufieürs petites notes ou diminutions
, qui fe chantent ou fe jouent très-légere-
ment. C ’eft ce que les Italiens appellent paffo. Voyez
Broderie. ( S )
Passage ,fe dit en Peinture, de la lumière 8c des
couleurs : on dit cespajfages de couleur, de lumières
, font charmans ; de beaux pajfages.
Pajfages de lumière, fe dit d’une ombre où demi-
teinte extrêmement légère, placée entre des maffes
de lumières , 8c qui loin de les féparer femblent les
réunir, en fervant comme de route à l’oeil pour paffer
facilement de l’une à l’autre.
Pajfage de couleur, fe dit de l’efpace qui fe trouve
dans un tableau entre deux couleurs différentes, 8c
qui par degrés infenfibles participe autant de l’une
que de l’autre. Il eft à remarquer que pajfage, en ce
cas, ne feroit que fonte de couleur, fi ces couleurs
qui le forment, n’étoient pas ce qu’on appelle de
beaux tons. On ne fe fert jamais du terme de pajfage,
fans l’épithete de beau ; ainfi de beaux pajfages, en
ce cas, lignifient toujours fonte ou pajfage de beaux
tons de couleur*
Pajfage de couleur, fie dit encore de celles qui renflent
diftinéles, ne fe perdant point enfemble par
degrés infenfibles, 8c qui par leur accord, font paffer
l’oeil de l’une à l’autre d’une façon fatisfaifante.
P assage , terme de Manège ; le pajfage fe fait lorfque
le cheval en tournant ou marchant de côté, èroi-
fe les jambes, un peu moins celles de derrière que
celles de devant ; 8c pour faire le pajfage des volt es.
bien proportionné, il faut que les jambes de devant
fàffent un cercle à-peu-près de la longueur du chev
a l, 8c celles de derrière un autre plus petit des
deux tiers.
La méthode du pajfage eft fi bonne , qu’elle habitue
le cheval à obéir franchement à la main, à la
bride, 8c aux talons ; en un m ot, à exécuter promptement
8c fans répugnance tout ce qu’on exige delui.
PASSAGE, terme d ’ouvriers en cuir, qui lignifie la
préparation que l’on donne aux peaux en les pàffant
dans différentes drogues, afin de les adoucir 8c dé
les rendre maniables 8c propres à être employées à
différentes fortes d’ouvrages. Voyez Passer;
Passage du patron, f Rubanier. ) eft la même
chofe que le pajfage des rames. Voye^ Passage des
rAbbAot des r am e s , {^Kubanter. j voici la maniéré
de les paflér ; on a dit ailleurs que le porte-rames
de devant contenoient neuf rouleaux dont voici
l ’ufage : on prend neuf rames ; fa voir-, fix de figure ,
8c trois de glacis, qui feront mifes alternativement
fur chacun, de la façon qu’il va être expliqué. Sup-
pofezque la première rame d’un patron fàffe iin pris,
un laifle, un pris deux fois, deux laiflé Sj deux pris *
un laifle, un pris trois fois , deux laiffés, deux pris,
tm laifle, un pris, deux laiffés 8c le dernier pris ; je
paffe la rame de la première haute *liffe * puis
la fécondé haute-liffe faifant un laifle , je paffe la rame
à côté de la bouclette de cette fécondé haute*
hffe, qui fait un pris dans la bouclette > enfuite la
troifieme haute-liffe faifant un pris, je paffe la rame
dans la bouclette de cette haute-liflè. La quatrième
faifant un laiffé, je paffe à côté de la bouclette de
cette quatrième ; la cinquième qui fait un pris doit
ctre prife dans la cinquième haute-liffe ; la fixieme
ocieptieme haute-liffe faifant deux laiffés, il faut de
meme que la rame paffe à côté des bouclettes de ces
eux autes-lifles; la huitième 8c neuvième font
deux pris, la rame doit paffer dans les bouclettes de
lome X I I .
eès deux haûtés-ïiffes ; la dixième fait Un laifle ; la
onzième Un pris trois fois alternativement ; il faut
faire comme ci-deffus confécutivement,ce qui mene
jufqu à la quinzième haute-liffe inclufe ; la feizieme
8c dîx-feptieme haute-liffe faifant deux laiffés , je
paffe la rame à côté des bouclettes de ces hautes*
liffes ; la dix-huitieme 8c dix-neuvieme faifant deux
pris,larame eft paffée dans les bouclettes de ces deux
hâutes-liffes ; la vingtième faifant un laiffé , je paffe
a côté.de la bouclette;la vingt-unieme faifant un pris,
je paffe la rame dans la bouclette de celle-ci; la. vingt;
deuxieme 8c vingt * troifieme faifant deux laiffés,
la rame fe paffe à côté Mes boulettès de la vingt-
deuxieme 8c vingt - troifieme haute - liffes ; enfin la
vingt-quatrieme qui fait un pris, je pafferai la rame
dans la bouclette de cette vingt-quatrieme j ce qui
achèvera le paffage de cette rame, que vouspafferez
enfuite fur le premier rouleau 8c à-travers la première
grille du porte-rame de devant, vous attacherez
une pierre à cette rame ; qui y reftera jufqu’à ce
que toutes les rames du patron foient ainfi paffées 8c
arrangées fur les différens rouleaux, 8c à-travers les
différentes grilles de ce porte-rameS', en attachant
toutes ces rames à la pierre, pour lés tenir ènfemblé
aflujetties par le poids de cette pierre, 8c les empêcher
par ce moyen de fe dépaffer : ce qui vient d’ê;
tre dit pour cette rame, doit s’entendre de toutes les
autres dont on rie parlera plus, pour éviter les répétitions.
Après avoir paffé cette première rame -, on
paffe la fécondé rame fuivant l’ordre indiqué par le
patron , 8c de la même maniéré que la première ;
cette fécondé rame fe porte lur le fecorid rouleau j
mais dans la même grille que la première : de
même la troifieme, 8c ainfi de fuite jufqu’à la fixiez
-me inclufivement ; on paffe enfiite les' trois rames
de glacis de la même façon que les fix autres :
ces trois rames fie portent fûr les trois derniers rouleaux
, 8c toujours dans la même grille. Elles doivent
etre attachées à une pierre féparée:, oii l’on attachera
de meme toutes les rames de glacis qui feront toujours
fur les trois derniers rouleaux ; c’eft-à-dire, les
plus proches du battant, 8c cette opération s’appelle
courje de rames ; enfiiite on pouffe une grille pour
donner pajfage à neuf autres rames qui vont fuivre ;
ces neuf rames que l’on va paflér, doivent être pri-
fes du fécond retour, piiis les neuf autres d’un troifieme
retour, 8c toujours de même tant qu’il y aura
de retours, obfervant de pouffer une nouvelle trille
après le paffage de neuframes ; on voit qu’après ces
différens pajfages qu’il n’y a encore que neuf rames
du patron de paffées ; favoir, fix de figure * 8c trois
de glacis, puifque l’une n’eft que la répétition de
l’autre. Rendons-nous plus clair : füppofons un patron
à fix retours, il eft certain que la première rame
du fécond retour n’eft fuppofée que la continuation de
la première rame du premier retour ; la première du
troifieme retour de même, 8c ainfi des autres ; juft
qu’à la première du fixieme retour ; cette continuation
fuppofée de la première rame fe prouve de cé
que ce fera toujours la même marche 8c la même
haute-liffe qui la feront lever.; conféqitemment ayant
paffé trente-fix rames de figure, 8c dix-huit de glacis
qui font cinquante-quatre ; il eft aifé de voir que,
puifqu’il y a fix retours , 8c divifant trente-fix rames
par üx retours, il vient fix rames de figures ; de même
divifant les dix-huit rames de glacis parles fix retours
, il vient trois rames de glacis , qui font en tout
neuf rames de paffées ; ces neuf rames étârit ainfi
paffées, On en prend neuf autres du premier retour ;
on fait de même qu’aux neuf premières, on continue
jufqu’au bout, obfervant que toujours après les fix
premières- rames paflées , d’en prendre trois de glacis
lorfque l’ouvrage en porte : lorfqu’il n’y a point
de glacis ; les neufs rames font par conféquent toutes I Q