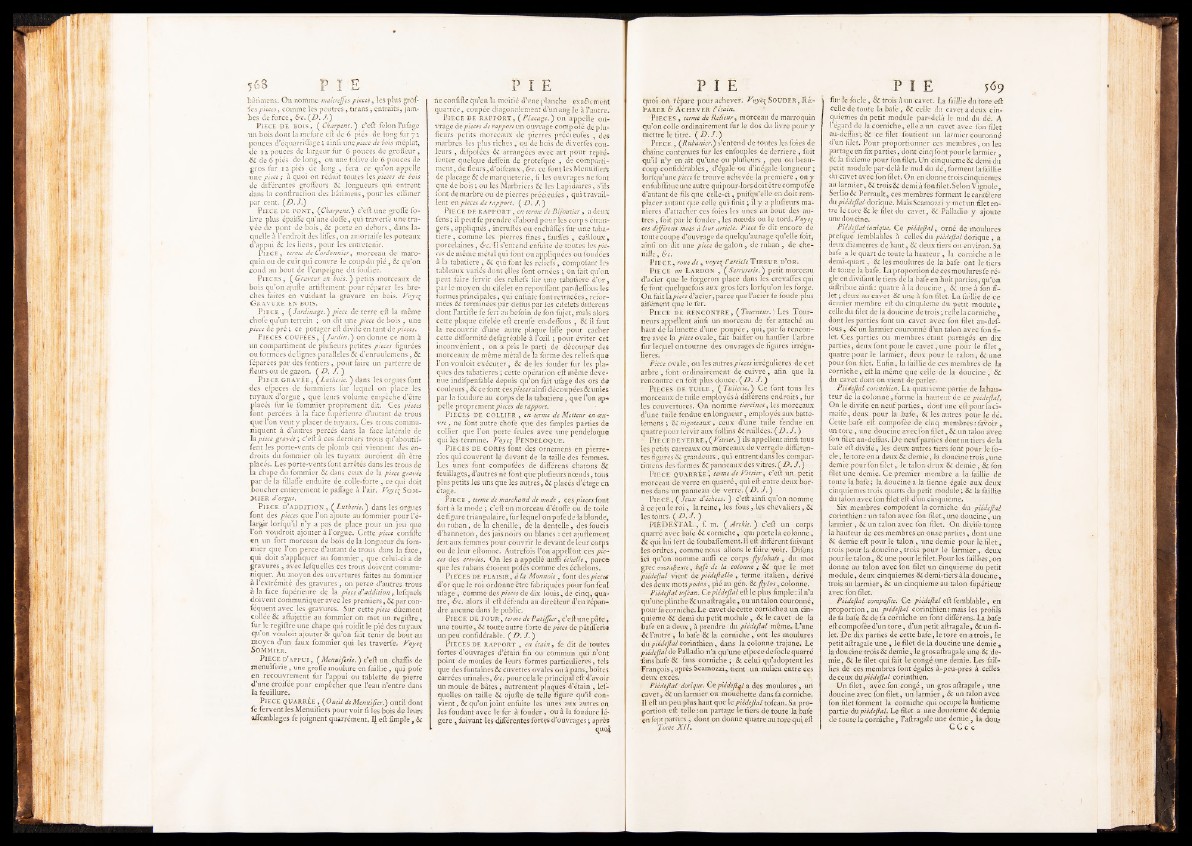
bâtimens. On nomme maitrejfes pièces, les plus grôf-
fes pièces, comme les poutres, tirans, entraits, jambes
de force, &c. (D . J.)
P IECE DE BO IS , ( Charpent. ) c’eft félon l’ufage
un bois dont la mefure eft de 6 pies de long fur 72
pouces d’équarriffage ; ainfi une piece de bois méplat,
de 12 pouces de largeur fur 6 pouces de groffeur ,
& de 6 pies de long, ou une folive de 6 pouces de
gros fur 12 pies de long , fera ce qu’on appelle
une pièce ; à quoi on réduit toutes les pièces de bois
de différentes groffeurs 8c longueurs qui entrent
dans la conftruétion des bâtimens, pour les eftimer
par cent. (D . J.)
P i e c e DE PO N T , (Charpent.') c’eft une groffe folive
plus épaifl'e qu’une doffe, qui traverfe une travée
de pont de bois, 8c porte en dehors, dans laquelle
à l’endroit des lilfes, on amortaife les poteaux
d’appui 8c les liens, pour les entretenir.
P IE C E , terme de Cordonnier, m o r c e a u d e m a ro q
u in o u de c u i r q u i c o u v r e le co u p d u p ié , 8c q u ’ o n
c o u d a u b o u t d e l ’em p e ig n e d u fo u lie r .
P IE C E S , ( Graveur en bois. ) petits morceaux de
bois qu’on ajufte artiftement pour réparer les brèches
faites en vuidant la gravure en bois. Voye£
G r a v u r e e n b o i s .
P iE C E , (Jardinage.) piece de t e r r e e ft la m êm e
c h o f e q u ’u n te r r e in ; o n d it u n e piece de bois , u n e
piece d e p r e ; c e p o ta g e r e ft d iv i fé en tan t de pièces,
P i è c e s c o u p é e s , (Jardin.) on donne ce nom à
lin compartiment de plufieurs petites pièces figurées
ou formées de lignes parallèles 8c d’enroulemens , 8c
féparées par des fentiers , pour faire un parterre de
fleurs ou de gazon. (D . J . )
P i e c e g r a v é e , (Lutherie. ) dans les orgues font
des efpeces de fommiers fur lequel on place les
tuyaux d’orgue , que leurs volume empêche d’être
placés fur le fommier proprement dit. Ces pièces
font percées à la face fupérieure d’autant de trous
que l’on veut y placer de tuyaux. Ces trous communiquent
à d’autres percés dans la face latérale de
la piece gravée ; c’eft à ces derniers trous qu’aboutif-
fent les porte-vents de plomb qui viennent des endroits
du fommier oii les tuyaux auroient dû être
placés. Les porte-vents font arrêtés dans les trous de
la chape du fommier 8c dans ceux de la piece gravée
par de la fillaffe enduite de colle-forte , ce qui doit
boucher entièrement le paffage à l’air. Voye^ S o m m
i e r d? orgue.
P i e c e d ’a d d i t i o n , ( Lutherie.') dans les orgues
font des pièces que l’on ajoute au fommier pour l’élargir
lorfqu’il n’y a pas de place pour un jeu que
l’on voudroit ajouter à l’orgue. Cette piece conftfte
en un fort morceau de bois de la longueur du fommier
que l’on perce d’autant de trous dans la face,
qui doit s’appliquer au. fommier, que celui-ci a de
gravures , avec lefquelles ces trous doivent communiquer.
Au moyen des ouvertures faites au fommier
à l’extrémité des gravures , on perce d’autres trous
à la face fupeneure de la piece d.'addition, lefquels
doivent communiquer avec les premiers, & par con-
féquent avec les gravures. Sur cette piece dûement
collée 8c affujettie au fommier on met un regiftre,
fur le regiftre une chape qui roidit le pié des tuyaux
qu’on vouloit ajouter & qu’on fait tenir de bout au
moyen d’un faux fommier qui les traverfe. Voye^
S o m m i e r .
P i e c e d ’ a p p u i , (Menuiferie. ) c’eft un chaflis de
menuiferie , une groffe moulure en faillie , qui pofe
en recouvrement fur l’appui ou tablette de pierre
d’une croifée pour empêcher que l’eau n’entre dans
la feuillure.
P iE C E QUARREE , (Outil de Menuijîer.) outil dont
fe fervent les Menuifiers pourvoir fi les bois de leurs
affemblages fe joignent quarrément. I( eft fimple, 8c
De co n ftfte q f f e n la m o it ié d’Une p lan c h e e x a $ ejmèftt
q u a r r é e , c o u p é e d ia g o n a iem én t d ’u n an g l e à l’ a u t r e .
P i e c e d e r a p p o r t , (Placage.) on appelle ouvrage
de pièces de rapport un ouvrage comp oi'é de p lufieurs
petits morceaux de pierres préciëufes , dés
marbres les plus riches ,‘ qu de bois de diverfes couleurs
, difpolées 8c arrangées avec art pour repré-
fenter quelque deffein de grotefque , de compartiment
, de fleurs, d’oifeaux, &c. ce font les Menuifiers
de placage & de marqueterie, fi les ouvrages ne font
que de bois ; ou les Marbriers 8c les Lapidaires, s’ils
font de marbre ou de pierres précieufes , qui travaillent
en pièces de rapport. (D , J.)
P i e c e df. R A P PO R T , en terme de Bijoutier, a deufc
fe n s ; i l p eu t f e p re n d r e d ’a b o rd p o u r le s c o r p s é tr an g
e r s , a p p l iq u é s , in c ru fté s o u en ch â ffé s fu r u n e tab at
iè r e , com m e le s p ie r re s fin es , fau ffe s , c a i l l o u x ,
p o r c e la in e s , &c. I l s ’ e n ten d en fu ite de to u te s le s pièces
d e m êm e m é ta l q u i fo n t o u a p p liq u é e s o u foucléeS
à la ta b a t iè r e , & q u i fo n t le s r e lie f s , c om p o fa n t lé s
ta b le a u x v a r ié s d o n t e lle s fo n t o rn é e s ; On fa it q u ’o n
p eu t fa ire f e r v i r d e s r e lie f s fu r u n e t a b a t iè r e d’o r ,
p a r l e m o y e n d u c i fe le t en rep o u ffa n t p ar -d effou s le s
fo rm e s p r in c ip a le s , q u i èn fu ite fo n t r e t r a c é e s , r e fo r mé
e s & te rm in é e s p a r d effus p a r le s c i fe le t s d iffé ren s
d o n t l ’a r t ifte fe fe r t au b e fo in de fo n fu je t , ma is a lo r s
c e t te p la q u e c i f e lé e e ft c r e ii fe en-d effou s , 8c i l fa u t
la r e c o u v r i r d’u n e a u t r e p la q u e lifte p o u r c a c h e t
c e t te d iffo rm ité d e fa g ré a b le à l’ oeil ; p o u r é v i te r c e t
in c o n v é n i e n t , o n a p ris le p a r t i d e d é c o u p e r d e s
m o r c e a u x de m êm e m é ta l d e la fo rm e d e s r e lie f s q u e
l ’ o n v o u lo i t e x é c u t e r , 8c de le s fo n d e r fu r le s p la q
u e s d es ta b a t iè r e s ; c e t te o p é r a t io n e ft m êm e d e v e n
u e in d ifp en fab le d epu is q u ’o n fa it u fa g e d e s o r s d e
c o u le u r s , & c e fo n t ces/>ie«r a in fi d é c o u p é e s & u n ie s
p a r la fo u d u r e au co rp s de la t a b a t iè r e , q u e l’ o n ap-*
p e lle p ro p r em e n t pièces de rapport.
P i è c e s d e c o l l i e r , en terme de Metteur en oeuvre
, n e fo n t au t r e c h o fe q u e des fim p le s p a r tie s d e
c o l l ie r q u e l’ o n p o r te fe u le s a v e c u n e p en d e lo q u e
q u i le s te rm in e . Vôye% P e n d e l o q u e .
P i è c e s d e c o r p s font.des ornemens eft pierreries
qui couvrent le devant de la taille des femmes.
Les unes font compofées de différens chatons 8C
feuillages, d’autres ne font que plufieurs noeuds, tous
plus petits les uns que les autres, 8c placés d’étage eij
étage.
P iE C E , terme de marchand de mode , ces pièces font
fort à la mode ; c’eft un morceau d’étoffe ou de toile
de figure triangulaire, fur lequel on pofe de la blonde,
du ruban, de la chenille, de la dentelle, des foucis
d’hanneton, des jais noirs ou blancs : cet ajuftement
fert aux femmes pour couvrir le devant de leur corps
ou de leur eftomac. Autrefois l’on appelloit ces pièces
des crevées. On les a appellé aufli échelle, parce
que les rubans étoient pofes comme des échelons.
PIECES DE p l a i s i r , à la Monnoie , fo n t d e s pièces
d ’o r q u e le r o i o rd o n n e ê t r e fa b r iq u é e s p o u r fo n f e u !
u fa g e , com m e des pièces d e d ix lo u i s , de c in q , q u a t
r e , &c. a lo r s i l e ft d é fen d u a u d i r e û e u r d ’en r ép an d
r e a u c u n e dans le p u b lic.
P lE C E DE FOU R, terme de Patijjîer, c ’ e ft u n e p â t e ,
u n e t o u r t e , & to u te au t re fo r t e d e piece d e p â t iffe r ia
u n p eu co n fid é r a b le . (D . J .)
PIECES DE r a p p o r t , en étain, f e d it d e to u te s
fo r te s d’ o ü v r a g e s d’ é ta in fin o u com m u n q u i n’ o n t
p o in t de m o u le s d e leu rs fo rm e s p a r t i c u l iè r e s , te ls
q u e des fo n ta in e s & c u v e t te s o v a le s o u à p an s , b o îte s
c a rr é e s u r in a le s , &c. p o u r c e la le p rin c ip a l e ft d’a v o i r
u n m o u le de b âtes , au t r em e n t p laq u e s d’é ta in , le l-
q u e lle s o n ta ille 8c a ju fte de t e lle figu re q u ’il c o n v
ie n t , & qu ’ o n jo in t e n fu ite le s u n e s a u x au tres en
le s fo u d an t a v e c le f e r à f o u d e r , o u à la fo u d u r e lé g
è r e , fu iv a n t le s d iffé ren te s fo r te s d ’o u v r a g e s ; ap rès
q u o i'
quoi on fépare pour achever. Vyyêç Soüdèr , Ré parer
& A ch ever l'étain .
PIECES , terme de R e lieu r , morceau de marroquin
qu’on colle ordinairement fur le dos du livre pour y
mettre le titré. ( D . J. )
Piece , (R u b an ier .) s’entend de toutes les foies de
chaîne contenues fur les enfçuples de derrière , foit
qu’il n’y en ait qu’une ou plufieurs , peu ou beaucoup
confidérables, d’égale ou d’inégale longueur ;
lorlqu’une piece fe trouve achevée la première , on y
en fubftitiie une autre qui pour-lo rs doit être compofée
d’autant de fils que celle-ci, puifqu’elle en doit remplacer
autant que celle qui finit ; il y a plufieurs maniérés
d’attacher ces foies les unes au bout des autres
, foit par le fouder, les noeuds ou le tord. Voye^
ces différens mots à leur article. P iec e fe dit encore de
toute coupe d’ouvrage de quelqu’aunage qu’elle foit,
ainfi on dit une piece de galon, de ruban , de chenille
, &c .
P i e c e , roue d e , v oye^l'article T ireur d’or.
Piec e ou Lardon , ( Serrurerie. ) petit morceau
d’acier qüe le forgeron place dans les crevaffes qui
fe font quelquefois aux gros fers lorfqu’on les forge.
On fait la piece d’acier, parce que l’acier fe foude plus
aifémeftt que le fer.
Piece de rencontre , ( Tourneur. ) Les Tourneurs
appellent ainfi un morceau de fer attaché au
haut de la lunette d’une poupée, qui, par fa rencontre
avec la piece ovale, fait baiffer ou hauffer l’arbre
fur lequel on tourne des ouvrages de figures irrégulières.
P iece ovale, ou les autres pièces irrégulières de cet
arbre , font Ordinairement de cuivre , afin que la
rencontre en foit plus douce. ( D . J .)
PIECES de t u il e , { T u i le r ie .) Ce font tous les
morceaux de tuile employés à différens endroits, fur
les couvertures. On nomme tiercines, les morceaux
d’une tuile fendue en longueur, employés auxbatte-
lemens ; 8c n ig o tea u x , ceux d’une tuile fendue en
quatre pour fervir aux follins 8c ruillées. (D . J . ) . •
■' PiECEDEVERRE, ( Vitrier.) ils appellentainfi tous
les petits carreaux ou morceaux de verrede différentes
figures & grandeurs, qui entrent dans les compar-
timens des-formes & panneauxdesvitres.fi?. J. j .
Piece quarrée ‘ terme de V itr ie r , c’eft un. petit
morceau de verre en. quarré ,• qui eft entre, deux bornes
dans un panneau de verre. ( D . J . )
Pie c è , ( J e u x d'échecs. ) c’eft ainfi qu’on nomme
à ce jeu le roi-, la reine, les fous, , les chevaliers, 8c
les tours. ( D . J . )
PIÉDESTAL , f. m. ( A r ch it. ) c’eft un corps
quarré avec bafe.& corniche, qui porte la colonne,
8c qui lui fert de foubaffement.il eft différent fuivant
les ordres, comme nous allons le faire voir. Difons
ici qu’on nomme aufli ce corps j ly lo b a je , du mot
grec (j~rüÀe/3aT/ç, bafe de la colonne ; 8£; que le mot
■ piédeftal vient depiédeftatlo , terme italien, dérivé
des deux motsp o d o s , pié au gén. 8c f ty lo s , colonne.
P iédeftal ïofean. Cep iéd e jla l eft le plus fimple : il n’a
qu’une plinthe & un aftragale, Ou un talon couronné,
pour fa corniche. Le cavet de cette corniche a un cinquième
8c demi du petit module, & le cavet de la
bafe en a deux, à prendre du p iéd e jla l même. L’une
8c l’autre , la bafe 8c la corniche, ont les moulures
du p iéd ejla l corinthien, dans la colonne trajane. Le
p iéd ejla l de Palladio n’a qu’une efpece defocle quarré
■ fans bafe 8c fans corniche ; & celui qu’adoptent les
François , après Scamozzi, tient un milieu entre ces
deux excès.
P iéd e jla l dorique. C e p iéd ejla l a des moulures , un
cavet , 8c un larmier ou mouchette dans fa corniche.
Il eft un peu plus haut que le p iéd e jla l tofean. Sa proportion
eft telle:on partage le tiers de toute la.bafe
en fept parties, dont on donne, quatre au tore qui eft
Tome X I I .
ftir le fôcl'é, & trois à un cavet. La faillie du tore eft:
celle de toute la bafe, 8c celle du cavet a deux cinquièmes
du petit module par-delà le nud du dé. A
l’égard de la corniche, elle a un cavet avec fon filet
au-deffus’; 8c ce filet foutient un larmier couronné
d’un filet. Pour proportionner ces membres, on les
partageen fix parties, dont cinq font pour le larmier,
8c la fixieme pour fon filet. Un cinquième & demi du
petit module par-delà le nud du dé, forment la faillie
du cavet avec fon filet. On en donne trois cinquièmes
au larmier, 8c trois & demi à fon filet. Selon Vignole,
Serlio & Perrault, ces membres forment lecarai&ere
du piédejlal dorique. Mais Scamozzi y met un filet entre
le tore 8c le filet du cavet, & Palladio y ajoute
une doucine.
Piédejlal ionique. Ce piédejlal, orné de moulures
prefque femblables à celles du piédejlal dorique , a
deux diamètres de haut, 8c deux tiers ou environ. Sa
bafe a le quart de toute la hauteur , la corniche a le
demi-quart, 8c les moulures de la bafe ont le tiers
de toute la bafe. La proportion de ces moulures fo régie
en divifant le tiers de la bafe en huit parties ,qu’on
diftribue ainfi: quatre à la doucine , 8c une à fon £-
let ; deux au cavet 8c une à fon filet. La faillie de ce
dernier membre eft du cinquième du petit module,
celle du filet de là doucine de trois ; reftela corniche,
dont les parties font un cavet avec fon filet au-def-
fous, & un larmier couronné d’un talon avec fon filet.
Ces parties ou membres étant partagés en dix
parties, deux font pour le cavet, une pour lè filet,
quatre pour le larmier, deux pour le talon, 8c une
pour fon filet. Enfin, la faillie de ccs membres de la
corniche, eft la même que celle de la doucine, 8c
du cavet dont on vient de parler.
Piédejlal corinthien. La quatrième partie de .la hauteur
de la colonne, forme la hauteur de ce piédejlal.
On le divife en neuf parties, dont une eft pour la ci-
maife, deux pour la bafe, & les autres pour le dé.
Cette bafe eft compofée de cinq membres : favoir,
un tore, une doucine avec fon filet, 8c un talon avec
fon filet aü-deffus. D e neuf parties dontun tiers delà
bafe eft.divifé, les deux autres tiers font pour le focle
, le tore en a deux 8c demie, la doucine trois, une
demie pour fon filet, le talon deux 8c demie, 8c fon
filet une demie. Ce premier membre a la faillie de
toute la bafe ; la doucine a la fienne égale aux deux
cinquièmes trois quarts du petit module; &: la faillie
du talon-avec fon filet éft d’un cinquième» '
. Six membres compofent la- corniche: du piédejlal
corinthien : un talon avec fon filet, une doucine, un
larmier, 8c un talon avec fon filet. On divife toute
la hauteur de ces membres en onze parties, dont une
8c demie eft pour le talon, une demie pour le .filet,
trois pour la doucine, trois pour le larmier , deux
pour le talon, 8c une pour le filet. Pour les faillies ,<on
donne au talon avec fon filet un cinquième du petit
module, deux cinquièmes & demi-tiers à la doucine,
trois au larmier, 8c un cinquième au talon fupérieur
avec fon filet.
. Piédejlal compojite. Ce piédeftal eft femblable-, en
proportion, au piédejlal corinthien : mais les profils
de la baie 8c de fa corniche en font différens, La bafe
eft compofée d’un tore, d’un petit aftragale, & un filet.
De dix parties de cette bafe, le tore en a trois, le
petit aftragale une , le filet de la doucine une demie ,
la doucine trois 8c demie, le gros aftragale une 8c de-»
mie, 8c le filet qui fait le congé une demie. Les faillies
de ces. membres font égales à-peu-près à Celles
de ceux du'.piédejlal corinthien.
' Un filet, avec fon congé, un gros aftragale, une
doucine avec fon filet, un larmier, & un talon avec
fon filet forment la corniche qui occupe la huitième
partie, du piédejlal. Le filet a une douzième & demie
de toute la corniche, l’aftragale une demie, la doit
C C ù