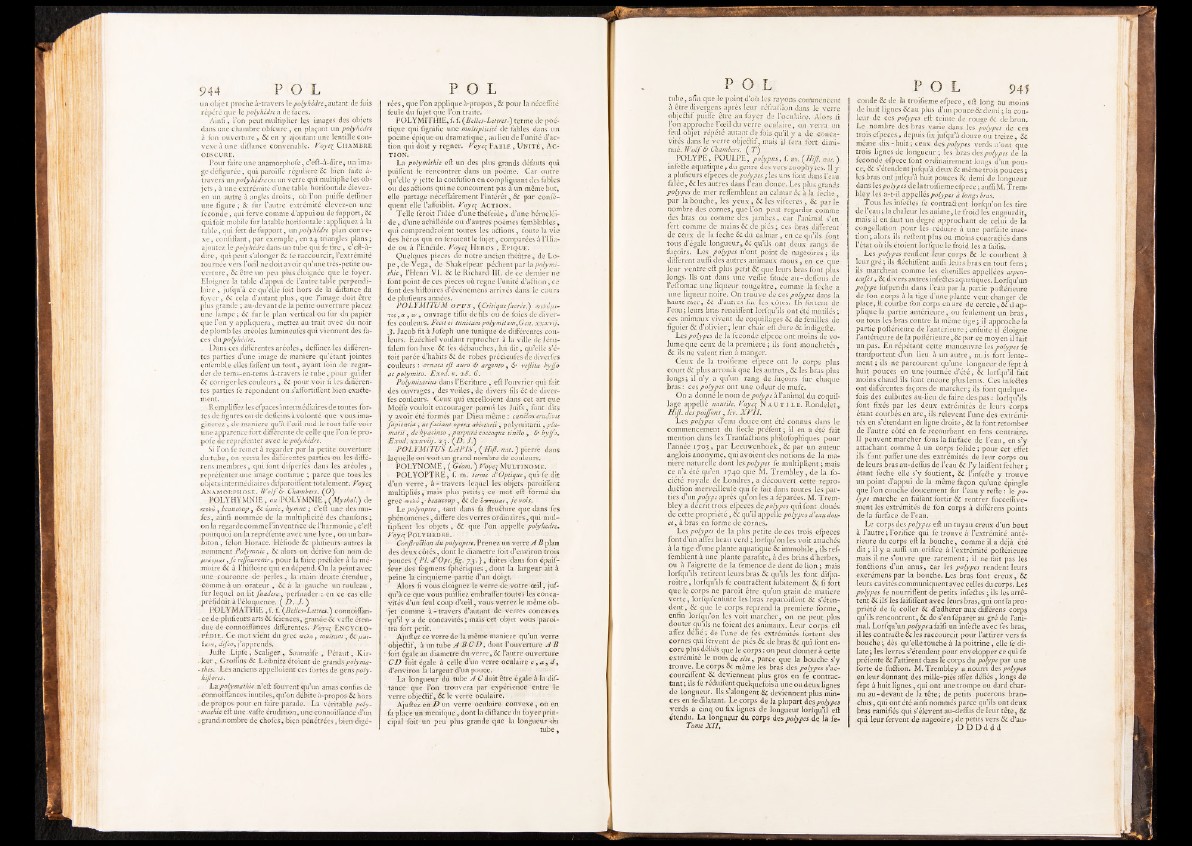
un objet proche à-travers le polyhèdrt, autant de fois
répété que le pofyhédre a de faces.
Ainfi, l’on peut multiplier les images des objets
dans une chambre obfcure , en plaçant un polyhèdrt
à fon ouverture, 8c en y ajoutant une lentille convexe
à une diftance convenable. Voye^ C h am b r e
o b s c u r e .
Pour faire une anamorphofe, c’eft-à-dire, un image
défigurée, qui paroifle régulière 8c bien faite à-
travers unpolyhédreou un verre qui multiplie les objets
, à une extrémité d’une table horifontale élevez-
en un autre à angles droits, oii l’on puiffe deffiner
une figure ; & fur l’autre extrémité elevez-en une
fécondé, qui ferve comme d’appui ou de fupport, &
quifoit mobile fur la table horifontale rappliquez à la
table, qui fert de fupport, un polyhèdrt plan convexe
, confinant, par exemple, en 24 triangles plans ;
ajoutez le polyhèdrt dans un tube qui fe tire , c’eft-â-
dire, qui peut s’alonger & fe raccourcir, l’extrémité
tournée vers l’oeil ne doit avoir qu’une très-petite ouverture,
8c être un peu plus'éloignée que le foyer.
Eloignez la table d’appui de l’autre table perpendi-
laire , jufqu’à ce qu’elle foit hors de la diftance du
fo y e r , 8c cela d’autant plus, que l’image doit être
plus grande ; au-devant de la petite ouverture placez
une lampe ; & fur le plan vertical ou fur du papier
que l’on y appliquera, mettez au trait avec du noir
de plomb les aréoles lumineufes qui viennent des faces
du polyhèdrt.
. Dans ces différentes aréoles, deffinez les différentes
parties d’une image de maniéré qu’étant jointes
enfemble elles faffent un tout, ayant foin de regarder
de tems-en-tems à-travers le tube, pour guider
8c corriger les couleurs,. 8c pour voir fi les différentes
parties fe répondent ou s’affortiffent bien exactement.
.
Rempliffez les efpaces intermédiaires de toutes fortes
de figures ou de deffeins à volonté que vous imaginerez
, de maniéré qu’à l’oeil nud le tout faffe voir
une apparence fort différente de celle que l’on fe pro-
pofe de rôpréfénter avec le polyhèdrt.
Si l’on fe remet à regarder par la petite ouverture
du tube, on verra les différentes parties ou les diffé-
rens membres, qui font difperfés dans les aréoles ,
repréfenter une image continue ; parce que tous -les
objets intermédiaires dilparoiffent totalement. Voyt{
A n a m o r p h o s e . Wolf & .Chambers. (O) • .
POLYHYMNIE, ou iPOLYMNIE * (Mythol.) de
, beaucoup t 6c JftvoV, hymne ; c’eft une des mu-
fes , ainfi nommée de la multiplicité des chanforts ;
on la regarde comme l’inventrice de l’harmonie, c’eft
pourquoi on la repréfente avec une ly re , ou unbar-
biton, félon Horace. Héfiode 6c plufieurs' autres là
.nomment Polymnie, & alors on dérive fon nom de
[Avetopcti J e rejfouvenir, pour la faire préfider à la mémoire
_6c à l’hiftoire qui en dépend. On la peint avec
•une -couronne de perles-,i Ja -main -droite étendue-,
-comme à un orateur, 6c à hn gauche un rouleau ,
fur lequel on lit fuadere perfùader en ce cas elle
préfidoit à l’éloquence. . ( D . J. )
PjOLYMATHIE, L f. (Bdits-Lettres.') connoiffan-
-ce d e plufieurs a r ts& fc ien c e s , grande 8c vafte étendue
dé connoiffances différentes. - Voyt^-En o ÿ c e o -
- PÉd ie .. Ce mot vient du grec <ao\u, rnuïtum , pu,-
ûam, difco, j’apprends.
Jufte Lipfe, Scaliger, Saumaife , Pétàut, Kir-
- k e r , Grofiius & Leibnitzétoient de grands polyma-
-thés. Lés anciens appelloient ces fortes de gens polyhiflores.
Y&polymatlûe- n’eft fbuvent qu’un amas confus de
- connoiffances inutiles, qu’on débite à-propos-& hors
de propos pour en faire parade. - La véritable poly-
■ mcithie-eft une vafte érudition,une connoiffance d’un
; grandmombre.de chofes, bien pénétréesbien digérées,
que l’on applique à-propos, & pour la néceffité
feule du fujet que l’on traite.
POLYMITHIE, f. f. (Belles-Lettres.) terme de poétique
qui fignifie une multiplicité de fables dans un
poème épique ou dramatique, au lieu de l’unité d’action
qui doit y regner. Voye^ Fa b l e , U n it é , A c t
io n ;
La polymithie eft un des plus grands défauts qui
puiffent fe rencontrer dans un poème. Car outre
qu’elle y jette la confufion en compliquant dès fables
ou des aérions qui ne concourent pas à un même but,
elle partage néceffairement l’intérêt, 8c par confé-
quent elle l’affoiblit. Voye^ A c t io n .
Telle feroit l’idée d’une thélèïde, d’une héracléï-
d e , d’une achilléïde ou d’autres poèmes femblables,
qui comprendroient toutes les aérions, foute la vie
des héros qui en feroient le fujet, comparées à l’Iliade
ou à l’Enéide. Voye^ Hé r o s , Ép iq u e .
Quelques pièces de notre-ancien théâtre, de Lope
, de Vega, de Shakefpear pèchent par la polymithie
9 l’Henri VI. & le Richard III. de ce dernier ne
font point de ces pièces oii regne l’unité, d’ariion, ce
font des hiftoires d’événemens arrivés dans le cours
de plufieurs années.
PO LYMITUM OPUS y (Critiquefa crée.)
TCf ouvrage tiffu de fils ou de foies de diverfes
couleurs. Fecit ei tunicampolymitam^Gen. xxxvij.
3. Jacob fit à Jofeph une tunique de différentes couleurs.
Ezéchiel voulant reprocher à la ville de Jéru-
falem fon luxe 8c fes débauches, lui dit, qu’elle-s’é-
toit parée d’habits & de robes précieufes de diverfes
couleurs : ornata eft auro & argento, & vèftita byffo
ac polymito. Exod. v. 2 8. 6Y
Polymitarius dans l’Ecriture , eft l’ouvrier qui fait
des ouvrages, des voiles; de divers fils & de diverfes
couleurs. Ceux qui exçelloient dans cet art que
Moïfe vôuloit encourager-parmi les Juifs,- font-dits
y avoir été formés par Dieu même : cunclos erudivit
fapitnùa , ut faciant opéra abut'arii, polymitarii , plumant
, de hyacinto , purpura coccoque tinclo , & byffo.
Exod. xxxviij. 23. (D. J.) •
POLYMLTUS L A P IS , ( Hiß. nat. ) pierre dans
laquelle on-voit- un grand nombre- de couleurs.
POLYNOME, ( Gèom. ) Woye\ Mu l t in o m e .
POLYOPTRE, f. m. terme daOptique, qui fe dit
d’un verre, à - travers lequel les objets paroiflent
multiplies, mais plus petits•; ce' mot eft formé du
grec j ' beaucoup, 6c de otrropeti, je vois.
Le polyoptre, -tant dans-fa ftruéhire que dans fes
. phénomènes, différé des verres ordinaires , qui multiplient
les objets , & que l’on appelle polyhtdre.
Voyei POLYHEDRE.ij
Conftriiclion du polyoptre.Vrevitz un v e r r e z B plan
des deux côtés, dont le diamètre foit d’environ trois
pouceä ' PVtPOpt. fig. y3 . ) , ‘faites dans fon épaif-
feur des fegmens fphériques, dont la largeur ait à
‘ peine la cinquième partie d’un1 doigt.
Alors fi vous éloignez le verre de votre oe il, jufi-
qu’à ce que vous puilfiez émbraffer toutes les concavités
d’un feul coup d’oeil, vous verrez le même ob-
1jet éôm’më à-travers d’autant de verres concaves
'qu ’il y a de concavités; mais cet objet vous paroî-
1 tra fort petite
Ajuftez ce verre de la même maniéré qu’un verre
objeérif, à un tube A B C D , dont Couverture A B
1 fort égale au diamètre du-verre, 6c l’autre ouverture
' C D loit égale à celle d’un verre oculaire e , a , d ,
d’environ la largeur d’un pouce. ‘
La longueur du tube A C doit être égale à-la diftance
que l?on trouvera par expérience entré le
verre objeérif, & le verre oculaire.
Ajuftez en-Z? un verre oculaire convexe , où en
fa place un menifque., dont la diftance du foyer principal
foit un peu plus grande que -la -longueur -du
tube ,
tube, afin que le point d’où les rayons commencent
à être divergens après leur réfraérion dans le verre
objeérif puiffe être au foyer de l’oculaire. Alors li
l’on approche l’oeil du verre oculaire, on verra un
feul objet répété autant de fois qu’il y a de. concavités
dans le verre objeérif, mais il fera fort diminué.
Wolf & Chambers. ( T )
POLYPE, POULPE, polypus, f. m. (Hift. nat.)
infeéte aquatique, du genre des yers zoophytes. Il ÿ>
a plufieurs efpeces de polypes f e s uns font dans l’eau
falée, & les autres dans l’eau .douce. Les plus grands
polypes de mer reffemblent au calmar & à la f’eche,
par la bouche, les y e u x , 6c les vifeeres , 6c par le
nombre des cornes, que l’on peut regarder comme
des bras ou comme des jambes, car l’animal s’en
fert comme de mains & de pies ; ces bras „different '
de ceux de la feche & du calmar, en c,e qu’ils font
tous d’égale longueur, & qu’ils ont deux rangs de
fuçoirs. Les polypes n’ont point de nageoires ; ils
different auffi des autres animaux mous, en ce que
leur ventre eft plus petit & que leiirs bras.font plus-
longs. Ils ont dans une veffie fituée au-deffoiis de
l’eftomac une liqueur rougeâtre, comme la feche a
une liqueur noire. On trouve de ces polypes dans la
haute mer, 6c d’autres fur les côtes. Ils fortent de
l’eau ; leurs bras renaiffent lorsqu’ils ont été mutilés ;
ces ànimaux vivent de coquillages 6c de feuilles de
figuier 6c d’olivier ; leur chair eft dure 6c indigefte.
Les polypes de la fécondé efpece ont moins de volume
que ceux de la première ; ils font mouchetés,
& ils ne valent rien à manger.
Ceux de la troifieme efpece ont le corps plus,
court 6c plus arrondi que les autres, 6c les bras plus
longs ; il n’y a qu’un rang de fuçoirs fur chaque
bras : ces polypes ont une odeur de mufe.
On a donné le nom de polype à l’animal du coquillage
appellé nautile. Voye^ N a u t i l e . Rondelet,
Hift. des poiffons, liv. XWII.
Les polypes d’eau douce ont été connus dans le
commencement du fiecle préfent; il en a été fait
mention dans les Tranfaétions philofophiques pour
l’année 1703, par Leeuwenhoek, & par un auteur
anglois anonyme, qui avoient des notions de la maniéré
naturelle dont les polypes fe multiplient ; mais
ce n’a été qu’en 1740 que M. Trembley, de la fo-
ciété royale de Londres, a découvert cette repro-
duérion merveilleufe qui fe fait dans toutes les parties
d’un polype après qu’on les a féparées. M. Trembley
a décrit trois efpeces 6epolypes qui font doués
de cette propriété, 6c qu’il appelle polypes d'eau douc
e bras en forme de cornes.
Les polypes de la plus petite de ces trois efpeces
font d’un affez beau verd ; lorfqu’on les voit attachés
à la tige d’une plante aquatique & immobile , ils reffemblent
à une plante parafite, à des brins d’herbes,
ou à l’aigrette de la femence de dent de lion ; mais
lorfqu’ils retirent leurs bras 6c qu’ils les. font difpa-
roître, lorfqu’ils fe contraélent fubitement & fi fort
que le corps ne paroît être qu’un grain de matière
verte, lorfqu’enfiiite les bras reparoiflènt & s’étendent,
6c que le corps reprend fa première forme,
enfin lorfqu’on les voit marcher, on ne peut plus
douter qu’ils ne foient des animaux. Leur corps eft
affez délié ; de l’une de fes extrémités fortent des
cornes qui fervent de piés 6c de bras 8c qui font encore
plus déliés que le corps : on peut donner à cette
extrémité le nom de tête, parce que la bouche s’y
trouve. Le corps 8c même les bras des polypes s’ac-
courciffent & deviennent plus gros en fe contractant
; ils fe réduifent quelquefois à une ou deux lignes
de longueur. Ils s’alongent 8c deviennent plus minces
en fe dilatant. Le corps de la plupart des polypes
verds a cinq ou fix lignes, de longueur lorfqu’il eft
étendu. La longueur du çorps des polypes de la fe-
Tome XII»
èonde 8c de la troifieme efpece, eft long au moins
de huit lignes 8c au plus d’un pouce 8c demi ; la couleur
de ces polypes eft teinte de rouge 8c de.brun.
Le nombre des bras varie dans les polypes de ces
trois efpeces, depuis fix jufqu’à douze ou treize, 8c
meme dix-huit; ceux des polypes verds n’ont que
trois lignes de longueur ; les bras des polypes de la
fécondé efpece font ordinairement longs d’un pouce,
8c s etendent jufqu’à deux 8c même trois pouces ;
les bras ont jufqu’à huit pouces 8c demi de longueur
dans les polypes de la troifieme efpece ; auffi M. Trembley
les a-t-il ap.pellés polypes à longs bras.
Tous les infeftes fe contrarient lorfqu’on les tire
de l’eau ; la chaleur les anime, le froid les engourdit,
mais il en faut un degré approchant de celui de la
congellation pour les réduire à une parfaite inaction
; alors ils reftent plus ou moins contrariés dans
l’état où ils étoient lorfque le froid les a faifis.
Les polypcs renflent leur corps & le courbent à
leur gré ; ils fléchiffent auffi leurs bras en tout fens ;
ils marchent comme les chenilles appellées arpen-
teufes, 8c divers autres inferies aquatiques. Lorfqu’un
polype fufpendu dans l’eau par la partie poftérleure
de fon corps à la tige d’une plante veut changer de
place, il courbe fon corps en arc de cercle, & il applique
la partie anterieure., ou feulement un bras,
ou tous les bras contre là même tige ; il approche la
partie poftérieure de l’antérieure ; enfuite il éloigne
l’anterieure de la pofterieure, 8c par ce moyen il fait
un pas. En répétant cette manoeuvre les polypes fe
tranfportent d’un lieu à un autre, m.is fort lentement
; ils ne parcourent qu’une longueur de fept à
huit pouces en une journée d’été, 8c lorfqu’il fait
moins chaud ils font encore plus lents. Ces inferies
ont différentes façons de marcher; ils font quelquefois
des culbutes au-lieu défaire des pas,: lorfqu’ils
font fixés par les deux extrémités de leurs corps
étant courbés en arc, ils relevent l’une des extrémités
en s’étendant en ligne droite, 8c la font retomber
de l’autre côté en fe recourbant en fens contraire«
Il peuvent marcher fous la furfàce de l’eau, en s’y
attachant comme à un corps folide ; pour cet effet
jls ‘font p.affer une des extrémités de leur corps ou
de leurs bras au-deffus de l’eau 8c l’y laiffent fecher j
étant feche elle s’y foutient, 8c l’inferie y trouve
un point d’appui de la même façon qu’une épingle
que l’on Couche doucement fur l’eau y refte : le polype
marche en faifant fortir & rentrer liicceffive-
ment les extrémités de fon corps à différens points
de la furface de l’eau.
Le corps des polypes eft un tuyau creux d’un bout
à l’autre ; l ’orifice qui fe trouve à l’extrémité antérieure
du corps eft la bouche, comme il a déjà été
dit ; il y a auffi un orifice à l’extrémité poftérieure
mais il ne s’ouvre que rarement ; il ne fait pas les
fonriions d’un anus,. Car les polypes rendent leurs
excrémens par la bouche. Les bras font creux, 8c
leurs cavités communiquent avec celles du corps. Les
polypes fe nourriffent de petits inferies ; ils les arrêtent
8c ils* les faififfent avec leurs bras, qui ont la propriété
de fe coller 8c d’adhérer aux différens corps
qu’ils rencontrent, 8c de s’en féparer au gré de l’animal.
Lorfqu’un polype a faifi un inferie avec fes bras,
il les contrarie & les raccourcit pour l’attirer vers fa
bouche ; dès qu’elle touche à là poitrine, elle fe dilate
; les levres s’étendent pour envelopper ce qui fe
préfente & l’attirent dans le corps du polype par une
forte de furiion. M. Trembley a nourri des polypes
en leur donnant des mille-piés affez déliés, longs de
fept à huit lignes, qui ont une trompe ou dard charnu
au-devant de la tête; de petits pucerons bran-
chus, qui ont été ainfi nommés parce qu’ils ont deux
bras ramifiés qui s’élèvent au-defliis de leur tête, 8c
qui leur fervent de nageoire ; de petits vers 8c d’ai*•
D D D d d d