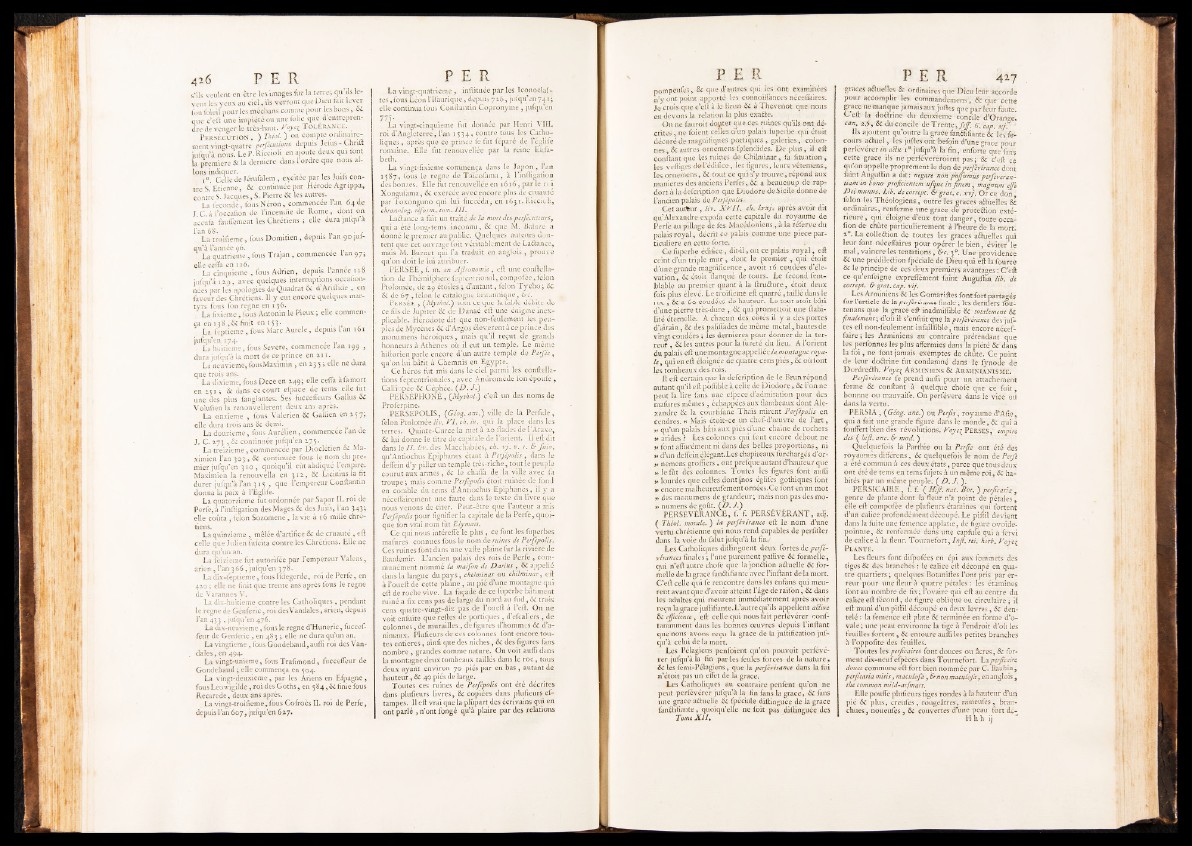
s’ ils veulent en être les images lur la terre; qu ils lèvent
les yeux au ciel, ils verront que Dieu fait lever
fon foleil pour les méchans comme pour les bons, &
que c’ eft une impiété ou une folie que d entreprendre
de venger le très-haut. Foyei T o l é r a n c e .
P e r s é c u t i o n , ) Théol. ) on compte ordinairement
vingt-quatre perféditions depuis Jelus-Chnit
jufqu’à nous. Le P. Riccioli en ajoute deux qui font
la première & la derniere dans l’ordre que nous allons
indiquer. i ‘ ■
i ° . Celle de Jérufalem, excitee par les Juiis contre
S. Etienne, El continuée par Hérode Agrippa,
contre S. Jacques, S. Pierre El les autres.
La fécondé, fous Néron, commencée l’an 64 de
J. C. à i’occafion de l’incendie de Rome , dont on
accula fauffement les Chrétiens ; elle dura jufqu’à
l’an 68. . . . f
La troifieme, fous Doraitien, depuis 1 an 90 juiqu’à
l’année 96. ,
La quatrième, fous Trajan , commencée 1 an 97;
^lle ceffa en 116. . ,
La cinquième , fous Adrien, depuis ia n n e e iiS
julqu’â i20 , avec quelques interruptions qccalion-
nées par les apologies de Quadrat El d Ariltide , en
faveur des Chrétiens. Il y eut encore quelques martyrs
fous fon régné en 136.
La fixieme, fous Antonin le Pieux ; elle commença
en 138., & finit en 153. . .
La feptieme , fous Marc Aurele, depuis 1 an 161
jufqu’en 174. ,
■ La huitième, fous Severe, commencée 1 an 199 ,
dura jufqu’à la mort de ce prince en 211.
La neuvième, fousMaximin , en 23 5 ; elle ne dura
que trois ans. _ v |
La dixième, fousDece en 249; elle ceffa àfamort
en 251 ; & dans ce court efpace de tems elle tut
une des plus fanglantes. Ses fucceffeurs Gallus El
Volulien la renouvellerent deux ans après.
La onzième , fous Valerien El Gallien en 257»
elle dura trois ans El demi. *j
La douzième, fous Aurélien, commencée 1 an de
J. C. 273 , El continuée jufqu’en 27 5.
La treizième, commencée par Dioclétien El Maximien
l’an 303 , & continuée fous le nom du premier
jufqu’en 310 , quoiqu’il eût abdiqué 1 empire.
Maximien la renouvella en 3 12 , El Licinius la fit
durer jufqu’à l’an 315 , que l’empereur Conftantin
donna la paix à i’Eglife.
La quatorzième tut ordonnée par Sapor II. roi de
Perfe, a l’inftigation des Mages Ec des Juifs, l’an 3 43 »
elle coûta , félon Sozomene, la vie à 16 mille chrétiens.
La quinzième , mêlée d’artifice & de cruauté , eft
celle que Julien fufeita contre les Chrétiens. Elle ne
dura qu’un an.
La leizieme fut autorifée par l’empereur Valens,
arien , l’an 3 66, jufqu’en 378.
La dix-feptieme, fous Ifdegerde, roi de Perfe, en
420 ; elle ne finit que trente ans après fous le régné
de Varannes V.
La dix-huitieme contre les Catholiques , pendant
le régné de Génferic, roi desVandales, arien, depuis
l’an 433, jufqu’en 476.
. La dix-neuvieme, fous le régné d’Huneric, fuccef-
feur de Genferic, en 483 ; elle ne dura qu’un an.
La vingtième, fous Gondebaud, aufli roi des Van-
. dales, en 494.
La vingt-unieme, fous Trafimond, fucceffeur de
Gondebaud ; elle commença en <04.
La vingt-deuxieme , par les Ariens en Efpagne,
fous Leowigilde, roi des Goths, en 584, & finie fous
Recarede, deux ans après.
La vingt-troifieme, fous Cofroès II. roi de Perfe,
depuis l’an 607, jufqu’en 627.
La vingt-quatrieme , inftituée par les Iconoclastes
, fous Léon l’Ifaurique, depuis 7 26, jufqu’ en 741 ;
elle continua fous Conftantin Copronyme , jufqu’en
La vingt-cinquieme fut donnée par Henri VIII.
roi d’Angleterre, l’an 1534, contre tous les Catholiques
, après que ce prince fe fut féparé de Péglife
romaine. Elle fut renouvellée par la reine Eiifa-
beth. . .
La vingt-fixieme commença dans le Japon , l’an
1587, fous le régné deTaïcofama, à l ’inftigation
des bonzes. Elle fut renouvellée en 1616, par le n i
Xongufama, El exercée avec encore plus de cruauté
parToxonguno qui lui fuccéda, en 1631.Riccic.l1,
chronolog. réform. tom. III.
Laitance a fait un traité de la mort des perfècutturs,
qui a été long-tems inconnu, El que M. Baluze a
donné le premier au public. Quelques auteurs doutent
que cet ouvrage loit véritablement de Laêtance,
mais M. Burnet qui l’a traduit en anglois, prouve
qu’on doit le lui attribuer.
. PERSÉE, f. m. en Agronomie , eft une conftella-
tion de l’hémifphere feptentrional, compofée, félon
Ptolomée, de 29 étoiles ; d’autant, félon Ty ch o ; Ec
& de 67 , félon le catalogue britannique, &c,
P e r s Ée , (Mythol.') tout ce que la fable débite de
ce fils de Jupiter El de Dânaé eft une enigme inexplicable.
Hérodote dit que non-feulement les peuples
de Mycènes & d’Argos éleverent à ce prince des
monumens héroïques, mais qu’il reçut de grands
honneurs à Athènes oit il eut un temple. Le même
hiftorien parle encore d’un autre temple de Perfée ,
qu’on lui bâtit à Chemnis en Egypte.
Ce héros fut mis dans le ciel parmi les conftella-
tions feptentrionales, avec Andromède fon epoufe ,
Calliopée El Céphée. (D . J . ) .
PERSÉPHONÉ , (Mythol.) c’ eft un des noms de
Proferpine.
PERSÉPOLIS, (Géog.anc.) ville de la Perfide,
félon Ptolomée liv. F l. ck.iv. qui la place dans les
terres. Quinte-Curce la met à 20 ftades de l ’Àraxe,
& lui donne le titre de capitale de l ’orient. Il eft dit
dans le II. liv. des Macchabées, ch. vj. v. 1. & fuiv.
qu’Antiochus Epiphanes étant à Perfépolis , dans le
deffein d’y piller un temple très-riche, tout le peuple
courut aux armes, & le chaffa de la ville avec fa
troupe ; mais comme Perfépolis étoit ruinée de fond
en comble du tems d’Antiochus Epiphanès, il y a
néceffairement une faute dans le texte du livre que
nous venons de citer. Peut-être que l’auteur a mis
Perfépolis pour lignifier la capitale de la Perfe, quoique
fon vrai nom fût Elymais.
Ce qui nous intéreffe le plus , ce font les fuperbes
mafures connues fous le nom de ruines de Perfépolis.
Ces ruines font dans une vafte plaine fur la rivierê de
Baudemir. L’ancien palais des rois de Perfe , communément
nommé la maifon de Darius , & appelle
dans la langue du pays, chelminar ou chilminar, eft
à l’oueft de cette plaine , au pié d’une montagne qui
eft de roche vive. La façade de ce fuperbe batiment
ruiné a fix cens pas de large du nord au fud, El trois
cens quatre-vingt-dix pas de l’oueft à l’eft. On ne
voit enfuite que reftes de portiques , d’efeabers , de
colonnes de murailles , de figures d’hommes El d’animaux.
Plufieurs de ces colonnes font encore toutes
entières, ainfi que des niches, El des figures fans
nombre , grandes comme nature. On voit aufli dans
la montagne deux tombeaux taillés dans le ro c , tous
deux ayant environ 70 piés par en bas , autant de
hauteur, & 40 piés de large.
Toutes ces ruines de Perfépolis ont été décrites
dans plufieurs livres, & copiées dans plufieurs ef-
tampes. Il eft vrai que la plûpart des écrivains qui en
ont parlé , n’ont fongé qu’à plaire par des relations
pompeufes, Ec que d’autres qui les ont examinées
n’y ont point apporté les connoiffances néceffaires.
Je crois que c’eft à le Brun de à Thevenot que nous
en devons la relation la plus exaéte.
On ne fauroit douter que cqs ruines qu’ils, ont détentes
, ne foient celles d’un palais fuperbe qui étoit
décoré de magnifiques portiques, galeries, . colonnes
& autres ornemens fplendides. De plus. , il eft
confiant que J,es ruines de Chilminar, fa fituation ,
les veftiges dé l’édifice, les figures, leurs vêtemens,,
les ornemens, St tout ce qui s’y trouve, répond aux
maniérés des anciens Perfes, El a beaucoup de rapport,
à la defeription que Diodore de.Si.cile donne de
l’ancien palais de Perfépolis.
Cet auteur , liv., X F I l . ch. lx x j{ après avoir dit
qu*Alexandre expofa, cette capitale du royaume de
Perfe au pillage de les Macédoniens, à la réferve du
palais royal, décrit ce palais comme une piece particulière
en cette forte.. . . ►
Ce fuperbe édifice, dit-il, ou ce palais ro y a l, eft
ceint d’un triple mur, dont le premier, qui étoit
d’une grande magnificence , avoit 16 coudées d’çle-
vation, St étoit flanqué de tours. L e fécond fem-
blable au premier quant à la ftrufture, étoit deux
fois plus élevé. Le troifieme eft quarré, taillé dans le
r o c , & a 60 coudées de hauteur. Le tout etoit bâti
d’une pierre très-dure ,. St qui promettoit une fiabilité
éternelle. A chacun des côtés il y a des portes
d’airain St des paliffades de même métal, hautes de
vingt coudées ; les dernieres pour donner de la terreur
, El les autres pour la fureté du lieu. A l’orient
du palais eft une montagne appellée Lamontagne royale
, qui en eft éloignée de quatre cens p iés, St où lont
les tombeaux des rois.
Il eft certain que la defeription de le Brun répond
autant qu’il eft poflible à celle de D iodore, St l’on ne
peut la lire fans une efpece d’admiration pour des
mafures mêmes , échappées aux flambeaux dont Alexandre
St la courtifane Thaïs mirent Perfépolis en
cendres. « Mais étoit-ce un chef-d’oeuvre de l’a r t ,
» qu’un palais bâti aux piés d’une chaîne de rochers
» arides ? Les colonnes qui .font encore debout ne
» font affurément ni dans des belles proportions, ni
» d’un deffein élégant.Les chapiteaux furchargés d’or-
» nemens grofiiers, ont prefque autant d’hauteur que
» le fut des colonnes. Toutes les figures font aufli
» lourdes que celles dont [nos églifes gothiques font
» encore malheureufement ornées.Ce lont en un mot
» des monumens de grandeur; mais non pas des mo-
» numens de goût. (D . J.')
PERSÉVÉRANCE, f. f. PERSÉVÉRANT, adj.
( Théol. morale. ) la perfévèrance eft le nom d’une
vertu chrétienne qui nous rend capables de perfifter
dans la voie du falut jufqu’à la fin./
Les Catholiques diftinguent deux fortes de perfé-
vlrances finales ; l’une purement paflive El formelle,
qui n’eft autre chofe que la jonftion aétuelle St formelle
de la grâce fanélifiante avec l’inftant de la mort.
C ’eft celle qui fe rencontre dans les enfans qui meurent
avant que d’avoir atteint l’âge de raifon, & dans
les adultes qui meurent immédiatement après avoir
reçu la grâce juftifiante.L’autre qii’ils appellent active
El efficiente, eft celle qui nous fait perlévérer eonf-
tammment dans les bonnes oeuvres depuis l’inftant
que nous avons reçu la grâce de la juftification jufqu’à
celui de la mort.
Les Pélagiens penfoient qu’on pouvoit perfévé-
rer jufqu’à la fin par les feules forces de la nature,
& les femi-Pélagiens, que la perfévérance dans la toi
n’étoit pas un effet de la grâce.
Les Catholiques au contraire penfent qu’on ne
peut perfévérer jufqu’à la fin fans la grâce, El fans
line grâce aôuelle El l'péciale diftinguée de la grâce
l'an&ifiante, quoiqu’elle ne foit pas diftinguée des
Tome X I I *
grâces agnelles & ordinaires que Dieu leur àççorde
pour accomplir les. commandemens;; & que cette
grâce ne manque jamais aux juftes que par leur faute.
G eft la doôrine du- deuxieme concile d’Orange.
can. 2-3-, & -du-concile de Trente ,f e f f i 6. cap. x j ? '
Ils ajoutent qu’outre la grâce fanttifiante ÔL les'fe-
cours a â u e l, les juftes-om befoin d’une grâce pour
perfévérer in aetu i® jufqifà l'a fin, enforte que lan$
cette grâce ils ne perféveréroient pas-; El c’eft ce
qu’on appelle proprement le don de perfévèrance dont
faint Auguftin a dit : negare non pojfumus per feveran-
tiam in bono proficientem ufque in finem, magnum efje
Deimu-nus. Lib. decorrept. & grat. c. xvj. O t cç. don
félon les Théologiens, outre les grâces actuelles Ec
ordinaires, renferme une grâce de protection extérieure,
qui éloigne d’eux tout danger , toute occa-
fionde chiite particulièrement à l’heure de la mort.
2°. La collection de toutes les grâces aCtuelles qui
leur font néceffaires pour opérer le bien, éviter le
mal, vaincre les tentations, & c . 30. Une providence
El une prédilection fpéciale de Dieu qui eft la fource
El le principe de ces deux premiers avantages : C ’eft
ce qu’enfeigne expreffément faint Auguftin lib . de
corrept. & grat. cap. v i f
Les ./^miniens & les Gomariftes font fort partagés
fur l’article de la perfévérance finale ; les derniers fou-
tenans que la grâce eft inadmifîible El totalement El
finalement j d’où il s’enfuit que la perfévérance des juftes
eft non-feulement infaillible, mais encore néçef-
faire ; les Arminiens au çontraire prétendant que
les perfonnes les plus affermies dans la piéré El dans
la f o i , ne font jamais, exemptes de chüte. Ce point
de leur doCtrine fut condamné dans le fynode de
DordreCth. V oy e{ A rminiens & A rminianisme.
Perfévèrance fe prend aufli pour un attachement
ferme & confiant -à; quelque chofe que cè f a i t ,
bonnne ou mauvaife. On perfévere, dans le vice où
dans la vertu.
PERSIA , {G èo g . anc.) ou P e r ß s , royaume d’Afie,
qui a fait une grande figure dans le monde, El qui a
fouffert bien des révolutions; F o y e r Perses, empire
des ( h iß . anc. & mod. )
Quelquefois la Parthie ou la P erfie ont été des
royaumes différens, El quelquefois le nom de Perfe
a été commun à ces deux états, parce que tous deux
ont été de tems en tems fujets à un même roi, & habités
par un même peuple. (D . J. Y
PERSICAIRE, f. f. ( H iß . na t. B o t . ) perßearia. ,
genre de plante dont la fleur n’a point de pétales,
elle eft compofée de plufieurs étamines qui fortent
d’un calice profondément découpé. Le piftil devient
dans la fuite une femence applatie, de figure ovoïde-
pointue, El renfermée dans une capfule qui a fervi
de calice à la fleur. Toumefort, In ß . reï. herb. F o y e r
P l a n t e .
Les fleurs font difpofées en épi aux fommets des
tiges El des branches : le calice eft découpé en quatre
quartiers ; quelques Botanifles l’ont pris par erreur
pour une fleur à quatre pétales : les étamines
font au nombre de fix; l’ovaire qui eft au centre du
calice eft fécond, de figure oblique ou circulaire ; il
ell muni d’un piftil découpé en deux levres, El dentelé
: la femence eft plate & terminée en forme d’ovale;
une peau environne la tige à l’endroit d'où les
feuilles fortent, El entoure aufli les petites branches
à l’oppofite des feuilles.
Toutes les perficaircs font douces ou âcres, & forment
dix-neuf efpèces dans Tournefort. Laptrficaire
douce commune eft fort bien nommée par C. Bauhin,
p erficariamitis, maculofa , & non maculofa , en anglois ,
the common mild-arfmart.
Elle pouffe plufieurs tiges rondes à la hauteur d’un
pié El plus, creufes, rougeâtres, rameufes, bran-
chues, noueufes, Ec couvertes d’une peau fort de-
H h h ij