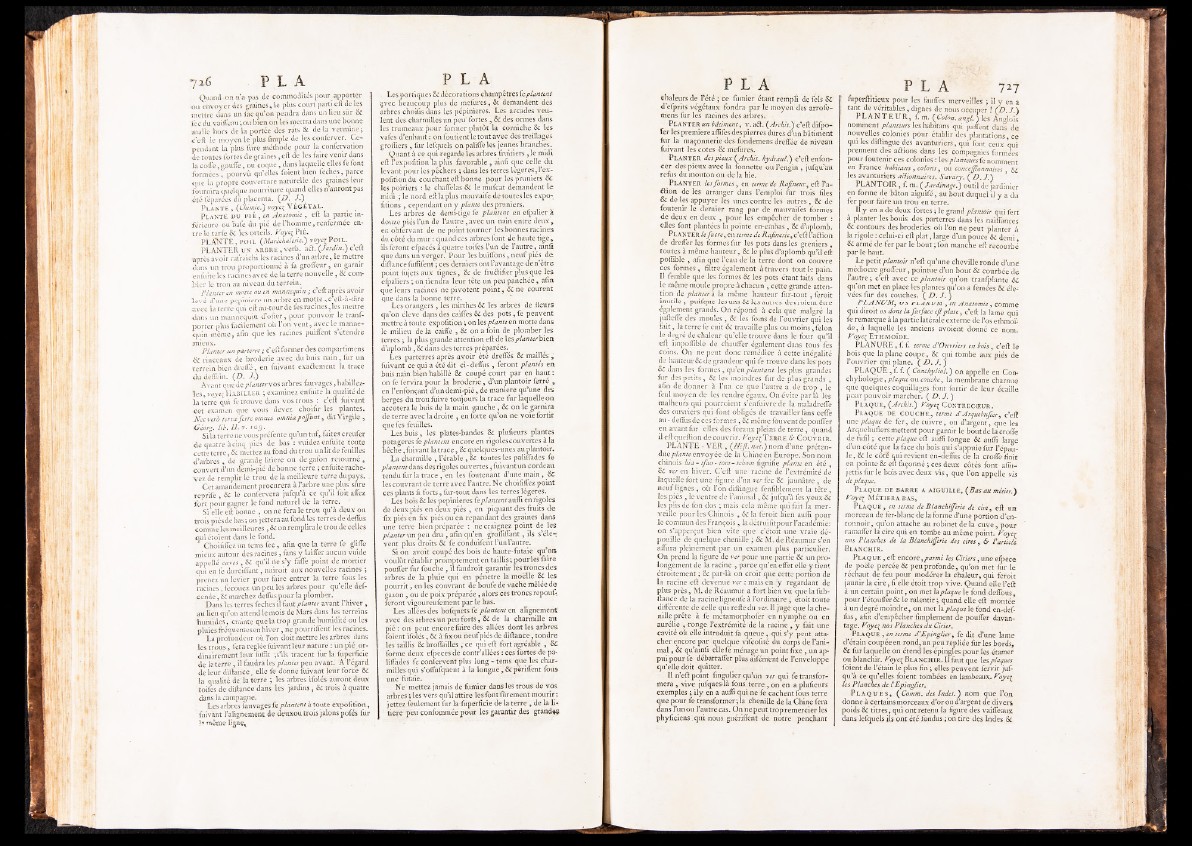
Quand -on n’a pas de commodités pour^ apporter
ou envoyer des graines, le plus court parti eft de les
mettre dans un lac qu’on pendra dans un lieu sûr ce
fcc du vaiffeau ; ou bien on les mettra dans une bonne
malle hors de la portée des rats & de la vermine ;
.c’eft le moyen le plus fimple de les conferver. Cependant
la plus fure méthode pour la conferyatioii
de toutes fortes de graines, eft de les faire venir dans
la côft'e, gouffe, ou coque, dans laquelle elles fe font
formées , pourvu qu’elles foient bien feches, parce
que la propre couverture naturelle des graines leur
fournira quelque nourriture quand elles n aurontpas
•été féparees du placenta. {D . J.)
P l a n t e , {Chimie.) voye^ V é g é t a l .
P l a n t e d u v i t . 9 en Anatomie t eft la partie inférieure
ou Bafe du pie de l’homme, renfermee entre
le tarfe 8c les orteils. Voyt{ P ii.
PL/CNTÉ, POIL {Maréchalerie.) voye{ POIL.
PLANTER un a r b r e , verb. aâ. {Jardin.) c’eft
après avoir rafraichi les racines d’un arbre, le mettre
éans un trou proportionné à fa groffeur , en garnir
enfuite les racines avec de la terre nouvelle, 8c combler
le trou au niveau du terrein.
Planter en motte ou en mannequin ; c’ eft apres avoir
levé d’une pepiniere un arbre en motte, c eft-a-dire
avec la terre qui eft au-tour de fes racines, les mettre
•dans un mannequin d’ofier, pour pouvoir le tranf-
porter plus facilement où l’on veut, avec le mannequin
même, afin que les racines puiffent s’étendre
mieux.
Planter un parterre ; c’ eft former des compartimens
& rinceaux de broderie avec du buis nain, fur un
terrein bien dreffé, en fuivant exactement la trace
dudeffein. (D . J.)
Avant que de planter vos arbres fauvages, habillez-
les voyez Ha b il l e r ; examinez enfuite la qualité de
la terre qui fe trouve dans vos trous * c eft fuivant
cet examen que vous devez choifir les plantes.
Necverà ter r ce ferre omnes omnia poffunt, dit Virgile ,
tGéorg. lib. II. y. i og. r r . r
Si la terre ne vous préfente qu’un tuf, faites creufer
de quatre à cinq piés de bas : vuidez enfuite foute
cette terre, 8c mettez au fond du trou un lit de feuilles
d’arbres , de grande litiere ou de gafon retourné ,
couvert d’un demi-pîé de bonne terre ; enfuite rache-
-vez de remplir le trou de la meilleure tefre du pays. ,
Cet amandement procurera à l’arbre une plus sure
reprife , 8c le confervera jufqu’à ce qu’il foit allez
fort pour gagner le fond naturel de la terre.
Si elle eft bonne , on ne fera le trou qu’à deux ou
trois piés de bas ; on jettera au fond les terres de deffus
comme les meilleures , 8c on remplira le trou de celles
qui étoient dans le fond.
Choififfez Un tems fe c , afin que la terre fe gliffe
mieux autour des racines, fans y laiffer aucun vuide
appellé caves , 8c qu’il rie s’y faffe point de mortier
qui en fe durciffant, nuiroit aux nouvelles racines';
prenez un levier pour faire entrer la terre fous les
racines , fecouez un peu les arbres pour qu’elle def-
cende, 8c marchez deffus pour la plomber.
Dans les terres feches il faut planter avant l’hiver,
au beu qu’on attend le mois de Mars dans les terreins
humides, crainte que la trop grande humidité ou les
pluies fréquentes en hiver, ne pourriffent les racines.
La protondeur otv l’on doit mettre les arbres dans
les trous, fera réglée fuivanf leur nature : un pié. ordinairement
leur fufiit ;s’ils tracent fur la liiperficie
de la. terre , il faudra les planter peu avant. A l’égard
de leur diftance, elle fe donne fuivant leur force 8c
la qualité de." la terre ; les arbres ifolés auront deux
toiles de diftance dans les jardins, & trois à quatre
dans la campagne.
Les arbres fauvages fe plantent à toute expôfition,
fuivant l’alignement de deuxou trois jalons pofés fur
même ligne»
Les portiques 8c décorations champêtres fe plantent
^vec beaucoup plus de mefures, & demandent des
arbres choifis dans les pépinières. Les arcades veulent
des charmilles un peu' fortes , 8c des ormes dans
les trumeaux pour former plutôt la corniche & les
vafes d’enhaut: onfoutientletoutavec des treillages
grofliers , fur lefquels on paliffe les jeunes branches.
Quant à ce qui regarde les arbres fruitiers , 1e midi
eft l’expofition la plus favorable , ainli que celle du
levant pour les pêchers ; dans les terres légères, l’expofition
du couchant eft bonne pour les pruniers 8c
les poiriers : le chaflelas 8c le mufcat demandent le
midi ; le nord eft la plus mauvaife-de toutes les expo-
fitions , cependant on y plante des pruniers..
Les arbres de demi-tige fe plantent en efpalier à
douze piés l’un de l’autre, avec un nain entre deux ,
en obfervant de ne point tourner les bonnes racines
du côté du mur : quand ces arbres font de haute tige,
ils feront efpacés à quatre toifes l’un de l’autre, ainfî
que dans un verger. Pour lès buiffons, neuf piés de
diftance fuffifent ; ces derniers ont l’avantage de n’être
point fujets aux tignes, & de fru&ifier plus que les
efpaliers ; on tiendra leur tête un peu panchée , afin
que leurs racines ne pivotent point, 8c ne courent
que dans la bonne terre.
Les orangers , les mirthes 8c les arbres de fleurs
qu’on éleve dans des caiffes 8c des pots, fe peuvent
mettre à toute expofition ; on les plante en motte dans
le milieu de la caiffe , & on a foin de plomber les
terres ; la plus grande attention eft de les planter bien
d’aplomb ,8cdans des terres préparées.
L e s p a r te r r e s ap rè s a v o i r é té d refféS' 8c ma illé s
fu iv a n t c e q u i a é té d it c i -d e f fu s , f e r o n t plantés e n
b u is na in b ie n h a b illé 8c c o u p é c o u r t p a r en h a u t :
o n f e i’e r v i r a p o u r la b r o d e r i e , d ’u n p la n to ir fe r r e ,
e n l’ en fo n ç an t d’u n d em i -p ié , d e m a n ié r é q u ’u n e d e s
b e rg e s du t ro u f u iv e to u jo u r s la t r a c e fu r la q u e lle o n
a c c o te r a le b u is d e la m a in g a u c h e , & o n le g a rn i ra
de t e r r e a v e c la d ro ite , en fo r te q u ’ o n n e v o ie f o r t i r
q u e fe s feu ille s .
Les buis, les plates-bandes 8c plufieurs plantes
potagères fe plantent encore en rigoles couvertes à la
bêche, fuivant la trace, 8c quelques-unes au plantoir.
La charmille , l’érable , 8c toutes les paliffades fe
plantent dans des rigoles ouvertes,- fuivant un cordeau,
tendu fur la trace, en les foutenant d’une main, 8c
les couvrant de terre avec l’autre. Ne choififfez point
ces plants fi forts, fur-tout dans les terres légères.
Les bois 8c lés pepinieres fe plantent aufli en rigoles
de deux piés en deux piés , en piquant des fruits de
fix piés en fix piés ou en répandant des graines dans
une terre bien préparée : ne craignez point de les
planter un peu dru , afin qu’en grofliffant, ils s’ éle-;
vent plus droits 8c fe conduifent l’un l’autre.
Si on avoit coupé des bois de haute-futaie qu’on
voulut rétablir promptement en taillis ; pour les faire
pouffer fur fouche , il faudroit garantir les troncs des
arbres de la pluie qui en pénétré la moelle 8c les
pourrit, en les couvrant de boufe de vache mêlee de
gazon , ou de poix préparée, alors ces troncs repoufi
feront vigoureufement par le bas.
Les allées des bofquets fe plantent en alignement!
avec des arbres un peu forts, & de la charmille au
pié : on peut encore faire des allées dont les arbres!
foient ifolés, 8c à fix ou neuf piés de diftance, tondre
les taillis 8c broffailles ,- ce qui eft fort agréable , 8c
forme deux efpeces de çontr’allées : ces fortes de paliffades
fe confervenf plus long - tems que les charmilles
qui s’offufquent à la longuè, 8c périffent fous
Une futaie.
Ne mettez jamais de fumier dans les trous de vos
arbres ; les vers qu’il attire les font fûrement mourir :
jettez, feulement fur la-fuperficie de la terre , de la litière
peu confoflimée pour les garantir des grande
chaleurs de l’été ; ce fumier étant rempli de fèls 8c
d’éfprits végétaux fondra par le moyen des arrofe-
mens fur les racines des arbres;
Pl a n t e r un bâtiment, v. a£L {Archit ) c’eft difpo-
Ter les première aflïfes des pierres dures d’un bâtiment
lur la maçonnerie des fondemens dreffée de niveau
fuivant les cotes & mefures.
P l a n t e r dès pieux {Archit. hydraul.) c’eft enfoncer
des pieux avec la fonnette ou l’engin , jufqu’aii
refus du mouton ou de la hie.
P l a n t e r les formes, en terme de Rafineur, eft l’a-
âion de les arranger dans l’emploi fiir trois files
& de les appuyer les unes cohtré les autres , 8c de
foutenir le dernier rang par de mauvaifes formes
de deux en deux , pour les empêcher de tomber :
elles font plantées la pointe en-emhas , 8c d’aplomb.
P la n t e r le fucre, en terme de Rafinerie, c’eft l’àétion
de dreffer les formes fur les pots dans les greniers ,
toutes à même hauteur, 8c le plus d’aplomb qu’il eft
pofîlble , afin que l’eau de' là terre dont on. couvre
ces formes , filtre également à travers tout le pain.
Il femble que les formes 8c les pots étant faits dans
le même moule propre à chacun , cette grande attention
de planter à la même hauteur fur-tout , feroit
inutile , puifque les uns 8c les autres devroieiit être
également grands. On répond à cela que malgré la
jufteffe des moules , 8c les foins de l’ouvrier qui les
fait, la terre fe cuit 8c travaille plus ou moins, félon
le degré de chaleur qu’elle trouve dans le four qu’il
eft impofïible de chauffer également dans tous fes
coins. On ne peut donc remédier à cette inégalité
de hauteur & de grandeur qui fe trouve dans les'pots
& dans les formes, qu’en plantant les plus grandes
fur des petits, 8c les moindres fur de plus grands ,
afin de donner à l’un ce que l’autre a de trop , le
feul moyen de les rendre égaux. On évite par là les
malheurs qui pourroient s’enfuivrede la maladreffe
des ouvriers qui font obligés de travailler fans ceffe
au - deffus de ces formes , 8c même fouvent de pouffer
en avant fur elles des Sceaux pleins de terre, quand
il eft queftion découvrir. Voye[ T e r r e & C o u v r ir .
PLANTE - VER , {Hifl. nat.) nom d’une prétendueplante
envoyée de la Chine en Europe. Son nom
chinois hia- tfao - tom-tchom,lignifie plante en été ,
& ver en hiver. C ’eft une racine de l’extrémité de
laquelle fort une figure d’un ver fec 8c jaunâtre , de
neuf lignes, oii l’on diftingue fenfiblement la tête,
les piés , le ventre de l’animal, 8c jufqu’à fes yeux 8c
les plis de fon dos ; mais cela même qui fait la merveille
pour les Chinois , 8c la feroit bien aufli pour
le commun des François , la détruifitpour l’academie:
on s’apperçut bien vite que c’étoit une vraie dépouille
de quelque chenille ; & M. de Réaumur s’en
affura pleinement par un examen plus particulier.
On prend la figure de ver pour une partie 8c un prolongement
de la racine , parce qu’en effet elle y tient
étroitement ; 8c par-là on croit que cette, portion de
la racine eft devenue ver : mais en y regardant de
plus près, M. de Réaumur a fort bien vu que la fub-
ftance de la racine ligneufe à l’ordinaire i etoit toute
differente de celle qui refte du .ver. Il juge que la chenille
prête à fe metamorphofer en nymphe ou en
aurélie , ronge l’extrémité de la racine , y fait une
cavité oii elle introduit fa queue, qui s’y peut, attacher
encore par quelque vifçofité au corps de l’animal
, 8c qu’ainfi ellefe ménage un point fixe , un appui
pour le débarraffer plus aifément de l’enveloppe
qu’elle doit quitter.
Il n’eft point firigulier qu’un ver qui fe transformera
, vive jufques-là fous tèrre, on en a plufieurs
exemples ; ily en a aufli qui ne fe cachent fous terre
que pour fe transformer ; la chenille de la Chine fera
dans l’un ou l’autre cas. On ne peut trop remercier les
phyficiens .qui nous, guériffent de notre penchant
fiiperftitieiix pour les fauffes merveilles ; il y en â
tant dè véritables, dignes de nous occuper ! (D . J.)
P L A N T E U R , f. m. {Colon, angl. ) lés Anglois
nomment planteurs les habitans qui paffent dans de
nouvelles colonies pour établir des plantations ce
qüi les diftingüe des avanturiers, qui font ceux qui
prennent des actions dans, les compagnies formées
pour foutenir ces colonies : les planteurs fe nomment
en France habitans, colons, ou concefjîonnaires &
les avanturiers actionnaires. Savary. { D . J.)
PLANTOIR, f. im ( Jardinage.) outil de jardinier
en forme de bâton aiguifé, au bout duquel il y a du
fer pour faire un trou en terre.
Il y en a de deux fortes ; le grand plantoir qui fert
à planter lès bouis des parterres dans les naiffances
& contours des broderies oii l’on ne peut planter à
la rigole : celui-ci eft plat, large d’un pouce & demi,
8c armé de fer par le bout ; fon manche eft recourbé
par le haut.
Le petit plantoir n’eft qu’une cheville ronde d’une
médiocre groffeur, pointue d’un bout & courbée dé
l’autre ; c’eft avec ce plantoir qu’on tranfplante 8c
qu’on met en place les plantes qu’on a femees 8c élevées
fur des couches. {D . J .)
PLANUM) o s p l a n uM , en Anatomie, comme
qui diroit os dont la furfacè eft plate -, c’eft la lame qui
le remarque à la partie latérale externe de l’os ethmoû
de, à laquelle les anciens avoient donné ce nom;
Voye{ Et h m o ïd e .
PLANURE, f. f. terme d'Ouvriers en bois, c’eft le
bois que la plane coupe, 8c qui tombe aux piés dé
l’ouvrier qui plane. { D . J . )
PLAQUE, f. f. ( Conchyliol. ) on appelle en Corn
chyliologie, plaque ou, couche, la membrane charnue
que quelques coquillages font fortir de leur écaille
pour pouvoir marcher. ( D. J .)
P l a q u e , {Archit.) Voye^ C ô n t r e coe u r ;
P l a q u e d e c o u c h e , terme d’Arquebujier, c’ell
une plaque de fer, de cuivre, ou d’argent, que les
Arquebufiers mettent pour garnir le bout de la croffe
de nifil ; cette plaque eft aufli longue & aufli Iargé
d’un côté que la face du bois qui s’appuie fur l’épaule
, & le côtl qui revient en-deffus de la croflé finit
en pointe & eft façonné ; ces deux côtés font affu-
jettis fur le bois avec deux v is , que l’on appelle vis
de plaque.
Pl a q u e DE BARRE A a ig u il l e , {Bas au métier.)
Foye{ Mé t ie r a b a s ,
Pl a q u e , en terme de Blanchijferle de cire, eft un
morceau de fer-blanc de la forme d’une portion d ’entonnoir
, qu’on attache au robinet de la cu ve, pour
ramaffer la cire qui en tombe aii même point. Voye^
nos Planches de la Blanchifferie des cires, 6* C article
Bl a n c h ir .
Pl a q u e , eft encore, parmi les Ciriers, une elpece
de poêle percée & peu profonde, qu’on met fur le
réchaut de feu pour modérer la chaleur, qui feroit
jaunir la cire, fi elle étoit trop vive. Quand elle l’eft
à un certain point, on met la plaque le fond deffous ,
pour l’étouffer 8c le ralentir ; quand elle eft montée
à un degré moindre, on met la plaque le fond en-deffus,
afin d’empêcher Amplement de pouffer davantage.
Voye^ nos Planches du Cirier.
Pl a q u e , en terme d'Epinglier, fe dit d’une lame
d’étain coupée en rond, un peu repliée fur les bords,
& fur laquelle on étend les épingles pour les étamer
ou blanchir. Foye^ Bl a n c h ir . Il faut que les plaques
foient de l’étain le plus fin ; elles peuvent fervir jufqu’à
ce qu’elles foient tombées en lambeaux, f^oye^
les Planches de VEpinglièr.
P l a q u e s , ( Comm. des Indes. ) nùm que l’on
donne à certains morceaux d’or ou d’argent de divers
poids 8c titres, qui ont retenu la figure des vaiffeaux
dans lefquels ils ont été fondus ; on tiré des Indes 8c