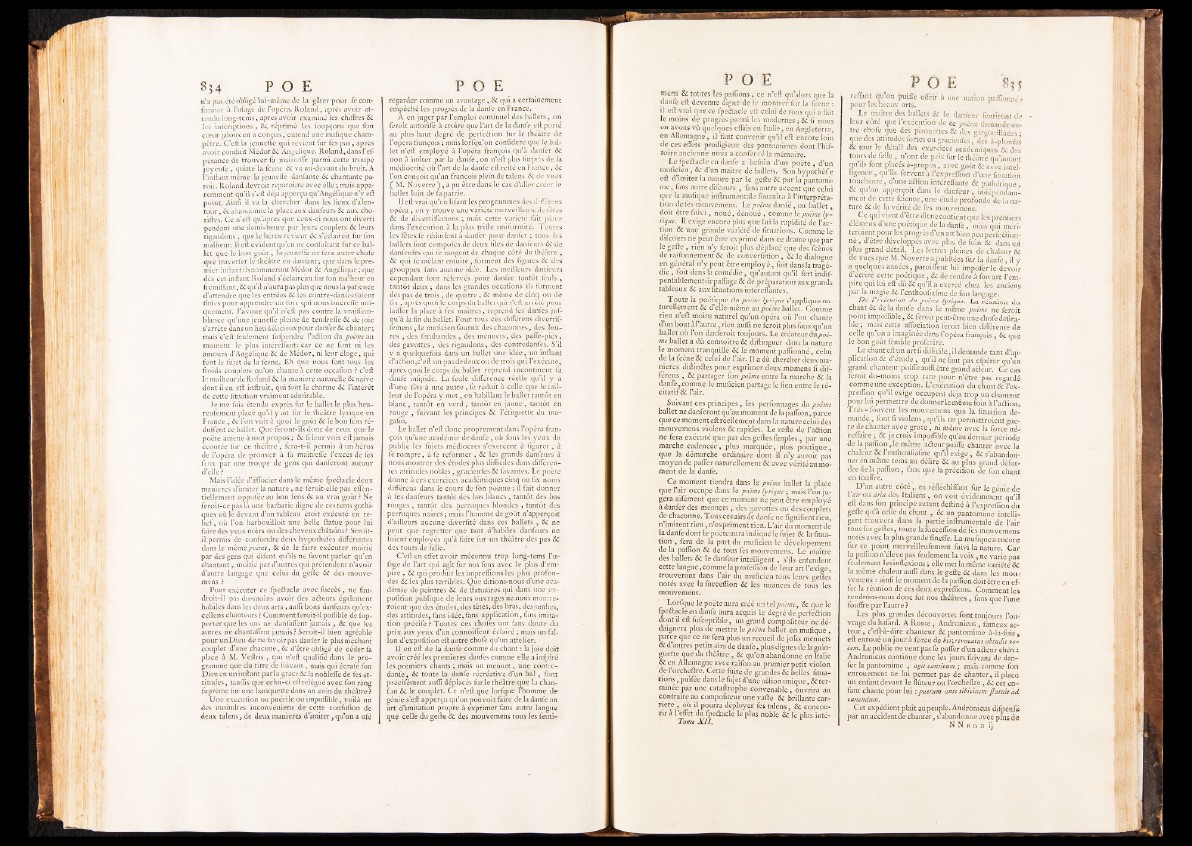
n’ a pas été obligé lui-même de la gâter pour fe conformer
à l’ufage de l’opéra. Roland, après avoir attendu
long-tems, après avoir examiné les chiffres &
les inlcriptions , réprimé les foupçons que fon
coeur jaloux en a conçus, entend une mufique champêtre.
C’eft la jeuneffe qui revient lur fes pas, après
avoir conduit Médor&c Angélique. Roland,dansl’el-
pérance de trouver fa maîtreffe parmi cette troupe
joyeufe, quitte la fcene & va au-devant du bruit. A
l’inftant meme la jeuneffe. danfante & chantante pa-
roît. Roland devroit reparoître avec elle ; mais apparemment
qu’il s’eft déjà apperçu qu’Angélique n’y eft
point. Ainli il va la chercher dans les lieux d’alentour
& abandonne la place aux danfeurs & aux cho-
riftes. Ce n’eft qu’après que ceux-ci nous ont diverti
pendant une demi-heure par leurs couplets & leurs
rigaudons , que le héros revient &c s’éclaircit fur fon
malheur. Il eu évident qu’en ne confultant fur ce ballet
que le bon goût, la jeuneffe ne fera autre chofe
que traverfer le théâtre en danfant; que dans le premier
inftant ils nommeront Médor & Angélique ; que
dès cet inftant Roland s’éclaircira fur Ion malheur en
frémifl'ant, & qu’il n’aura pas plus que nous la patience
d’attendre que les entrées & les contre-danlès foient
finies pour apprendre un fort qui nous intéreffe uniquement.
J’avoue qu’il n’eft pas contre la vraiffem-
blance qu’une jeuneffe pleine de tendreffe & de joie
s’arrête dans un lieu délicieuxpour danfer & chanter;
mais c’ eft feulement fufpendre l’attion du poème au
moment le plus intéreffant : car ce ne font ni les
amours d’Angélique & de Médor, ni leur éloge, qui
font le fujet de la fcene. Eh que nous font tous les
froids couplets qu’on chante à cette occafion ? c’eft
le malheur de Roland & la maniéré naturelle & naïve
dont il en eft inftruit, qui font le charme & l’intérêt
de cette fituation vraiment admirable.
Je me fuis étendu exprès fur le ballet le plus heu-
reufement placé qu’il y ait fur le théâtre lyrique en
France , & l’on voit à quoi le goût & le bon fens ré-
duifent ce ballet. Que feront-ils donc de ceux que le
poète amene à tout propos ; & fi leur voix eft jamais
écoutée fur ce théâtre , fera-t-il permis à un héros
de l’opéra de prouver à fa maîtreffe l’excèsde fés
feux par une troupe de gens qui danferont autour
d’elle ?
Mais l’idée d’affocier dans le même fpettacle deux
maniérés d’imiter la nature, ne feroit-eile pas effen-
tiellement oppofée au bon fens & au vrai goût ? Ne
feroit-ce pas là une barbarie digne de cestems gothiques
où le devant d’un tableau étoit exécuté en relie
f, où l’on barbouilloit une belle ftatue pour lui
faire des yeux noirs ou des cheveux châtains? Sèroit-
il permis de confondre deux hypothèfes différentes
dans le même poème, & de le faire exécuter moitié
par des gens qui difent qu’ils ne favent parler qü’en
chantant, moitié par d’autres qui prétendent n’avoir
d’autre langage que celui du gefte & des motive-
mens ?
Pour exécuter ce fpettacle avec fuccès, ne fau-
droit-il pas du-moins avoir des atteins également
habiles dans les deux arts, aufli bons danfeurs qu’ex-
cellens chanteurs ? Comment feroit-il poflïble de fup-
porterque les uns ne danfaffent jamais , &c que les
autres ne chantaffent jamais? Seroit-il bien agréable
pour un Dieu de nefavoirpas danfer le plus méchant
couplet d’une chacone, & d’être oblige de céder fa
place à M. Veftris , qui n’eft qualifie dans le programme
que du titre de fuivant, mais qui écrafe fon
Dieu en un inftant parla grâce ôc.la nobleffe de fes attitudes
, tandis que celui-ci eft relégué avec fon rang
J'uprème fur une banquette dans un coin du théâtre ?
Une execution ou puérile ou iinpoffible,-voilà un
des moindres inconvéniens de cette confufion de
deux talens , de deux maniérés d’imiter, qu’on a ofé
regarder comme un avantage, & qui a certainement
empêché les progrès de la danfe en France.
À en juger par l’emploi continuel des ballets, on
feroit autorifé à croire que l’art de la danfe eft porté
au plus haut degré de perfettion fur le théâtre de
l’opera françois ; mais lorfqu’on confidere que le ballet
n’eft employé à l’opéra françois qu’à danfer &:
non à im'iter par la danfe, on n’eft plus furpris de la
médio'crité où l’art de la danfe eft refté en France, &
l’on conçoit qu’un françois plein de talens & de vues.
( M. Noverre ) , a pu être dans le cas d’aller créer le
ballet loin de fa patrie.
Il eft vrai qu’en lifant les programmes des différens
opéra, on y trouve une variété merveilleufe de fêtes
& de divertifl'emens ; mais cette variété fait place
.dans l’exécution à la plus trifte uniformité. Toutes
les fêtes fe réduifent à danfer pour danfer ; tous les
ballets font compofés de deux files de danfeurs & de
danfeufes qui fe rangent de chaque côté du théâtre ,
& qui fe mêlant enfuite, forment des figures & des
grouppes fans aucune idée. Les meilleurs danfeurs
cependant font réfervés pour danfer tantôt feuls ,
tantôt deux ; dans les grandes occafions ils forment
des pas de trois, de quatre , & même de cinq ou de
f ix , après quoi le corps du ballet qui s’eft arrêté pour
laiflèr la place à fes maîtres, reprend fes danfes juf-
qu’à la fin du ballet. Pour tous ces différens divertif-
femens, le muficien fournit des chaconnes, des lou-
res , des farabandes , des menuets, des paffe-piés,
des gavottes , des rigaudons, des contredanfes. S’il
y a quelquefois dans un ballet une idée r un inftant
d’attion,c’eft un pas de deux ou de trois qui l’exécute,
après quoi le corps du ballet reprend incontinent fa,
danfe infipide. La feule différence réelle qu’il y a
d’une fête à une autre , fe réduit à celle que le tailleur
de l’opéra y met, en habillant le ballet tantôt en
blanc, tantôt en verd, tantôt en jaune, tantôt en
rouge , fuivant les principes & l’étiquette, du ma-
Le ballet n’eft donc proprement dans l’opéra françois
qu’une académie de danfe, où fous les yeux du
public les fujets médiocres s’exercent à figurer, à
fe rompre, à fe reformer , & les grands danfeurs à
nous montrer des études plus difficiles dans différentes
attitudes nobles, gracieufes & favantes. Le poète
donne à ces exercices académiques cinq ou fix noms
différens dans le cours de foh poème ; il fait donner
à fes danfeurs tantôt des bas blancs , tantôt des bas
rouges , tantôt des perruques blondes , tantôt des
perruques noires ; mais l’homme de goût n’apperçoit
d’ailleurs aucune diverfité dans ces ballets , & ne
peut que regretter "que tant d’habiles danfeurs ne
foient employés qu’à faire fur un théâtre des pas &
des tours de faite. ‘
C’eft en effet avoir méconnu trop long-tems l’ufage
de l’art qui agit fur nos fens avec le plus d’empire
, & qui produit les impreffions les plus profondes
& les plus terribles. Que dirions-nous d’une académie
de peintres .& de ftatuaires qui dans une ex-
pofition publique de leurs ouvrages ne nous montre-
roient que des études, des têtes, des bras, des jambes,
des attitudes, fans idée, fans application,, fans imitation
précife? Toutes ces chofes ont fans doute du
prix aux yeux d’un corinoiffeur éclairé ; mais un fal-
lon d’expofition eft autre chofe qu’un attelier.
Il en eft de la danfe comme du chant : la joie doit
avoir créé les premières danfes comme elle a infpiré
les premiers chants ; mais un menuet, une contre-
danfe, & toute la danfe récréative d’un bal , font
précifément auffi déplacés fur le théâtre que la chan-
fon & le couplet. Ce n’eft .que lorfque l’homme de
génie s’eft apperçu qu’on pouvoit faire de la danfe un
art d’imitation propre à exprimer fans autre langue
que celle du gefte de des mouvemens tous les fentimens
Se toutes îes pallions , ’ce n’eft qu^alors qite îa
danfe eft devenue digne de fe montrer fur la fcene :
il elbyrai que ce fpettacle eft celui de tous qui a fait
le moins de progrès parmi les modernes ; & fi nous
en avons vû quelques eflais en Italie, en Angleterre,
en Allemagne, il faut convenir qu’il eft encore loin
de ces effets prodigieux des pantomimes dontl’hif-
toire ancienne nous a conferve la mémoire.
Le fpettacle en danfe a befoin d’un poète , d’un
muficien, & d’un maître de ballets. Son hypothèf e
eft d’imiter la nature par le gefte & par la pantomime,
fans autre difeours , fans autre accent que celui
que la mulique inftrumeritâlé fournira à l’interprétation
de fes -mouvemens. Le poème danfe, ou ballet,
doit etre fu iv i, noué, dénoué , comme le poème lyrique.
Il exige encore plus que lui la rapidité de l’action
& unë grande variété de fituations. Comme le
difeours ne peut être exprimé dans ce drame que par
le gefte , rien n’y feroit plus déplacé que des fcènes
de raifonnement & de converfation , & le dialogue
en général n’y peut être employé, foit dans la tragédie
, foit dans la comédie, qu’autant qu’il fert indif-
penfablementdepaffage & de préparation aux grands
tableaux & aux fituations intéreffantes^
Toute la poétique du poème lyrique s’applique naturellement
& d’elle-même au poème ballet. Comme
rien n’eft moins naturel qu’un opéra où l’on chante
d’un bout à l’autre, rien auffi ne feroit plus faux qu’un
ballet où l’on danferoit toujours. Le créateur dupoè-
me ballet a dû connoître & diftinguer dans la nature
le moment tranquille & le moment paffionné, celui
de la fcène & celui de l’air. Il a dû chercher deux maniérés
diftinttes pour exprimer deux momens fi différens
, & partager fon poème entre la marche & la
danfe, comme.le muficien partage le fien entre le récitatif
& l’air.
Suivant ces principes, les perfonnages du poème
ballet ne danferont qu’au moment de la paffion, parce
que de moment eft réellement dans la nature celui des
mouvemens violens & rapides. Le refte de l’attion
ne fera exécuté que par desgeftes fimples, par une
marche cadencée, plus marquée, plus poétique ,
que la démarche ordinaire dont il n’y auroit pas
moyen de paffer naturellement & avec vérité au moment
de la danfe.
Ce moment tiendra dans le poème ballet la place
que l’air occupe dans le poème lyrique ; mais l’on jugera
aifément que ce moment ne peut être employé
à danfer des menuets , des gavottes ou des couplets
de chaconne. Tous ces airs de danfe ne lignifient rien,
n’imitent rien , n’expriment rien. L’air du moment de
la danfe dont le poète aura indiqué le fujet & la fituation
, fera de la part du muficien le dévelopement
de la paffion & de tous fes mouvemens. Le maître
des ballets & le danfeur intelligent , s’ils entendent
cette langue,comme la profeffiôn de leur art l’exige,
trouveront dans l’air du muficien tous leurs geftes
notés avec la fucceffion & les nuances de tous les
mouvemens.
Lorfque le poète aura créé un tel poème, & que le
fpettacle en danfe aura acquis le degré de perfettion
dont il èft fufceptible, un grand compofiteur ne dédaignera
plus de mettre le poème ballet en mufique ,
parce que ce né fera plus un recueil de jolis menuets
& d’autres petits airs de danfe, plus dignes de la guinguette
que du theatre , & qu’on abandonne en Italie
& eh Allemagne avec raifon au premier petit violon
de l’orcheftre. Cette fuite.de grandes & belles fitua-
tions, puifée dans le fuj et d’une attion unique, & terminée
par une cataftrophe convenable, ouvrira au
contraire au compofiteur une vafte & brillante carrière
, où il pourra déployer fes talens, & concourir
à l ’effet du fpettacle le plus noble & lè plus inté-
Tome X I I .
féâàht cjVi on pivifîe offrir à une nation pâffiortfféè
pour les beaux arts.
Le maître des balle« & le dahfetir fentironi Je
■ H H que l’exécution de ce poème demande an-
tre. chofe que dés* pftoùettes & des gafgomllades ;
que des attitudes fortes ou gracieufes,' des à-plombs
& tout le détail des exercices academiques & dés
tours de faîle , n’ont de prix fur le théâtre qu’auïant
qu’ils font placés à-propos, avec goût & avec intei-
ltgence , qu’ils fervent à l’expteffioil d'une fituation
touchante, d’une aétion iutcreiümte ik. pathétique ,
& qù’ôn appérçSït'dWfe danfeur, indépendamment
de cette feiencè, une étude profonde de la nature
& de la vérité dé fes mouvemens.
Ce qui vient d’ être diî necoutienf une îés premiers
élémens d’une poétique Je la danfe, mais qui méri-
teroienf pour les progrès d’un art bien peu perfectionne
, d’êtfe développés.avéc plus de foin & dans un
plus grand détail. Les lettres pleines de chaleur &
de vues que M. Novërre ajmbliées fur la danfe 5 il y
a^uclques années, paroiffent lui impofer le devoir
d écrire; cette poétique , & de rendre à fon, art l’ém-
pire ipi: lui eft dt; Oc qu’il a exercé chez les anciens
par la magie, & ri’snthoufiafme defonlangàp,
De t execution du poème lyrique, La réunion dit
chant & dé la danfe dans le même poèm e ne feroit
point impoiïiblc, & feroit peut-être une chofe defira-
ble j - mais cette alïbciation feroit bien différente de
celle qu’on a imaginée dans l’opéra françois , St eue
lé bon goût femble proferire.
Le criant èft un artli difficile , il demandé tarit c ’ap*
piicatio:: St d’étude , qu’il ne faut pas élpëfer qu’un
grand chanteur puiffe auffi être grand aûeur. Ce cas
feroit du-moins trop rare pour n’être pas regardé
comme une exception. L’exécution du chant St l’ex-
jprêffion qu’il exige occupent déjà trop un chanteur
pour lui purmettre de donner le-même foin à-l’afiion.
Très - iouVcnt les mopveii'.rns qué là fituation demande
, font 11 violens, qû’its ne permet! roient guère
de chaîner avec grâce , ni même avec la force né*’
ceffaire ; St je crois impoffible qu’au dernier période
Je ia paffion, le même aétcurpuifle chanter avec la
Ohàléur &' j’énthoufiâfme qu’il exige , St s’abandoip
inér en mèmè tems au délire St au plus grand défor-
dre de la paffion, fansqué la préçi'fioii Je,fon chant
en fouffi'e.
D ’un autre côté ,, en réfléchiffant fur le génie de
Vair où .aria des Italiens , on voit évidemment qu’il
eft dans fon principe autant deftiné à l’expreffion du
gefte qu’à celle du chant , & un pantomime intelligent
trouvera dans la partie inftrumentale de l’air
tous fes geftes, toute la fucceffion defes mouvemens
notés avec la plus grande fineffe. La mufique a encore
fur ce point merveilleufement fuivi la nature. Car
la paffion n’élevepas feulement la v o ix , ne varie pas
feulement les inflexions ; elle met la même variété &
la même chaleur auffi dans le gefte & dans les mou}
vemens : ainfi le moment de la paffion doit être en effet
la réunion de ces deux expreffions. Comment les
rendrons-nous donc fur nos théâtres , fans que l’une
fouffre par l’autre ?
Les plus grandes découvertes font toujours l’ouvrage
duhafard. A R ome, Andronicus , fameux acteur
, c’eft-à-dire chanteur & pantomime à-la-fois ,
eft enroué un jouir à force de èis;revocatus. obtudit vô-
cem. Lè public ne veut pas fe paffer d’un atteur chéri è
Andronicus continue donc les jours fuivans de danfer
la pantomime , agit canticum • mais comme fon
enrouement ne lui permet pas de chanter, il place
un enfant devant le flûteur ou l’orcheftre , & cet enfant
chante pour lui : puerum ante tibicinem Jlatuit ad
canendum.
Cet expédient plaît au peuple. Andronicus difpertfé
par un accident de chanter, s’abandonne avec plus de
NNi i f t i i ij