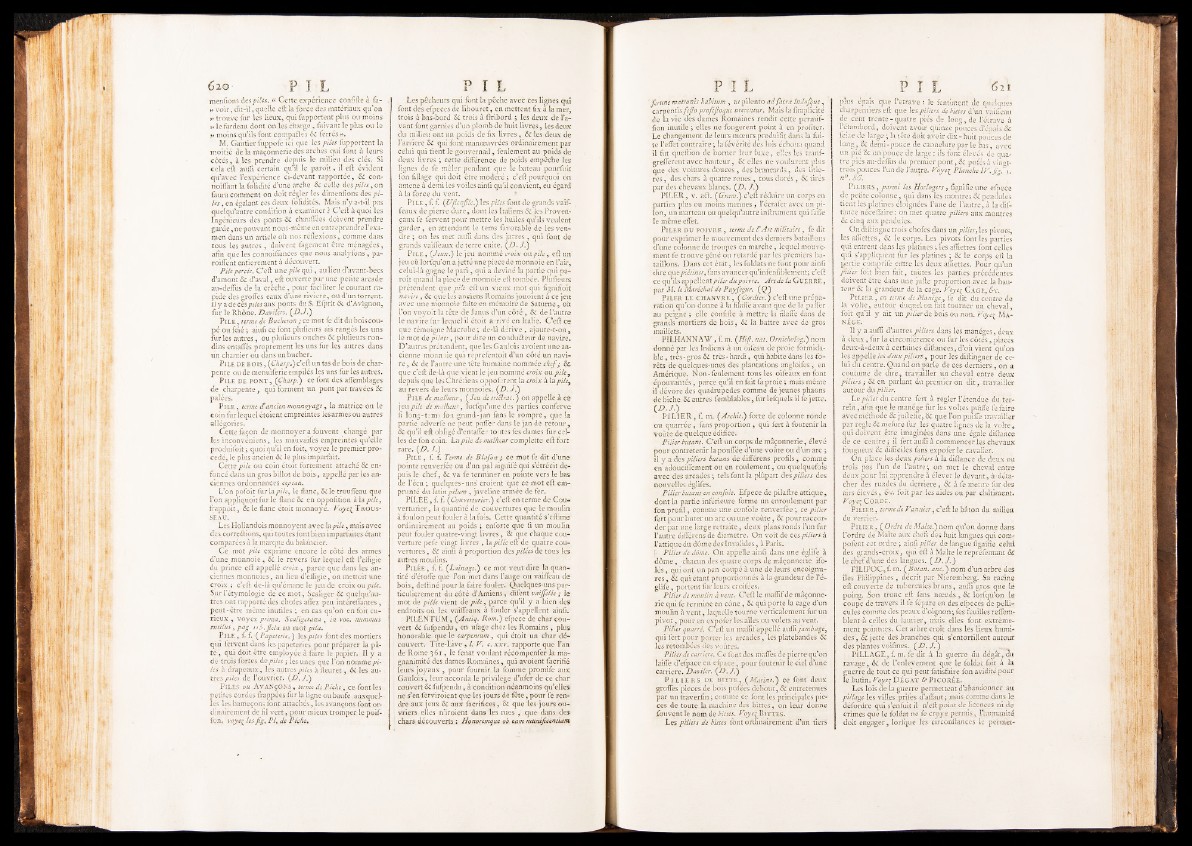
menfions despiUs. « Cette expérience confifte à fa-
» voir, dit-il, quelle eft la force des matériaux qu’on
» trouve fur les lieux, qui fupportent plus ou moins
» le fardeau dont, on les charge , fuivant le plus ou le
» moins qu’ils font compares 6c ferrés ».
M. Gautier fuppofe ici que les piles fupportent la
moitié de la maçonnerie des arches qui font à leurs
côtés, à,les prendre depuis le milieu des clés. Si
cela eft auffi certain qu’il le paroît, il eft évident
qu’avec l’expérience ci-devant rapportée, & con-
noiffant la folidité d’une arche & celle des piles, on
faura comment on doit régler les dimenfions des piles
, en égalant ces deux folidités. Mais n’y a-t-il pas
quelqu’autre condition à examiner ? C’eft à quoi les
Ingénieurs des ponts 6c chauffées doivent prendre
garde, ne pouvant nous-même en entreprendre l’examen
dans un article oii nos réflexions, comme dans
tous les autres , doivent fagement être ménagées,
afin que les connoiffances que nous analyfons , pa-
roiffent entièrement à découvert.
Pile percée. C ’eft une pile q ui, au lieu d’avant-becs
d’amont & d’aval, eft ouverte par une petite arcade
au-deffus de la crèche, pour faciliter le courant rapide
des groffes eaux d’une riviere, ou d’un torrent.
Il y a dé ces piles aux ponts du S. Efprit 6c d’Avignon,
fur le Rhône. Davilers. (D.J .)
P i l e , terme de Bûcheron ; c e m o t f e d it du b o is co u p
é o u f c ié ; a iu li c e fo n t p lu fieu r s ais r an g é s le s u ns
fu r le s a u t r e s , o u p lu fieu r s o u ch e s 6c p lu fie u r s r o n d
in s entaffés p ro p r em e n t le s u ns fu r le s au t res dans
u n c h an t ie r o u dans u n b û ch e r .
P i l e d e b o i s , ( Charp.) c’ eft un tas de bois de charpente
ou de menuiferie empilés les uns fur les autres.
P i l e d e p o n t , (Charp.') ce font des affemblages
de charpente , qui forment un pont par travées 6c
palée$.
P i l e , terme cC ancien monnoyage, la m a t r ic e o u le
c o in fu r le q u e l é to ie n t em p r e in te s le s a rm es o u au t res
a llé g o r ie s .
Cette façon de morinoyer a fouvent changé par
les inconvéniens, les mauvaifes empreintes qu’elle
produifoit ; quoi qu’il en foit, voyez le premier procédé,
le plus ancien 6c le plus imparfait.
Cette pile ou coin étoit fortement attaché 6c enfoncé
dans un gros billot de bois, appellé par les anciennes
ordonnances cepeau,.
L’on pofoit fur la pile, le flanc, 6c le trouffeau que
l’on appliquoit fur le flanc 6c en oppofition à la pile,
frappoit, 6ç le flanc étoit monnoyé. Voye{ T r o u s s
e a u .
Les Hollandois monnayent avec la pile, mais avec
des correôions, qui toutes font bien imparfaites étant
comparées à la marque du balancier.
Ce mot pile exprime encore le côté des armes
d’une monnoie, 6c le revers fur lequel eft l’effigie
dj.1 prince eft appellé croix , parce que dans les anciennes
monnoies, au lieu d’effigie, on mettoit une
croix. ; c’eft de-là qu’émane le jeu de croix ou pile.
Sur l’étymologie de ce mot, Sealiger 6c quelqu’au-
tres ont rapporté des chofes affez peu intéreffantes,
peut - être même inutiles ; en cas qu’on en foit curieux
, voyez prima. Scaligerana , in voc. nummus
rutilus , pag. nS.jlda.au mot pila.
P i l e , f. f. •( Papeterie. ) les piles font des mortiers
qui fervent dans les papeteries pour préparer la pâte
, qui doit être employée à faire le papier. Il y a
dé trois fortes de piles ; les unes que l’on nomme piles
à drapeaux, les autres piles à fleuret, 6c les autres
piles de l’ouvrier. (D. J.)
P i l e s ou A v a n ç o n s , terme de Pêche, ce. font les
petites cordes frappées fur la ligne ou baufe auxquelles
les hameçons font attachés, les avançons font ordinairement
de fil vert, pour mieux tromper le poif-
fon. voyeç les fig. PI. de Pêche.
Les p ê c h e u r s q u i fo n t la p ê c h e a v e c Ces lig n e s q u i
fo n t d e s e fp e c e s de l ib o u r e t , e n m e t te n t f ix a la m e r ,
t ro is à b a s -b o rd 6c t ro is à ft r ib o rd ; le s d e u x d e l’a v
a n t fo n t g a rn ie s d’u n p lom b d e h u it l i v r e s , le s d e u x
d u m i lie u o n t u n p o id s d e f ix l i v r e s , 6c le s d e u x d e
l ’a r r ie r e & q u i fo n t m a noe u v r é e s o rd in a ir em e n t p a r
c e lu i q u i t ie n t le g o u v e r n a i l , fe u lem en t a u p o id s d e
d e u x l iv r e s ; c e t te d iffé r en c e de p o id s em p ê ch e le s
lig n e s d e f e m ê le r p en d an t q u e le b a te a u p o u r fu it
fo n f illa g e q u i d o i t ê t r e m o d é r é ; c ’ e ft p o u r q u o i o n
am en e à d em i le s 'v o i le s a infi q u ’i l c o n v ie n t , eu é g a rd
à la fo r c e d u v e n t .
P i l e , f. f. (Ujlcnjile.) les piles font de grands vaif-
feaux de pierre dure, dont les Italiens 6c les Provençaux
fe fervent pour mettre les huiles qu’ils veulent
garder , en attendant le tems favorable de les vendre
; on les met aufîi dans des jarres , qui font de
grands vaiffeaux de terre cuite. (D . J.)
P i l e , (Jeux.) le jeu nommé croix ou pile, eft un
jeu oîi lorfqu’on a jette une piece de monnoie en l’air,
celui-là gagne le pari, qui a deviné la partie qui pa-
roît quand la piece de monnoie eft tombée. Plufieurs
prétendent que pile eft un vieux mot qui fignifioit
navire , 6c que les anciens Romains jouoient à ce jeu
avec une monnoie faite en mémoire de Saturne, oh
l’on voyoit la tête de Janus d’un côté , 6c de l’autre
le navire ftir lequel il étoit a -rivé en Italie. C’eft ce
que témoigne Macrobe ; de-là dérive , ajoute-t-on,
le mot de pilon , pour dire un condu&eur de navire.
D ’autres prétendent, que les Gaulois avoient une ancienne
monnoie qui repréfentoit d’un côté lin navir
e , & de l’autre une tête humaine nommée chef ; 6c.
que c’eft: de-là que vient le jeu nommé croix ou pile ,
depuis que les Chrétiens oppoferent la croix à lapiley
au revers de leurs monnoies. (D . J.)
P lL E de malheur, (Jeu de trictrac.) o n a p p e lle à c e
j e u pile de malheur, lo r fq u ’u n e d e s p a r tie s e o n fe r v e
fi lo n ^ - tem s fo n g r a n d - ja n fans le r om p r e , q u e la
p a r t ie a d v e r fe n e p e u t p a ffe r dans le ja n de r e t o u r ,
6c q u ’il e ft o b lig é d’ en ta ffe r to u te s fe s d am es fu r c e lle
s d e fo n c o in . L a pile de malheur c om p le t te e ft f o r t
r a r e . (D . î.)
P i l e , f. f. Terme de Blafon ; ce mot fe dit d’une
pointe renverfée ou d’un pal aiguifé qui s’étrécit depuis
le chef, 6c va fe terminer en pointe vers le bas
de l’écu ; quelques-uns croient que ce mot eft emprunté
du latin pilum , javeline armée de fer.
PILÉE, f. f. (Couverturier.) c’eft en terme de Cou-
verturier, la quantité de couvertures que le moulin
à foulon peut fouler à la fois-. Cette quantité s ’effime
ordinairement au poids ; enforte que fi un moulin
peut fouler quatre-vingt livres, & que chaque couverture
pefe vingt livres , la pilée eft de quatre couvertures
, 6c ainfi à proportion des pilées de tous les
autres moulins.
P i l é e , f. f. (Lainage.) ce mot veut dire la quantité
d’étoffe que l’on met dans l’auge ou vaiffeau de
bois, deftiné pour la faire fouler. Quelques-uns particulièrement
du côté d’Amiens, difent vaiffelée ; le
mot de pilée vient de pile, parce qu’il y a bien des
endroits oii les vaiffeaux à fouler s’appellent ainfi.
PILENTUM , (Antiq. Rom.) efpece de char couvert
6c fufpendu, en ufage chez les Romains , plus
honorable que le carpenium, qui étoit un char découvert.
Tite-Live , L F. c. xxv. rapporte que Pan
de Rome 361, le fenat voulant récompenfer la magnanimité
des. dames'Romaines, qui avoient facrifié
leurs joyaux , pour fournir la fomme promife aux
Gaulois, leur-accorda le privilège d’ufer de ce char
couvert 6c fufpendu, à condition néanmoins qu’elles
ne s’en ferviroient que les jours de fête, pour fe rendre
aux jeux & aux- faerifices, 6c que les jours ouvriers,
elles n’iroient dans les rues , que dans, des
chats découverts ; Hçnoremque ok eam murùficentiam
’ ferttnt malronis habitum , ut pilento adfalra luàôfqiie,
carpentisfeßo profefioque uterehtur. Mais la fimplicité
de la vie des dames Romaines rendit cette permif-
fion inutile ; elles ne fongerent point à en profiter.
Le changement de leurs moeurs produifit dans la fuite
l’effet contraire ; la févérité des lois échoua quand
il fut queftion de borner leur luxe, elles les tranf-
grefferent avec hauteur, 6ç elles ne voulurent plus
que des voitures douces, des brancards, des litières
, des chars à quatre roues, tous dorés, 6c tirés
par des chevaux blancs. (D. J.)
PILER, v. a£L (Gram.) c’eft réduire un corps en
parties plus ou moins menues , l’écrafer avec un pilon,
un marteau ou quelqu’autré infiniment qui faffe
le même effet.
P i l e r d u p o i v r e , terme de l'Art militaire, f e dit
p o u r e x p r im e r le m o u v em e n t d e s d e rn ie r s b a ta illo n s
d ’ une c o lo n n e de t ro u p e s en m a r c h e , le q u e l m o u v e m
e n t fe t r o u v e g ê n é o u r e ta rd é p a r le s p rem ie r s b a taillons
» D a n s c e t é t a t , le s fo ld a ts n e fo n t p o u r a in fi '
d ir e q u e piétiner, fan s a v a n c e r q u ’in fen fib lem e n t ; c ’ e ft
c e q u ’ils a p p e lle n t piler du poivre. Art de la GU ER R E ,
p a r M. le Maréchal de Puyfegur. (Q )
P i l e r l e c h a n v r e , (Cordier.) c’eft une préparation
qu’on donne à la filaffe avant que de la paffer
au peigné ; elle confifte à mettre la filaffe dans de
grands mortiers de bois, 6c la battre avec de gros
maillets..
PILHANNAW, f. m. (Hiß. nat. Ornitholog.) nom
donné par les Indiens à un oifeau de proie formidable
, très-gros 6c très-hardi, qui habite dans les forêts
de quelques-unes dès plantations arigloifes, en
Amérique. Non-feulement tous les oifeaux en font
épouvantés , parce qu’il en fait fa proie ; mais même
il dévore des quadrupèdes comme de jeunes phaons
de biche 6c autres femblables, fur lefquels il fe jette»
(D .J .)
P IL IE R , f. m. (Arcfiit.) forte de colonne ronde
ou quarrée , fans proportion , qui fert à foutenir la
voûte de quelque édifice.
Pilier butant. C’eft un corps de maçonnerie, élevé
pour contretenir la pouflee d’une voûte ou d ’un arc ;
il y a des piliers butans de différens profils, comme
en adouciffement ou en roulement, ou quelquefois
avec des arcades; tels font la plupart des piliers des
nouvelles églifes.
Pilier butant en confole. Efpece de pilaftre attique,
dont la partie inférieure forme un enroulement par
fon p rofil, comme une confole renverfée ; ce pilier
fert pour buter un arc ou une voûte, 6c pour raccorder
par une large retraite, deux plans ronds l’un fur
l’autre différens de diamètre. On voit de ces piliers à
l’attique du dôme deslnvaiides, à Paris.
[- Pilier de dôme. On appelle ainfi dans une églife à
dôme, chacun des quatre corps de mâçonnerie îfo-
Jés, qui ont. un pan coupé à une de leurs encoignures
, 6c qui étant proportionnés à la grandeur de l’é-
glife, portent fur leurs croifées.
Pilier de moulin à vent. C ’eft le mafllf de mâçonnerie
qui fe termine en cône, 6c qui porte la cage d’un
moulin à vent, laquelle tourne verticalement fur un
pivot, pour en expofer les ailes ou volets au vent.
Pilier quarré. C ’eft un maffif appellé auffi jambage,
qui fert pour porter les arcades, les platebandes 6c
les retombées des voûtes»
Pilier de carrière. Ce font des maffes de pierre qu’on
laiffe d’efpace en efpace, pour foutenir le ciel d’une
carrière. Daviler. (D . J.)
P i l i e r s d e b i t t e , ( Marine. ) ce font deux
groffes pièces de bois pofées dèb'out, 6c entretenues
par un traverfin ; comme ce font les principales pièces
de toute.la machine des bittes, on leur donne
fouvent le nom de bittes. Voye^ B i t t e s .
Les piliers de bittes fbnt ordinairement d’un tiers
p lu s épa is q u e l’ e traV e : le fen t im en t d e q u e lq u e s
ch a rp en t ie r s e ft q u e le s piliers de bittes d ’u n v a iffe a u
de c e n t t r e n te - q u a t re p ié s d e lo n g , d e l ’é î r a v e à
l’ é tam b o rd , d o iv e n t a v o i r q u in z e p o u c e s d’ é p a is 6c
fe iz e de la r g e ; la t ê t e d o i t a v o i r d ix - h u it p o u c e s d e
l o n g , 6c d em i -p o u c e d e c a n n e lu r e p a r le b as a v e c
u n p ié 6c u n p o u c e d e la r g e : iis fo n t é le v é s de q u a t
r e pi.es au -d e ffu s du p r em ie r p o n t , & p o fé s à v in g t -
t ro is p o u c e s l’u n d e l ’a u t r e . Foyer Planche IF 1fis. 1.
n°. 8G.
P i l i e r s , parmi les Horlogers, lig n ifie u n e e fpeCe
d e p e t ite c o lo n n e , q u i dans le s m o n tr e s 6c p en d u le s
t ie n t le s p la t in e s é lo ig n é e s l’ u n e de l ’a u t r e , à la d is tan
c e f té c e ffa ir e : o n m e t q u a t re piliers a u x m o n tr e s
6c c in q a u x p en d u le s .
On diftingue trois chofes dans un pilier, les pivots,
les affiettes, 6c le corps. Les pivots font les parties
qui entrent dans les platines ; les affiettes font celles
qui s’appliquent fur les platines ; 6c le corps eft la
partie comprife entre les deux affiettes. Pour .qu’un
pilier foit bien fait, toutes les parties précédentes
doivent être dans une jufte proportion avec la hauteur
& la grandeur de la cage. Foye^ C age, &c.
P i l i e r , en terme de Manège, f e d it d u c e n t r e d e
la v o l t e , a u to u r d u q u e l o n fa i t to u rn e r u n c h e v a l ,
f o i t qu ’ i l y a it u n pilier d e b o is o u n o n . Fôye^ M a -
NÉGÈ.
Il y a auffi d’autres piliers dans les manèges, deux
à deux, fur la circonférence ou fur les côtés, placés
deux-à-deux à certaines diftances, d’oh vient qu’on
les appelle les deux piliers, pour les diftinguer de ce*
lui du centre. Quand on parle de ces derniers , on a
coutume de dire, travailler iin cheval entre deux
piliers ; 6c en parlant du premier on dit, travailler
autour du pilier.
Le pilier du centre fert à regler l’ étendue du ter*
rein, afin que le manège fur les voites puiffe fe faire
avec méthode & juftefiè, & que l’ôn puiffe travailler
par réglé 6c mefure fur les quatre lignes de la volte ,
qui doivent être imaginées dans une égale diftance
de ce centre ; il fert auffi à commencer les chevaux
fougueux 6c difficiles fans expofer le cavalier.
On place les deux piliers à la diftance de deux où
trois pas l’ un de l’autre ; on met le cheval entre
deux pour lui apprendre à élever le devant, à ‘détacher
dés ruades du derrière, & à fe mettre fur des
airs élevés, &c. foit par les aides ou par châtiment*
Foye^ C o r d e .
P i l i e r , terme de Fannier, c ’ e ft l e b â to n d u m i lie u
du v er r ie r ...
P i l i e r , ( Ordre de Malte.) nom qu’on donne dans
l’ordre de Malte aux chefs des huit langues qui corn-
pofent cet ordre ; ainfi pilier de langue fignifie celui
des grands-croix, qui eft à Malte le repréfentant 6c
le chef d’une des langues. (D .J . )
PILIPOC,f. m. (Botan. anc. ) nom d’un arbre des
îles Philippines, décrit par Nieremberg. Sa racine
eft couverte de tubercules bruns, aufîi gros que le
poing. Son tronc eft fans noeuds, 6c lorfqu’on le
coupe de travers il fe fépare en des efpeces de pellicules
comme des peaux d’oignon ; fes feuillesreffem-
blent à celles du laurier, mais elles, font extrêmement
pointues* Cet arbre croît dans les lieux humides’,
6c jette des branches qui s’entortillent autour
des plantes voifines. ( D . J. )
PILLAGE, f. m. fe dit à la guerre du dégât, au
ravage, 6c de l’enlevement que le foldaî fait à la
guerre de tout ce qui peut fatisfaire fon avidité pour
le butin. F o y iD é g â t & P i c o r é e .
Les lois de la guerre permettent d’abandonner au
pillage les villes prifes d’aflaut ; mais comme dans le
défordre qui s’enfuit il n’eft point de licences ni de
crimes que le foldat ne fe croye permis, l’humanité
doit engager, lorfque les circonftances le permet