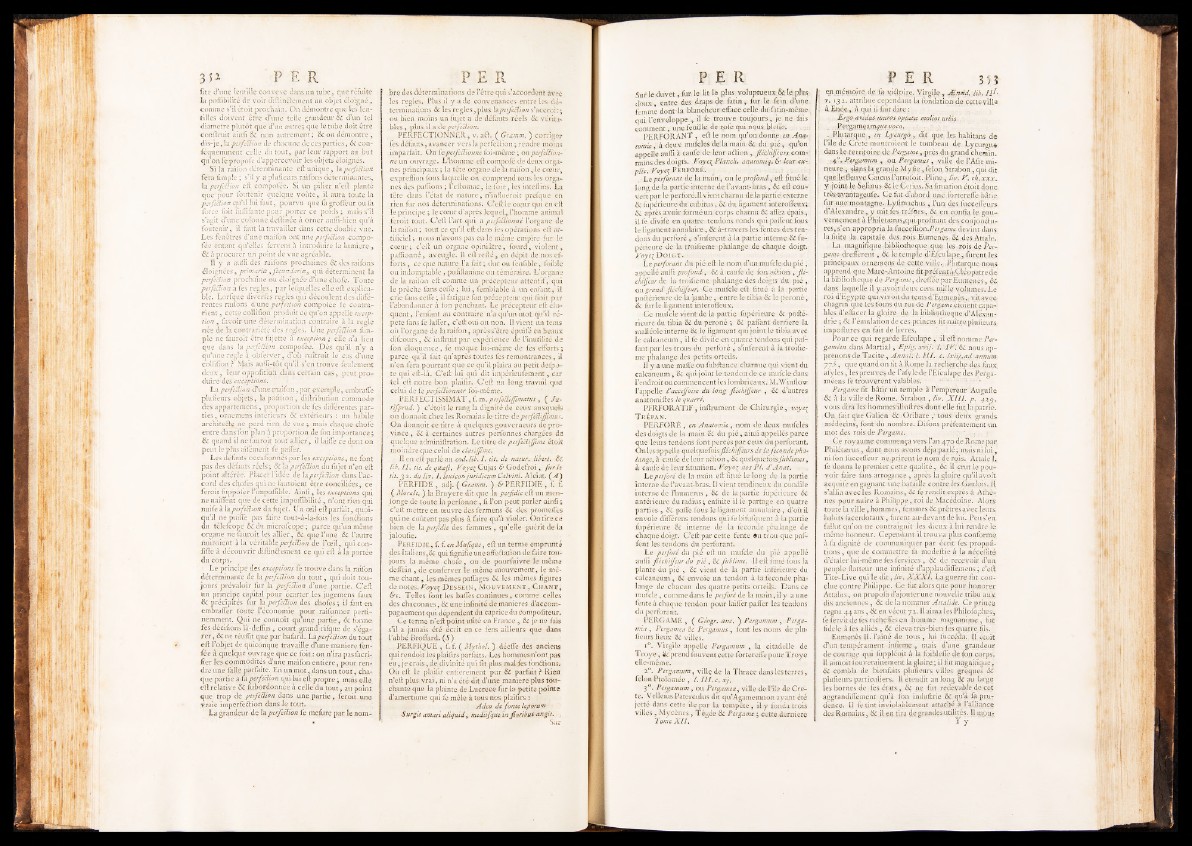
35* P E R
fi te d’une lentille Convexe dans un tube, que refultè
la pofiibilité de voir diftinftement un objet éloigné ,
comme s’il étoit prochain. On démontre que les lentilles
doivent être d’une telle grandeur 8c d’un tel
diamètre plutôt que d’un autre; que le tube doit être
conftruit ainfi 8c non autrement ; 8c on démontre ,
dis-je, la perfection de chacune de ces parties, 8ccon-
féquemment celle du tout, par leur rapport au but
qu’on fe propofe d’appercevoir lés objets éloignés.
Si la raifon déterminante eft unique, la perfection
fera fimple ; s’il y a plufieurs raifons déterminantes,
la perfection cil compofée. Si un pilier n’eft planté
que’ pour foutenir quelque voûte, il aura toute la
perfection qu’il lui faut, pourvu que fa groffeur ou fa
force foit l'ufiifante peur porter ce poids ; mais s’il
s’agit d’une colonne deftinée à orner aufîl-bien qu’à
foutenir, il faut la travailler dans cette double vue.
Les fenêtres d’une maifon ont une perfection compofée
entant qu’elles fervent à introduire la lumière ,
8c à procurer un point de vue agréable.
Il y a aufli des raifons prochaines & des raifons
éloignées, primaria .fecundariæ, qui déterminent la
perfection prochaine ou éloignée d’une chofe. Toute
perfection a fes réglés, par lefquelles elle eft explicable.
Lorfque diverfes réglés qui découlent des différentes
raifons d’une perfection compofée fe contrarient
, cette collifion produit ce qu’on appelle exception
, favoir une détermination contraire à la réglé
née de la contrariété des réglés. Une perfection fimple
ne fauroit être fujette à exception ; elle n’a lieu
que dans la perfection compofée. Dès qu’il n’y a
qu’une réglé à obfefver,. d’oùnaîtroit le cas d’une
collifion ? Mais aufïi-tôt qu’il s’en trouve feulement
deux, leur oppofitioii dans certain cas-, peut produire'des
exceptions.
La perfection d’une maifon, par exemple, embraffe
plufieurs objets, lapôfîtiôn, diftribution commode
des appartenons, proportion de fes différentes parties
, ornemens intérieurs 8c extérieurs : un habile
archite% ne perd rien de vue ; mais chaque chofe
entré dansfon plan à proportion de fon importance;
8c quand il ne fauroit tout allier, il laiffe ce dont on
peut le plus aifémen't fe paffer.
Les défauts occafionnes par les exceptions, ne font
pas des défauts réels ; 8c la perfection du fujet n’en eft
point altérée. Placer l’idée de la perfection dans l’accord
des chofes qui ne fauroient être conciliées, ce
feroit fuppôl'êr l’impoflîble. Ainfi, les exceptions qui
ne naiffent que de cêtte inippflibilité, n’ont rien qui
nuife à la perfection du fujet. Un oeil eft parfait, quoiqu’il
ne puiffe pas faire tout-à-la.-fo.is les fondions
du télefeope 8c du microfçope; parce qu’un même
organe ne fauroit les allier, 8c que l’une 8c l’autre
nuiroient à la véritable perfection de l’oeil, qui con-
lifte à découvrir diftin&ement ce qui eft à la portée
du corps.
Le principe des exceptions fe trouve dans la raifon
déterminante de la perfection du tout, qui doit toujours
prévaloir fur la perfection d’une partie. C ’eft
un principe capital pour .écarter les jugemens faux
8c précipités fur Im perfection des chofes; il faut en
embraffer toute l’économie pour raifonner pertinemment.
Qui ne connoît qu’une partie, & forme
fes décifions là-deffus, court grand rifque de s’égare
r , 8c ne réuffit que par hafard. imperfection du tout
eft l’objet de quiconque travaille d’une maniéré fen-
fée à quelque puvrage que ce foit.: on n’ira pas facri-
fier les commodités.d’une maifon entière, pour rendre
une fall.eparfaite. En .un-mot,- dans un tout', chaque
partie a fa perfection qui lui eft propre ; mais elle
eft relative 8c fubordonnée à celle du tout, au point
que trop de perfection clans une partie, feroit une
vraie imperfèftion dans le tout.
La grandeur de la perfection fe mefure par le nom-
P t D
1 I b l i bre
des déterminations de l’être qui s’accordent àVec
les réglés. Plus il y a de convenances entre les déterminations
8c les réglés, plus \mperfection s’accroît ;
ou bien moins un fujet a de défauts réels 8c véritables
, plus il a de perfection.
PERFECTIONNER, v. aft. ( Gramm. ) corriger
fès défauts, avancer vers la perfection ; rendre moins
imparfait. On fe perfectionne foi-même ; On perfectionne
un ouvrage. L’homme eft compofé de deux organes
principaux ; la tête organe de la raifon, le coeur,
expreffion fous laquelle on comprend tous les organes
des pallions ; l’eftomac, le foie, les inteftins. La
tête dans l’état de nature, n’influeroit prefque en
rien fur nos déterminations. C’eft le Goeur qui en eft
le principe ; le coeur d’après lequel, l’homme animal
feroit tout. C’eft l’art qui a perfectionné l’organe de
la raifon ; tout ce qu’il eft dans fes opérations eft artificiel
; nous n’avons pas eu le même empire fur le
coeur ; c’eft un organe opiniâtre, fourcl, violent,
paflionné, aveugle. Il eft refté, en dépit de nos efforts
, ce que nature l’a fait ; dur ou fenfible, foible
ou indomptable, pufillanime ou téméraire. L’organe
de la raifon eft comme un précepteur attentif, qui
le prêche fans ceffe ; lu i, femblable à un enfant, il
crie fans ceffe ; il fatigue fon précepteur qui finit par
l’abandonner à fon penchant. Le précepteur eft éloquent
, l’enfant au contraire n’a qu’un mot qu’il répété
fans fe laffer, c’eft oui ou non. Il vient un tems
où l’organe de la raifon, après s’être épuifé en beaux
difeours , 8c inftruit par expérience de l’inutilité de
fon éloquence, fe moque lui-même de fes efforts ;
parce qu’il fait qu’après toutes fes remontrances, il
n’en fera pourtant que ce qu’il plaira au petit delpo-
,te qui eft-là. C’eft lui qui dit impérieufement, car
tel eft notre bon plaifir. C’eft un long travail que
celui de fe perfectionner foi-même.
PERFECTISSIMAT, f. m. perfeciiffimatus, ( J a-
rifprud. ) c’étoit le rang la dignité de ceux auxquels
on donnoit chez les Romains le titre de perfeclifjimus.
On donnoit ce titre à quelques gouverneurs de province
, 8c à certaines autres perfonnes chargées de
quelque adminiftration. Le titre de perfectijjime étoit
moindre que celui de clariffimi, .
Il en eu parlé au cod.lib.I. lit. de natur. libert. &
Lib. II. tit. de qucejl. Voye{ Cujas & Godefroi, furie
tit. j 2. du liv. I. lexiconjuridicumCalvini. Âlciat. (A )
PERFIDE , adj. ( Gramm- ) G PERFIDIE > f. £
( Morale. ) la Bruyere dit que la perfidie eft un men-
fonge de toute la perfonne , fi l’on peut parler ainfi ;
c’eft mettre en oeuvre des fermens 8c des promeffes
qui ne coûtent pas plus à faire qu’à violer. On tire ce
bien de la perfidie des femmes , qu’elle guérit de la
jaloufie.
P e r f i d i e , f. f. enMufîqüe, eft un ternie emprunté
des Italiens,& qui fignine une affectation de faire toujours
la même chofe, ou de pourfuivre le même
deffein , de conferverle même mouvement, le même
chant, les mêmes paffages 8c les mêmes figures
de notes.Voye^ D e s s e i n , M o u v e m e n t , C h a n t ,
&c. Telles font les baffes continues, comme celles
des chaconnes, 8c une infinité de maniérés d’accompagnement
qui dépendent du caprice du Compofiteur,
Ce terme n’eft point ufité en France , 8c je ne fais
s’il a jamais été écrit en ce fens ailleurs que dans
l’abbé Broffard. ( i 1)
.. PERFIQUE , f. f. ( Mythol. ) déeffe des anciens
quirendoit les plaifirs parfaits. Les hommesn’ont pas
eu ; je crois, de'divinité qui fît plus mal fes fondions»
Où eft le plaifir entièrement pur 8c parfait ? Rien
n’eft plus, vrai, ni n’a été dit d’une maniéré plus touchante
que la plainte de Lucrèce fur la petite pointe
d’amertume qui fe mêle à tous nos plaifirs j
Adeo dé fonte leporum
Surgit aman aliquid, medùfque, in ftqribus angit.
Sur
P E R
Sur le duvet, fur le lit: lé plus voluptueux; & là pîfijs
doux entre des. draps; de fatin,. fur le fe in d’une,
femme dont'la blancheur, efface celle du- fiitin-même,
qui. l’enveloppe , il fe trouve toujours, je ne fais
comment, upe feuille de rpfe quinpus.hleffe. . ,
PERFORANT , eft le nom. qu’on donne,en Ann-
tomiefï. deux miifcles délia main & du. pié,. qu’on
appelle aufli à caufedelenr a dion , fici.hiffeii.rs, com-'
mùnsdes doigtà. X o y Planch, anatomiq.&Aeur, 8§ra
plie. Voye{ PERFORÉ.-, j '
Le perforant de la maini, ou le profond, eâ $ tué, Le;
long de, la partie interne de l’avant-bras., &c eft cou-:
vert par le perforé. Il vient charnu deJa partie, externe
8c liipérieure-du' cubitus, 8c du ligament interoffeux;
8c après avoir formé un, corps charnu 8c affez épais.*
il fe divife en quatre tendons ronds qui paflent fous
le ligament annulaire, Sc.àrtrav.ers les fentes; des tendons
du perforé * s ’inforent à la partie interne. 8c fin-
périeure de la troifieme phalange .de; chaque doigt.
ffoye^ D o i g t «. •
Le perforant .du pié eft le nom d’tui mufc 1 e,du pié ,
appelle aufli profond, 8c à caufe de fon action, fii-
cluffeur de la troifiemcphalange des doigts du pié
ou grand fLéchiffeur. Ce mufclé eft litué à la partie
poftérieure de la jambe ; entre le tibia, 8c le péroné,
& lùr le ligament interoffeux.
Ce mufcle vient de la partie fupérieure & pofté-
rieure du tibia 8c du péroné ; 8c paffant derrière la
malléole interne 8c le ligament qui joint le tibia avec
le calcanéum , il fe divife en quatre tendons qui paffant
par les trous du perforé , s’inferent à la troiûe-
me phalange des petits orteils.
Il y a une mafle ou fubftance. charnue qui vient du
calcanéum, 8c qui joint le tendon de ce mufcle dans
l’endroit oucommencent les lombricaux. M.W inflow
l’appelle faccejfoire du Long jléckiffeur , 8c d’autres
anatomiftes le quarré.
PFRFORATÏF, inftrument de Chirurgie, voye^
T r é p a n .
PERFORÉ , en Anatomie, nom de deux mufclés
des doigts de la main 8c du p ié , ainfi appelles parce
que leurs tendons font perces par ceux du perforant.
Onles appelle quelquefoisfléchijjeurs de la fécondé phalange,
à eaufe de leur aétion, 8c quelquefois fublimes,
à caufe de leur fituation. Voyo^ nos PL d'Anat.
Le perforé de la main eft fitué le long de la partie
interne de l’avant-bras. Il vient tendineux du condile
interne de l’humerus , 8c de la partie fupérieure 8c
antérieure du radius ; enfuite il fe partage en quatre
parties , 8c paffe fous le ligament annulaire, d’oii il
envoie différens tendons qui fe bifufquent à la partie
fupérieure Sc interne de la fécondé phalange de
chaque doigt. C’eft par cette fente «u trou que paf-
fent les tendons du perforant.
Le perforé du pié eft un mufcle du pié appellé
aufli fLéchiffeur du pié, 8c fublime. Il eft lirué fous la
plante du pié , 8c vient de la partie inférieure du
calcanéum , 8c envoie un tendon à la fécondé phalange
de chacun des quatre petits orteils. Dans ce
mufcle, comme dans le perforé de la main, il y a une
fente à chaque tendon pour laifl'er paffer les tendons
du perforant.
PERGAME , ( Géogr. anc. ) Pergamum , Perga-
mia , Pergamea 8c Pergamus, font les noms de plufieurs
lieux 8c villes.
i°. Virgile appelle Pergamum , la citadelle de
T ro y e , 8c prend fouvent cette fortereffe pour Troye
elle-mçme.
i° . Pergamum, ville de la Thrace dans les terres,
felon Ptolomée , l. III. c. xj.
3°. Pergamum, ©u Pergamea, ville de l’île de Crete.
Velleius Paterculus dit qu’Agamemmon ayant été
jette dans cette île par la tempete, il y fonda trois
villes , Mycènes , Tégée 8c Pergame ; cette .derniere
Tome X IL
P E R 3 53
qn mpnioh'el d^ffa yiélpire. Vjrgije r Ænnd. Hb. iïf*
v. ig 2. attribue cependant la fondation de cette ville
à.Enée,,:,à qui il Êut-dire :
ittfirps opt(itfç mplipr urbif ,
„ Pergamgam^f v;ocq. . :
. Phit^rquq,, in fycurgo,, dit que, Les habitans de
l’ile de Cretè montrôient le tombeau de Lycurgue
dans Lie tei;ru:qire.de,Pepganie, près;du grand chemin.
;^fvP«/gqmum , : q\i Pergqfnus, ville de l’Alie mineure
* d$ps |a grandeMyfie, félon Strabon, qui dit
R&exfôfieuye Qaïensi’arrp.foit. Pline, liv. P’, ch.xxx.
y rjpjj^t; le. Sejlinus- & lejÇetius,. Sa fituation étoit donc
très-uyuûtagçufe., C.e fut d-abord iinp.fortereffe bâtie
fijir uuç'uionfeigne. Lyfimachus , l’un; desiliceefleurs
d’Alexandre, y mit fes tréfors*, 8c en cpnfia le gou-;
yeruement à, Philetæj,us,qui.prpfîtaut dps. çQnjonélu-
res,-s’en.appropria la fucçeflion./>t;/'^/«t, devint dans
la fuite la . capitale, des. rois Éumeuçs, 8c..des,Attale.
La magninque-; bibliothèque que les . rpis de Per-
gamc' drefïèrent, 8c le ,templ,c d’E.fçulapq, furent les
principaux ornemens de cette ville.r Plutarque nous
apprend que Marfi-Antoine fitp.çéfenÉijjÇléopatre de
la bibliothèque de Pergame, àrefîee par Eumei-iès, dedans
laquelle il y-.avpit .deux cens -mille volumes. Le
roi d’Egypte qui.viyôitdu têtus vitavep
chagrin que les foins du rpi de Pergame é tôjent capa-'
blés d’eftacer la gloire de la bibliothèque d’Alexandrie
; 8c l’émulation de ces-princes fit naître plufieurs;
iinpoftures en fait de li.vres..,
Pour ce qui regarde Efculape , il eft nomme Per-
garnéen dans Martial, Epig. xvij. 'l: ■ IP''. & nous apprenons!
de Tacite , Anrialyl. ILI. c. Ixiifad. anttutn-
y y5 , que quand on fit àRoiçie la recliffrchpdps faux,
afyles, les preuves de l’afyle de l’Efculape des Perga-
méens fé trouvèrent valàbles.
Pergame fit bâtir’un temple à l’emperèur Augufte
8c à la ville de Rome. Strabon , liv. X I I I . p. 42 c),
vous dîtà les' hommesilluftiés>dont elle fut la patrie.
On fait que Galien 8c,Oribaze ,' tous dettx grands
médecins, font'du nombre. Difons préfentement un
mot des rois de Pergame.
. Ce royaume commença vers l’an 470 de.Rom,e par
Philétærus , d.pnt nous avons déjà parlé ;mais ni lui.
ni fon fucceffeur neprirent le nom de rois. Attale I.
fe 'donna le premier cette qualité, 8c il crut le pouvoir
faire fans arrogance , après la gloire qu’il a voit
acquife en gagnant une bataille contre les-Gaulois. Il
s’allia avec les Romains, 8c fe rendit exprès à Athènes
pour nuire à Philippe, roi çle.Macédoine. Alors
toute la v ille , hommes, femmes 8c prêtres avec leurs
habits facerdotaux, furent au-devant dé lui. Peu s’en
fallut qu’on ne contraignît les dieux à lui rendre le
même honneur. Cependant il trouva plus conforme
à fa dignité de communiquer par écrit fes propçfi-
tions, que de commettre fa modeftie à la néçeffité
d’étaler lui-même fes fervices , 8c de recevoir d’un
peuple flatteur une infinité d’applaudiffemens c’eft
Tite-Live qui le dit, liv. X X X I . La guerre fut conclue
contre Philippe. Ce fut alors que ppur honorer
Attalus, on propofa d’ajouter une nouvelle tribu aux
dix anciennes , 8c de la nommer Attalide. Ce prince
régna 44 ans, 8c en vécut 71. Il ainra les Philofophes,
fe fervit de fes riçheffes en homme magnanime, fi.it
fidele à fes alliés , 8c éleva très-bien fes quafre fils.
Eumenès II. l’auié de tous , lui fuccéda. Il étoit
d’un tempérament infirme , mais d’une grandeur
de courage qui fuppléojt à la foibleffe de fon eprps.
Il aimoit f ouverainement la gloire ; il fut magnifique,
8c combla de bienfaits plufieurs, villes greques &c
plufieurs particuliers. Il étendit au long 8c au large
les bornes de fes états , 8ç ne fut redevable de çet
aggrandiflement qu’à fon induftrie 8c qc’à fa pruT
dence. Il fe tint inviolablement attaché à l’alliance
des Rorpains, 8ç il en tira de grandesutilités. Il m,ouj.